Mémoires D'une Invasion
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Calendrier Sportif
CONTACTS SSID Conseil général des Landes Direction de la Solidarité départementale SSID Service Sports Intégration et Développement Hôtel du Département Jean-Claude Ribert Service Sports Intégration Éducateur sportif départemental 23, rue Victor Hugo Tél. 06 84 52 47 59 40025 Mont-de-Marsan cedex et Développement Tel. : 05 58 05 40 89 Fax : 05 58 05 41 41 Gabriel Damien Mél. : [email protected] Éducateur sportif départemental Tél. 06 79 03 27 94 www.landes.org Magali Damien Professeur d’EPS Tél. 06 82 51 15 73 Alex Marsan CALENDRIER Agent d’animation Tél. 06 33 09 31 84 SPORTIF Carole Dugarry Agent d’animation Tél. 06 79 03 01 26 2009-2010 Julia Dupouy Professeur d’EPS Tél. 06 19 38 07 69 Sport adapté Rémi Focchanère Professeur d’EPS Tél. 06 19 38 06 37 Céline Gueylard Professeur d’EPS Tél. 06 33 87 42 33 Marielle Denier Professeur d’EPS Accompagnement sportif Tél. 06 33 12 51 71 Conception-imp. : CG40 - 08/09 Handilandes06-Aff32x50 7/04/06 9:38 Page 1 Liste complète de contacts utiles dans la brochure du SSID Les Actions Solidaires Samedi 27 Tennis de Table - Sorde l’Abbaye SEPTEMBRE 2009 DÉCEMBRE AG FFSA Mardi 8 Réunion CDSA40 - Mont-de-Marsan Mardi 1 PO Natation - Hagetmau Mercredi 31 Course d’orientation Sport Intégré - Dax (14h) Mercredi 9 Course d’orientation - Soustons (adultes & jeunes) Mercredi 3 Basket Jeunes - Dax Du 14 au 18 Formation Athlétisme - Hagetmau Samedi 5 Basket - Monségur (R) (47) AVRIL Mardi 15 Surf adapté - Côte landaise Basket Intégration - Monségur (47) Samedi 3 Basket Intégration - Horsarrieu Samedi 19 Equitation -
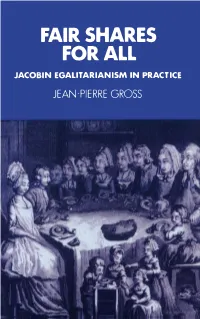
Fair Shares for All
FAIR SHARES FOR ALL JACOBIN EGALITARIANISM IN PRACT ICE JEAN-PIERRE GROSS This study explores the egalitarian policies pursued in the provinces during the radical phase of the French Revolution, but moves away from the habit of looking at such issues in terms of the Terror alone. It challenges revisionist readings of Jacobinism that dwell on its totalitarian potential or portray it as dangerously Utopian. The mainstream Jacobin agenda held out the promise of 'fair shares' and equal opportunities for all in a private-ownership market economy. It sought to achieve social justice without jeopardising human rights and tended thus to complement, rather than undermine, the liberal, individualist programme of the Revolution. The book stresses the relevance of the 'Enlightenment legacy', the close affinities between Girondins and Montagnards, the key role played by many lesser-known figures and the moral ascendancy of Robespierre. It reassesses the basic social and economic issues at stake in the Revolution, which cannot be adequately understood solely in terms of political discourse. Past and Present Publications Fair shares for all Past and Present Publications General Editor: JOANNA INNES, Somerville College, Oxford Past and Present Publications comprise books similar in character to the articles in the journal Past and Present. Whether the volumes in the series are collections of essays - some previously published, others new studies - or mono- graphs, they encompass a wide variety of scholarly and original works primarily concerned with social, economic and cultural changes, and their causes and consequences. They will appeal to both specialists and non-specialists and will endeavour to communicate the results of historical and allied research in readable and lively form. -

Carte Touristique Des Landes 2019 2019 Landes Des Touristique Carte D | | | Biscarrosse E Tonneins Y Biscarrosse
le naturel LES LANDES Ouvert tous les jours jusqu’au 03/11/19 (Calendrier sur rhune.com) A B C D E F G H I J K L M N Léognan Aire-sur-l'Adour.................... J9 Maillères.............................H-i7 BASSIN LégendeSauveterre Amou..................................G10 Mano .................................... G3 1 -de-Guyenne Angoumé...............................D9 Mant ................................... H10 1 D’ARCACHON AngresseDuras ............................ C10 Marpaps .............................G10 Office de Tourisme Arboucave............................i10 Mauries ................................i10 Arengosse .............................F7 Maurrin...................................i8 Argelos...............................G10 Mauvezin-d'Armagnac...... J-K7 Musée de france Argelouse............................. G4 Maylis ................................... G9 Biganos Arjuzanx ................................F7 Mazerolles..............................i8 www.rhune.com Classé Patrimoine mondial de l'UNESCO Arsague.............................. F10 Mées......................................D9 La Teste- Artassenx...............................i8 Meilhan................................. G8 de-Buch Arthez-d'Armagnac .............. J8 Messanges ............................C8 Musée Arue........................................i6 Mézos ....................................D6 Cap Ferret Arx......................................... L6 Mimbaste............................ E10 CarteLe Barp touristique Miramon Aubagnan...................... -

Itinerary Timetable
ITINERARY TIMETABLE KM STAGE 19 TIMETABLE To be run Run Caravan 45 kph 43 kph 41 kph DISTANCE FROM NEUTRALISED PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) NEUTRALISED TO OFFICIAL START D281 MOURENX (D281-D9) START 10:20 12:20 12:20 12:20 D9 Quartier des Crêtes (OS-MARSILLON) 4.4km Quartier Bachard (ABIDOS) LAGOR CATEGORISED CLIMB 207 0 MOURENX RACE 10:30 12:30 12:30 12:30 START Km 12.1 - Côte de Bareille 202.1 4.9 MASLACQ (D9-VC-D275) 10:37 12:36 12:37 12:37 Climb of 1.9km at 5.1% 199.1 7.9 D275 ARGAGNON (near) (D275-D817) 10:41 12:40 12:41 12:41 198.1 8.9 D817 Gouze (MONT) (D817-D275) 10:43 12:42 12:42 12:43 RELAIS-ÉTAPE 194.9 12.1 D275 Côte de Bareille 10:48 12:46 12:47 12:48 193.1 13.9 ARTHEZ-DE-BÉARN (D275-D946-D731-D31-D946) 10:50 12:48 12:49 12:50 3, allée de Lattre de Tassigny 189.9 17.1 D946 N'haux 10:55 12:53 12:54 12:55 33410 Cadillac 188.9 18.1 Crossroad D946-D31 10:56 12:54 12:55 12:56 Km 168,4 185.8 21.2 D31 HAGETAUBIN (near) (D31-D945) 11:01 12:58 13:00 13:01 182.8 24.2 D945 LACADÉE 11:05 13:02 13:04 13:05 ROUTE FOR 180.2 26.8 SAULT-DE-NAVAILLES (D945-D101) 11:09 13:06 13:07 13:09 NON-RACE VEHICLES LANDES (40) 173.8 33.2 D933 S CASTAIGNOS-SOUSLENS (near) 11:18 13:14 13:16 13:18 Exit directly from the off-course 170.3 36.7 MOMUY 11:24 13:19 13:21 13:24 parking area (don’t follow the race 166.3 40.7 HAGETMAU (D933 S-VC-D933 S) 11:29 13:24 13:27 13:29 route). -

Decisión De Ejecución (UE)
7.6.2021 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea L 199 I/1 II (Actos no legislativos) DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/906 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 4096] (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 259, apartado 1, letra c), Considerando lo siguiente: (1) La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica contagiosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, de manera que el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países se vean perturbados. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias, que a continuación pueden propagarlos a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en explotaciones en las que se crían aves de corral u otras aves cautivas. -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

B COMMISSION DECISION of 24 February 2006 On
2006D0148 — EN — 28.06.2006 — 001.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ºB COMMISSION DECISION of 24 February 2006 on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France (notified under document number C(2006) 632) (Only the French text is authentic) (2006/148/EC) (OJ L 55, 25.2.2006, p. 51) Amended by: Official Journal No page date ºM1 Commission Decision 2006/438/EC, of 27 June 2006 L 174 7 28.6.2006 2006D0148 — EN — 28.06.2006 — 001.001 — 2 ¼B COMMISSION DECISION of 24 February 2006 on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France (notified under document number C(2006) 632) (Only the French text is authentic) (2006/148/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (1), and in particular, Article 57(2) thereof; Whereas: (1) Avian influenza is an infectious viral disease in poultry and birds, causing mortality and disturbances which can quickly take epizootic proportions liable to present a serious threat to animal health and under certain circumstances to human health. There is a risk that the disease agent might be spread to other holdings thus reducing sharply the profitability of poultry farming, to wild birds and from one Member State to other Member States and third countries through the international trade in live birds or their products. -

NAPOLEON a Screenplay by Stanley Kubrick September 29, 1969
NAPOLEON A Screenplay by Stanley Kubrick September 29, 1969 Converted to PDF by mypdfscripts.com FADE IN: INT. BEDROOM CORSICA - NIGHT A well worn teddy-bear is cradled in the arms of Napoleon, age 4, who dreamily sucks his thumb, listening to a bedtime story told by his young mother, Letizia. His 5-year old brother, Joseph, is already asleep, beside him. NARRATOR Napoleon was born at Ajaccio in Corsica on August 15th, 1769. He had not been a healthy baby and his mother, Letizia, lavished him with care and devotion. In middle age, he would write about her from St. Helena. NAPOLEON (V.O.) My mother has always loved me. She would do anything for me. MAIN TITLES INT. DORMITORY BRIENNE - NIGHT It is still dark on a freezing winter morning. The boys are being awakened by a monk, loudly ringing a bell. Candles are lit. Napoleon, age 9, sun-tanned, leaps out of bed, rubbing his arms and shivering. He tries to pour a pitcher of water, discovering that it has frozen solid. NAPOLEON Who has been putting glass in my pitcher? Look here, someone has filled my pitcher with glass! DUFOUR Oh, my goodness! Someone has filled Bonaparte's pitcher with glass. Now, who on earth would do a thing like that? BREMOND Oh, heavens, look someone has filled my pitcher with glass too! 2. MONK Silence! Silence! You should not make fun of Monsieur Bonaparte, he comes from a country where it is never very cold. He has probably never seen ice before. DUFOUR Never seen ice before? Oh, dear me -- how very odd. -

Infirmier(Es) De L'education Nationale Du Departement
INFIRMIER(ES) DE L’EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DES LANDES Collèges et écoles de secteur / Lycées ETABLISSEMENTS NOM PRÉNOM ECOLES DE SECTEUR Collège Gaston Crampe AIRE-SUR- CLAUDE LACOURTY Stéphanie E.M.PU AIRE SUR ADOUR L'ADOUR NOUGARO 05.58.51.53.00 FRANÇOISE AIRE-SUR- E.E.PU GIROUD/VICTOR L'ADOUR LOURTI JACQUES E.E.PU LE VIGNAU PREVERT E.E.PU RENUNG CAZERES-SUR- E.P.PU L'ADOUR DUHORT- E.P.PU BACHEN EUGENIE-LES- E.P.PU BAINS E.M.PU AMOU Collège du Pays des Luys CAZENAVE Valérie CASTEL- E.M.PU AMOU SARRAZIN 05.58.89.02.53 E.M.PU DONZACQ E.E.PU AMOU E.E.PU BASTENNES E.E.PU BONNEGARDE E.E.PU BRASSEMPOUY CASTAIGNOS- E.E.PU SOUSLENS CASTELNAU- E.E.PU CHALOSSE E.E.PU GAUJACQ E.P.PU ARSAGUE E.P.PU NASSIET E.P.PU POMAREZ Collège Nelson Mandela LIGEZ Amandine E.M.PU SANGUINET BISCARROSSE 05.58.09.88.88 E.E.PU SANGUINET E.P.PU BISCARROSSE PLAGE Collège Saint Exupéry PARENTIS EN BORN 05.58.78.92.92 Collège Jean Mermoz BERTIN Marie E.M.PU BISCARROSSE MEYRIE BISCARROSSE 05.58.78.14.33 E.M.PU BISCARROSSE PIERRICQ E.E.PU BISCARROSSE PIERRICQ E.E.PU BISCARROSSE PETIT PRINCE E.E.PU BISCARROSSE MEYRIE E.M.PU CAPBRETON Collège Jean Rostand ABADIE Catherine CABPRETON GROUPE SCOL E.E.PU CAPBRETON SAINT 05.58.72.11.96 EXUPERY E.P.PU SEIGNOSSE GRAND CHENE 1 INFIRMIER(ES) DE L’EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DES LANDES Collèges et écoles de secteur / Lycées SOORTS- E.P.PU ECOLE A HOSSEGOR SOORTS- E.P.PU HOSSEGOR ALBERT E.M.PU DAX Collège Léonce Dussarrat DAX POMADE 05.58.74.05.05 SOUSSENS Béatrice E.M.PU DAX GALLIENI ANTOINE DE E.M.PU -

Porter À Connaissance De L'état À L'échelle De La Communauté De Communes CHALOSSE TURSAN
Servitudes d’Utilité Publique Porter à connaissance de l’État à l’échelle de la Communauté de communes CHALOSSE TURSAN Mise à jour du document : 12/02/18 Direction Départementale des Territoires et de la Mer www.landes.gouv.fr Liste des Servitudes d’Utilité Publique Communauté de Communes de Chalosse Tursan Communes : Aubagnan, Audignon, Arboucave, Aurice, Banos, Bas-Mauco, Bats, Castelnau-Tursan, Castelner, Cauna, Cazalis, Clèdes, Coudures, Dumes, Eyres Moncuge, Fargues, Geaune, Hagetmau, Haut-Mauco, Horsarrieu, Labastide-Chalosse, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Mauries, Miramont Sensacq, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montgaillard, Montsoué, Morganx, Payros Cazautets, Pécorade, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol Cazalet, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Colombe, Saint-Sever, Samadet, Sarraziet, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Urgons Ministère qui a Communes concernées – Intitulé servitude institué la servitude – Actes instituant la servitude Service gestionnaire A2 Ministère de Audignon et Banos Servitude attachée à l’Agriculture – Direction ASA d’Audignon Départementale des l’établissement des Aurice canalisations Territoires et de la Mer et ASA de Meilhan souterraines Chambre d’Agriculture d’irrigation Aurice et Cauna ASA de Cauna-Lamothe-Aurice Bas-Mauco ASA de Benquet Bas-Mauco et Saint-Sever ASA de Jean de l’Amou Bats ASA de Bats et Urgons Castelnau-Tursan ASA de Bats et Urgons ASA des producteurs de maïs semence/réseau de St Loubouer ASA de Castelnau Tursan ASA de Pécorade Cazalis, Momuy et Saint-Cricq-Chalosse -

Fiche 10 Affluents Sud Adour Et Bos 13-12-11
Fiche n°10 Structure gestionnaire du bassin versant des affluents du sud Adour et du Bos Périmètre Structures membres BUANES MONTSOUE SYNDICAT CLASSUN SAINT-LOUBOUER INTERCOMMUNAL EUGENIE-LES-BAINS SAINT-SEVER D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BAHUS * FARGUES VIELLE-TURSAN MONTGAILLARD BATS PAYROS-CAZAUTETS SYNDICAT CASTELNAU-TURSAN PUYOL-CAZALET INTERCOMMUNAL CLEDES SAINT-LOUBOUER D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BAS ET COUDURES SARRAZIET DU PETIT BAS * EYRES-MONCUBE URGONS GEAUNE VIELLE-TURSAN SYNDICAT ARTASSENX BENQUET INTERCOMMUNAL AURICE BRETAGNE-DE-MARSAN D’AMENAGEMENT DE BASCONS HAUT-MAUCO LA VALLEE DU BOS * BAS-MAUCO SAINT-SEVER ARBOUCAVE MONTAUT AUBAGNAN PHILONDENX AUDIGNON PIMBO SYNDICAT BANOS PUYOL-CAZALET INTERCOMMUNAL BATS-TURSAN SAINTE-COLOMBE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU GABAS- COUDURES SAINT-SEVER LAUDON * DUMES SAMADET EYRES-MONCUBE SERRES-GASTON HORSARRIEU TOULOUZETTE LACAJUNTE URGONS ARBOUCAVE MAYLIS BERGOUEY MONSEGUR CASSEN MUGRON CAUPENNE NOUSSE SYNDICAT GAMARDE-LES-BAINS PHILONDENX INTERCOMMUNAL GOOS POYANNE D’AMENAGEMENT DE HAGETMAU PRECHACQ LES BAINS LA VALLEE DU LOUTS * LACAJUNTE SAINT-AUBIN LAHOSSE SAINT-CRICQ-CHALOSSE LARBEY SAINT-GEOURS-D'AURIBAT LOUER SAMADET LOURQUEN SERRESLOUS-ET-ARRIBANS AIRE-SUR-L'ADOUR MIRAMONT-SENSACQ SYNDICAT BAHUS-SOUBIRAN PECORADE INTERCOMMUNAL DE DUHORT-BACHEN RENUNG RIVIERES DU SUD-EST LATRILLE SAINT-AGNET LANDAIS * LAURET SARRON MAURIES SORBETS DOAZIT HAURIET LABASTIDE-CHALOSSE MANT MAURRIN * structure compétente en matière de gestion des cours d’eau Liste des communes concernées ( 79 -

Fouché Justifies Bonaparte's Brumaire Coup J. David Markham When
Fouché Justifies Bonaparte’s Brumaire Coup J. David Markham When General Bonaparte returned from Egypt in October of 1799, he found a France in political turmoil. The ruling Directory was corrupt and very unpopular. Talk of a coup was in the air and there were at least two being planned. The more important group plotting a coup included Emmanuel Joseph Sieyès, Roger Ducos, Lucien Bonaparte among others. Among the ‘others’ was one Joseph Fouché, who was minister of police at the time. To be successful, the coup needed support of the army, and Bonaparte, who had known republican leanings, was the ultimate choice. Once the coup took place on 18 Brumaire (8-9 November 1799), Napoleon was installed as First Consul and the period of France known as the Consulate began. It fell upon Fouché to provide a public explanation and justification for what had happened. This very rare document is that explanation and justification, distributed to the French Public on 11 November, 1799. The scan of the document is followed by the translation by Dr. Bill Chew III. The engraving is from my personal collection, as is the document. EQUALITY – LIBERTY The Minister of the General Police of the Republic, to His Fellow Citizens. Of the 20th Brumaire, Year 8 of the French Republic, one and indivisible. Citizens, The Government was too weak to sustain the glory of the Republic against the external enemies, and guarantee the rights of Citizens against the domestic factions: it had become necessary to consider giving that government power and greatness. The national wisdom, the Council of Ancients, conceived of this thought, and manifested the necessary will.