Dans L'ombre D'edouard Leclerc, Roger Berthier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Décision N° 16-DCC-210 Du 9 Décembre 2016 Relative À La Prise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 16-DCC-210 du 9 décembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce exploité par la société ATAC par la société Worksea et ITM Entreprises L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 novembre 2016, relatif à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce exploité par la société ATAC par la société Worksea et ITM Entreprises, formalisée par une lettre d’intention en date du 22 juillet 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. ITM Entreprises, société contrôlée à 100 % par la société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement des Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ». -

Why Food Waste Is Becoming a Revolution? Putting the Bin out of Business Could Be Good for Business November 2017
Why food waste is becoming a revolution? Putting the bin out of business could be good for business November 2017 This article was written by Léonore Perrin from “We are Phenix” a successful French social company born in 2014 who helps businesses to turn waste into wealth by unleashing the potential of surplus products. L’Institut du Commerce asked “We are Phenix” to explain to the ECR Community the current waste initiatives’ landscape in France. Since 2017, l’Institut du Commerce embodies the Efficient Consumer Response in France. The association supports its members (manufacturers, retailers and service providers) to work together to better fulfill the consumers’ needs. More precisely, it provides them with the perfect framework to build collectively tomorrow’s businesses thanks to a better understanding of the deep changes occurring for the shopper, the supply chain and the retail (data, environment, technology…). There is an urge to eradicate waste in our societies. The circular economy is a basic yet revolutionary approach that could transform tomorrow’s production and consumption. L’Institut du Commerce is proud to announce the launch in December 2017 of a new working group entitled « Circular Economy: How can retail have a positive impact »? Each year, an estimated 1.3 billion tons of food is lost or wasted globally. That’s over a third of the world’s food production which is thrown away, somewhere between farm to fork. In the European Union it is estimated that 11% of food losses and waste occurs at the production level, while 17% at the distribution level. From food banks to food aid organizations, food redistribution is not a new thing. -
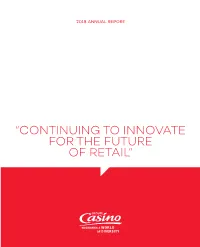
“Continuing to Innovate for the Future of Retail” Contents Contents
2018 ANNUAL REPORT “CONTINUING TO INNOVATE FOR THE FUTURE OF RETAIL” CONTENTS CONTENTS INTERVIEW WITH “WHAT’S THE PURPOSE JEAN-CHARLES HIGHLIGHTS KEY FIGURES NAOURI PAGE 6 PAGE 12 OF AN ANNUAL REPORT?” PAGE 2 POWERFUL STRATEGIC A RESPONSIBLE GOVERNANCE BRANDS ALLIANCES APPROACH t’s a question that comes up often, in them an enticing shopping experience, PAGE 14 PAGE 20 PAGE 30 PAGE 38 all large companies. and making their lives easier with I With 12,000 stores that open their helpful services and innovative digital doors every morning – under such solutions. banners as Vival, Franprix, Naturalia, To infuse some of that energy into our Éxito, Assaí and Devoto – and hundreds annual report, we interviewed around of transformation projects to be sixty men and women who work in a very INTERNATIONAL INNOVATION AUGMENTED A MORE PRESENCE CULTURE STORES AGILE MODEL implemented in an ever shorter time to wide range of positions within the market, the Casino Group views the company, from store greeter to Executive PAGE 48 PAGE 58 PAGE 68 PAGE 78 annual report as an invaluable Committee member. “What does Casino opportunity to take a step back from the represent for you?”, “How is your job frenetic race against the clock that evolving?” and “What are today’s trends represents the daily routine in the retail in terms of customer expectations?”. sector. The result is this annual report, which BANNERS AND SOCIETAL FINANCIAL Casino has more than 220,000 service- provides an overview of the Casino SUBSIDIARIES PERFORMANCE PERFORMANCE oriented employees who are fully Group and shares the beliefs and committed to providing our customers enthusiasm of a small sample of the PAGE 86 PAGE 108 PAGE 122 with safe, high-quality products, offering people behind its success. -

Retail Food Sector Retail Foods France
THIS REPORT CONTAINS ASSESSMENTS OF COMMODITY AND TRADE ISSUES MADE BY USDA STAFF AND NOT NECESSARILY STATEMENTS OF OFFICIAL U.S. GOVERNMENT POLICY Required Report - public distribution Date: 9/13/2012 GAIN Report Number: FR9608 France Retail Foods Retail Food Sector Approved By: Lashonda McLeod Agricultural Attaché Prepared By: Laurent J. Journo Ag Marketing Specialist Report Highlights: In 2011, consumers spent approximately 13 percent of their budget on food and beverage purchases. Approximately 70 percent of household food purchases were made in hyper/supermarkets, and hard discounters. As a result of the economic situation in France, consumers are now paying more attention to prices. This situation is likely to continue in 2012 and 2013. Post: Paris Author Defined: Average exchange rate used in this report, unless otherwise specified: Calendar Year 2009: US Dollar 1 = 0.72 Euros Calendar Year 2010: US Dollar 1 = 0.75 Euros Calendar Year 2011: US Dollar 1 = 0.72 Euros (Source: The Federal Bank of New York and/or the International Monetary Fund) SECTION I. MARKET SUMMARY France’s retail distribution network is diverse and sophisticated. The food retail sector is generally comprised of six types of establishments: hypermarkets, supermarkets, hard discounters, convenience, gourmet centers in department stores, and traditional outlets. (See definition Section C of this report). In 2011, sales within the first five categories represented 75 percent of the country’s retail food market, and traditional outlets, which include neighborhood and specialized food stores, represented 25 percent of the market. In 2011, the overall retail food sales in France were valued at $323.6 billion, a 3 percent increase over 2010, due to price increases. -

Décision N° 14-DCC-11 Du 28 Janvier 2014 Relative À La Prise De Contrôle Par La Société Franprix Leader Price Holding De 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 14-DCC-11 du 28 janvier 2014 relative à la prise de contrôle par la société Franprix Leader Price Holding de 47 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire Le Mutant et de 22 fonds de commerce de boucherie L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 décembre 2013, relatif à la prise de contrôle de 47 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire et de 22 fonds de commerce de boucherie par la société Franprix Leader Price Holding (« FLPH »), formalisée par un protocole d’accord conclu le 25 octobre 2013 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés le 14 janvier 2014 par la partie notifiante ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. La société Franprix Leader Price Holding (ci-après « FPLPH ») est une filiale du groupe Casino Guichard Perrachon (ci-après « Casino »), dont le principal objet est la prise de participation dans des sociétés exploitant des magasins sous les enseignes Franprix et Leader Price. Le groupe Casino, troisième acteur français du secteur de la distribution à dominante alimentaire, gère un parc de plus de 12 000 magasins dans le monde (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins discompteurs) sous les enseignes notamment Géant Casino, Franprix, Casino Supermarché, Petit Casino, Casino Shop, Casino Shopping, Spar, Vival, Monoprix et Leader Price. -

Company Presentationpresentation
April 2020 CompanyCompany PresentationPresentation 1 Who we are Family Business based in Provence created in 2000 by Franck Bonfils, current CEO. The first peanuts come out of Setting up in the first warehouse Construction of the first plant in Launch of the first ORGANIC the family kitchen. Carpentras! range. New plant of 10 000 M² Launch of the « Bulk full service » Launch of the brand Launch of the first bag operational in 2020 to support the concept in French supermarkets « JUSTE BIO ». biodegradable and compostable development of the activity Who we are A fast and continuous growth since A constantly reinforced workforce 2014… on strategic positions 73 48 30 80 100 32 13,5 19 7,5 4,5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Turnover in M€ Staff Our mission: Simplify access to organic high quality products 4000 Supermarkets equipped with our distributors in France and abroad A wide and differentiating range: 141 references certified organic ALL segments covered PLASTIC FREE ORGANIC CHOICE All are products are controlled and packaged in France. Our Quality Policy: 7 500 T of organic products packaged in 2019 • A precise knowledge of the ORGANIC sector • An ECOCERT certified production site 60% of the investments devoted to Quality and production tools An enhanced analysis plan: • 100% of the “raw material / supplier” pair controlled by independent laboratories, • Products manufactured and / or packaged in our premises, • A systematic control of the batches during production. New supplier : Analysis of the 6 first receptions -

FRENCH MARKET PRESENTATION for : FEVIA from : Sophie Delcroix – Elise Deroo – Green Seed France Date : 19Th June, 2014
FRENCH MARKET PRESENTATION For : FEVIA From : Sophie Delcroix – Elise Deroo – Green Seed France Date : 19th June, 2014 FEVIA 1 I. GREEN SEED GROUP : WHO WE ARE II. MARKET BACKGROUND AND CONSUMER TRENDS III. THE FRENCH RETAIL SECTOR IV. KEY RETAILERS PROFILES V. FOODSERVICE VI. KEY LEARNINGS VII. CASE STUDIES FEVIA 2 Green Seed Group Having 25 years of experience, the Green Seed Group is a unique international network of 11 offices in Europe, North America and Australia, specializing in the food & beverage sector OUR MISSION Advise both French and foreign food and beverage companies or marketing boards, on how to develop a sustainable and profitable position abroad Green Seed France help you to develop your activity in France using our in-depth knowledge of the local food and beverage market and our established contacts within the trade FEVIA 3 A growing and unique international network Germany (+ A, CH) The Netherlands Scandinavia U.S.A./Canada Great Britain Belgium France Portugal Spain Italy 11 offices covering 18 countries Australasia FEVIA 4 The Green Seed model Over the last decade, one of the most important trends in the French food & drink trade has been for retailers to deal with their suppliers on a direct line. Green Seed France has developed its business model around this trend. We act as business facilitators ensuring that every step of the process is managed with maximum efficiency. From first market visit, to launch as well as the ongoing relationship that follows. We offer a highly cost-effective solution of “flexible local sales and marketing management support” aimed at adding value. -

Décision N° 17-DCC-82 Du 12 Juin 2017 Relative À La Prise De Contrôle Conjoint De La Société DB Allinges Par La Société Emiro Et M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 17-DCC-82 du 12 juin 2017 relative à la prise de contrôle conjoint de la société DB Allinges par la société Emiro et M. Martellucci aux côtés d’ITM Entreprises L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 mai 2017, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société DB Allinges par la société Emiro et M. Martellucci aux côtés d’ITM Entreprises, formalisée par un protocole d’accord en date du 10 avril 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. ITM Entreprises, société contrôlée à 100 % par la société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par […] personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement des Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Écomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales, mais aussi de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ». -

Décision N° 18-DCC-142 Du 23 Août 2018 Relative À La Prise De Contrôle Exclusif Des Sociétés SDRO Et Robert II Par La Société Groupe Bernard Hayot
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 18-DCC-142 du 23 août 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés SDRO et Robert II par la société Groupe Bernard Hayot L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 juin 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Groupe Bernard Hayot des sociétés SDRO et Robert II, formalisée par des promesses synallagmatiques de vente du 23 mai 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés les 18 et 25 juillet 2018 par la partie notifiante ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération 1. Groupe Bernard Hayot est une société par actions simplifiée, à la tête d’un groupe du même nom (ci-après, « GBH »), principalement actif dans trois pôles d’activité : la distribution alimentaire et non-alimentaire, la distribution automobile, et des activités industrielles diverses (agroalimentaire, matériaux de construction, rechapage de pneumatiques). GBH est actif dans la zone Antilles-Guyane, mais également à la Réunion, à Cuba, à Saint Domingue, à Trinidad et Tobago, en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, au Maroc, au Ghana et en Chine. En Martinique, GBH exploite trois hypermarchés sous l’enseigne Carrefour, situés à Ducos, à Dillon / Fort-de-France et à Cluny / Schœlcher. Il exerce par ailleurs une activité sur le marché de la distribution en gros de produits à dominante alimentaire, à la fois en qualité de grossiste-importateur via les sociétés Sodicar, Pamagel et Héritiers Clément et de centrale d’achats via la société Bamappro. -

Strategic Retail Management Text and International Cases 3Rd Edition Strategic Retail Management Joachim Zentes • Dirk Morschett • Hanna Schramm-Klein
Joachim Zentes Dirk Morschett Hanna Schramm-Klein Strategic Retail Management Text and International Cases 3rd Edition Strategic Retail Management Joachim Zentes • Dirk Morschett • Hanna Schramm-Klein Strategic Retail Management Text and International Cases 3rd Edition Joachim Zentes Hanna Schramm-Klein FB Wirtschaftswissenschaften, Universität Siegen Universität des Saarlandes Siegen, Germany Saarbrücken, Germany Dirk Morschett Universität Fribourg Fribourg, Switzerland ISBN 978-3-658-10182-4 ISBN 978-3-658-10183-1 (eBook) DOI 10.1007/978-3-658-10183-1 Springer Gabler Library of Congress Control Number: 2016954795 Springer Gabler © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2007, 2011, 2017 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, repro- duction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, elec- tronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -

Supermarket Wars: Global Strategies for Food Retailers
SUPERMARKET WARS Global strategies for food retailers Andrew Seth and Geoffrey Randall SUPERMARKET WARS This page intentionally left blank Supermarket WARS Global strategies for food retailers Andrew Seth and Geoffrey Randall © Andrew Seth and Geoffrey Randall 2005 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The authors have asserted their right to be identified as the authors of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 2005 by PALGRAVE MACMILLAN Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010 Companies and representatives throughout the world PALGRAVE MACMILLAN is the global academic imprint of the Palgrave Macmillan division of St. Martin’s Press, LLC and of Palgrave Macmillan Ltd. Macmillan® is a registered trademark in the United States, United Kingdom and other countries. Palgrave is a registered trademark in the European Union and other countries. ISBN-13: 978–1–4039–1910–6 ISBN-10: 1–4039–1910–0 This book is printed on paper suitable for recycling and made from fully managed and sustained forest sources. -

Enseignes Communes Carrefour Carrefour Market Franprix Hyper
Enseignes Communes Carrefour Carrefour Market Franprix Hyper Géant Hyper U Simply Market ENSEIGNE(S) : CARREFOUR MOIS : octobre 2014 PRIX MAXIMAL AUTORISE 360,00 € Nb de produits : 101 PRIX DU PANIER 357,14 € N° FAMILLE PRODUITS LIBELLE LIBELLE PRODUITS PROPOSES PRIX FARINE FLUIDE FRANCINE 1KG ou 1 FARINE MENAGERE FLUIDE 1KG 2,69 € FARINE GATEAU FRANCINE 1KG 2 BISCOTTES SANS SEL X35 300G BISCOT.HEUDEBERT S.SEL 300G 3,18 € COQUILLETTE SAGITTAIRE 500G ou 3 COQUILLETTES BLE DUR 500G 1,51 € COQUILLETTE BARILLA 500G MACARONI SAGITAIRE 500G ou 4 MACARONI BLE DUR 500GRS 1,51 € PATES MAESTRIA MACARONI 500GR Pain, céréales, biscuits RIZ PRETRAITE SOCARIZ 1KG ou RIZ 5 RIZ LONG ETUVE 20/30% BRISURE 1 KG 1,97 € et légumes secs BLANCHI 20/30% BRIS.1KG COQUELINE ABRICOT LU 165G ou 6 BISCUIT FOURRE ABRICOT 160G 2,52 € BARQUETTE ABRICOT CRF 2X120G 7 LENTILLES BLONDES SACHET 1KG LENTILLES 1KG GARRIDO 1,87 € HARICOT ROSE LE FORBAN 500G ou 8 HARICOTS ROUGES SACHET 500 GRS 0,99 € HARICOTS ROSES CELIMENE JORDANS SPECIAL MUESLI 750G ou 9 CEREALES MUESLI AUX FRUITS 750GRS 4,99 € MUESLI FRUIT CRF DISC 600G 10 PAIN 400 GRS PAIN LONG CRU 535 GRS 0,99 € STEAK HACHE EXTRA MOELLEUX BOITE DE 1 KG 11 STEACK HAC.CHARAL EX.MOEL.K. 10,75 € X10 8TR.JBN SUP DD CRF ou 4 x 90G 12 JAMBON DE PARIS DD 8TR 360G 7,99 € JAMBON PARIS 2TR CRF 13 POULET FRAIS ENTIER AU KILO POULET PRET A CUIRE BOKAIL 7,19 € Viandes et charcuterie 14 ROUELLE DE PORC FRAICHE AU KILO ROUELLE JAMBON 1KG 9,31 € 15 Sceau de queue/groin de porc 2KG ASSORT.QUEUES & GROIN 2KG C.