Cheval De Précision
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Use of Direct Thaw Insemination to Establish Pregnancies with Frozen–Thawed Semen from a Standard Jack Rebecca J
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Digital Repository @ Iowa State University Animal Science Publications Animal Science 11-2010 Use of Direct Thaw Insemination to Establish Pregnancies with Frozen–Thawed Semen from a Standard Jack Rebecca J. Jepsen United States Department of Agriculture Lawrence E. Evans Iowa State University Curtis R. Youngs Iowa State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/ans_pubs Part of the Animal Sciences Commons, and the Veterinary Medicine Commons The ompc lete bibliographic information for this item can be found at https://lib.dr.iastate.edu/ ans_pubs/371. For information on how to cite this item, please visit http://lib.dr.iastate.edu/ howtocite.html. This Article is brought to you for free and open access by the Animal Science at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Animal Science Publications by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Use of Direct Thaw Insemination to Establish Pregnancies with Frozen–Thawed Semen from a Standard Jack Abstract Pregnancy rates reported after artificial insemination with frozen–thawed jack spermatozoa have been relatively low compared with those attained in other species. Cholesterol is known to influence post-thaw fertility of both jack and stallion semen, and altering the amount of cholesterol in the freezing extender may help improve the fertility of frozen–thawed jack semen samples. In this study, we report clinical work that was performed using semen samples collected from a single jack. -

Genetic Diversity in Spanish Donkey Breeds Using Microsatellite DNA Markers José Aranguren-Méndez, Jordi Jordana, Mariano Gomez
Genetic diversity in Spanish donkey breeds using microsatellite DNA markers José Aranguren-Méndez, Jordi Jordana, Mariano Gomez To cite this version: José Aranguren-Méndez, Jordi Jordana, Mariano Gomez. Genetic diversity in Spanish donkey breeds using microsatellite DNA markers. Genetics Selection Evolution, BioMed Central, 2001, 33 (4), pp.433-442. 10.1051/gse:2001126. hal-00894382 HAL Id: hal-00894382 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00894382 Submitted on 1 Jan 2001 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Genet. Sel. Evol. 33 (2001) 433–442 433 © INRA, EDP Sciences, 2001 Original article Genetic diversity in Spanish donkey breeds using microsatellite DNA markers a;b a; José ARANGURENMÉNDEZ , Jordi JORDANA ∗, c Mariano GOMEZ a Unitat de Genètica i Millora Animal, Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona, Spain b Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Veterinarias, Departamento de Producción Animal, Maracaibo 4001-A, Venezuela c Servicio de Ganadería, Diputación Foral de Bizkaia, Avda. Lehendakari Aguirre, 9, 2 ◦, 48014 Bilbao, Spain (Received 27 November 2000; accepted 23 April 2001) Abstract – Genetic diversity at 13 equine microsatellite loci was compared in five endangered Spanish donkey breeds: Andaluza, Catalana, Mallorquina, Encartaciones and Zamorano- Leonesa. -

Pharmacovigilance of Veterinary Medicinal Products
a. Reporter Categories Page 1 of 112 Reporter Categories GL42 A.3.1.1. and A.3.2.1. VICH Code VICH TERM VICH DEFINITION C82470 VETERINARIAN Individuals qualified to practice veterinary medicine. C82468 ANIMAL OWNER The owner of the animal or an agent acting on the behalf of the owner. C25741 PHYSICIAN Individuals qualified to practice medicine. C16960 PATIENT The individual(s) (animal or human) exposed to the VMP OTHER HEALTH CARE Health care professional other than specified in list. C53289 PROFESSIONAL C17998 UNKNOWN Not known, not observed, not recorded, or refused b. RA Identifier Codes Page 2 of 112 RA (Regulatory Authorities) Identifier Codes VICH RA Mail/Zip ISO 3166, 3 Character RA Name Street Address City State/County Country Identifier Code Code Country Code 7500 Standish United Food and Drug Administration, Center for USFDACVM Place (HFV-199), Rockville Maryland 20855 States of USA Veterinary Medicine Room 403 America United States Department of Agriculture Animal 1920 Dayton United APHISCVB and Plant Health Inspection Service, Center for Avenue P.O. Box Ames Iowa 50010 States of USA Veterinary Biologic 844 America AGES PharmMed Austrian Medicines and AUTAGESA Schnirchgasse 9 Vienna NA 1030 Austria AUT Medical Devices Agency Eurostation II Federal Agency For Medicines And Health BELFAMHP Victor Hortaplein, Brussel NA 1060 Belgium BEL Products 40 bus 10 7, Shose Bankya BGRIVETP Institute For Control Of Vet Med Prods Sofia NA 1331 Bulgaria BGR Str. CYPVETSE Veterinary Services 1411 Nicosia Nicosia NA 1411 Cyprus CYP Czech CZEUSKVB -

Genetics and Biodiversity Journal Journal Homepage
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Revues Scientifiques de l'université de Tlemcen Genetics and Biodiversity Journal Journal homepage:http://ojs.univ-tlemcen.dz/index.php/GABJ Journal homepage:http://ojs.univ-tlemcen.dz/index.php/GABJ Original Research Paper MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION AND TYPOLOGY OF DONKEY FARMING (EQUUS ASINUS) IN THE WILAYA OF TLEMCEN Labbaci M1 , Djaout A2, Benyarou M1, Ameur Ameur A1, Gaouar S.B.S1 Department of Biology, Faculty of Sciences of Nature and Life, Earth and Universe Sciences, Abi Beker University Belkaid , (UABT), Tlemcen, Algeria National institute of agronomical Research of Algeria (INRAA), Agro system division. Sétif *Corresponding Author: Labbaci M, University Abou Bekr Bélkaid, Tlemcen; Email: [email protected] Article history: Received: 20 March 2018, Revised: 10 April 2018, Accepted: 28 June 2018 Abstract Due to the absence of the ethnic data and studies of racial characterizations of this species in Algeria, which is an endangered species, we contributed to the phenotypical study of donkey population in the area of Tlemcen. A manpower of 61 adult asses, distributed on the level of two areas from where 11 body measurements and 06 phenotypical characters were retained for this study. Measurements LTC, HG, TP, LH, LE, PC, LoT, LoO, LQ, LaT and TM are respectively of 157,26±12,88; 116,16±7,23; 124,26±7,03; 37,15±3,21; 27,07±3,27; 17,50±1,86; 52,39±4,06; 30,15±2,19; 41,42±5,76; 23,01±2,06 and 46,24±4,16cm. -

L'elevage De L'âne Du Poitou Dans
est lu par ... Jean-Pierre et Lisette Les purs Guy et Marie-Christine Odéstef 163 L’ELEVAGE DE L’ÂNE DU POITOU DANS L’ILE DE RÉ Ré Nature Environnement dédié à la nature, ses espaces naturels, sa faune et sa flore ne pouvait pas ignorer les métiers du secteur primaire, ceux des terres et des eaux du territoire insulaire surtout que parmi ses adhérents figurent des maraîchers, des viticulteurs, des sau- niers, un pêcheur, des ostréiculteurs. Ce fut le cas dans le Tome 1 « Connaître et comprendre la nature dans l’île de Ré » avec la culture de la pomme de terre et la culture des huitres sur l’île de Ré. Ils font le bonheur des enfants (et des grands) au parc de la Barbette à Saint Martine, ils ralentissent la vitesse des voitures mieux qu’un radar au bord des glacis des remparts de Vauban, ils baladent des centaines de visiteurs, ils emmènent même les mariés lors de leur noce, vous les avez reconnus, ce sont les ânes à culotte, les baudets (*) de Léau ! Régis Léau et Balthazar de Ré, champion national Qui était mieux placé que Régis Léau, l’éleveur de Saint-Martin pour parler : • Sauvegarde de la race • Joies et peines de son élevage • Anecdotes et noms de ses ânes. L’homme est avenant, intarissable sur ses bêtes et l’aventure de son élevage…… (*) Equus asinus 164 Asturia de l’œillet des dunes : Régis, les ânes en culotte c’est une histoire de famille ? Régis Léau : André Léau, mon père, a lancé son élevage d’ânes en 1985. -

English Channel and the Mediterranean, France Incorporates All the Contrasts of Central and Eastern Europe in an Accentuated Form
Contents I. Assesment of biodiversity in farm animals . 7 1. france and the farm sector . 7 1.1 france: european geography in a nutshell . 7 1.2 temperate climate . 8 1.3 overseas dependencies (dom-tom). 8 2. livestock farming at a glance . 9 2.1 farmers and their holdings . 9 2.2 agricultural land use and livestock production . 9 2.3 current state of genetic diversity . 11 2.4 breed trends. 12 3. assessment of conservation programmes . 13 3.1 in situ conservation. 13 3.2 ex situ conservation . 14 4. current use of animal genetic resources . 14 4.1 economic impact. 14 4.2 social impact . 16 4.3 optimising the use of animal genetic resources . 16 5. particular features of the French system. 17 II. Animal production demand trends in France . 19 1. livestock management policy, strategy. programmes and infrastructure . 19 1.1 the 1966 livestock law . 19 1.2 institutionalisation of conservation in France . 19 1.3 le bureau des ressources génétiques . 19 1.4 regional development projects . 19 2. management programmes and structures . 19 2.1 national cryobank . 19 2.2 biological resource centres . 20 2.3 genetic management systems . 20 2.4 health management systems . 20 3. demand . 21 3.1 livestock farming systems . 21 3.2 consumer demand . 21 3.3 joint development of breeds and their local environment . 21 4. alternative strategies for preserving and utilising farm animal genetic resources . 22 4.1 product diversification . 22 4.2 looking for variants . 23 4.3 strategies combining conservation and use . 23 4.4 biotechnology and conservation strategy . -

Differences in Ability of Jennies and Mares to Conceive with Cooled And
Animal Reproduction Science 112 (2009) 22–35 Differences in ability of jennies and mares to conceive with cooled and frozen semen containing glycerol or not Marianne Vidament a,∗, Pierrick Vincent b, Franc¸ois-Xavier Martin c, Michele Magistrini a, Elisabeth Blesbois a a INRA, UMR0085, UMR INRA/CNRS/Haras Nationaux/University Tours: Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Physiologie Animale et Syst`emes d’Elevage, Centre de recherche de Tours, NOUZILLY 37380, France b Les Haras Nationaux, Direction des Services et des Sites, Secteur Centre-Ouest, 17017 Saintes, France c SABAUD – Association pour la Sauvegarde du Baudet du Poitou, 15 rue Thiers, 79000 Niort, France Received 18 October 2007; received in revised form 21 March 2008; accepted 25 March 2008 Available online 28 March 2008 Abstract A suitable method for the cryopreservation of donkey semen would be very valuable for the ex situ management of genetic diversity in this species. This report uses a variety of observation and trials to evaluate the effect of cryoprotectants in per-cycle pregnancy rates (PC) in equids females (jennies (donkey) and mares (horse)). This was explored by (1) comparing the results of insemination of jennies and mares with cooled or frozen donkey semen, (2) examining the possible toxic effect of the cryoprotectant (CPA) glycerol in these two species and (3) studying alternative solutions. Donkey and horse semen was either used immediately, or cooled according to some steps of the pre- freezing procedure or frozen and thawed. The pre-freezing procedure included semen dilution, centrifugation, resuspension in milk or in INRA82 + 2% egg yolk + various % CPA (expressed as final concentrations in extended semen (v/v)) and then cooling to 4 ◦C. -

Équidés Activités Formation
Société Française des Equidés de Travail ÉQUIDÉS ACTIVITÉS FORMATION Equines – Equinos Activities – Actividades Tr aining Cour ses – Formaciones Непарнокопытные животные Виды деятельности Обучение 。 - Société Française des Equidés de Travail La Société Française des Equidés de Travail est la Société-mère des La SFET assure ou délègue l’organisation de ces épreuves. Elle en chevaux de trait, ânes et mulets, et chevaux de territoire français. Ses propose les règlements, les programmes et les calendriers. Elle assure ou missions consistent à encourager l’élevage, et à favoriser la formation, la délègue les engagements à ces épreuves via le site d’engagement : valorisation, la commercialisation des équidés de travail. Elle rassemble 25 www.equides-excellence.fr. Elle veille à la bonne application des races françaises d’équidés au sein desquelles sont représentés les règlements et sanctionne leur non-respect. Elle désigne et forme les juges éleveurs et utilisateurs des berceaux de race et des zones d’élevage du des diverses épreuves relevant de sa compétence via la plateforme de territoire national. formation : www.equides-formation.fr. Quelques chiffres Enfin, elle s’assure de la régularité du déroulement des épreuves, en particulier en contrôlant l’identité, les vaccinations et l’absence de 9 races de chevaux de trait - 9 races de poneys et chevaux de territoire - 7 races d’ânes sanctions disciplinaires en matière de dopage des équidés. Elle enregistre les résultats des épreuves et les transmet à l’établissement public de 250 000 équidés de travail soit le quart de la population nationale d’équidés l’Institut Français du Cheval et de l'Équitation (Ifce) notamment pour 10 000 éleveurs et utilisateurs l’élaboration des critères et outils d’amélioration génétique. -
World Watch List for Domestic Animal Diversity, 3Rd Edition
Introduzione ultima 29/11/00 6:39 PM Page I WORLD WATCH LIST for domestic animal diversity 3rd edition EDITED BY BEATE D. SCHERF FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS ROME,OCTOBER 2000 Introduzione ultima 29/11/00 6:39 PM Page II The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. ISBN 92-5-104511-9 All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for educational or other non-commercial purposes are authorized without any prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the copyright holders. Applications for such permission should be addressed to the Chief, Publishing and Multimedia Service, Information Division, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy or by e-mail to [email protected] © FAO 2000 Introduzione ultima 29/11/00 6:39 PM Page III ACKNOWLEDGEMENTS he production of this third edition of the World Watch List for Domestic Animal Diversity (WWL-DAD:3) has been largely based on the Global TDatabank for Farm Animal Genetic Resources which has been developed and maintained by FAO for country use.The extensive information in this data- bank is continuously collated and recorded by countries. -
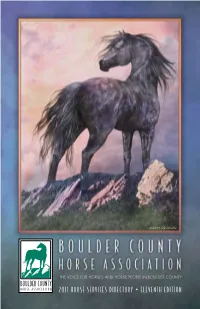
BCHA Directory2011.Pdf
-- -- Purina Feeds Poultry Feed & Equipment Custom Feeds Hay, Straw, & Bedding Agland Feed Shavings MannaPro Feed Wild Bird Center Pet Food & Supplies Caged Bird Supplies Blanket Washing & Repair Large Grooming & Pharmaceutical Department 7455 HYGIENE RD. HYGIENE , CO 80533 303-776-4757 Take 17th Ave. - Just West of Longmont 1 BCHA HORSE SERVICES DIRECTORY Advertisers’ Index . 4. Apparel, Boots, Hats & About the Directory . 6. Leather Goods . 31. A Bit About the Boulder County Boot Repair . 32. Horse Association . 7. Barn & Stable BCHA Membership Application . 9. Construction & Hardware . 32. BCHA President & Past Presidents . 10. Supplies & Equipment . 32. BCHA Awards . 11. Fencing . 32. Microchipping Horses . 12. Boarding . 33. Minimizing the Sweet in Horse Feed, . Breeders An Article by Nancy Loving, D .V .M . 14 Appaloosa . 36. HOOF Registration Form . 17. Arabian . 36. Information for Barn Emergencies . 18. Cleveland Bay . 36. Barn Information Sheet . 19. Missouri Foxtrotter . 36. Directory Sponsors . 77. Morgan . 36. BCHA Products for Sale . 78. National Show Horse . 36. Norwegian Fjord . 37. Paso Fino . 37. Paint . 37. Agencies, Government . 20. Quarter Horse . 37. Associations, Clubs & Organizations Rocky Mountain Horses . 37. Local . 22. Saddlebred . 38. Regional . 22. Thoroughbred . 38. State . .23 Warmblood . 38. National . 24. Bedding . 38. Associations, Breed Carriages & Carts . 38. Regional . 24. Clinics & Shows . 39. State . .25 Colleges & Schools . 39. National . 25. Farriers . 39. International . 30. Farrier Supplies . 40. Advertising & Marketing . 31. Feeds . 40. Animal Communicators . 31. Hay Sales/Services . 41. Animal Protection . 31. Shavings . 43. Supplements & Vitamins . 43. 2 TabLE OF CONTENTS Fitness, Health & Well-Being . 44. Tack & Saddlery . 64. Fly Control . 45. Accessories . 67. Gifts, Art, Videos & Books . 45. -

Introduction by Valerie Porter
ASSES by Valerie Porter Introduction the Indian khur, the Turkmenistani kulan, the Iranian onager and the extinct Syrian wild ass. ‘The ass, in his natural temper, is humble, patient, and quiet, and The European or Eurasian wild ass (Equus hydruntinus) bears correction with firmness. He is extremely hardy, both with has been extinct since perhaps the Iron Age (1200 BC–AD 400). regard to the quantity and quality of his food, contenting himself A 17th century specimen from Portugal, purported to have with the most harsh and disagreeable herbs, which other animals been the last representative of the species, was re-examined but will scarcely touch. In the choice of water he is, however, very showed a strong relationship to domestic donkeys (Orlando nice; drinking only of that which is perfectly clear, and at brooks et al., 2009; see also Cardosa et al., 2013). The distribution of with which he is acquainted. He is very serviceable to many the Eurasian wild ass had ranged from Mediterranean Europe persons who are not able to buy or keep horses; especially where to the Middle East, certainly as far east as Iran and possibly be- they live near heaths or commons, the barrenness of which will yond. Genetic data suggests that it was a subspecies of the keep him; being contented with any kind of coarse herbage, such Asiatic wild ass (E. hemionus) but the taxonomy remains to be as dry leaves, stalks, thistles, briers, chaff, and any sort of straw. clarified. It is sometimes described as the Eurasian hemione. He requires very little looking after, and sustains labour beyond most others. -

Fenotipska I Molekularno-Genetička Karakterizacija Populacije Balkanskog Magarca U Republici Srbiji
UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE Ljubodrag D. Stanišić Fenotipska i molekularno-genetička karakterizacija populacije balkanskog magarca u Republici Srbiji Doktorska disertacija Beograd, 2017 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Ljubodrag D. Stanišić Phenotypic and molecular genetic characterization of Balkan donkey population in Serbia Doctoral Dissertation Belgrade, 2017 Mentor 1: Dr Jevrosima Stevanović, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu Mentor 2: Dr Vladimir Dimitrijević, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu Članovi Komisije: Dr Zoran Stanimirović, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu Dr Slobodanka Vakanjac, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu Dr Jelena M. Aleksić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu Datum odbrane:__________________ Fenotipska i molekularno-genetička karakterizacija populacije balkanskog magarca u Republici Srbiji Rezime Balkanski magarac (Equus asinus L.) predstavlja ugroženu, neselektovanu, nestrukturiranu i tradicionalno gajenu autohtonu rasu magaraca. Za formiranje standarda rase i implementaciju odgajivačkih, reproduktivnih i mera upravljanja koje bi omogućile očuvanje i održivu eksploataciju balkanskog magarca, neophodan je uvid u fenotipske karakteristike, genetski status i poreklo balkanskog magarca. Stoga, jedan od ciljeva istraživanja je uspostavljanje