MAURICE NIVAT, UNE GRANDE FIGURE 89 ◦◦◦◦••◦◦ Une Brève Biographie Scientifique De Maurice Nivat 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
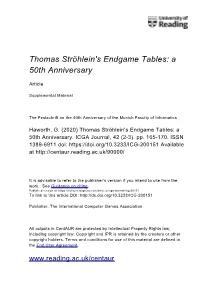
Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50Th Anniversary
Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50th Anniversary Article Supplemental Material The Festschrift on the 40th Anniversary of the Munich Faculty of Informatics Haworth, G. (2020) Thomas Ströhlein's Endgame Tables: a 50th Anniversary. ICGA Journal, 42 (2-3). pp. 165-170. ISSN 1389-6911 doi: https://doi.org/10.3233/ICG-200151 Available at http://centaur.reading.ac.uk/90000/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Published version at: https://content.iospress.com/articles/icga-journal/icg200151 To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.3233/ICG-200151 Publisher: The International Computer Games Association All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online 40 Jahre Informatik in Munchen:¨ 1967 – 2007 Festschrift Herausgegeben von Friedrich L. Bauer unter Mitwirkung von Helmut Angstl, Uwe Baumgarten, Rudolf Bayer, Hedwig Berghofer, Arndt Bode, Wilfried Brauer, Stephan Braun, Manfred Broy, Roland Bulirsch, Hans-Joachim Bungartz, Herbert Ehler, Jurgen¨ Eickel, Ursula Eschbach, Anton Gerold, Rupert Gnatz, Ulrich Guntzer,¨ Hellmuth Haag, Winfried Hahn (†), Heinz-Gerd Hegering, Ursula Hill-Samelson, Peter Hubwieser, Eike Jessen, Fred Kroger,¨ Hans Kuß, Klaus Lagally, Hans Langmaack, Heinrich Mayer, Ernst Mayr, Gerhard Muller,¨ Heinrich Noth,¨ Manfred Paul, Ulrich Peters, Hartmut Petzold, Walter Proebster, Bernd Radig, Angelika Reiser, Werner Rub,¨ Gerd Sapper, Gunther Schmidt, Fred B. -

Philippe Flajolet, the Father of Analytic Combinatorics Bruno Salvy, Bob Sedgewick, Michèle Soria, Wojtek Szpankowski, Brigitte Vallée
Philippe Flajolet, the Father of Analytic Combinatorics Bruno Salvy, Bob Sedgewick, Michèle Soria, Wojtek Szpankowski, Brigitte Vallée To cite this version: Bruno Salvy, Bob Sedgewick, Michèle Soria, Wojtek Szpankowski, Brigitte Vallée. Philippe Flajolet, the Father of Analytic Combinatorics. 23rd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2011), 2011, Reykjavik, Iceland. pp.1-2. hal-01336772 HAL Id: hal-01336772 https://hal.inria.fr/hal-01336772 Submitted on 23 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. FPSAC 2011, Reykjav´ık, Iceland DMTCS proc. AO, 2011, 1–2 Philippe Flajolet, the Father of Analytic Combinatorics Bruno Salvy Bob Sedgewick Michele` Soria Wojtek Szpankowski Brigitte Vallee´ May 2011 Philippe Flajolet, mathematician and computer scientist extraordinaire, suddenly passed away on March 22, 2011, at the prime of his career. He is celebrated for opening new lines of research in analysis of algo- rithms, developing powerful new methods, and solving difficult open problems. His research contributions will have impact for generations, and his approach to research, based on curiosity, a discriminating taste, broad knowledge and interest, intellectual integrity, and a genuine sense of camaraderie, will serve as an inspiration to those who knew him for years to come. -

R ˘Azvan Diaconescu
RA˘ ZVAN DIACONESCU list of publications MONOGRAPHS AND TEXTBOOKS [1-B] Institution-independent Model Theory. volume of Studies in Universal Logic series. Birkhauser¨ Basel, 2008. (386 pages). [2-B] (with K. Futatsugi) CafeOBJ Report: the language, proof techniques, and methodologies for object-oriented algebraic specification, volume 6 of AMAST Series in Computing. World Scientific Singapore, 1998. (174 pages) [3-B] Category-based Semantics for Equational and Constraint Logic Programming. D.Phil thesis, University of Oxford, 1994. (published as OUCL Monograph PRG-116, 120 pages) JOURNAL ARTICLES [4-J] Borrowing interpolation. Journal of Logic and Computation, Oxford Univ. Press. DOI:10.1093/logcom/exr007 [5-J] An axiomatic approach to structuring specifications. Theoretical Computer Science, 433:20–42, Elsevier, 2012. [6-J] Interpolation for predefined types. Mathematical Structures in Computer Science, 22(1):1–24, Cambridge Univ. Press, 2012. [7-J] Grothendieck inclusion systems. Applied Categorical Structures, 19(5):783–802, Springer, 2011. [8-J] Structural Induction in Institutions. Information and Computation, 209(9):1197–1222, Elsevier, 2011. [9-J] (with I. T¸ut¸u) On the Algebra of Structured Specifications. Theoretical Computer Science, 412(28):3145–3174, Elsevier, 2011. [10-J] On quasi-varieties of multiple valued logic models. Mathematical Logic Quarterly, 57(2):194–203, Wiley, 2011. [11-J] Coinduction for preordered algebras. Information and Computation, 209(2):108–117, Elsevier, 2011. [12-J] (with M. Petria) Saturated models in institutions. Archive for Mathematical Logic, 49(6):693–723, Springer, 2010. [13-J] Quasi-Boolean encodings and conditionals in algebraic specification. Journal of Logic and Algebraic Programming, 79(2):174–188, Elsevier, 2010. -

2019 AMS Prize Announcements
FROM THE AMS SECRETARY 2019 Leroy P. Steele Prizes The 2019 Leroy P. Steele Prizes were presented at the 125th Annual Meeting of the AMS in Baltimore, Maryland, in January 2019. The Steele Prizes were awarded to HARUZO HIDA for Seminal Contribution to Research, to PHILIppE FLAJOLET and ROBERT SEDGEWICK for Mathematical Exposition, and to JEFF CHEEGER for Lifetime Achievement. Haruzo Hida Philippe Flajolet Robert Sedgewick Jeff Cheeger Citation for Seminal Contribution to Research: Hamadera (presently, Sakai West-ward), Japan, he received Haruzo Hida an MA (1977) and Doctor of Science (1980) from Kyoto The 2019 Leroy P. Steele Prize for Seminal Contribution to University. He did not have a thesis advisor. He held po- Research is awarded to Haruzo Hida of the University of sitions at Hokkaido University (Japan) from 1977–1987 California, Los Angeles, for his highly original paper “Ga- up to an associate professorship. He visited the Institute for Advanced Study for two years (1979–1981), though he lois representations into GL2(Zp[[X ]]) attached to ordinary cusp forms,” published in 1986 in Inventiones Mathematicae. did not have a doctoral degree in the first year there, and In this paper, Hida made the fundamental discovery the Institut des Hautes Études Scientifiques and Université that ordinary cusp forms occur in p-adic analytic families. de Paris Sud from 1984–1986. Since 1987, he has held a J.-P. Serre had observed this for Eisenstein series, but there full professorship at UCLA (and was promoted to Distin- the situation is completely explicit. The methods and per- guished Professor in 1998). -

The Best Nurturers in Computer Science Research
The Best Nurturers in Computer Science Research Bharath Kumar M. Y. N. Srikant IISc-CSA-TR-2004-10 http://archive.csa.iisc.ernet.in/TR/2004/10/ Computer Science and Automation Indian Institute of Science, India October 2004 The Best Nurturers in Computer Science Research Bharath Kumar M.∗ Y. N. Srikant† Abstract The paper presents a heuristic for mining nurturers in temporally organized collaboration networks: people who facilitate the growth and success of the young ones. Specifically, this heuristic is applied to the computer science bibliographic data to find the best nurturers in computer science research. The measure of success is parameterized, and the paper demonstrates experiments and results with publication count and citations as success metrics. Rather than just the nurturer’s success, the heuristic captures the influence he has had in the indepen- dent success of the relatively young in the network. These results can hence be a useful resource to graduate students and post-doctoral can- didates. The heuristic is extended to accurately yield ranked nurturers inside a particular time period. Interestingly, there is a recognizable deviation between the rankings of the most successful researchers and the best nurturers, which although is obvious from a social perspective has not been statistically demonstrated. Keywords: Social Network Analysis, Bibliometrics, Temporal Data Mining. 1 Introduction Consider a student Arjun, who has finished his under-graduate degree in Computer Science, and is seeking a PhD degree followed by a successful career in Computer Science research. How does he choose his research advisor? He has the following options with him: 1. Look up the rankings of various universities [1], and apply to any “rea- sonably good” professor in any of the top universities. -

PHILIPPE FLAJOLET 1 December 1948 – 22 March 2011
Combinatorics, Probability and Computing (2011) 20, 647–649. c Cambridge University Press 2011 doi:10.1017/S0963548311000320 PHILIPPE FLAJOLET 1 December 1948 – 22 March 2011 Philippe Flajolet at the Institut Henri Poincare´ in October 2010 Philippe Flajolet, mathematician and computer scientist extraordinaire, the father of analytic combinatorics, suddenly passed away on 22 March 2011, at the prime of his career. He is celebrated for opening new lines of research in the analysis of algorithms, developing powerful new methods, and solving difficult open problems. His research contributions will have an impact for generations, and his approach to research, based on curiosity, discriminating taste, broad knowledge and interests, intellectual integrity, and a genuine sense of camaraderie, will serve as an inspiration to those who knew him, for years to come. The common theme of Philippe’s extensive and far-reaching body of work is the scientific approach to the study of algorithms, including the development of the requisite mathematical and computational tools. During his forty years of research he contributed nearly 200 publications, including many fundamental contributions and representing uncommon breadth and depth. He is best known for his fundamental advances in mathematical methods for the analysis of algorithms, and his research also opened new Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.40.219, on 25 Sep 2021 at 04:42:55, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0963548311000320 648 P. Flajolet avenues in various domains of applied computer science, including streaming algorithms, communication protocols, database access methods, data mining, symbolic manipulation, text-processing algorithms, and random generation. -

Lecture Notes in Computer Science 1378 Edited by G
Lecture Notes in Computer Science 1378 Edited by G. Goos, J. Hartmanis and J. van Leeuwen Maurice Nivat (Ed.) Foundations of Software Science and Computation Structures First International Conference, FoSSaCS'98 Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS' 98 Lisbon, Portugal, March 28 - April 4, 1998 Proceedings ~ Springer Series Editors Gerhard Goos, Karlsruhe University, Germany Juris Hartmanis, Cornell University, NY, USA Jan van Leeuwen, Utrecht University, The Netherlands Volume Editor Maurice Nivat LITP, Universit6 Paris 7 2, Place Jussieu, F-75251 Paris Cedex 05, France E-mail: Maurice.Nivat @litp.liafa.jussieu.fr Cataloging-in-Publication data applied for Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Foundations of software science and computation structures : first international conference ; proceedings / FoSSaCS '98, held as part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS '98, Lisbon, Portugal, March 28 - April 4, 1998. Maurice Nivat (ed.). - Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Budapest ; Hong Kong ; London Milan ; Paris ; Santa Clara ; Singapore ; Tokyo : Springer, 1998 (Lecture notes in computer science ; Vol. 1378) ISBN 3-540-64300-1 CR Subject Classification (1991):F.3. F.4.2, El.I, D.3.3-4, D.2.1 ISSN 0302-9743 ISBN 3-540-64300-1 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the German Copyright Law of September 9, 1965, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer -Verlag. -

The EATCS Award 2020 Laudatio for Toniann (Toni)Pitassi
The EATCS Award 2020 Laudatio for Toniann (Toni)Pitassi The EATCS Award 2021 is awarded to Toniann (Toni) Pitassi University of Toronto, as the recipient of the 2021 EATCS Award for her fun- damental and wide-ranging contributions to computational complexity, which in- cludes proving long-standing open problems, introducing new fundamental mod- els, developing novel techniques and establishing new connections between dif- ferent areas. Her work is very broad and has relevance in computational learning and optimisation, verification and SAT-solving, circuit complexity and communi- cation complexity, and their applications. The first notable contribution by Toni Pitassi was to develop lifting theorems: a way to transfer lower bounds from the (much simpler) decision tree model for any function f, to a lower bound, the much harder communication complexity model, for a simply related (2-party) function f’. This has completely transformed our state of knowledge regarding two fundamental computational models, query algorithms (decision trees) and communication complexity, as well as their rela- tionship and applicability to other areas of theoretical computer science. These powerful and flexible techniques resolved numerous open problems (e.g., the su- per quadratic gap between probabilistic and quantum communication complex- ity), many of which were central challenges for decades. Toni Pitassi has also had a remarkable impact in proof complexity. She in- troduced the fundamental algebraic Nullstellensatz and Ideal proof systems, and the geometric Stabbing Planes system. She gave the first nontrivial lower bounds on such long-standing problems as weak pigeon-hole principle and models like constant-depth Frege proof systems. She has developed new proof techniques for virtually all proof systems, and new SAT algorithms. -

Kolmogorov Complexity in Perspective. Part II: Classification, Information Processing and Duality Marie Ferbus-Zanda
Kolmogorov Complexity in perspective. Part II: Classification, Information Processing and Duality Marie Ferbus-Zanda To cite this version: Marie Ferbus-Zanda. Kolmogorov Complexity in perspective. Part II: Classification, Information Processing and Duality. Synthese, Springer Verlag (Germany), 2010, pp.00. hal-00525505 HAL Id: hal-00525505 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00525505 Submitted on 13 Oct 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Kolmogorov Complexity in perspective Part II: Classification, Information Processing and Duality∗ Marie Ferbus-Zanda LIAFA, CNRS & Universit´eParis Diderot - Paris 7 Case 7014 75205 Paris Cedex 13 France [email protected] Abstract We survey diverse approaches to the notion of information: from Shan- non entropy to Kolmogorov complexity. Two of the main applications of Kolmogorov complexity are presented: randomness and classification. The survey is divided in two parts published in a same volume. Part II is dedicated to the relation between logic and information sys- tem, within the scope of Kolmogorov algorithmic information theory. We present a recent application of Kolmogorov complexity: classification us- ing compression, an idea with provocative implementation by authors such as Bennett, Vit´anyi and Cilibrasi. -

A Rational Deconstruction of Landin's J Operator
BRICS RS-06-4 Danvy & Millikin: A Rational Deconstruction of Landin’s J Operator BRICS Basic Research in Computer Science A Rational Deconstruction of Landin’s J Operator Olivier Danvy Kevin Millikin BRICS Report Series RS-06-4 ISSN 0909-0878 February 2006 Copyright c 2006, Olivier Danvy & Kevin Millikin. BRICS, Department of Computer Science University of Aarhus. All rights reserved. Reproduction of all or part of this work is permitted for educational or research use on condition that this copyright notice is included in any copy. See back inner page for a list of recent BRICS Report Series publications. Copies may be obtained by contacting: BRICS Department of Computer Science University of Aarhus IT-parken, Aabogade 34 DK–8200 Aarhus N Denmark Telephone: +45 8942 9300 Telefax: +45 8942 5601 Internet: [email protected] BRICS publications are in general accessible through the World Wide Web and anonymous FTP through these URLs: http://www.brics.dk ftp://ftp.brics.dk This document in subdirectory RS/06/4/ A Rational Deconstruction of Landin’s J Operator∗ Olivier Danvy and Kevin Millikin BRICS† Department of Computer Science University of Aarhus‡ February 28, 2006 Abstract Landin’s J operator was the first control operator for functional languages, and was specified with an extension of the SECD machine. Through a se- ries of meaning-preserving transformations (transformation into continu- ation-passing style (CPS) and defunctionalization) and their left inverses (transformation into direct style and refunctionalization), we present a compositional evaluation function corresponding to this extension of the SECD machine. We then characterize the J operator in terms of CPS and in terms of delimited-control operators in the CPS hierarchy. -
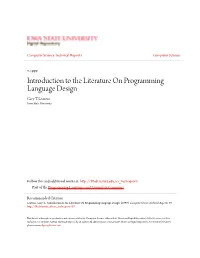
Introduction to the Literature on Programming Language Design Gary T
Computer Science Technical Reports Computer Science 7-1999 Introduction to the Literature On Programming Language Design Gary T. Leavens Iowa State University Follow this and additional works at: http://lib.dr.iastate.edu/cs_techreports Part of the Programming Languages and Compilers Commons Recommended Citation Leavens, Gary T., "Introduction to the Literature On Programming Language Design" (1999). Computer Science Technical Reports. 59. http://lib.dr.iastate.edu/cs_techreports/59 This Article is brought to you for free and open access by the Computer Science at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Computer Science Technical Reports by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Introduction to the Literature On Programming Language Design Abstract This is an introduction to the literature on programming language design and related topics. It is intended to cite the most important work, and to provide a place for students to start a literature search. Keywords programming languages, semantics, type systems, polymorphism, type theory, data abstraction, functional programming, object-oriented programming, logic programming, declarative programming, parallel and distributed programming languages Disciplines Programming Languages and Compilers This article is available at Iowa State University Digital Repository: http://lib.dr.iastate.edu/cs_techreports/59 Intro duction to the Literature On Programming Language Design Gary T. Leavens TR 93-01c Jan. 1993, revised Jan. 1994, Feb. 1996, and July 1999 Keywords: programming languages, semantics, typ e systems, p olymorphism, typ e theory, data abstrac- tion, functional programming, ob ject-oriented programming, logic programming, declarative programming, parallel and distributed programming languages. -

A Verified Prover Based on Ordered Resolution Anders Schlichtkrull, Jasmin Christian Blanchette, Dmitriy Traytel
A Verified Prover Based on Ordered Resolution Anders Schlichtkrull, Jasmin Christian Blanchette, Dmitriy Traytel To cite this version: Anders Schlichtkrull, Jasmin Christian Blanchette, Dmitriy Traytel. A Verified Prover Based on Ordered Resolution. CPP 2019 - The 8th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs, Jan 2019, Cascais, Portugal. 10.1145/3293880.3294100. hal-01937141 HAL Id: hal-01937141 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01937141 Submitted on 27 Nov 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A Verified Prover Based on Ordered Resolution Anders Schlichtkrull Jasmin Christian Blanchette Dmitriy Traytel DTU Compute Department of Computer Science Department of Computer Science Technical University of Denmark Vrije Universiteit Amsterdam ETH Zürich Kongens Lyngby, Denmark Amsterdam, the Netherlands Zürich, Switzerland [email protected] [email protected] [email protected] Abstract interpreted universally. Each literal is either an atom A or The superposition calculus, which underlies first-order the- its negation :A. An atom is a symbol applied to a tuple of orem provers such as E, SPASS, and Vampire, combines or- terms—e.g., prime¹nº. The empty clause is denoted by ?.