Plan De Conservation DU SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL 2018 - 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

QHN Spring 2020 Layout 1
WESTWARD HO! QHN FEATURES JOHN ABBOTT COLLEGE & MONTREAL’S WEST ISLAND $10 Quebec VOL 13, NO. 2 SPRING 2020 News “An Integral Part of the Community” John Abbot College celebrates seven decades Aviation, Arboretum, Islands and Canals Heritage Highlights along the West Island Shores Abbott’s Late Dean The Passing of a Memorable Mentor Quebec Editor’s desk 3 eritageNews H Vocation Spot Rod MacLeod EDITOR Who Are These Anglophones Anyway? 4 RODERICK MACLEOD An Address to the 10th Annual Arts, Matthew Farfan PRODUCTION Culture and Heritage Working Group DAN PINESE; MATTHEW FARFAN The West Island 5 PUBLISHER A Brief History Jim Hamilton QUEBEC ANGLOPHONE HERITAGE NETWORK John Abbott College 8 3355 COLLEGE 50 Years of Success Heather Darch SHERBROOKE, QUEBEC J1M 0B8 The Man from Argenteuil 11 PHONE The Life and Times of Sir John Abbott Jim Hamilton 1-877-964-0409 (819) 564-9595 A Symbol of Peace in 13 FAX (819) 564-6872 St. Anne de Bellevue Heather Darch CORRESPONDENCE [email protected] A Backyard Treasure 15 on the West Island Heather Darch WEBSITES QAHN.ORG QUEBECHERITAGEWEB.COM Boisbriand’s Legacy 16 100OBJECTS.QAHN.ORG A Brief History of Senneville Jim Hamilton PRESIDENT Angus Estate Heritage At Risk 17 GRANT MYERS Matthew Farfan EXECUTIVE DIRECTOR MATTHEW FARFAN Taking Flight on the West Island 18 PROJECT DIRECTORS Heather Darch DWANE WILKIN HEATHER DARCH Muskrats and Ruins on Dowker Island 20 CHRISTINA ADAMKO Heather Darch GLENN PATTERSON BOOKKEEPER Over the River and through the Woods 21 MARION GREENLAY to the Morgan Arboretum We Go! Heather Darch Quebec Heritage News is published quarterly by QAHN with the support Tiny Island’s Big History 22 of the Department of Canadian Heritage. -

Sir John Joseph Caldwell Abbott Canada’S Third Prime Minister
1 Sir John Joseph Caldwell Abbott Canada’s third prime minister Quick Facts Term(s) of Office: June 16, 1891–November 24, 1892 Born March 12, 1821, St. Andrews, Lower Canada (now Saint-André-d’Argenteuil, Quebec) Died October 30, 1893, Montréal, Quebec Grave site: Mount Royal Cemetery, Montréal, Quebec Education University of McGill College, B.C.L. 1854 Personal Life Married 1849, Mary Bethune (1823–1898) Four sons, four daughters Occupations Lawyer (called to the bar of Canada East in 1847) 1853–1876 Professor of Law, McGill 1855–1880 Dean of Law, McGill 1862 President, Canada Central Railway 1862–1884 Raised and commanded the Argenteuil Rangers 1885–1891 Member, Board of Directors, Canadian Pacific Railway 1887, 1888 Elected Mayor of Montréal Political Party Liberal-Conservative (forerunner of the Conservative party) 1891–1892 Party Leader Constituencies 1867–1874, 1881–1887 Argenteuil, Quebec Other Ministries 1862–1863 Solicitor General (Province of Canada) 1887–1891 Minister Without Portfolio 1891–1892 President of the Privy Council Political Record Chair, House of Commons Banking Committee 1867–1874 Senator and Leader of the Government in the Senate 1887–1893 The first prime minister to lead the country from the Senate 2 Biography I hate politics, and what are considered their appropriate methods. I hate notoriety, public meetings, public speeches, caucuses, and everything that I know of that is apparently the necessary incident of politics—except doing public work to the best of my ability. —Sir John J. C. Abbott, June 4, 1891 Unusual sentiments for a man who was to become prime minister twelve days later. -

National Historic Sites of Canada System Plan Will Provide Even Greater Opportunities for Canadians to Understand and Celebrate Our National Heritage
PROUDLY BRINGING YOU CANADA AT ITS BEST National Historic Sites of Canada S YSTEM P LAN Parks Parcs Canada Canada 2 6 5 Identification of images on the front cover photo montage: 1 1. Lower Fort Garry 4 2. Inuksuk 3. Portia White 3 4. John McCrae 5. Jeanne Mance 6. Old Town Lunenburg © Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2000) ISBN: 0-662-29189-1 Cat: R64-234/2000E Cette publication est aussi disponible en français www.parkscanada.pch.gc.ca National Historic Sites of Canada S YSTEM P LAN Foreword Canadians take great pride in the people, places and events that shape our history and identify our country. We are inspired by the bravery of our soldiers at Normandy and moved by the words of John McCrae’s "In Flanders Fields." We are amazed at the vision of Louis-Joseph Papineau and Sir Wilfrid Laurier. We are enchanted by the paintings of Emily Carr and the writings of Lucy Maud Montgomery. We look back in awe at the wisdom of Sir John A. Macdonald and Sir George-Étienne Cartier. We are moved to tears of joy by the humour of Stephen Leacock and tears of gratitude for the courage of Tecumseh. We hold in high regard the determination of Emily Murphy and Rev. Josiah Henson to overcome obstacles which stood in the way of their dreams. We give thanks for the work of the Victorian Order of Nurses and those who organ- ized the Underground Railroad. We think of those who suffered and died at Grosse Île in the dream of reaching a new home. -

From the Closet to the Grave: Architecture, Sexuality and the Mount Royal Cemetery
175 ISSN: 1755-068 www.field-journal.org vol.7 (1) From the Closet To the Grave: Architecture, Sexuality and the Mount Royal Cemetery Evan Pavka This paper argues that the burials of individuals who engaged, or were speculated to have engaged, in same-sex relations in the late-nineteenth and early twentieth centuries were in constant relation to the material and metaphoric closet. Due to limited archival material concerning cases of same-sex activity in Montreal, Canada, I look out toward international grave sites to construct a framework for analysis. Using case studies from French and American cemeteries alongside those in Mount Royal Cemetery in Montreal, I argue that, for those whose memory is directed by the living, the grave functions much like the closet—closing or disclosing what institutions and society deemed “abominable.” However, more powerful individuals were able to subvert the authority of the cemetery by immortalizing their “romantic friendships” in the grave. By navigating the binaries of the closet—closure/disclosure, hetero/homosexual and repression/pride— the grave has the potential to function as an important archive of identity, sexuality and memory. 176 www.field-journal.org vol.7 (1) The article ‘Israeli Supreme Court Rejects Family Petition To Bury Trans Woman As Their ‘Son’,’ published by Buzzfeed in 2015, outlines how the parents of trans-activist May Peleg sought to commemorate her as “their son.”1 Emphasizing burial as an instrument to rectify her gender and sexuality, the spatial realities of the closet embedded in this article parallel the burials of those who engaged in same-sex relations in the late-nineteenth and early twentieth centuries.2 The article speaks to the continued presence of the closet—closing or disclosing gender and sexuality—in death. -

Early Encounters with Mount Royal: Part One
R IOTS :G AVAZZIANDTHEONETHATWASN ’ T $5 Quebec VOL 5, NO. 8 MAR-APR 2010 HeritageNews Montreal Mosaic Online snapshots of today’s urban anglos Tall Tales Surveys of historic Mount Royal and the Monteregian Hotspots The Gavazzi Riot Sectarian violence on the Haymarket, 1853 QUEBEC HERITAGE NEWS Quebec CONTENTS eritageNews H DITOR E Editor’s Desk 3 ROD MACLEOD The Reasonable Revolution Rod MacLeod PRODUCTION DAN PINESE Timelines 5 PUBLISHER Montreal Mosaic : Snapshots of urban anglos Rita Legault THE QUEBEC ANGLOPHONE The Mosaic revisited Rod MacLeod HERITAGE NETWORK How to be a tile Tyler Wood 400-257 QUEEN STREET SHERBROOKE (LENNOXVILLE) Reviews QUEBEC Uncle Louis et al 8 J1M 1K7 Jewish Painters of Montreal Rod MacLeod PHONE The Truth about Tracey 10 1-877-964-0409 The Riot That Never Was Nick Fonda (819) 564-9595 FAX (819) 564-6872 Sectarian violence on the Haymarket 13 CORRESPONDENCE The Gavazzi riot of 1853 Robert N Wilkins [email protected] “A very conspicuous object” 18 WEBSITE The early history of Mount Royal, Part I Rod MacLeod WWW.QAHN.ORG Monteregian Hotspots 22 The other mountains, Part I Sandra Stock Quebec Family History Society 26 PRESIDENT KEVIN O’DONNELL Part IV: Online databases Robert Dunn EXECUTIVE DIRECTOR If you want to know who we are... 27 DWANE WILKIN MWOS’s Multicultural Mikado Rod MacLeod HERITAGE PORTAL COORDINATOR MATTHEW FARFAN OFFICE MANAGER Hindsight 29 KATHY TEASDALE A childhood in the Montreal West Operatic Society Janet Allingham Community Listings 31 Quebec Heritage Magazine is produced six times yearly by the Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN) with the support of The Department of Canadian Heritage and Quebec’s Ministere de la Culture et Cover image: “Gavazzi Riot, Haymarket Square, Montreal, 1853” (Anonymous). -

Library of Congress
Library of Congress Peculiarities of American cities. Willard Glazier PECULIARITIES OF AMERICAN CITIES. BY CAPTAIN WILLARD GLAZIER, AUTHOR OF “SOLDIERS OF THE SADLLE,” “CAPTURE, PRISON-PEN AND ESCAPE,” “BATTLES FOR THE UNION,” “HEROES OF THREE WARS,” “DOWN THE GREAT RIVER,” ETC., ETC. IIlustrated. LC PHILADELPHIA: HUBBARD BROTHERS, PUBLISHERS, No. 723 CHESTNUT STREET. 1886. E168 .G553 Entered according to Act of Congress, in the year 1883, by WILLARD GLAZIER, In the Office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C. 194604 12 To her WHO IS NEAREST AND DEAREST; WHOSE HEART HAS ENCOURAGED; WHOSE HAND HAS CONTRIBUTED TO THE ILLUSTRATION AND EMBELLISHMENT OF ALL MY LITERARY WORK, This Volume IS LOVINGLY INSCRIBED BY THE AUTHOR. PREFACE. It has occurred to the author very often that a volume presenting the peculiar features, favorite resorts and distinguishing characteristics, of the leading cities of America, would Peculiarities of American cities. http://www.loc.gov/resource/lhbtn.05993 Library of Congress prove of interest to thousands who could, at best, see them only in imagination, and to others, who, having visited them, would like to compare notes with one who has made their PECULIARITIES a study for many years. A residence in more than a hundred cities, including nearly all that are introduced in this work, leads me to feel that I shall succeed in my purpose of giving to the public a book, without the necessity of marching in slow and solemn procession before my readers a monumental array of time-honored statistics; on the contrary, it will be my aim, in the following pages, to talk of cities as I have seen and found them in my walks, from day to day, with but slight reference to their origin and past history. -
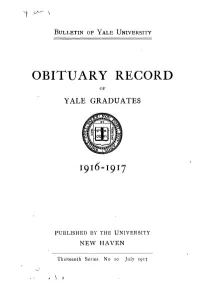
1916-1917 Obituary Record of Graduates of Yale University
N BULLETIN OF YALE UNIVERSITY OBITUARY RECORD OF YALE GRADUATES I916-I917 PUBLISHED BY THE UNIVERSITY NEW HAVEN Thirteenth Series No 10 July 1917 BULLETIN OF YALE UNIVERSITY Entered as second-class matter, August 30, 1906, at the-post-office at New Haven, Conn, under the Act of Congress of July 16, 1894 The Bulletin, which is issued monthly, includes 1. The University Catalogue 2 The Reports of the President and Treasurer 3 The Pamphlets of the Several Schools 4 The Directory of Living Graduates THE TLTTLE, MOREHOtSE & TAYLOR COMPANY, NEW HAVEN, CONN OBITUARY RECORD OF GRADUATES OF YA1E UNIVERSITY Deceased dating the yea* ending JULY 1, 1917 INCLUDING THE RECORD OF A FEW WHO DIED PREVIOUSLY HITHERTO UNREPORTED [No 2 of the Seventh Printed Series, and No 76 of the whole Record The present Series consists of -frve numbers] OBITUARY RECORD OF GRADUATES OF YALE UNIVERSITY Deceased during the year ending JULY I, 1917, Including the Record of a few who died previously, hitherto unreported [No 2 of the Seventh Printed Series, and No 76 of the whole Record The present Series consists of five numbers ] YALE COLLEGE (ACADEMIC DEPARTMENT) Robert Hall Smith, B.A. 1846 Born February 29, 1828, m Baltimore, Md Died September n, 1915, on Spesutia Island, Harford County, Md Robert Hall Smith was the son of Samuel W and Elinor (Donnell) Smith, and was born February 29, 1828, in Baltimore, Md. Through his father, whose parents were Robert and Margaret Smith, he traced his descent from Samuel Smith, who came to this country from Ballema- goragh, Ireland, in 1728, settling at Donegal, Lancaster County, Pa. -

76285 Encovrabat.Indd
Mount Royal Protection and Enhancement Plan Mount Royal Protection and Enhancement Plan Plan and Enhancement Protection Royal Mount Printed in Canada Legal deposit Bibliothèque nationale Second quarter 2009 ISBN-978-2-7647-0793-7 Une version française de ce document est disponible sur demande ou sur le site Internet de la Ville de Montréal à ville.montreal.qc.ca ville.montreal.qc.ca Printed on recycled paper Mount Royal Protection and Enhancement Plan Ville de Montréal April 2009 I am pleased to present the Mount Royal Protection and Enhancement Plan. Its tremendous breadth and depth are the fruit of careful work on the part of the many experts consulted, along with the active participation of residents, associations and institutions, all of them equally concerned that it should include specifi c measures to protect and enhance the Mountain. I am convinced that the measures in the Plan will make Mount Royal one of the fi nest natural and heritage sites on the continent. There will be many challenges as we continue to work toward this goal, and the Plan has the advantage of identifying them clearly: protecting and upgrading natural habitats that are especially sensitive because they are in the heart of the city; preserving and restoring the built heritage and, fi nally, maintaining and enhancing landscapes and views. Gérald Tremblay Meeting these goals calls for a wide variety of actions – from day-to-day vigilance Mayor of Montréal to moving forward with long-term strategic projects. One of the strengths of the Plan is in fact its detailed description of the means for pursuing all of these goals. -

Mcgill University Archives Mcgill University, Montreal Canada
McGill University Archives McGill University, Montreal Canada MG4240 J.W. McConnell Fonds Accession 2004‐0114 This is a guide to one of the collections held by the McGill University Archives, McGill University. Visit the McGill University Archives homepage (http://www.mcgill.ca/archives) for more information TABLE OF CONTENTS Introduction 2 Acknowledgments 2 Fonds Description 3 Series and Subseries Description 7 Correspondence 7 Journals, Scrapbooks, Address Books 8 Personal and Family Records 9 Philanthropy and Fundraising 10 Hospitals and Health Care Higher Education War Effort High Society 11 Business Commitments 12 Company Promotions Commercial Trust Company, Ltd. The Montreal Star St. Lawrence Sugar Refineries Ltd. Property Holdings (St. Lawrence Sugar Refineries) File Listing by Container (including photographs and moving images) 13 MG 4240/Acc.04-114 1 INTRODUCTION The John Wilson McConnell Fonds and Finding Aid were prepared over the summer and fall of 2004 by Shannon Hodge, Contract Archivist and Gordon Burr, Senior Archivist and Records Manager, McGill University. ACKNOWLEDGEMENTS The creation of the John Wilson McConnell Fonds was made possible by the generous funding of the J.W. McConnell Family Foundation. The Fonds would not be possible without the donations of records and material made by representatives of the McConnell family. The McGill University Archives would like to thank Dr. William Fong and Mr. Nicolas McConnell for their time and expertise in the initial identification and organization of the records. MG 4240/Acc.04-114 2 FONDS DESCRIPTION TITLE: JOHN WILSON McCONNELL FONDS DATES: ca1898-1980 EXTENT: 13.6 m [textual]; 206 photographs; 7 moving images [4 16mm ; 400’, 1 16mm ; 2000’, 2 VHS cassettes] Biographical Information Beginnings in Business John Wilson McConnell was born in Muskoka, Ontario 01 July 1877 to John McConnell and Margaret Anne (née Wilson) McConnell, both immigrants to Canada of Ulster-Scots origin. -

Land Capitalization, Public Space, and the Redpath Family Home, 1837-1861 Roderick Macleod
Document generated on 09/25/2021 8:45 a.m. Journal of the Canadian Historical Association Revue de la Société historique du Canada The Road to Terrace Bank: Land Capitalization, Public Space, and the Redpath Family Home, 1837-1861 Roderick Macleod Volume 14, Number 1, 2003 Article abstract The efforts of nineteenth-century Montreal land developer John Redpath to URI: https://id.erudit.org/iderudit/010324ar subdivide his country estate into residential lots for the city's rising middle DOI: https://doi.org/10.7202/010324ar class were marked by a shrewd sense of marketing and a keen understanding of the political climate – but they were also strongly determined by the Redpath See table of contents family's need for status and comfort. Both qualities were provided by Terrace Bank, the house at the centre of the estate, and both would only increase with the creation of a middle-class suburb around it on the slopes of Mount Royal. Publisher(s) As a result, the Redpath family home, and the additional homes built nearby for members of the extended Redpath family, influenced all stages of the The Canadian Historical Association / La Société historique du Canada planning and subdivision process, which met with great success over the course of the 1840s. In its use of personal correspondence, notarial documents, ISSN plans, the census, and cemetery records, this paper brings together elements of city planning, political and social history, and family history in order to 0847-4478 (print) provide a nuanced picture of how the nineteenth-century built environment 1712-6274 (digital) was shaped and how we should read pubic space. -

Dictionnaire Des Parlementaires Du Québec De 1792-À
1 Dictionnaire 1 des parlementaires 1 du Québec 1 de 1792 à nos jours LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC 1000, route de l'Église, bureau 500, Québec (Quebec) G1V 3V9 VENTE ET DISTRIBUTION Téléphone : 418 643-5150 ou, sans frais. 1 800 463-2100 Telecopie : 418 643-6177 ou. sans frais, 1 800 561-3479 lntemet : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliotheque et Archives Canada Vedette principale au titre Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos jours 3e éd. Publ. antérieurement sous le titre: Répertoire des parlementaires québécois, 1867-1978. Québec : Bibliothèque de la Législature, Service de documentation politique, 1980. ISBN 978-2-551-19836-8 1. Parlementaires - Québec (Province)- Biographies- Dictionnaires français. 2. Québec (Province). Assemblée nationale - Biographies - Dictionnaires français. 1. Rochefort, Martin. II. Lemieux, Frédéric, 1973- . III. Québec (Province). Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Division de la recherche. IV. Dictionnaire des parlementaires (lu Québec. V. Titre: Répertoire des parlementaires québécois, 1867-1978. Dictionnaire des parlementaires du Québec - _ _ = . - - r' de 1792 à nos jours LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC Cet ouvrage a été réalisé par la Division de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale sous la direction de Martin Rochefort. Chargé de projet Frédéric Lemieux Rédaction et mise à jour Martin Rochefort Frédéric Lemieux Louise Côté Mathieu Fraser Alain Gariépy Mélanie Lemire Stéphane Pageau Traitement et analyse des informations biographiques Jacques Gagnon Frédéric Lemieux Martin Rochefort Révision Frédéric Lemieux Danielle Simard Service du Journal des débats, sous la direction de Carole Lessard Depuis 1792, les parlementaires québécois ont siégé dans plusieurs édifices dont les images Relations avec l'éditeur illustrent la couverture cle cet ouvrage. -

Jvaanriaitntt Nî (Eanata
Oh* JVaanriaitntt nî (Eanata dottïte Eatahllelfro in (Banana 8>Qmt ijftatorir BiUB ...t«... Œanaoa anb Nerofnnnblanb Annual Strçrurt 19ir Qfat J\a00riattan o, au* E:;iablitïlnù in (Cauaba #0m? étaient &\UB ...ttt. (Eanana ann NpuifmtttMatrâ Annual BiUnurt RE -LAYING OF THE CORNER STONE OF THE NEW PARLIAMENT BUILDINGS BY HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF CONNAUGHT. GOVERNOR-GENERAL OF CANADA. 1ST OF SEPT.. 1916 PAGE 30 îfy'iBtuvu IGanômarka Àfiaonation nf Ûlattaba Patron FIELD MARSHAL HIS ROYAL HIGHNESS, THE DURE OF OONNAUGHT AND STRATHEARN, K.G., G.C.M.G., Etc. Visitor HIS EXCELLENCY THE DUKE OF DEVONSHIRE, K.G., G.C.M.G., Etc. Governor General of Canada. Honorary President THE RT. HONORABLE .SIR ROBERT LAIRD BORDEN, P.C., G.C.M.G. Prime (Minister. President PEMBBRTON SMITH, Esq., Montreal. Vice-Presidents P. B. CASGRAIN, Esq., K.C., Quebec. W. D. LIGHTHALL, KJC, F.R.S.C., Montreal. SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LLJD., FJLS.C, Toronto. General Secretary MRS. J. B. SIMPSON, 173 Percy St., Ottawa. French Secretary BENJAMIN SULTE, LLJD., F.R.S.C, Ottawa. Treasurer GEORGE DURNFORD, Esq., FJCA., Montreal. COUNCIL—-The.President, Vice-iPresidents, Secretaries, Treasurer, all subscribing Fellows of Sections I and II of the Royal Society of Canada, and one representative from each corresponding Society (with power to add.) ANNUAL MEETING—Held yearly in connection with the meeting of the Royal Society of Canada. 3 GUIDE. TO "HISTORICAL SOCIETIES" ESTABLISHED IN CANADA. (Corresponding Members of the Historic Landmarks Association) ANTIQUARIAN AND NUMISMATIC SOCIETY OP MONTREAL. Chateau de Ramezay. W. D. Lighthall, Esq., K.C., F.R.S.C, President, Quebec Bank Building, Montreal, Que.