COMMUNE DE WICRES Canton De La Bassée
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
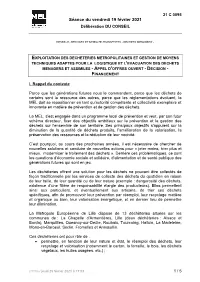
Modèle Subvention-Convention
21 C 0095 Séance du vendredi 19 février 2021 Délibération DU CONSEIL RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - DECHETS MENAGERS - EXPLOITATION DES DECHETERIES METROPOLITAINES ET GESTION DE MOYENS TECHNIQUES ADAPTES POUR LA LOGISTIQUE ET L'EVACUATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - APPEL D'OFFRES OUVERT - DECISION - FINANCEMENT I. Rappel du contexte Parce que les générations futures nous le commandent, parce que les déchets de certains sont la ressource des autres, parce que les réglementations évoluent, la MEL doit se repositionner en tant qu’autorité compétente et collectivité exemplaire et innovante en matière de prévention et de gestion des déchets. La MEL, s'est engagée dans un programme local de prévention et veut, par son futur schéma directeur, fixer des objectifs ambitieux sur la prévention et la gestion des déchets sur l'ensemble de son territoire. Ses principaux objectifs s'appuient sur la diminution de la quantité de déchets produits, l’amélioration de la valorisation, la préservation des ressources et la réduction de leur nocivité. C’est pourquoi, au cours des prochaines années, il est nécessaire de chercher de nouvelles solutions et conduire de nouvelles actions pour « jeter moins, trier plus et mieux, moderniser le traitement des déchets ». Derrière ces problématiques, ce sont les questions d’économie sociale et solidaire, d’alimentation et de santé publique des générations futures qui sont en jeu. Les déchèteries offrent une solution pour les déchets ne pouvant être collectés de façon traditionnelle par les services de collecte des déchets du quotidien en raison de leur taille, de leur quantité ou de leur nature (exemple : dangerosité des déchets, existence d’une filière de responsabilité élargie des producteurs). -

15 Mars 2020 Etat Des Candidatures Régulièrement Enregistrées Arrond
Elections municipales et communautaires - premier tour - 15 mars 2020 Etat des candidatures régulièrement enregistrées Arrondissement de Lille Communes de moins de 1000 habitants Libellé commune Sexe candidat Nom candidat Prénom candidat Nationalité Beaucamps-Ligny F BAUGE Pascale Française Beaucamps-Ligny M BEHAREL Kilien Française Beaucamps-Ligny F BERGER Charlotte Française Beaucamps-Ligny F BOGAERT Caroline Française Beaucamps-Ligny M BONNEEL André Française Beaucamps-Ligny F DEBAECKER Noémie Française Beaucamps-Ligny F DEHAUDT Ingrid Française Beaucamps-Ligny M DEPOIX Eric Française Beaucamps-Ligny M DIGNE Eric Française Beaucamps-Ligny M DOURLOU Pascal Française Beaucamps-Ligny M DUMORTIER Tanguy Française Beaucamps-Ligny F DURREAU Cécile Française Beaucamps-Ligny M FLAVIGNY Fabrice Française Beaucamps-Ligny M FOUCART François Française Beaucamps-Ligny F GILMANT Claudine Française Beaucamps-Ligny M GUEGAN Julien Française Beaucamps-Ligny F HOUSPIE Karine Française Beaucamps-Ligny F JUMAUCOURT Bernard Française Beaucamps-Ligny F LECHOWICZ Sarah Française Beaucamps-Ligny F LEFEBVRE Catherine Française Beaucamps-Ligny M MAEKER Dominique Française Beaucamps-Ligny M MORCHIPONT Jérôme Française Beaucamps-Ligny M NONQUE Ferdinand Française Beaucamps-Ligny M PERCHE Gautier Française Beaucamps-Ligny M RENARD Ronny Française Beaucamps-Ligny M SCELERS Stéphane Française Beaucamps-Ligny M SEGUIN Antoine Française Beaucamps-Ligny F STAQUET Evelyne Française Beaucamps-Ligny F TALPE Sophie Française Beaucamps-Ligny F TOURBIER Véronique Française -

Département Du Nord Communes D'illies Et Salomé Demande D
Le 21/12/2018 Décision du TA de Lille - Désignation commissaire - n° E18000147/59 du 28/09/2018 Arrêté d'enquête publique unique du 03/10/ 2018 modifié par l'arrêté du 08/10/2018 – Préfecture du Nord Département du Nord communes d'Illies et Salomé Demande d'AUTORISATION d'EXPLOITER d'un entrepôt logistique sur les communes d'Illies et de Salomé présentée par la société PRD ENQUÊTE PUBLIQUE du 05/11 au 29/11/2018 siège de l'enquête : mairie d'Illies CONCLUSIONS ET AVIS commissaire enquêteur: Pierrette MAILLARD 1 2 Projet permis de construire 2 Considérant que le futur projet se situe dans un espace agricole dite plaine des Weppes , le site initial est constitué d' une zone humide, de fossés et des haies discontinues et est longé par le ru La Libaude, dans laquelle se déverse les eaux de ruissellement et pluviales, à proximité se situent quelques habitations ( hameau de Auvillers et 1 habitation sur la RD141), il est éloigné des centres bourgs d'Illies et Salomé d'environ d'1km, il est accolé à la zone d'activités commerciales du hameau des Auvillers se développent à quelques kms le futur parc du « nouveau monde» à La Bassée, la zone industrielle et économique de Billy- Berclau , la future zac d'Herlies : ceux-ci donnant sur les axes RN41 et RN47 , ce projet est lui-même relié par la RD141 à la RN41 et par la RD145 à la RN47, au sud de Salomé se trouve le canal d'Aire sur la Deûle, et à proximité la gare SNCF de Salomé. -

Chretien Du Bois -1
CHRETIEN DU BOIS -1- 2388/4468. CHRETIEN DU BOIS Born 1597 Died before 10 Oct 1655 Married 2389/4469. Born Died Probable children (order of birth unknown): Antoine Du Bois b. d. m. (1) Marie Mesurelles 06 Aug 1653 Mannheim, Germany (2) Jeanne Scipion Farinau 21 May 1661 Mannheim, Germany Isaac Du Bois b. d. m. Known children: Francoise Du Bois b. 17 Jun 1622 d. m. Pierre Billiou 20 Apr 1649 Leiden, Holland Anne Du Bois bapt. 30 Nov 1625 d. m. 1194/2234. Louis Du Bois b. 21 Oct 1626 Wicres, Artois Province, France d. 1696 Kingston, Ulster County, New York m. 1195/2235. Catherine Blanchan 10 Oct 1655 Mannheim, Germany Jacques Du Bois bapt. 27 Oct 1628 Wicres, Artois Province, France d. 1676 Kingston, Ulster County, New York m. Pierronne Bentyn 25 Apr 1663 Leiden, Holland The parents of Chretien Du Bois, a Huguenot who resided at Wicres near Lille in Artois Province, Pas de Calais, France, which is French Flanders, have not been proved but he undoubtedly was related to, perhaps a son of, Wallerand Du Bois and Madeleine de Croix who were married in 1583. Chretien was born in 1597 and died before 10 October 1655. (THE AMERICAN DESCENDANTS OF CHRETIEN DE BOIS OF WICRES, FRANCE, William Heidgerd, Huguenot Historical Society, New Paltz, New York, 1968, partial photocopy from Philip C. Ellsworth, Bethany, OK, 1986.) Wallerand Du Bois was a son of Antoine Du Bois and Philipotte de Landas. Antoine Du Bois was the fifth or sixth generation of the family to be Seigneur de la Bourse, which was near Lille. -

À Pieddans Le NORD À Pieddans Le NORD
10-En bas Flandre 24/06/08 17:14 Page 1 En-Weppes, un nom de famille à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD à particule ! Lille Métropole Lille Métropole o le Balades Balades Le Maisnil eû 6 D a A 25 N 10 l e d en Nord : en Nord : l a Lille Santes n morceaux choisis morceaux choisis a Frounes- C en-Weppes D 41 N 41 Wavrin En Bas Flandre N 41 e Fournes en Weppes, Le Maisnil Mons-en-Pévèle l l i L s Hantay a e D i l la Bassée 1 v l 4 1 (8 km - 2 h 00 à 2 h 40) a e t l N A m 4 : o 7 r n F o i t à Lens a é e r r i C a - t i t l i e u m q Toutes les informations pratiques mentionnées u e « Les Rendez-vous nature » o r F è couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. i Découvrez la faune et la flore du y t n e département grâce aux sorties guidées n a 3 m i Activités et curiosités F C gratuites du Conseil Général du Nord : Fromelles : Musée de la Guerre e c (brochure disponible au 03.20.57.59.59). i r Le Pays de Weppes, quartier de possède une forte identité (03.20.50.60.72). t c a Hantay : Gallodrome au café Tréhoux d l’ancienne châtellenie de Lille, bucolique et paysagère. D’ailleurs Hébergements-Restauration é (03.20.29.05.06). -

Procès-Verbal De La Réunion Du Conseil Municipal Du 26 Novembre 2015
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mairie d’ESCAUDŒUVRES 59161 Tél : 03.27.72.70.70 Fax : 03.27.72.70.92 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 A 19 HEURES Suite à la convocation qui lui a été adressée en date du 19 novembre 2015, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Patrice EGO, Maire. Etaient Présents : MM. EGO Patrice – DOMISE-PAGNEN Gérard – RICHEZ Annick – MORY Nicole – PLATEAU André – EGO Anne-Sophie – ACURCIO Jorge – ROCQUET Marie-Thérèse – COLAU Johann – PEREIRA Fabienne – BRASSART Marie-Josée – CREPIN Régis – QUIEVREUX Monique – OLIVIER Mickaël – LALANDE Réjane – DOISE Pierre – NINET Isabelle – FONTAINE Annick Formant la majorité en exercice, Absents excusés ayant donné procuration : Mme GONCALVES Ernestine a donné procuration à Mme LALANDE Réjane – Mme VANDEVILLE Laëtitia a donné procuration à Mme FONTAINE Annick – M. DUEZ Jean-Pierre a donné procuration à M. DOISE Pierre Absent excusé : M. ROGER René Absent : M. CARDON Raymond Madame MORY Nicole a été élue Secrétaire. 1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil municipal du 25 juin, 22 juillet, 27 août, 19 septembre et 30 septembre 2015 La séance ouverte, Monsieur le Maire demande à l’ensemble des membres du Conseil municipal présents s’ils ont bien été destinataires des procès-verbaux des réunions du Conseil municipal du 25 juin, 22 juillet, 27 août, 19 septembre et 30 septembre 2015 et s’il y a des observations à formuler. Sans observation de la part de la majorité des conseillers présents, Monsieur le Maire déclare les procès-verbaux des réunions du Conseil municipal du 25 juin, 22 juillet, 27 août, 19 septembre et 30 septembre 2015 adoptés à la majorité – 5 abstentions des élus d’une équipe pour gérer. -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -
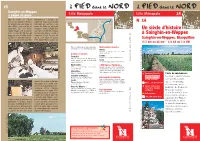
Un Siècle D'histoire À Sainghin-En-Weppes
à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD Sainghin-en-Weppes a sauvé sa peau Lille Métropole Lille Métropole Dans la famille des « petits principalement à fabriquer des No 14 métiers » de Sainghin-en-Weppes, capotes de voiture et des harnais 6 le de la de la eû A 25 de la de la D a les tanneurs sont sans doute les mais aussi des courroies et des l e Lille Lys Lys ld a à la à la plus célèbres – avec peut-être les taquets de filature en cuir pour an à la à la D 41 N 41 C Deûle Deûle briquetiers. En 1841, Pierre l’industrie textile. L’élaboration D 22 Un siècle d’histoire Sainghin- Antoine Floquet crée la tannerie d’un cuir à semelle très résistant, Marquillies D 141 en-Weppes N 41 mais c’est son fils Narcisse qui qui intéressa l’armée, permit à D 22 D 145 à Sainghin-en-Weppes Hantay donne son essor à l’atelier à la fin l’entreprise d’éviter la crise des D 141 la Bassée du XIXe siècle, avant que ne lui suc- années 1930. Dans les années N 47 Sainghin-en-Weppes, Marquillies cède à nouveau son fils Jean Nory 1950, l’atelier Nory se tourne vers Lens (3,5 km ou 11 km - 1 h 10 ou 3 h 00) 3 Toutes les informations pratiques mentionnées Manifestations annuelles couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. Aubers : Sports en Weppes le 31 août Activités et curiosités (03.20.50.63.85). -

Agence Responsable Tél Resp. Port Resp. Tél. Agence Adresse CP Ouverture Agence
Agence Responsable Tél Resp. Port Resp. Tél. Agence Adresse CP Ouverture Agence LILLE CENTRE FENNELL Vincent 03 20 78 54 18 06 22 47 48 57 LILLE Rihour Adj. : MALLET Julie 03 20 78 54 07 06 03 74 47 93 03 20 78 54 54 28 Place Rihour 59000 L au S Adj. : GUFFROY Matthieu 03 20 78 54 12 07 71 32 48 14 LILLE Royale PARISON BENJAMIN 03 20 12 10 31 06 29 21 52 67 03 20 12 10 30 42 Rue Royale (RDC) 59000 M au S HUYGHE Jeremy 03 20 21 91 64 06 03 74 64 49 LILLE Gambetta 03 20 21 91 40 323 Rue L. Gambetta 59000 M au S Adj. : BEUSCART Nicolas 03 20 21 91 45 06 14 73 41 59 LILLE Cormontaigne GONCALVES Bérengère 03 20 22 75 51 06 12 08 60 84 03 20 22 75 50 3 Bld Montebello 59000 M au S LILLE Victor Hugo FERRANT Fanny 03 20 29 85 30 06 12 08 60 98 03 20 29 85 55 2/2 Bis Bld Victor Hugo 59000 M au S LILLE Flandres FENNELL Vincent 03 20 78 54 18 06 22 47 48 57 03 20 78 54 05 28 Place Rihour (3ème étage) 59000 L au V LILLE Nationale REVIDI Benjamin 03 20 78 54 39 07 71 32 48 20 03 20 78 54 34 31 Rue Nationale 59800 M au S LA MADELEINE PERENCHIES BAELDE Alexia 03 20 00 19 81 06 14 07 33 07 03 20 00 19 80 16 Rue de la Prevote 59840 M au S STIEVENART Sandrine 03 20 81 83 10 07 77 25 82 01 CROIX République 03 20 81 83 33 2 Place de la République 59170 L au S Adj. -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2019- Recueil N°10 Du 14 Janvier 2019
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNÉE 2019 – NUMÉRO 10 DU 14 JANVIER 2019 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2019- RECUEIL N°10 DU 14 JANVIER 2019 TABLE DES MATIÈRES CABINET DU PRÉFET - DIRECTION DES SÉCURITÉS Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant sur la composition et le fonctionnement de la commission commu- nale d’accessibilité de DUNKERQUE CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE LOOS SEQUEDIN Décision n°42 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire Décision n°43 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire Décision n°45 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire DIRECCTE DES HAUTS DE FRANCE Décision du 11 janvier 2019 portant affectation des agents de contrôles dans les unités de contrôle et gestion des interims – unité départementale du Nord Lille SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE Arrêté du 10 janvier 2019 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargés de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de LILLE (annexes) – ANNULE ET REMPLACE SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES Arrêté préfectoral du 04 janvier 2019 fixant la composition du bureau de la commission de suivi du site (CSS) de l’établissement GALLOO FRANCE à Halluin Arrêté préfectoral du 04 janvier 2019 donnant acte de la déclaration d’ouverture de travaux miniers de -

Périmètres De Protection Des Captages D'alimentation En Eau
Préfecture du NORD - DDASS du Nord - DRDAF du Nord SITE_179 Périmètres de Protection des Captages d'Alimentation en Eau Potable Liste des Périmètres de Protections concernés par le site Communes concernées ou limitrophes du site Informations transmises à la demande par la DDASS du Nord. CODE_PPC SURF_ha SAISE CODE_INSEE NOM_COM Légende : PPI 0,022 à vue 59005 Allennes-les-Marais Données transmises à titre informatif, ne se substituant pas - Captage & N° BSS PPI 0,026 à vue 59011 Annœullin aux Arrêtés préfectoraux en vigueur (DUP / annexes / plans). PPI = Périmètre de Protection Immédiat PPI 0,018 à vue 59193 Emmerin PPI 0,031 à vue 59266 Gondecourt Sources des données : DDASS 59 / DDAF 59 / BRGM PPR = Périmètre de Protection Rapproché PPI 0,031 à vue 59286 Haubourdin Référentiels cartographiques : PPIGE www.ppige-npdc.fr PPE = Périmètre de Protection Eloigné PPI 0,034 à vue 59304 Herrin (I2G : orthophotoplan 2006 / IGN : Scan25, BD Parcellaire) Saisie & réalisation : DDASS59(CD/JC) & DRDAF(PFY/JPR/FM) Autres sites PPI 0,023 à vue 59316 Houplin-Ancoisne Zonage non ou mal renseigné PPI 0,031 à vue 59437 Noyelles-lès-Seclin Version JANVIER 2009 PPI 0,157 BP 59524 Sainghin-en-Weppes PIG = Projet d'Intérêt Général PPI 0,113 BP 59553 Santes PPI 0,105 BP 59560 Seclin EnglosEnglos PPI 0,109 BP 59648 Wattignies EscobecquesEscobecques SequedinSequedin PPI 0,222 BP 59653 Wavrin LeLe MaisnilMaisnil PPI 0,108 BP 59670 Don PPI 0,126 BP Erquinghem-le-SecErquinghem-le-Sec Erquinghem-le-SecErquinghem-le-Sec PPI 0,066 BP PPI 0,078 BP PPI 0,093 BP LilleLille -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN
G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen .