Le Defi De L Eau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Titre De La Randonnee
TITRE DE LA RANDONNEE: Entre Marly & Chatou; Impressionnisme et hydraulique (19,2 km et 15,5 km) 20/05/2014 CARACTERISTIQUES : Carte IGN: IGN 2214ET - IGN 2314OT Kilométrage longue : 19,2 km courte : 15,5km Responsables : randonnée principale : Patrick ALLUCHON serre-file : Sylvie MARTIN Courte : non prévu mais possible RDV : Chevry7h50 Départ : 8h00 Distance point de départ : 28km Point de départ : entrer dans le parc de Marly par la porte du Roi qui donne sur l’avenue des combattants suivre l’allée jusqu’au Parking Trajet :En sortant du parking CMprendre la D95 jusque Chateaufort. A l’intersection avec la D938 route de Versailles prendre sur la droite. On remonte sur le plateau jusqu’à l’intersection avec la D36 que l’on prend à gauche. Au 4ème rond-point « rond-point des mines » prendre à droite Avenue de l’Europe et continuer jusqu’à la RN10 direction Saint Cyr l’école. Dans Saint Cyr au grand carrefour prendre la D7 rue du Docteur Vaillant en direction de l’aérodrome de Saint Cyr. La D7 passe sous l’autoroute A12 et juste après à l’intersection prendre à droite et continuer la D7 Route de Marly puis route de Saint Cyr. Arrivé près du parc de Marly la route fait un grand virage à droite puis un grand virage à gauche. A la fin du dernier virage on trouve sur la droite la porte du Roi que l’on emprunte pour continuer sur une allée et trouver un grand parking plus loin sur la gauche. DESCRIPTION : 1ersecteur : En quittant le parking prendre l’allée qui mène au socle du château que l’on contourne puis remonter l’allée royale vers le musée promenade. -

LOUVECIENNES (78) Le Domaine Sisley LOUVECIENNES, LE CACHET DE L’OUEST PARISIEN
Nue-propriété LOUVECIENNES (78) Le Domaine Sisley LOUVECIENNES, LE CACHET DE L’OUEST PARISIEN Au cœur des Yvelines, département très côté de l’ouest parisien rassemblant 1,4 million d’habitants, Louveciennes profite d’une situation privilégiée entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, à seulement 15 km de Paris. Pourvue d’espaces naturels couvrant la moitié de son territoire, Louveciennes fut la source d’inspiration de peintres impressionnistes de renom dont Sisley, Renoir et Pissarro, séduits par ses paysages bucoliques. Bordée par la Seine et entourée des forêts domaniales de Louveciennes et de Marly-le-Roi, la ville est recherchée pour son cadre de vie préservé. Chic et résidentielle, Louveciennes est dotée de belles propriétés et d’un patrimoine historique riche : le Château de la Comtesse du Barry, l’Aqueduc de Louveciennes ou encore le Château de Voisins accueillant le centre de formation de BNP Paribas (plus de 1 200 événements organisés chaque année) illustrent parfaitement cet héritage du XVIIème siècle. Ville moderne, Louveciennes s’est munie d’équipements culturels, éducatifs et sportifs de grande qualité et bénéficie d’une vie associative active, répondant aux attentes des habitants. 02 - - Louveciennes - Le Domaine Sisley 1 2 Au cœur des principaux bassins d’emploi d’Île-de-France Alliant proximité avec les principaux bassins d’emploi et qualité de vie élevée, Louveciennes séduit une population hautement qualifiée (près de 25% de cadres) dont le revenu net médian est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Au coeur d’une aire urbaine de niveau mondial, Louveciennes profite pleinement du dynamisme économique du territoire (1,3 million d’entreprises et 5,7 millions d’emplois). -

LOUVECIENNES (78) Entre Versailles Et Saint-Germain-En-Laye
Nue Propriété LOUVECIENNES (78) Entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye Le Domaine Sisley Louveciennes, le cachet de l’ouest parisien Au cœur des Yvelines, département très côté de l’ouest parisien rassemblant 1,4 million d’habitants, Louveciennes profite d’une situation privilégiée entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, à seulement 15 km de Paris. Pourvue d’espaces naturels couvrant la moitié de son territoire, Louveciennes a inspiré des peintres impressionnistes de renom tels que Sisley, Renoir et Pissarro, séduits par ses paysages bucoliques. Bordée par la Seine et entourée des forêts domaniales de Louveciennes et de Marly-le-Roi, la ville est recherchée pour son cadre de vie préservé. Chic et résidentielle, Louveciennes est dotée de belles propriétés et d’un patrimoine historique riche : le Château de la Comtesse du Barry, l’Aqueduc de Louveciennes ou encore le Château de Voisins accueillant le centre de formation de BNP Paribas (plus de 1 200 événements organisés chaque année) illustrent parfaitement cet héritage du XVIIème siècle. Ville moderne, Louveciennes s’est munie d’équipements culturels, éducatifs et sportifs de grande qualité et bénéficie d’une vie associative active, répondant aux attentes des habitants. Le domaine national de Marly-le-Roi, limitrophe de Louveciennes Louveciennes, bordée par la Seine La mairie de Louveciennes Au cœur des principaux bassins d’emploi d’Ile-de-France Alliant proximité avec les principaux bassins d’emploi et qualité de vie élevée, Louveciennes séduit une population hautement qualifiée (près de 25% de cadres) dont le revenu net médian est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. -

Les Systèmes Hydrauliques, Chronologie Des Travaux D'adduction
Le système hydraulique Chronologie des travaux d’adduction Les installations de Clagny Les installations de la Bièvre Le projet de détournement de la Loire Les étangs « gravitaires » La machine de Marly Le canal de l’Eure Autres LES PREMIERES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE VERSAILLES 1639 Le fontainier Claude Denis crée une pompe à proximité de l’étang de Clagny, qui recueille les eaux du ru portant le même nom. Cette pompe, actionnée par un cheval, alimente le jet qui orne la fontaine de la terrasse et les deux autres bassins ponctuant l’axe principal du jardin du château de Louis XIII. CREATION DU SYSTEME HYDRAULIQUE PAR LOUIS XIV 1664 Louis XIV fait perfectionner les installations hydrauliques de l’étang de Clagny : la Tour d’Eau construite par Le Vau remplace la pompe de Claude Denis. Cette tour abrite au rez-de-chaussée une nouvelle pompe, réalisée par l’ingénieur Denis Jolly, et au premier étage un réservoir de plomb, conçu par le fontainier François Francine. Construction d’un réservoir surélevé (580 m3) sous lequel est aménagée, deux ans plus tard, la célèbre grotte de Thétis. 1665 Mise en service de la pompe de Denis Jolly. La pompe, actionnée par deux manèges mus chacun par un cheval, a une capacité de 600 m3 par jour. Elle élève l’eau pompée dans l’étang de Clagny jusqu’au réservoir aménagé au premier étage de la Tour d’Eau (capacité inférieure à 100 m3). Ces installations ne permettent pas le fonctionnement simultané et continu de toutes les fontaines. 1666 François et Pierre Francine complètent les installations de l’étang de Clagny par trois moulins à vent. -

Lettre N°76 (Mai 2018)
MAI / JUIN 2018 - N°76 Vers plus de protection des Sommaire espaces agricoles et forestiers ? 2 Activité du Cadeb Agenda associatif Zone agricole protégée (ZAP) pour la Plaine de Montesson ; clas- sement en "forêt de protection" de la forêt de Saint Germain. Le Cadeb 3 Dernière minute : l’ag- sera toujours présent pour faire entendre la voix de la raison de la pro- glo menacée? tection de nos environnements maraîchers et boisés. Le Vésinet, Marly : des Demandé depuis 2003 par l’association des Amis de la forêt de arbres seront plantés Saint Germain et de Marly, le classement de la forêt est en bonne voie, 4 Le Cadeb reste agréé avec l’annonce de l’enquête publique du 3 mai au 2 juin. La plupart des 78 : Un nouveau préfet grandes forêts péri-urbaines d’Ile-de-France sont déjà des forêts de protection. Ce statut juridique spécifique garantit – pour l’avenir - une St Germain : enquête protection contre les atteintes à la forêt. Toutefois, les associations publique sur la forêt environnementales regrettent qu’il n’y ait pas eu, avant l’enquête pu- 5 L’Etang–la--Ville ne blique, de concertation sur la délimitation des secteurs éliminés de ce veut pas fusionner futur classement. 6 Menaces sur l’abreuvoir La préservation du caractère agricole de la plaine de Montesson de Marly fait désormais consensus. Des protections existent déjà dans les diffé- rents documents d’urbanisme : schéma régional (SDRIF), intercommu- 7 Quoi de neuf à Saint- nal (Scot) et plans locaux (PLU). Près de 200 hectares sont inclus dans Germain-en-Laye? un périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) permettant à la 8 Projet de modification Région d’acquérir des terrains pour les louer à des agriculteurs. -

Le Cadeb Continue Sa Route !
Sommaire Le Cadeb continue sa route ! 2 Activité du Cadeb Agenda associatif 3 Cadeaux de Noël & réduction Le CADEB continue sa route ! des déchets, une union pos- sible ! Le CADEB est profondément heureux d’être de nouveau en mesure de faire paraitre la Lettre du CADEB dont l’importance dans la vie du CADEB n’a cessé 4 Pitié pour les arbres de la Fo- de croître au fil des ans. Notre rédacteur en chef, Jean-Claude Parisot, ayant rêt de Saint Germain en Laye ! pris une retraite bien méritée, nous nous sommes trouvés bien démunis pour 5 Carrière de Gypse des Buttes assurer une succession, ô combien difficile, vu le niveau rédactionnel atteint du Parisis : enquête publique par la Lettre du CADEB. Cependant nous sommes tous profondément attachés complémentaire à continuer l’œuvre de Jean-Claude Parisot, même si c’est plus modestement que nous nous lançons dans l’aventure collective. 6 BEZONS Stade des Berges 7 Demande d’autorisation de Comme annoncé à l’Assemblée Générale de 2019, l’Assemblée Générale du recherches de sites géother- CADEB du 1er octobre 2020 a acté le départ de notre présidente Paulette Men- miques -dit «grand Parc guy. Sa présence rassurante et vigilante nous manquera. A la suite du Conseil Nord» d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été élu, et Emmanuelle Wicquart a accepté de reprendre le poste de présidente. 8 Rencontre avec Ile de France Nous la remercions chaleureusement d’avoir bien voulu assumer ce poste. Le Mobilités nouveau bureau l’entourera et la secondera de son mieux. -

Les Grandes Eaux De Versailles
prés_de_l'hist.xp_fc_16_01 16/01/02 15:04 Page 10 cla Maquettistes:cla(Celine Lapert):292:pp.10_15_présence_de_l'histoire: Les grandes eaux de Versailles PASCAL LOBGEOIS Louis XIV veut sans cesse agrémenter le parc de Versailles de nouveaux bassins et fontaines. Pour trouver les ressources en eau nécessaires, il fait appel à la toute nouvelle Académie royale J. de Givry des sciences. orsque Louis XIV décide d’agran- 1. En 1668, lorsque Pierre Patel exécute dir Versailles en 1661, la tâche à ce tableau, le parc de Versailles compte e accomplir est immense, car il veut déjà plus d’une quinzaine de bassins, dont les premiers Parterres d’eau (a) et la pre- faire du modeste château de mière branche du Grand Canal (b). Pour Lbriques et de pierres légué par son père les alimenter, les ingénieurs du roi ont le symbole de sa puissance. Le jeune roi, construit de nouveaux réservoirs : celui de sur qui les fontaines du château de Vaux- la grotte de Thétis (c) et ceux de l’aile droite le-Vicomte ont fait grande impression, du château (d). Château et parc sont situés veut les surpasser à Versailles, mais les sur un promontoire. On aperçoit la colline lieux sont quasi dépourvus de ressources de Satory (e), franchie par l’eau de la Bièvre. En vignette, l’aqueduc de Maintenon devait en eau. La position dominante du parc transporter l’eau de l’Eure jusqu’à Versailles, sied aux ambitions du souverain, mais mais ce projet pharaonique fut finalement n’est guère compatible avec la domesti- abandonné faute de moyens, à cause de cation de l’élément liquide nécessaire l’entrée en guerre de la France. -

Répertoire Des Sites Impressionnistes En Normandie Et À Paris Île-De-France
CONTRAT DE DESTINATION NORMANDIE – PARIS ÎLE-DE-FRANCE DESTINATION IMPRESSIONNISME Gustave Caillebotte 1848-1894 Berthe Morisot Edgar Degas 1841-1895 1834-1917 Répertoire des sites impressionnistes en Normandie et à Paris Île-de-France Jacques-Sylvain Klein Jean-François Millet Claude Monet 1814-1875 1840-1926 Auguste Renoir Eugène Boudin 1841-1919 1824-1898 Répertoire des sites impressionnistes en Normandie et à Paris Île-de-France Avertissement Ce répertoire communal des sites impressionnistes en Normandie et à Paris Île-de-France a été établi par Jacques- Sylvain Klein, historien de l’art, dans le cadre du Contrat de destination « Normandie - Paris Ile-de-France : Destination introduction Impressionnisme ». Le répertoire est mis à la disposition de tous les signataires du Contrat de destination et, plus largement, de tous ceux qui contribuent à mettre en valeur la destination Impressionnisme. La reproduction des textes est donc autorisée par l’auteur et par les Comités Régionaux de Tourisme de Normandie et de Paris Île-de-France à la condition de la mention suivante : Rien de tel, pour comprendre l’impressionnisme, que de retrouver « Source : Jacques-Sylvain Klein, Répertoire des sites impressionnistes les lieux où le mouvement a pris naissance et où il s’est épanoui, en Normandie et à Paris Île-de-France ». bien avant de se diffuser en France et à travers le monde. Ces lieux mythiques se trouvent essentiellement dans deux régions qu’il La présente version a été actualisée en novembre 2017. est quasi impossible de séparer : la Normandie et l’Île-de-France. Les indications d’œuvres en fin de chaque notice sont les À preuve, le tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant, qui a tableaux que l’auteur a sélectionnés parce qu’ils lui paraissent donné son nom à l’impressionnisme. -

Le Système D'alimentation En Eau Potable Du Smgsevesc
LE SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SMGSEVESC SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD Association des Hauts de Glatigny Versailles Samedi 25 mars 2017 Le SMGSEVESC en quelques chiffres Maitre d’Ouvrage : SMGSEVESC (Versailles Grand Parc et Saint QuentinSOMMAIRE en Yvelines, Cœur de Seine (T4 partiel),…) Délégataire SEOP (Société des Eaux de l’Ouest Parisien /SUEZ), autres 33 communes sur le périmètre du SMGSEVESC (sur les départements 78 et 92) Nombre d’habitants desservis: 450 000 SMGSEVESC Flins- Nombre de clients : 40 000 Aubergenville Le Pecq 1 ressource en eau souterraine: Nappe de Croissy SEPG 1 usine de production de 120 000 m3/j: Louveciennes PARIS 1000 km de réseau de distribution LOUVECIENNES SMGSEVESC 2 I SMGSEVESC - SEOP - Versailles Mars 2017 Un système d’Alimentation en Eau Potable (AEP): 6 étapes 1 2 3 4 5 6 Une ressource Des forages ou Les usines de Un réseau de Des canalisations Des compteurs en eau en une station de production transport et des pour distribuer (intelligents) qualité et en prise en d’eau en rendent l’eau réservoirs pour l’eau potable et communiquent les quantité rivière permettent potable stocker et l’instrumentation index de de prélever l’eau acheminer l’eau qualité et (AAC) consommation afin de l’acheminer et lui donner une pression en vers les usines pression réseau satisfaisante 5 PRODUCTION DISTRIBUTION CLIENTELE Le système AEP + le cycle assainissement forment le petit LE CYCLE DE L’ASSAINISSEMENT (Collecte, épuration et valorisation) cycle -

Lettre N°69 (Janvier 2017)
JANVIER 2017 - N°69 Sommaire L’énergie, le climat et nous Deux associations membres du Cadeb, les Conférences Carrillonnes et 2 Activité du Cadeb Forum et Projets Pour le Développement Durable, ont uni leurs efforts pour présenter une conférence sur un sujet « brûlant » : L’énergie, le climat et Agenda associatif nous ; que pouvons -nous faire ? Philippe Coulon nous a Nous avons été accueillis par M. Jean-Roger Davin, maire de Croissy, et quittés par M. Bernard Grouchko, maire du Vésinet, et vice-président de la commu- nauté d’agglomération, en charge du développement durable. 3 Les restos du cœur ou- vrent à Sartrouville Cet événement, soutenu par la communauté d’agglomération, a rassem- blé 90 personnes à Houilles et 130 personnes à Croissy, venant d’une ving- taine de communes de l’agglomération et au-delà. 4 Une année aux jardins associatifs de Sartrouville Cela témoigne de la force de rayonnement d’une telle initiative. Beaucoup Carrières sur Seine multi- de gens ont envie d’entendre parler du climat, et d’agir utilement. plie ses jardins familiaux Le premier objectif était d’informer tout le monde sur le climat, y compris ceux qui croient ne pas pouvoir comprendre et ceux qui croient déjà savoir, 5 Bougival veut son centre en maniant avec humour et pédagogie les concepts scientifiques. européen de musique Le deuxième objectif était de permettre à chacun de comprendre les en- jeux d’une transition énergétique et de faire émerger des idées et des pro- 6 Produire localement son jets qui permettent de la mettre en place. énergie : c’est possible Voilà pourquoi, à Croissy, la conférence se complétait par des stands, où 7 Environnement en bref l’on pouvait consulter des documents et discuter avec les personnes pré- sentes. -

Rapport Moral Ye 2019
YVELINES ENVIRONNEMENT Association loi 1901 reconnue d’utilité publique Assemblée Générale Rapport Moral pour l’Année 2019 Yvelines Environnement 20 rue Mansart - 78000 Versailles Tél : 01 39 54 75 80 Fax : 01 39 54 61 66 e-mail : [email protected] Sommaire 1 Avant-propos p.5 1-1 Le Grand Paris et les transports p.5 1-2 Point sur les CDT (Contrats de Développement Territorial) p.6 2 Réalisations pendant l’année 2019 p.7 2-1 Cycle d'Education à l'Environnement 2018-2019 « nos amis les aliments de nos saisons » p.7 2-2 Exposition à la Bergerie Nationale p.8 2-3 Journées de formation dans le cadre du Cycle d’Education à l’Environnement 2019-2020 p.8 2-4 Brèves p.8 2-5 Commissions et Comités p.9 3 Dossiers et Commissions suivis par Yvelines Environnement pendant l’année 2019 p.10 3/A – les Dossiers 3-1 La Plaine de Versailles p.10 3-2 L’OIN de Saclay – l’EPAPS p.13 3-3 Conseil Départemental Environnement Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) p.15 3-4 Le Schéma de Services Portuaires d’Ile-de-France – Port Seine Métropole Ouest (PSMO) p.15 3-5 Les conséquences du Schéma Régional Eolien dans les Yvelines p.17 3-6 Le Tram 13 Express p.17 3-7 Le PLUI de GPS&O p.18 3-8 L’avancée du RER E p.19 3-9 Le SPI Vallée de Seine (Secrétariat permanent - Pollutions industrielles) p.19 3-10 CALCIA : projet d’extension de carrière p.20 3-11 Centrale photovoltaïque au sol à Triel-sur-Seine p.20 3-12 Centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Gargenville et Issou (Total) p.22 3-13 Flacourt : Incendie dans un centre de stockage -
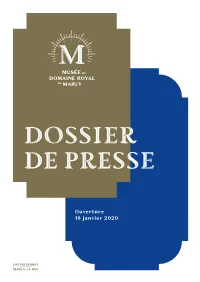
Ouverture 18 Janvier 2020
DosSIER de preSsE Ouverture 18 janvier 2020 LOUVECIENNES MARLY-LE-ROI Som- maire 4 – 5 Un musée intime sur un site historique 6 – 18 Le parcours de visite du musée du Domaine royal de Marly 19 – 22 L’offre culturelle 23 Chiffres-clés 24 Informations pratiques Contacts presse Le mot du président Le 18 janvier 2020, le musée du Domaine royal de Marly ouvre ses portes au public. Enfin… Cet événement était attendu même s’il a pu paraître long à venir après trois ans de fermeture. Cette rénovation n’était pas programmée. Aussi, passée l’urgence du sinistre, le comité syndical s’est engagé dans une démarche de réflexion pour faire évoluer le musée, ouvert en 1982 et à la muséographie datée. L’objectif était ainsi de donner un nouvel élan à cette institution dont le potentiel s’appuie sur un personnage emblématique, Louis XIV, et une situation géographique à l’en- trée d’un parc, à l’orée de la forêt, faisant de cette visite au musée une desti- nation culture et nature. Cette rénovation s’est appuyée sur deux axes : proposer un parcours favori- sant la compréhension et la découverte de Marly et améliorer l’accueil des visiteurs. Marly, c’est à la fois la grande Histoire de par sa création par Louis XIV mais aussi la petite histoire puisque ce château nous raconte la vie plus intime de ce souverain. Le parcours a ainsi été entièrement repensé et étendu. Il met ainsi en lumière les spécificités de cette résidence en contrepoint de Versailles et complète la connaissance des publics sur Louis XIV.