Rapport Phase 1 Furans Gland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
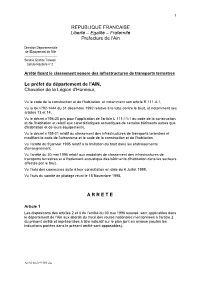
Arrêté Bruit 99 RN.Doc 2
1 REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté – Egalité – Fraternité Prefecture de l'Ain Direction Départementale de l'Equipement de l'Ain ---------------------------------- Service Grands Travaux Cellule Routière n°2 Arrêté fixant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres Le préfet du département de l'AIN, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1, Vu la loi n?92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n?95-20 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, Vu le décret n?95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, Vu l'avis des communes suite à leur consultation en date du 6 Juillet 1998, Vu l'avis du comité de pilotage réuni le 18 Novembre 1998, A R R E T E Article 1 Les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de l'Ain aux abords du tracé des routes nationales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées à titre indicatif sur le plan joint en annexe (seules les indications portées dans le présent arrêté sont opposables). -

1- Rapport- Chazey-Bons
Réf. : Décision du Tribunal Administratif de LYON - N° E19000235 /69 du 12/09/2019 Réf. : Arrêté de M. le Maire de CHAZEY-BONS – N° 58/2019 du 18/11/2019 COMMUNE DE CHAZEY-BONS ENQUÊTE PUBLIQUE TABLE DES MATIÈRES 1 – GÉNÉRALITÉS .......................................................................... 2 1-1 Généralités sur la législation ............................................................................. 2 LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR , SON RAPPORT , SES CONCLUSIONS ET SON AVIS : ............... 4 LE PLAN LOCAL D ’URBANISME – DÉFINITION : ............................................................ 6 1-2 Préambule ...................................................................................................... 7 1-3 Contexte ......................................................................................................... 8 1-4 Objets de l’enquête – Cadre Réglementaire et Technique ................................. 10 1-5 Évaluation environnementale du PLU .............................................................. 16 1-6 Justification des choix d’Aménagement et de Développement ........................... 20 1-7 Mise à Jour du Zonage d’Assainissement ......................................................... 24 2 – CADRE DE L’ENQUÊTE ............................................................ 25 2-1 Contexte Juridique « Élaboration du PLU, Abrogation de la carte Communale et « Modification du Zonage d’Assainissement » ........................................................ 26 2-2 Cadre Juridique « Élaboration du -

Le Journal D'information De Votre Commune
Le Journal d’information de votre commune Bulletin municipal – janvier 2020 . |Chazey-Bons – janvier 2020 Le mot des Maires Ce mot a une connotation particulière pour moi car comme vous le savez, après quatre mandats, dont deux en tant que conseiller et adjoint et deux autres en tant que maire, je ne solliciterai pas un nouveau mandat lors des prochaines élections municipales de mars 2020. Comme je l’ai annoncé début septembre au conseil municipal ainsi que par voie de presse il s’agit pour moi de passer le flambeau aux jeunes générations et permettre un renouvellement nécessaire des instances locales. Ces douze ans à la tête de la commune ont certainement été très prenants mais aussi très enrichissants. De l’extérieur on ne voit et ne retient généralement que l’action liée aux projets qui marquent les grandes réalisations et les choix faits. Mais il y a aussi une partie moins visible qui consiste au fonctionnement administratif au jour le jour d’une commune. Les domaines et sujets à traiter sont très variés, les situations et évènements à gérer sont de toutes sortes, certains heureux, comme les mariages, d’autres plus tristes. Lors de ces douze ans mon action a été guidée par quelques idées directrices qui m’apparaissaient fondamentales pour le devenir de notre commune : x Préparer l’avenir avec des investissements pour le futur, notamment avec une école primaire attrayante et des services périscolaires adaptés, des travaux d’infrastructure permettant l’accueil de nouveaux habitants et le maintien d’une activité économique dynamique. x Engager les services administratifs dans un mode opérationnel moderne et efficace avec un accent mis sur la gestion informatique des services et la suppression des transactions papier chaque fois que possible. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°01-2016-095
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°01-2016-095 AIN PUBLIÉ LE 7 JUILLET 2016 1 Sommaire 01_Pref_Préfecture de l’Ain 01-2016-07-01-005 - Arrêté n°16-135 autorisant l'épreuve dite La magie du Confluent (2 pages) Page 3 01-2016-06-30-008 - Arrêté Préfectoral portant création de la commune nouvelle de Chazey Bons (3 pages) Page 6 01-2016-07-07-001 - Avis de consultation publique AOC Bois du Jura (3 pages) Page 10 01-2016-04-01-006 - Décision de délégation de signature Centre Hospitalier de Belley (4 pages) Page 14 2 01_Pref_Préfecture de l’Ain 01-2016-07-01-005 Arrêté n°16-135 autorisant l'épreuve dite La magie du Confluent 01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2016-07-01-005 - Arrêté n°16-135 autorisant l'épreuve dite La magie du Confluent 3 01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2016-07-01-005 - Arrêté n°16-135 autorisant l'épreuve dite La magie du Confluent 4 01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2016-07-01-005 - Arrêté n°16-135 autorisant l'épreuve dite La magie du Confluent 5 01_Pref_Préfecture de l’Ain 01-2016-06-30-008 Arrêté Préfectoral portant création de la commune nouvelle de Chazey Bons 01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2016-06-30-008 - Arrêté Préfectoral portant création de la commune nouvelle de Chazey Bons 6 PREFET DE L'AIN DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE L'INTERCOMMUNALITE Réf : cne nouvelle de Chazey Bons ARRETE portant création de la commune nouvelle de Chazey-Bons Le préfet de l’Ain Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2113-2 et suivants -

DDE Ain : Permis De Construire, 1979-1990
DIRECTION DEPARTEMENTALE N° du versement DES TERRITOIRES DE L'AIN 547W VERSEMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DE L’AIN Service: SUBDIVISION Bureau: BELLEY-CULOZ Sommaire Art 1-35 : Permis de construire. Métrage linéaire: 1979-1990 Nombre d’articles : 35 Dates extrêmes : 3.50 Lieu de conservation: Archives départementales de l’Ain Communicabilité: libre Mission archives 13/03/2014 page 1/7 N° Analyse Début Fin article 1 Permis de construire : Andert-Condon : 79c88179 Barbe jacqueline. 1979 1979 Arbignieu : 79c87028 Aucourt alain. Armix : 79c87184 Union Rénoise des Centres de Vacances. Cheignieu-la-Balme : 79c87021 Anselmet marcel. 79c87020 Lyet suzanne. 79c88712 Miraillet clément. 79c85322 Bayle jean- louis. Colomieu : 79c87031 Codex marius. 79c88538 Develay roger. Conzieu : 79c87024 Brun christian. 79c87155 Martin michel. 79c86039 Champier jean. La-Burbanche : 79c92568 Thomas georges. 79c88349 Pommerol lucien. 79c91378 France jean-françois. Massignieu-de-Rives : 79c89987 Dujourdy édouard. 79c88970 Compagnie nationale du Rhône. 2 Permis de construire : Magnieu : 79c90804 Poncet fernand. 79c89986 Favre 1979 1979 jean. Peyrieu : 79c91083 commune de peyrieu . Pugieu : 79c89315 Collier pierre. 79c89224 Ruat jacques. 79c89531 Michaud bernard. Rossillon : 79c87202 Carrara jean. 79c92331 Bodin jacques. 3 Permis de construire : Arbignieu : 80c03020 Ortel roger. Brens : 80c03171 1980 1980 Coopérative agricole laitière Bugey. 80c03211 Serra laurent. Cheignieu-la- Balme : 80c03116 Lemoine michel. 80c03152 Revert julien. Colomieu : 80c03206 Quinet m-j. 80c03181 Naudin Elysé. Contrevoz : 80c03121 Jullien christian. Conzieu : 80c03180 Brun christian. Cuzieu : 80c03255 Cellard serge. Marignieu : 80c03218 Lothammer rené. Nattages : 80c03133 Paste alain. Parves : 80c03117 Gasquez joseph. Rossillon : 80c03224 Bouvier marcel. SAINT-Champ-Chatonod : 80c03238 Buillas robert. Virieu-le-grand : 80c90477 Vernay paul. Virignin : 80c23016 ADAPEI. -

Cluse, Toujours Tu M'intéresses
Cluse, toujours tu m’intéresses Par monts et par vaux Bourg-en-Bresse le 28 avril 2016 Portail Ouest de la cluse à Ambérieu-en-Bugey Portail Est de la cluse des Hôpitaux entre Cheignieu et Pugieu L’omniprésence des reliefs calcaires : les karsts D’où viennent ces calcaires ? Une émersion certaine dès - 140 Ma Au Tertiaire et au Quaternaire, différents modes d’érosion ont sculpté les paysages, au gré des variations climatiques passant du tropical au tempéré alterné avec plusieurs glaciations. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est ce qui reste de plusieurs dizaines de millions d’années de morsures érosives, de phénomènes tectoniques, de dépôts variés. La déglaciation selon Guy Montjuvent Une préhistoire riche Un autre biface du portail ouest trouvé à Douvres Racloir moustérien 60 mm La Chênelaz (Hostiaz) Photo Marc Cartonnet La fréquentation par les ours Datations entre 30 000 et 24 000 Les chemins, anciens, sont améliorés et une deuxième voie est mise en place après la conquête romaine sous l’autorité d’Agrippa (63-12), général d’Auguste, entre Lyon et Genève. L’occupation humaine dans la cluse se poursuit, notamment pendant une période insécure entre 260 et 280 (grottes-refuges). St Rambert est fondé durant la période mérovingienne. Son Abbaye et sa crypte dateraient du XIème siècle (pèlerinage). Deux établissements des Hospitaliers étaient dédiés à la charité, aux soins (Les Hôpitaux) Les anciens chemins s’éloignent des crues de l’Albarine tout en reliant les places fortes qui contrôlent et encaissent les taxes. La forteresse de Rossillon et celle de Cornillon sont relayées par un avant-poste plus au contact de la France, au profit de la Maison de Savoie : le château de St Germain devient siège de bailliage après 1355. -

La Rétrospective De La Communauté De Communes Bugey Sud De L'année
Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz • Conzieu • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît • Haut-Valromey • Izieu • La Burbanche • Lavours • Magnieu • Marignieu • Massignieu-de-Rives • Murs-et-Gélignieux • Parves-et-Nattages • Peyrieu • Pollieu • Prémeyzel • RossillonLa lettre • Ruffieu • Saint-Germain-les-Paroisses • Saint-Martin-de-Bavel • Talissieu Valromey-sur-Séran • Virieu-le-Grandde BUGEYSUD • Virignin • Vongnes • Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz# Janvier • Conzieu 2019 • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît • Haut-Valromey • Izieu • La Burbanche • Lavours • Magnieu • Marignieu • Massignieu-de-Rives • Murs-et-Gélignieux • Parves-et-Nattages • Peyrieu • Pollieu • Prémeyzel • Rossillon • Ruffieu • Saint-Germain-les-Paroisses • Saint-Martin-de-Bavel • Talissieu Valromey-sur-Séran • Virieu-le-Grand • Virignin • Vongnes • Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz • Conzieu • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît -

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public De L
RRaappppoorrtt aannnnuueell ssuurr llee PPrriixx eett llaa QQuuaalliittéé dduu SSeerrvviiccee ppuubblliicc ddee ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt nnoonn ccoolllleeccttiiff 22001177 Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr SSOOMMMMAAIIRREE I. Caractérisation technique du service 3 1. Présentation du territoire desservi 3 2. Mode de gestion du service 4 3. Estimation de la population desservie 4 4. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 5 II. Tarification de l’assainissement non collectif 6 III. Dépenses et recettes de service 7 IV. Indicateurs de performance 8 1. Bilan depuis la création du service 8 2. Bilan de l’année 2017 12 2.1. Contrôles de conception 15 2.2. Contrôles d’exécution 16 2.3. Contrôles de diagnostic de l’existant 17 2.4. Contrôles de bon fonctionnement 18 2.5. Contrôles de diagnostic et de bon fonctionnement dans le cadre d’une vente 19 2.6. Certificats d’urbanisme et déclarations préalables 21 2.7. Contre-visites 21 3. Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 21 V. Perspectives pour l’année 2018 22 2 I. Caractérisation technique du service 1. Présentation du territoire desservi La Communauté de communes Bugey Sud a été créée le 1er janvier 2014 par fusion des Communautés de communes Belley Bas-Bugey, Bugey Arène-Furans, Terre d’Eaux et du Colombier et avec extension du territoire à la commune d’Artemare. -

87-SGN-862-RHA.Pdf
RN 504 - CLUSE DBS HOPITAUX RTUPg PES PROTECTI0N8 QONT^g I^g MinU' iwui"' »»' -> iw,pi-iii.,i .n ^....-^i... I , -nil. .,.iii,jiniiii,f BRGM KBOULEMKNTS ROCHgUX 87 SGN 862 RHA SEPTEMBRE 1988 par J.C. BESSON A.M. MALATRAIT BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL Service géologique régional Rhône-Alpes 23, boulevard du 11 -Novembre 1918 - B.P. 6083 - 69604 VILLEURBANNE CEDEX Tél.: 78.89.72.02 - 1 - TABLE DES MATIERES 1 - INTRODUCTION 3 2 - OBJECTIFS DE L'ETUDE ET MOYENS MIS EN OEUVRE 3 3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE MORPHOLOGIQUE 4 4 - CONTEXTE GEOLOGIQUE 7 5 - IDENTIFICATION DES MASSES INSTABLES 8 5.1 - Secteur 1 : Saint-Rambert 9 5.2 - Secteur 2 : Tenay nord 11 5.3 - Secteur 3 : Tenay sud 13 5.4 - Secteur 4 : Pierre-Croisée 18 5.5 - Secteur 5 : Hôpitaux nord 21 5.6 - Secteur 6 : Hôpitaux sud 24 5.7 - Secteur 7 : Burbanche nord 25 5.8 - Secteur 8 : Burbanche sud 27 5.9 - Secteur 9 : Rossillon 29 5.10 - Secteur IC1 : La Balme 30 6 - EXAMEN DES ARCHIVES SNCF 32 7 - DONNES GENERALES SUR LE DIMENSIONNEMENT ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DES PROTECTIONS PROPOSEES 33 7.1 - Purge manuelle 33 7.2 - Grillage plaqué 33 7.3 - Merlon de terre 33 7.4 - Ecrans de filets métalliques 34 8 - CONCLUSIONS 36 Figures dans le texte Fig. 1 - Plan de situation à 1/250.000 5 Fig. 2 - Profil topographique caractéristique 6 Annexes Annexe I - Plan de situation à 1/25.000 Annexe II - Rapport d'expertise : chute de blocs maison Boutin Annexe III - Historique des chutes de rochers sur la ligne Ambérieu-Culoz - 2 PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES (hors texte) Pl. -

Vos Élus De La Chambre D'agriculture De L'ain
Vos élus de la chambre d’agriculture de l’Ain Nicolas André Séverine Copier Catherine Perillat Matthieu Troiano Céréalier-éleveur Viriat Bourg-en-Bresse Porc, céréales, vente Christian Fauvre Joëlle Morandat bovin viande, (SCEA Guillemot) directe Ceyzériat Céréales Foissiat St-Martin-du-Mont St-Jean-le-Vieux (GAEC SN2A) (GAEC de L’Orme) Samuel Pertreux Denis Lorin Stéphanie Artaud-Bertet Bovins lait, AOP Comté, Bourg-en-Bresse Éleveuse laitière, Vieu-d’Izenave Curciat Gilles Brenon Oyonnax (GAEC de la Combe du Val) Sermoyer Dongalon (GAEC du Chatonnax) Vernoux Porc, céréales, vente Vescours directe Jean-Yves Bertschi Hugo Danancher Arbigny Saint- Trivier Courtes St-Martin-Du-Mont Echenevex Alexis Paoli St Bénigne -de-Courtes St-Nizier (GAEC de L’Orme) (EARL des Belles Clies) St-Bénigne le-Bouchoux Beaupont Ceyzériat Chavannes Pont-de-Vaux sur Mantenay Domsure Montlin Reyssouze Reyssouze Servignat Cormoz Vesancy Divonne- Gorrevod St-Jean Lescheroux les-Bains Marie-Dominique Pelus St-Etienne sur St-Julien Coligny Boz sur Reyssouze Pirajoux Mijoux Xavier Fromont Reyssouze Reyssouze GEX St-Didier d’Aussiat Jean-Claude Laurent 361 Ozan Foissiat Bovin Allaitant, céréalier (GAEC de l’Espérance) Asnières/S. Chevroux Bernard Ponthus Izernore Grilly Jayat Salavre Confrançon 69 Béréziat Tossiat (GAEC du Voix) Marboz Villemotier Echenevex Cessy (EARL de Recornet) Manziat Boissey Verjon Sauverny Vésines x Pouillat Bâgé Marsonnas Malafretaz Etrez Versonnex Dortan Crozet Segny la-Ville Dommartin Montrevel Bresse Gontran Benier Feillens Chevry Ornex St -en-Bresse Vallons Bény Cras-sur- Courmangou Germagnat Lélex Thoiry Sulpice Reyssouze t Bâgé-le-Châtel a Arbent St-Didier St-GenisPrévessin St-Laurent Replonges St-Martin Chavannes Ferney- d'Aussiat Sergy Pouilly Moëns / Saône St-André de-B. -

Télécharger Le
Publié au BO-AGRI du MAAF le 16 juillet 2015 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Seyssel » homologué par le décret n°2011-1168 du 22 septembre 2011, modifié par décret n° 2015-835 du 7 juillet 2015, publié au JORF du 9 juillet 2015 CHAPITRE Ier I. - Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Seyssel », initialement reconnue par le décret du 11 février 1942, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de l’indication « molette » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette indication dans le présent cahier des charges. III. - Couleur et types de produit 1°- L'appellation d'origine contrôlée « Seyssel » est réservée aux vins tranquilles et mousseux blancs. 2°- L’appellation d’origine contrôlée «Seyssel » suivie de l’indication « molette » est réservée aux vins tranquilles blancs. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes : - Département de l'Ain : Corbonod et Seyssel ; - Département de la Haute-Savoie : Seyssel. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 26 avril 1944. -

Saint-Germain-Les-Paroisses PLAN LOCAL D'urbanisme
Saint-Germain-les-Paroisses PLAN LOCAL D’URBANISME 1.2- ANNEXE AU RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTUDES DONT RÉSULTENT LES CHOIX D'URBANISME Projet arrêté Projet approuvé par délibération par délibération en date du : en date dudu: : 09 mai 2019 Vincent BIAYS - urbaniste 101, rue d'Angleterre - 73000 CHAMBERY - Tél. : 06.800.182.51 SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES - Annexe au rapport de présentation du PLU - 2018 SOMMAIRE 1- Les structures administratives page 1 1-1- La Communauté de communes Bugey Sud page 1 1-2- Le syndicat à vocation scolaire (SIVOS) page 2 1-3- Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de E-communication de l'Ain (siea) page 2 2- Les documents supra communaux page 3 2-1- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) page 3 2-2- Le Schéma de COhérence Territoriale Bugey page 4 3- Étude démographie et logement page 8 4- Étude de l’économie locale page 10 4-1- Chiffres clefs page 10 4-2- Les entreprises, commerces et services page 10 4-3- L'activité agricole page 11 5- Étude sur les déplacements page 15 5-1- Le réseau viaire page 15 5-2- Le réseau ferré page 15 5-3- Le réseau de transport en commun page 15 5-4- Les déplacements doux page 16 5-5- Inventaire des capacités de stationnement public page 17 6- Inventaire des équipements publics page 18 6-1- Équipements sportifs et de loisirs page 18 6-2- Équipements socio-culturels page 18 6-3- Équipements éducatifs et liés à la petite enfance page 18 7- Étude patrimoniale page 19 7-1- Les bâtiments patrimoniaux page 19 7-2- Les murs et pierres debout page 19 7-3- Le patrimoine vernaculaire page 19 7-4- Le patrimoine classé ou inscrit à un inventaire page 24 7-5- Le patrimoine archéologique page 25 2 SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES - Annexe au rapport de présentation du PLU - 2018 1 LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES La commune adhère à trois structures intercommunales : ■ 1-1- LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BUGEY SUD Source : www.ccbugeysud.com/ Créée au 1er janvier 2014 par fusion des plusieurs communautés de com- munes déjà existantes, la communauté de communes Bugey Sud regroupe 50 communes.