LETTRE DES AMIS N° 130 - 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Page Garde CIZI.Cdr
Commune de Lécussan - Plan Local d’Urbanisme - Cartographie informative des zones inondables Projet de PLU arrêté le : Publicationle : 6-3 Approbation le : - Ingénieurs Conseils Technologies de l’environnement, de l’eau, de l’urbanisme Siège social: 1 rue Dieudonné-Costes Agence Sud-Est: 22 lotissement “Les Oliviers” 82000 MONTAUBAN Mail: [email protected] 13109 SIMIANES-COLLONGUES Tél: 05.63.03.34.42 Fax: 05.63.03.34.56 Découvrez nos activités sur le site www.age-environnement.fr Tél.: 04.42.22.70.79 Fax: 04.42.22.67.67 Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques majeurs naturels et technologiques Nature du risque: inondation - Source: CIZI (Carte Informative des Zones Inondables) D D D D p p p p n n n n n n n n v v v v o o o o f f f f ; ; ; ; M M M M · · · · d d d d v v v v t t t t t t t t b b b b o Zone exposée o o o Limite de commune Source : Fond topographique IGN SCAN 25, 2005 Carte d'aléas : BRGM, Octobre 2003 DDE SRS-mise à jour février 2006 0 1000 m Cartographie informative des zones inondables de Midi-Pyrénées 31 65 BASSIN DU LANNEMEZAN Dépt. de la Dépt. des Haute-Garonne Hautes-Pyrénées Carte I.G.N. 1846 - 2 1 2 3 4 O576 E8 LANNEMEZAN RIVIÈRES ÉTUDIÉES : - GERS - GESSE - LOUGE - SAVE COMMUNES CONCERNÉES : - ARNÉ - BOUDRAC - FRANQUEVIELLE - LÉCUSSAN - MONLONG - PINAS - RÉJAUMONT - SAINT- PLANCARD - TAJAN - UGLAS - VILLENEUVE- LÉCUSSAN arçons - Toulouse g conception et réalisation graphique les - Conduite de l'opération : DIREN de Midi-Pyrénées Cartographie établie par : BETURE-CEREC Édition : novembre 2000 Zones inondables Stations de référence Documents de référence lit ordinaire •• Isle-en-Dodon (Save) Photographies aériennes, mission IGN 1993. -

Contrat « Bourg-Centre » Commune De Lavernose-Lacasse 2019-2021
N° 2019.076 Communauté d'Agglomération Objet : Le Muretain Agglo Contrat « bourg-centre » Commune de Lavernose-Lacasse Département de la Haute Garonne 2019-2021 EXTRAIT DU REGISTRE En exercice : 59 DES Présents : 47 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ Absent excusé : 1 Procurations : 11 Ayant pris part au vote : 58 L'an deux mille dix neuf, le 25 juin à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Thomas, Salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT. Date de la convocation : 18 juin 2019 Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD, DULON, PÉLISSIÉ, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, GRANGÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX- MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, VIEU, COLL, GORCE, BERGIA, ISA A, MORAN, GASQUET, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE. Etait absent : Monsieur COUCHAUX. Pouvoirs : Madame Elisabeth SÉRÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT. Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD. Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA. Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Monsieur Gérard MONTARIOL. Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE. Monsieur Serge DEUILHÉ ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGÉ. Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE. Monsieur Jérôme BOUTELOUP ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP. Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX. Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Étienne GASQUET. Monsieur André MORERE ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAÏA. -

Inventaire Des Zones Humides De La Haute-Garonne Phase 1
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE LA HAUTE-GARONNE PHASE 1: PRE-INVENTAIRE Avril 2013 Opération réalisée avec le concours financier de l'Agence de l'Eau Adour Garonne Inventaire des zones humides de la Haute-Garonne – Phase 1 Conseil général de la Haute-Garonne SOMMAIRE RESUME NON TECHNIQUE A. OBJECTIF --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 B. Zone d’étude ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 C. collecte, synthèse et analyse des données existantes ------------------------------------------------- 2 D. Analyse cartographique -------------------------------------------------------------------------------------- 3 E. Planification de la campagne de terrain en phase 2 --------------------------------------------------- 4 a. Hiérarchisation des ZPT pour les prospections de terrain -------------------------------- 4 b. Hiérarchisation par secteurs ------------------------------------------------------------------- 6 RAPPORT D’ETUDE 1. Contexte général ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.1. Contexte juridique lié aux zones humides ----------------------------------------------- 9 1.2. Objectif de la mission --------------------------------------------------------------------- 10 2. Description de l’aire d’étude ------------------------------------------------------------------------------ 12 2.1. Définition de la zone d’étude ------------------------------------------------------------ -
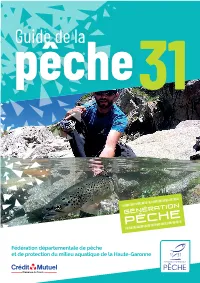
Guide-Peche-2021.Pdf
Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Garonne Plaisance du Touch SOMMAIRE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 4 Quelle carte pour 2021 6 Périodes d’ouverture et tailles légales 8 Comment mesurer un poisson 8 Limitation du nombre de captures 9 Nombre de cannes autorisées 9 Appâts 9 Classement piscicole 10 Heures légales de pêche 11 Modes de pêche prohibés 11 Procès verbaux 12 Réserves et pêches interdites 16 Les écrevisses PARCOURS SPÉCIAUX 18 Parcours spécifiques Μ22 Parcours animations pêche pour enfants 23 Parcours touristique et initiation 24 Parcours détente et initiation AGIR POUR LA PÊCHE 26 Calendriers des lâchers de truites 2021 28 Pêche en barque et float tube 28 Mises à l’eau 29 Pêche en embarcation en Haute-Garonne 30 Les associations de pêche 32 Les Ateliers Pêche Nature (APN) 33 Le pôle animation 31 34 Les dépositaires 38 Les pontons 40 Au service de la pêche 42 La garderie fédérale 44 Guide de pêche 44 Pêches spécialisées 46 Les hébergements pêche A L’INTÉRIEUR CARTE DÉTACHABLE > Réseau départemental > Lacs et plans d’eau > Lacs de montagne > Poster poissons LE MOT DU PRÉSIDENT L’année 2020 avait bien commencé et laissait présager une bonne année halieutique. La crise sanitaire et son train de mesures restrictives, est hélas venue perturber la pratique de notre loisir. Pour faire face à cette situation inédite, nous avons dû nous organiser pour assurer la continuité de gestion de la Fédération tout en respectant les consignes du confinement. Nous avons eu recours au télétravail pour le service administratif et à l’arrêt provisoire du service développement. -

Etat Initial Environnement
1re Couv EIE SCoT Sud Toulousain.ai 1 05/10/2012 11:41:44 2 RÉSENTATION SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE P SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU SUD TOULOUSAIN APPORT DE R ETAT INITIAL ENVIRONNEMENT Document approuvé 29OCTOBRE2012 SCOT SUD TOULOUSAIN Sommaire Positionnement du document dans la démarche SCOT ............................9 Thème 1 : La présentation du territoire...................................................... 11 1. La présentation administrative du SCOT Sud Toulousain .............................11 2. Un relief dissymétrique et façonné par l’eau...................................................14 3. Une géologie qui forme le relief et façonne les sols ......................................17 3.1. Les sols bruns alluviaux .........................................................................................................18 3.2. Les boulbènes ..........................................................................................................................18 3.3. Les terreforts............................................................................................................................18 3.4. Les sols à dominante calcaire des premiers reliefs pyrénéens .....................................19 4. Un climat tempéré influencé par des vents dominants .................................20 5. Un réseau hydrographique dense sur le territoire .........................................21 5.1. Présentation du réseau superficiel......................................................................................21 -

Ripisylve Et Lac Du Four De Louge (Identifiant National : 730030389)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030389 Ripisylve et lac du Four de Louge (Identifiant national : 730030389) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : Z2PZ0258) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Belhacène Lionel (ISATIS), .- 730030389, Ripisylve et lac du Four de Louge. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030389.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Belhacène Lionel (ISATIS) Centroïde calculé : 516341°-1827868° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 20/05/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2010 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Futur Captage D'eau Superficielle En Garonne À Saubens (31) – HTHGAR0004/F – Mai 2019
SIVOM SAGe (Saudrune – Ariège – Garonne) – Avis de l’hydrogéologue agréé sur le futur captage d'eau superficielle en Garonne à Saubens (31) – HTHGAR0004/F – mai 2019 SIVOM SAGe TABLE DES MATIERES Saudrune – Ariège - Garonne 1. PREAMBULE ................................................................................................................ 4 2. INFORMATIONS GENERALES SUR L’ALIMENTATION EN EAU DE LA COLLECTIVITE ......... 5 31120 Roques sur Garonne 2.3.2. Rive gauche ........................................................................................................... 8 2.3.3. Muret et Eaunes .................................................................................................... 8 3. SITUATION DES OUVRAGES ......................................................................................... 9 Futur captage d'eau superficielle en Garonne à 4. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE ...................................................... 11 4.1. Contexte géologique et hydrogéologique ..................................................................... 11 Saubens (31) 4.2. Contexte hydrologique .................................................................................................. 14 5. LES OUVRAGES DE CAPTAGE ...................................................................................... 20 Avis de l’hydrogéologue agréé portant sur les disponibilités en eau, sur les 6. CARACTERISTIQUES ET QUALITE DES EAUX CAPTEES .................................................. 25 7. ENVIRONNEMENT ET RISQUES -
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE Arrêté Cadre Interdépartemental
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale des Territoires Service Environnement, Eau et Forêt Pôle Politiques et Police de l'eau Arrêté cadre interdépartemental portant définition d'un plan d'actions sécheresse pour le sous-bassin de la Garonne Le Préfet de l'Ariège, Le Préfet des Landes Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Le Préfet de l'Aude La Préfète du Lot, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrénées, La Préfète de Lot-et-Garonne, Préfet de la Haute-Garonne, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, Officier de l'Ordre National du Mérite, La Préfète des Hautes-Pyrénées, Le Préfet du Gers, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur, Le Préfet du Tarn Le Préfet de la région Aquitaine, Limousin, Chevalier de la Légion d'Honneur, Poitou, Charentes, Préfet de la Gironde, Le Préfet de Tarn-et-Garonne, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Vu le code de la santé publique, notamment son livre III ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74 ; Vu le code pénal et notamment son livre Ier – titre III ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article -
Notice Explicative
NOTICE EXPLICATIVE SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 2 APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE D'ENSEMBLE 2 HISTOIRE GÉOLOGIQUE 2 DESCRIPTION DES TERRAINS 3 REMARQUES CONCERNANT LE MÉTAMORPHISME DES TERRAINS SECONDAIRES 16 APERÇU TECTONIQUE 17 SPÉLÉOLOGIE - PRÉHISTOIRE 21 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS 22 EAUX SOUTERRAINES 22 MATÉRIAUX DE CARRIÈRES 22 GITES MINÉRAUX ET HYDROCARBURES 23 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 23 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 23 DOCUMENTS ET COLLECTIONS CONSULTABLES . 24 AUTEURS DE LA NOTICE 25 -2- INTRODUCTION APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE D'ENSEMBLE Le territoire de la feuille Montréjeau se situe dans la partie méridionale du Bassin d'Aquitaine, sur la bordure septentrionale de la chaîne des Pyrénées ; il intéresse les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Cette feuille comporte deux régions morphologiquement et géologiquement distinctes. La partie nord correspond au plateau de Lannemezan, vaste surface monotone, vouée à la lande à bruyère, fougère, ajoncs épineux, modelée à partir d'un cône de déjection édifié au Quaternaire ancien d'où rayonnent les reliefs en creux des vallées gasconnes : Baïse, Gers, Gesse, Save, Louge, reflétant la forme conique de l'ancienne surface. Les dépôts du Quaternaire ancien surmontent les assises terrigènes des molasses miocènes qui masquent le substratum plissé pyrénéen dont, seuls, quelques témoins apparaissent à la faveur des entailles des vallées quaternaires. Ces terrains appartiennent pour les uns : à la série plissée sous-pyrénéenne ( Larroque—Lalouret), pour les autres (Campistrous, Villeneuve-Lécussan, Franquevielle) : à la zone nord- pyrénéenne. L'accident frontal chevauchant nord-pyrénéen, qui limite ces deux unités structurales, est masqué par les dépôts post-orogéniques. Séparée du plateau de Lannemezan par le couloir alluvial des vallées de la Neste et de la Garonne dans leurs cours est—ouest, la partie méridionale de la feuille est un pays de moyennes montagnes, très boisées, de morphologie confuse, qui s'étend sur les confins commingeois et bigourdans. -
Section Régionale Midi Pyrénées Lannemezan, 30 Septembre 2016
Journée technique AITF - Section régionale Midi Pyrénées Lannemezan, 30 septembre 2016 La journée technique organisée le 30 septembre 2016 à Lannemezan a réuni 43 participants. En introduction de la journée, Michel ESQUERRE, Président de la section régionale Midi Pyrénées de l’AITF, remercie Gisèle ROUILLON, Première adjointe au Maire de Lannemezan, d’accueillir cette journée technique qui permet à la section régionale de l’AITF de se rapprocher des adhérents sur les territoires de Midi Pyrénées. Il informe de l’élection du nouveau Bureau de la section régionale, dont er Thomas BREINIG assurera la présidence à compter du 1 janvier 2017. AITF Section Midi Pyrénées – Journée technique à Lannemezan, 30 septembre 2016 Lannemezan, une ville au fort dynamisme Gisèle ROUILLON, Première adjointe au Maire de Lannemezan, présente les excuses de Bernard PLANO, Maire de Lannemezan, Conseiller régional, retenu par l’accueil de Carole DELGA, Présidente de Région, en visite sur le site de l’aéroport dont il préside le syndicat Pyrénia. Gisèle ROUILLON présente la Ville de Lannemezan, cité stratégique située sur un plateau entre Tarbes et Toulouse, entre Océan et Méditerranée. Bourg agricole dont le développement s’est fait au XXème siècle, avec l’implantation de la Société des Poudres Azotée, puis Peychinet, à proximité des ressources hydroélectriques. Puis implantation d’un hôpital, d’un arsenal. Pendant la guerre de 1940, les usines tournaient à plein régime, jusqu’à 1200 ouvriers, avec une population atteignant 8 500 habitants. Les crises pétrolières et la réforme des armées ont entrainé un déclin de la Ville. En 1980 création d’un centre pénitentiaire. -

Haute-Garonne Secrete 31 Circuits
HAUTE-GARONNE secrète 31 Circuits découverte Édito Circuit 08 ––––––––––––– 25 Itinéraire tranquille des coteaux Circuit 09 ––––––––––––– 28 Toulouse en rose Pouvez-vous garder un secret ? Sommaire en vert, parcs et jardins Circuit 10 –––––––––––––– 31 Tout le monde sait bien que c’est impossible ! Circuit 01 ––––––––––––––– 4 Des lacs tout en hauteur Circuit 21 ––––––––––––– 64 Un balcon La croisée des chemins Comment garder confidentiels tous les bonheurs qui rendent la vie et un séjour sur les Pyrénées inoubliable ? Circuit 11 –––––––––––––– 34 Circuit 22 Sur les traces de l’or bleu ––––––––––––– 67 “Impossible vous dis-je ! D’autant qu’en Haute-Garonne, les occasions Circuit 02 ––––––––––––––– 7 Les chemins de la liberté de s’émerveiller, de se surprendre, de s’émouvoir ne manquent pas… Au fil de la Garonne Circuit 12 –––––––––––––– 37 Ce guide aux 31 circuits de découverte vous entraîne sur les chemins les plus Nos cathédrales, Circuit 23 ––––––––––––– 70 Circuit 03 –––––––––––––– 10 précieusement préservés que l’on ne conseille qu’aux amis. Alors profitez-en ! nos trésors Assiettes en fête Le canal du Midi, Le Sud-Ouest dans toutes ses splendeurs vous ouvre les bras ! Vous allez un ouvrage-d’exception Circuit 24 ––––––––––––– 74 plonger vos yeux dans l’eau verte du canal du Midi et dans les vastes contrées Circuit 13 ––––––––––––– 40 Autour du grand site Instants fraîcheurs, baignées de soleil du Lauragais. Vous allez découvrir que même en hiver Circuit 04 –––––––––––––– 13 Saint-Bertrand – des lacs et rivières la Haute-Garonne sait bien accueillir ses visiteurs dans les Pyrénées grâce Les cols du Tour Valcabrère à ses stations de Bourg d’Oueil, du Mourtis, de Superbagnères et de Peyragudes de France, Pyrénées Circuit 25 ––––––––––––– 76 Un voyage près où tous les types de glisse sont possibles. -

BULLETIN HYDROLOGIQUE DU BASSIN ADOUR-GARONNE | Synthèse Au 1 Mai 2019
Situation Hydrologique BULLETIN HYDROLOGIQUE Mars et Avril 2019 DU BASSIN ADOUR-GARONNE Synthèse bimestrielle au 1er mai 2019 A l’image du mois de février, les précipitations du mois de mars sont faibles sur la quasi-totalité du bassin. En revanche, le mois d’avril 2019 est marqué par des épisodes pluvieux répétés, apportant toutefois des quantités d’eau modérées sur la majeure partie du bassin. Globalement, sur la période de novembre 2018 à avril 2019, les cumuls pluviométriques affichent des déficits de 10 à 20 % sur la majorité du bassin. Pour les nappes libres du bassin, la pluviométrie d’avril n’a pas permis de compenser la sécheresse de fin février et de mars, ainsi que la recharge hivernale 2018-2019 moyenne. Ainsi, les niveaux piézométriques sont orientés à la baisse depuis le mois de mars et sont modérément bas sur l’ensemble des grands aquifères du bassin. En raison des faibles précipitations sur la majorité du bassin et de la fonte modérée du manteau neigeux, les débits des cours d’eau sont faibles et en baisse tout au long du mois de mars. Ils reprennent un peu d’intensité en avril sous l’effet des pluies modérées. L’hydrologie générale est déficitaire en mars comme en avril sur la quasi-totalité du bassin (98 % des stations de mesures). Les situations les plus tendues concernent les sous-bassins de l’Adour, du Tarn-Aveyron et l’axe Garonne au mois de mars, et les axes Garonne amont-Ariège au mois d’avril. En effet, les débits moyens mensuels sont caractérisés par des périodes de retour supérieures ou égales à 10 ans secs pour 53 % des stations en mars et 32 % des stations en avril.