Predicatio Ac Retributio. L'espagne Et Le Portugal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mistaken Identity: Is Cephas Peter
JBS 3/3 (October 2003) 1-20 A QUESTION OF IDENTITY: IS CEPHAS THE SAME PERSON AS PETER? James M. Scott The question whether the Cephas of Galatians 2.11 is Peter arose at least as early as tHe second century witH Clement of Alexandria.1 Because Paul HarsHly reprimands and corrects Peter in this passage, antagonists of the Church have found this scene crucial in attacking tHe Petrine primacy and infallibility. In 1708 Jean Hardouin, a French Jesuit, wrote his apologetic Dissertatio: In Qua Cepham a Paulo Reprehensum Petrum Non Esse Ostenditur (An Examination in Which It Is Demonstrated that Cephas Rebuked by Paul Is not Peter), arguing that this Cephas was not Peter the apostle. The Dissertatio, intended only for a friend’s reading, curiously ended up in print a year later as a small end-piece witHin Hardouin’s ponderous Opera Selecta.2 Although the Dissertatio is largely unknown due to so much of Hardouin’s corpus placed on the Index, this work nevertheless makes a significant contribution to the Cephas/Peter debate. That Hardouin assuredly Had tHe most bizarre literary tHeories and motivations ever expressed by a prominent scholar adds further interest and import to his argument. 1Eusebius (Eccles Hist, 1.12.2) says tHat Clement raised tHis question in His Hypotyposes 5. THe remaining fragments of tHis work do not include tHis passage. 2Jean Hardouin, “Dissertatio in Qua Cepham a Paulo RepreHensum Petrum non Esse Ostenditur,” Opera Selecta (Amsterdam: J. D. DeLorme, 1709). 1 JOURNAL OF BIBLICAL STUDIES I. THE IDEOLOGY OF JEAN HARDOUIN, S.J. -

A Few Remarks on the Ancient History of the City of Hadrumetum
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 7 Ser. II || July 2020 || PP 66-77 A few remarks on the ancient history of the city of Hadrumetum Jaroslaw Nowaszczuk University of Szczecin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Date of Submission: 14-07-2020 Date of Acceptance: 29-07-2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- I. INTRODUCTION Soussa (or Sousse), a city located on the Tunisian coast of the Mediterranean Sea, is mostly known as a tourist destination. Apart from enjoying excellent weather and mild climate which is characteristic of this area, visitors can see historical objects testifying to the former magnificence of the entire region. Many artefacts have been collected in an archaeological museum. The Christian catacombs are also a peculiarity with an ancient origin. To a present day traveller, the north–African location seems to be quite exotic because of the differences that exist between the commonly adopted habits and religions. It has been truly surprising to discover that Hadrumetum – as the city was called at that time – was embraced in the ancient times, as part of the great Roman Empire, by the same culture as Europe. Furthermore, events which have gone down in history took place there. The purpose of this article is to present some of them in a diachronic manner. GEOGRAPHICAL RESEARCH Distant Beginnings Gaius Sallustius Crispus, a Roman politician and historiographer in the times of Julius Caesar, states in his description of a war with Jugurtha, a Numidian king, that Phoenicians built several cities on the coast of Africa. -

Anne Le Fèvre Dacier in America Volker Schröder
Anne Le Fèvre Dacier in America Volker Schröder To cite this version: Volker Schröder. Anne Le Fèvre Dacier in America. 2020. halshs-02917300 HAL Id: halshs-02917300 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02917300 Submitted on 18 Aug 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Anne Le Fèvre Dacier in America | Anecdota 8/15/20, 10)55 AM Anecdota Rare texts and images from early modern France Anne Le Fèvre Dacier in America Information This entry was posted on VS August 11, 2020 by VS in Autographs, Biography, Correspondence. About The summer of 1720 in France brought not only an outbreak of bubonic plague in Marseille and the economically disastrous bursting of John Law’s Mississippi bubble, but also the death of the classical scholar and translator Anne Le Fèvre Dacier. The Shortlink daughter of Tanneguy Le Fèvre (an illustrious professor of Greek) and the wife of André https://wp.me/p8rKtd-kw Dacier (her father’s favorite student), “Madame Dacier” enjoyed international fame and was considered “the Learnedst Woman in Europe.”1 On the occasion of the tercentenary Navigation of Anne’s passing, here are some autograph letters found in American collections that Previous post illustrate her life and literary achievements. -

Two Crises of Historical Consciousness1 by Peter Burke
1 Two Crises of Historical Consciousness1 By Peter Burke Is it possible to know the past? Is it possible to tell the truth about ‘what actually happened', or are historians, like novelists, the creators of fictions? These are topical questions in the 1990s, both inside and outside the historical profession, though they are questions to which different people offer extremely diverse answers. Some people would describe the present situation as one of epistemological ‘crisis'. If the term ‘crisis' is employed in a precise sense, to refer not to any period of confusion but to a short period of turmoil leading to a major or structural change, then it may still be a little too early to say whether we are passing through a crisis or not. We would have to be out of the crisis before we knew that we had been in one. However, the turmoil is obvious enough, and it has led, as crises generally do, to a number of calls for `rethinking history'. One purpose of this article is to suggest that it would be unwise to study the philosophy or theory of history (in the sense of reflections on the purpose and method of historical writing), in isolation from the study of historiography. After all, the topical questions listed in the preceding paragraph are not new questions. They were being discussed with at least equal anxiety, excitement and irritation in the late seventeenth century. In order to put late twentieth-century problems `in perspective', as historians like to say, and to achieve a certain detachment, this article will begin by describing and analysing the seventeenth-century version of this debate on historical knowledge. -

Downloaded from Brill.Com09/25/2021 09:01:50AM Via Free Access
chapter 11 Distinctive Contours of Jesuit Enlightenment in France Jeffrey D. Burson Due largely to their persecution of more radical strains of Enlightenment that emerged from Diderot’s editorship of the Encyclopédie, many historians have too commonly neglected the important contributions of French Jesuit scholars to eighteenth-century culture. The distinctiveness of French Jesuit contribu- tions to scholarship during the century of Enlightenment is the subject of this chapter. This chapter also emphasizes some of the ways in which the radical- ization of the eighteenth-century French siècle de lumières—specifically its strains of atheism and materialism—were ironically shaped, however acciden- tally and indeed unintentionally, by debates already well underway among Jesuit intellectuals themselves.1 Accordingly, this chapter participates in a broader trend, evident among church historians as well as intellectual histori- ans, of restoring agency to Jesuit writers in helping to forge the scholarly milieu from which emerged the wider European Enlightenment, even if the Jesuit contribution to the Enlightenment is often ironic in that many philosophes subverted the original impetus for Jesuit scholarship. This chapter also partici- pates in scholarly conversations sparked in various ways by historians Alan C. Kors, Ann Thomson, and Margaret C. Jacob whose work situates the origins of Enlightenment radicalism in France, not strictly within a supposedly Spinozan atheism but rather within a more complex dialogue among theologians, scien- tists, and lay writers throughout Western Europe.2 1 The standard work on the Jesuit contributions to the Enlightenment remains Robert R. Palmer, Catholics and Unbelievers in Eighteenth-Century France (Princeton, nj: Princeton University Press, 1939); Dale K. -

Godfather to All Monkeys: Martin Folkes and His 1756 Library Sale George Kolbe
Godfather to All Monkeys: Martin Folkes and His 1756 Library Sale George Kolbe I acquired several engravings from David Edmunds around 1980 in Lon- don, all depicting the famous English numismatist, antiquary, mathema- tician, and astronomer Martin Folkes (1690–1754). These prints were finely engraved by Folkes’s contemporary, the celebrated painter and engraver William Hogarth. I kept and subsequently framed one of the engravings, sold one to a friend, and disposed of the remainder under circumstances unremembered. In 2013, the portrait was brought to life in a manner when I acquired, from Douglas Saville, the 1756 Catalogue of the Entire and Valuable Library of Martin Folkes, Esq. At the base of the title, “Price Sixpence” is printed, along with the notice that “Catalogues to be had at most of the considerable Places in Europe, and all the Booksellers of Great Britain and Ireland.” Though apparently printed in large numbers, my bookseller colleague rather shamelessly charged me considerably more than original issue price for the catalogue. In truth, the price paid was reasonable and the informa- tion derived has made it a bargain. It is hoped that the article presented here, despite its unseemly length, will provide the reader some fraction of the enjoyment I experienced from studying the catalogue. The auction sale was scheduled “By Samuel Baker, At his House in York-Street, Covent Garden, To begin on Monday, February 2, 1756, and to continue for Forty Days successively (Sundays excepted).” It is an octavo volume, 8 by 5 inches, comprising 156 pages with descriptions of 5126 lots. Following the title is a page comprising the “Conditions of Sale” which, if impossibly brief in today’s litigious world, nonetheless covered all the basics in a sensible manner. -
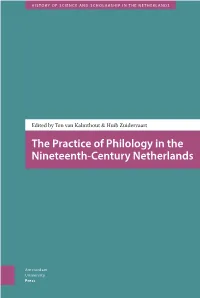
The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands
HISTORY OF SCIENCE AND SCHOLARSHIP IN THE NETHERLANDS HISTORY OF SCIENCE AND SCHOLARSHIP IN THE NETHERLANDS Edited by Van Kalmthout & Zuidervaart Van by Edited This volume offers a new perspective on the development of philology in Dutch scholarly culture of the nineteenth century. Until that period, this field of the humanities had far reaching implications on disciplines such as theology, chronology, astronomy, history, law and other domains of knowledge. Several fundamental changes occurred during the nineteenth century. Texts in the vernacular and national perspectives attracted attention; comparative approaches were introduced and several subfields grew into more-or-less independent (sub)disciplines in the humanities. This complex, but fascinating process of differentiation, specialization and professionalization redesigned the landscape of philology radically. Ton van Kalmthout and Huib Zuidervaart are senior researchers at the Huygens Institute of the Royal Dutch Academy of Arts and Science in The Hague. Nineteenth-Century Netherlands in the of Philology Practice The Edited by Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands ISBN: 978-90-8964-591-3 AUP.nl 9 789089 645913 The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands History of Science and Scholarship in the Netherlands, volume 14 The series History of Science and Scholarship in the Netherlands presents studies on a variety of subjects in the history of science, scholarship and academic institutions in the Netherlands. Titles in this series 1. Rienk Vermij, The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750, 2002, isbn 90-6984-340-4 2. Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas Haus. -

H-France Review Vol. 11 (February 2011), No. 60 Jeffrey D. Burson
H-France Review Volume 11 (2011) Page 1 H-France Review Vol. 11 (February 2011), No. 60 Jeffrey D. Burson, The Rise and Fall of Theological Enlightenment: Jean-Martin de Prades and Ideological Polarization in Eighteenth-Century France. Foreword by Dale Van Kley. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2010. xxiv + 494. Notes, bibliography, and index. $55.00 US (cl). ISBN 978-0-268-02220-4. Review by Alan Charles Kors, University of Pennsylvania. Jeffrey Burson’s rigorous study of the intellectual, institutional, and, in the end, cultural and political history of “the Prades affair” (1751-1752, with long-lasting effects) is an important contribution to the history of the French Catholic Church, of the Enlightenment of the philosophes, and of the ancien régime. In 1751, the Faculty of Theology at the University of Paris unanimously passed the doctoral thesis of the abbé Jean-Martin de Prades, which focused primarily though not exclusively on how and with what evidence one proved the truth of the Christian Revelation. The approval of the thesis occurred at the worst possible moment for Prades (who had contributed articles to Diderot’s Encyclopédie). It intersected fierce Jesuit-Jansenist rivalries, mounting Jesuit hostility toward Diderot’s Encyclopédie, tension between the parlement de Paris and the university, and a phase of crisis in royal-ecclesiastical relations. Prades’s thesis became a pawn in a complex set of struggles, and its initial approval by Prades’s examining committee occasioned crises at the Sorbonne (the Faculty of Theology in Paris), throughout the hierarchies of the Church and state, dramatically altering, in Burson’s view, the course of Catholic apologetics and of Catholic intellectual relationships to the Enlightenment. -

Una Questione Transculturale
QUADERNI CULTURALI IILA numero #due LA RAPPRESENTAZIONE DEL CIBO LATINOAMERICANO Una questione transculturale iila QUADERNI CULTURALI IILA numero #due LA RAPPRESENTAZIONE DEL CIBO LATINOAMERICANO Una questione transculturale iila Indice PREFAZIONE 5 Rosa Jijón INTRODUZIONE Chiara Stella Sara Alberti & Cristóbal F. Barría Bignotti Cucinare, mangiare, digerire: rappresentazioni del cibo latinoamericano in un contesto globale 7 Cocinar, comer y digerir: representaciones de la comida latinoamericana en un contexto global 15 SEZIONEI: MANGIARE Bananas: representaciones antagónicas en América Central y Estados Unidos 25 Rafael Climent-Espino Corn, Pope Leo X, and the New World in Giovanni Della Robbia’s Temptation of Adam and Eve 39 Barnaby Nygren SEZIONEII: CUCINARE Comida y sociedad: breve análisis de los libros de recetas mexicanos del siglo XIX 55 Adele Pia Villani La estética mexicana de la alimentación como sometimiento y liberación. De la Colonia a la Revolución 67 Alejandra Ortiz Castañares The contribution of Italian immigrants to the iconography of Brazilian Modernism: building national identity through the depiction of food 83 Claudia Mussi Torstillera in space and time: a Mesoamerican staple in colonial and contemporary art 101 Sheila Scoville SEZIONEIII: DIGERIRE ¿A qué sabe la cocina cubana traducida? 115 Stefano Tedeschi Lo que en la carne se conserva: identidad y patrimonio en Sudamérica en torno al corned beef 129 Eric Javier Markowski GLI AUTORI 141 Prefazione ell’agosto del 2018 abbiamo inaugurato la linea editoriale Quaderni Culturali IILA (Cua- dernos Culturales IILA) della Segreteria Culturale IILA. Il volume che ha aperto questo Nprogetto, un numero zero che ha raccolto gli atti del seminario internazionale“Cultura e sviluppo: una prospettiva italo-latinoamericana”, organizzato dall’IILA nel novembre del 2017 nel quadro delle celebrazioni per i 50 anni dell’Organizzazione, è stato il preludio di una serie di pubblicazioni monografiche con cadenza periodica. -

4. Veritas Filia Temporis
1 CHAPTER 4: VERITAS FILIA TEMPORIS Reading the minds of the people of the past may seem an impossible task. Yet this is exactly the sort of conjuring act the historian is asked to perform in any study of the effects of the information trade in early modern times. Fortunately, for the argument we have been advancing here, there is no need to read the minds of all readers; nor even a majority of them. We are only interested in the most attentive and vociferous of observers, those more or less close to the cultural elite, whose views were heard and heeded. 1 How many of these seventeenth- century observers worried that the newsletters appeared to be concocted from malicious gossip? How many worried that the newspapers just might be published at the bidding of powerful political interests with little inclination to tell the truth? And how many worried that histories of recent events might be based on faulty sources even when the writers endeavored to procure faithful accounts? Among those whose views have been recorded, our evidence suggests that few had any illusions about the reliability of political information imparted by the sources newly minted or voluminously increased during the course of the century. Nor did the information specialists themselves offer much in the way of a defense. In admitting that "truth is by nature elusive and slippery," Agostino Mascardi, the history theorist, could recommend nothing better to exculpate the inaccurate 2 historian than the injunction against throwing the first stone. But "omnis homo mendax," the phrase attributed to King David, was likely to offer readers little more in the way of consolation than the reminder that "those who are such harsh critics of historians' involuntary lies may well be astute trammelers of perfidy and deceit in their own lives." 2 Mascardi had no answer about historians who deliberately distorted the truth. -
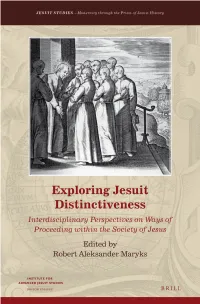
Exploring the Distinctiveness of Neo-Latin Jesuit Didactic Poetry in Naples: the Case of Nicolò Partenio Giannettasio 24 Claudia Schindler
Exploring Jesuit Distinctiveness <UN> Jesuit Studies Modernity through the Prism of Jesuit History VOLUME 6 The Boston College International Symposia on Jesuit Studies VOLUME 1 Edited by Robert Aleksander Maryks (Boston College) Editorial Board James Bernauer, S.J. (Boston College) Louis Caruana, S.J. (Pontif icia Università Gregoriana, Rome) Emanuele Colombo (DePaul University) Paul Grendler (University of Toronto, emeritus) Yasmin Haskell (University of Western Australia) Ronnie Po-chia Hsia (Pennsylvania State University) Thomas M. McCoog, S.J. (Fordham University) Mia Mochizuki (New York University Abu Dhabi and Institute of Fine Arts, New York) Sabina Pavone (Università degli Studi di Macerata) Moshe Sluhovsky (The Hebrew University of Jerusalem) Jeffrey Chipps Smith (The University of Texas at Austin) The titles published in this series are listed at brill.com/js <UN> Exploring Jesuit Distinctiveness Interdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus Edited by Robert Aleksander Maryks Published for the Institute for Advanced Jesuit Studies at Boston College LEIDEN | BOSTON <UN> This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-NonDerivative 3.0 Unported (cc-by-nc-nd 3.0) License, which permits any noncommercial use, and distribution, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Cover illustration: “Iuvenes ex Academia Parisiensi novem eligit, ac socios consilii sui detinat” ([Ignatius] chooses nine young men from the University of Paris and makes them companions of his project). Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu fundatoris (Rome, 1609), plate 39. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Maryks, Robert A., editor. -

Introduction: the Culture of Jesuit Erudition in an Age of Enlightenment
Georgia Southern University Digital Commons@Georgia Southern History Faculty Publications History, Department of 8-22-2019 Introduction: The Culture of Jesuit Erudition in an Age of Enlightenment Jeffrey D. Burson Georgia Southern University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/history-facpubs Part of the History Commons Recommended Citation Burson, Jeffrey D.. 2019. "Introduction: The Culture of Jesuit Erudition in an Age of Enlightenment." Journal of Jesuit Studies, 6 (3): 387-415: Brill. doi: https://doi.org/10.1163/22141332-00603001 https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/history-facpubs/104 This article is brought to you for free and open access by the History, Department of at Digital Commons@Georgia Southern. It has been accepted for inclusion in History Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons@Georgia Southern. For more information, please contact [email protected]. journal of jesuit studies 6 (2019) 387-415 brill.com/jjs Introduction: The Culture of Jesuit Erudition in an Age of Enlightenment Jeffrey D. Burson Georgia Southern University [email protected] Abstract Although works on religious, specifically Catholic, and more specifically Jansenist, contributions to the Enlightenment abound, the contributions of the Jesuits to the Enlightenment have remained relatively unexplored since Robert R. Palmer initially identified affinities between Jesuit thought and the emergence of the French Enlight- enment as long ago as 1939. Accordingly, this introduction and the essays contained within the pages of this special issue revisit and further explore ways in which the individual Jesuits contributed to broader patterns of European intellectual and cul- tural history during the age of Enlightenment.