Scénario Tendanciel SAGE Dropt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fiche Synoptique-GARONNE-En DEFINITIF
Synopsis sheets Rivers of the World The Garonne and the Adour-Garonne basin The Garonne and the Adour-Garonne basin The Garonne is a French-Spanish river whose source lies in the central Spanish Pyrenees, in the Maladeta massif, at an altitude of 3,404 m. It flows for 50 km before crossing the border with France, through the Gorges du Pont-des-Rois in the Haute-Garonne department. After a distance of 525 km, it finally reaches the Atlantic Ocean via the Garonne estuary, where it merges with the river Dordogne. The Garonne is joined by many tributaries along its course, the most important of which are the Ariège, Save, Tarn, Aveyron, Gers, Lot, and others, and crosses regions with varied characteristics. The Garonne is the main river in the Adour-Garonne basin and France’s third largest river in terms of discharge. par A little history… A powerful river taking the form of a torrent in the Pyrenees, the Garonne’s hydrological regime is pluvionival, characterised by floods in spring and low flows in summer. It flows are strongly affected by the inflows of its tributaries subject to oceanic pluvial regimes. The variations of the Garonne’s discharges are therefore the result of these inputs of water, staggered as a function of geography and the seasons. In the past its violent floods have had dramatic impacts, such as that of 23 June 1875 at Toulouse, causing the death of 200 people, and that of 3 March 1930 which devastated Moissac, with around 120 deaths and 6,000 people made homeless. -
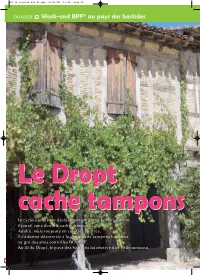
Week-End BPF* Au Pays Des Bastides
22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 22 DOSSIER Week-end BPF* au pays des bastides LeLe DroptDropt cachecache tamponstampons Le cyclotouriste est décidément un grand enfant. Gamin, ilil jouaitjouait sanssans doutedoute àà cache-tampons.cache-tampons. Adulte, mais toujours en culottes courtes, ilil s’adonnes’adonne désormaisdésormais àà lala chassechasse auxaux tamponstampons humideshumides au gré des sites contrôles BCN-BPF**.. Au fil du Dropt, le pays des bastides lui réserve une belle moisson. 22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 23 DOSSIER PRÉPARÉ PAR JEAN-LOUIS ROUGIER ss Une image typique des bastides. Ici, les couverts de Labastide-d'Armagnac dans le Gers. Beautru © Gérard * Brevet des provinces françaises. Brevet permanent des plus beaux sites de France, organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix du participant (voir Guide du cyclotouriste, pages 52-53). Juin 2009 23 Cyclotourisme 581 22_31_dossier_sld_V6.qxd 25/05/09 17:10 Page 24 DOSSIER Week-end BPF au pays des bastides Le Dropt à l’essai © Jean-Louis Rougier Long de 132 kilomètres, le Dropt visite trois départements : Dordogne, Lot-et-Garonne et Gironde. Il naît à Capdrot, non loin de Monpazier, pour se jeter dans la Garonne à Caudrot, en aval de La Réole. © Jean-Louis Rougier Montpazier. ous vous proposons de parcourir Monpazier, Villeréal et Duras. Trois petits des dizaines d’autres à vous offrir l’ombre de cette région avec le Dropt pour fil parcours pour un grand week-end BPF au leurs couverts ou de leur halle et l’éclat de rouge, en parcourant trois itinérai- pays des bastides. -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Lancement De La Consultation Du Public Sur Le Renforcement De La Coordination Des Mesures De Gestion De La Sécheresse Sur Le Bassin Adour-Garonne
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Toulouse, le 18 mai 2021 Lancement de la consultation du public sur le renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne La consultation du public sur l’arrêté relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne est ouverte au public du 12 mai 2021 au 2 juin 2021. Pourquoi cet arrêté ? L’importance de la sécheresse 2019, a fait l’objet d’un retour d’expérience conduit par le Conseil général de l’environnement et du développement durable dont les principales orientations ont été traduites dans un courrier circulaire du ministère en charge de l’ Écologie du 23 juin 2020. Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, préfet coordonnateur de bassin, doit prendre un arrêté d’orientation pour la gestion de crise sur l’ensemble du bassin, identifiant, entre autres, les zones d’alerte nécessitant une coordination interdépartementale ainsi que les conditions de déclenchement et mesures harmonisées. Contenu de cet arrêté ? Trois grandes pistes d’harmonisation de la gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne sont développées dans cet arrêté : 1. Le renforcement de l’articulation entre les échelles de pilotage départementales et par bassin versant à travers : des arrêtés-cadre interdépartementaux pour les grands sous-bassins (Lot, Dordogne, Garonne, Lèze, Arize, Ariège, Hers Vif, Dropt, Tarn, Aveyron, Neste et rivières de Gascogne, Cogesteau, Saintonge, Karst de la Rochefoucauld, Adour, Gaves) pilotés par un préfet référent ; des arrêtés-cadre départementaux décrivant la gestion coordonnée mise en place entre départements limitrophes sur les petits bassins interdépartementaux. -

Bureau De La CLE 18 Décembre 2019
BUREAU DE LA CLE COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2019 HOTEL DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE(TOULOUSE) Étaient présents : BEAUJARD Mathieu (SAGE – animateur zones humides – SMEAG), BOUSQUET Bernard (ADEBAG - CCI Occitanie), CADORET Vincent (Chef de projet SAGE Garonne – SMEAG), COMBRES Maryse (Représentant le SMEAG - Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine), DOUCET Frédéric (DDT Lot-et-Garonne), GUYOT Loïc (Responsable de l’Observatoire Garonne – SMEAG), JAQUEMET Laurence (Conseil départemental de la Haute-Garonne), JENN Jean-Pierre (France Nature Environnement – ANPER-TOS), LACOURT Marie-Thérèse (Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie), L’HOSTIS Aurélia (UFBAG), LOUIS Olivier (SEEF - Direction Départementale des Territoires de la Haute- Garonne), MAUREL François (EDF), PEYRAT Charles (Conseil Départemental d’Ariège), ROCHE Daniel (SAGE Eau-Aménagement-Urbanisme - SMEAG), SEIGNEUR Éléonore (DREAL Occitanie), SIMONIN Charlotte (Avocate, Cabinet DPC), SUAUD Thierry (Président de la CLE, Conseiller régional Occitanie), TRÉBUCHON Maxime (SAGE Charte Garonne et confluences – SMEAG), VINCINI Sébastien (Conseiller départemental de la Haute-Garonne). Étaient excusés : Communauté de Communes Cœur et Côteaux du Comminges, Conseil Départemental du Gers, Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne, Mairie de Fourques-sur- Garonne), AADPPED, Toulouse Métropole Cette réunion avait pour ordre du jour : 1- Calendrier pour l’approbation du SAGE 2- Conclusions de l’enquête publique et consolidation du projet de SAGE en réponse à la réserve et aux recommandations de la commission d’enquête 3- Avis du Bureau pour présenter le projet de SAGE pour adoption à la CLE 4- Questions diverses : actions 2020 Thierry SUAUD (Président de la CLE) accueille les participants et les remercie de leur présence. La séance plénière de la CLE aura lieu le 13 février 2020. -

Arrêté Interpréfectoral N°47-2021-01-07-007 Déclarant D’Intérêt Général Et Autorisant Le Programme De Travaux Pluriannuel De Gestion Du Bassin Versant Du Dropt Aval
Direction départementale des territoires Arrêté Interpréfectoral n°47-2021-01-07-007 déclarant d’intérêt général et autorisant le programme de travaux pluriannuel de gestion du bassin versant du Dropt Aval Le Préfet de Dordogne La Préf"te de #ironde Le Préfet de Lot$et$#aronne Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre ational du !érite Chevalier de l’Ordre ational du !érite Officier de l’Ordre ational du !érite Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L%&'&$() et L%&'&$*0 , Vu le code de l-environnement et notamment les livres .. et ./ , Vu le code général de la propriété des personnes publi0ues , Vu le décret n1 2++3$&3)+ du &* décembre 2++3 portant dispositions relatives aux régimes d-autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l-eau et des milieux a0uati0ues4 aux obligations imposées 5 certains ouvrages situés sur les cours d-eau4 5 l-entretien et 5 la restauration des milieux a0uati0ues et modifiant le code de l-environnement , Vu le décret n1 2++6$32+ du 2& 7uillet 2++6 relatif 5 l-exercice du droit de pêche des riverains d-un cours d-eau non domanial , Vu le schéma directeur d-aménagement et de gestion des eaux du Bassin Adour Garonne approuvé le &er décembre 2+&' et notamment ses mesures relatives 5 la gestion 0uantitative et 0ualitative de la ressource , Vu le plan de gestion des 9is0ues d’.nondations :P#9.; du bassin Adour Garonne 2+&)$ 2+2& approuvé le &er décembre 2+&' , Vu le dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation -

LA COMMUNE Du VERGT De BIRON Canton De MONPAZIER (Dordogne)
LA COMMUNE du VERGT de BIRON Canton de MONPAZIER (Dordogne) La commune en question est limitée à l’Est par celle ce Biron, au Nord par celle de Gaugeac, au Sud et à l’Ouest elle confronte le département du Lot et Garonne. Sa superficie est de 1.616ha 68a 40ca. Les terrains sont généralement argilo - calcaires, sauf aux alentours de Biron où ils passent à un ensemble sidérolithique sablonneux. L’époque préhistorique est assez bien représentée sur le territoire du Vergt de Biron : on y ramasse de temps à autre des silex taillés de différents âges. Les haches polies et les pointes de flèches néolithiques sont toujours plus abondantes vers le Lot et Garonne, par exemple à « Mongru ». A la sortie du bourg de Labrame, près de la borne départementale, un très beau mégalithique démontre qu’il y eut occupation du sol par les peuplades chalcolithiques (âge du cuivre), ou par celles de l’âge du Bronze. Ce lieudit est appelé « Le Point du Jour » et le dolmen appartient à M. André Beauvier domicilié tout à côté. La table de ce mégalithe, d’après l’évaluation d’un entrepreneur de travaux publics, pèserait plus de 60 tonnes. Il existe, depuis 1985, sur le plateau où est situé le dolmen, une aire de repos et de pique nique très agréable. D’après des notes relevées par feu M. le Curé Calès, le dolmen du « Point du Jour » possèderait une charmante légende, laquelle aurait été retrouvée (par le curé Calès), dans un journal personnel tenu au jour le jour par un ancien prêtre (vicaire de la paroisse de Saint-Cernin à la révolution, le curé Charles Dubalou.) Voici cette légende : Il était une fois un berger, boiteux et contrefait, qui un jour sauva la vie d’un loup gravement blessé. -

Sage Dropt Rapport De Presentation
SAGE DROPT RAPPORT DE PRESENTATION Projet validé par la CLE le 15 octobre 2019 EPIDROPT EPIDROPT SAGE DROPT – RAPPORT DE PRESENTATION CLIENT RAISON SOCIALE EPIDROPT 23 av de la Bastide COORDONNÉES 24500 EYMET Monsieur JARLETON INTERLOCUTEUR Tél. 05.53.57.53.42 (nom et coordonnées) [email protected] SCE PERISUD 2 - 13 rue André Villet 31400 TOULOUSE COORDONNÉES Tél. 05.67.34.04.40 - Fax 05.62.24.36.55 E-mail : [email protected] Madame Audrey LEMAIRE INTERLOCUTEUR Tél. 05.67.34.04.40 (nom et coordonnées) E-mail : [email protected] RAPPORT TITRE Rapport de Présentation du SAGE Dropt NOMBRE DE PAGES 20 NOMBRE D’ANNEXES 0 OFFRE DE RÉFÉRENCE 76410 N° COMMANDE Notification le 20/04/2016 SIGNATAIRE RÉVISION OBJET DE LA CONTRÔLE RÉFÉRENCE DATE RÉDACTEUR DU DOCUMENT RÉVISION QUALITÉ V1 Juin 2019 ALM JMA Page 2 / 21 novembre 19│ SCE EPIDROPT SAGE DROPT – RAPPORT DE PRESENTATION Intégration V2 27/09/2019 remarques suite ALM CLE juin 2019 novembre 19│ Page 3 / 21 EPIDROPT SAGE DROPT – RAPPORT DE PRESENTATION Sommaire 1. Présentation générale de la démarche ............................................................... 6 1.1. Qu’est-ce qu’un SAGE ? .............................................................................................. 6 1.2. Contexte règlementaire ................................................................................................ 7 1.3. Contenu du SAGE et sa portée réglementaire............................................................ 8 2. Le SAGE Dropt ................................................................................................... -

Tour DE France 2017 Eymet, Ville-Départ !
tour DE FrancE 2017 EymEt, VillE-Départ ! Press Kit June 2017 EymEt, VillE-Départ Du tour DE FrancE 2017 ! It was three years ago when the Tour de France Press Kit sped through Eymet in the driving rain. On the 12th of July, this year the town has been promoted to host the ‘depart’ of stage 11 of the ‘Grande Boucle', that takes the riders to Pau, hopefully this time under sunny skies! For this modest sized town of just 2,700 inhabi- tants, it is a tremendous opportunity for the community to come together to engage with the global audience of the Tour de France and to show the world what it has to offer. Press Kit - June 2017 texts Eymet Town Hall, communication department translation Linda Lovelock photo credits Au Fil du Temps association - P. Bacogne - C. Bor - Ph. Euilllet R. and G. Lallemant eyMet toWn Hall ContaCt 27, avenue de la Bastide • 24500 eymet tel 05 53 22 22 10 Mail [email protected] Web eymet-dordogne.fr in summary page 2 Press Kit Eymet Town Hall: contact 3 Prenez le temps d'Eymet ! 4 The good life in Eymet 5 Some notable Eymétois 6 Eymet, and its sense of history! 7 Eymet take the Tour! 8 Some pictures of Eymet Prenez le temps d’eymet ! Ten years ago, Eymet council invited some communication students to the Bastide to explore the town’s potential attractions and to suggest ways to promote it more widely. At the end of their stay they coined the slogan ‘Prenez le temps d’Eymet’, which was adopted as the town’s signature. -

Côtes De Duras"
Article AOC "Côtes de Duras" Abrogé par Décret n°2011-1391 du 26 octobre 2011 - art. 2 CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DE DURAS " Chapitre Ier I. ― Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras ", initialement reconnue par le décret du 16 février 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. ― Couleur et types de produit L'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés. III. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne : Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Saint- Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Sauvetat-du-Dropt (La), Savignac-de-Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982 et des 7 et 8 septembre 2005. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 3° Aire de proximité immédiate : L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes : Département de la Dordogne Sadillac, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Thénac. -

Canalfriends Travel Guide the Garonne Canal, the Garonne River
The Garonne Canal, the Garonne river And the Gironde estuary (From Toulouse to the Atlantic) Canalfriends Travel Guide The community of canal and river enthusiasts www.canalfriends.com This is Your guide In 2014, we created canalfriends.com, This new edition takes you from the first collaborative waterways Toulouse to the Atlantic, beyond the tourism platform in order to share our Garonne canal and river, to the Gironde passion and that of enthusiasts. estuary. The enthusiasm shown by participants Explore these regions on your own, with in our 2016 Garonne Canal Discovery family or friends. Day gave us the idea of producing The guides provide information on collaborative travel e-guides in the same waterways activities, accommodation, community spirit. restaurants, local produce and events. Special thanks to all the enthusiasts we For travellers with disabilities, the guides met (hikers, cyclists, boaters), who gave specify accommodation and activities us a better understanding of their providers able to cater to their needs. expectations. Your holiday will probably give you an With thanks also to the professionals appetite to return. Our other free from both the private and local downloadable guides are there to help government sectors that are you plan your next holiday. collaborating with us in greater numbers every year to develop our guides. Let us know what type of information you would like to find in this guide. Recommend a site or activity. Contact us with your comments, add your activity or accommodation. Receive free updates. [email protected] See you soon Canalfriends Team Guide Canalfriends canal de Garonne, Garonne & Gironde– p 2 Contents Map: Garonne canal, Garonne river and Gironde estuary................................................ -

WHERE to LIVE Lot-Et-Garonne Step Back In
WHERE TO LIVE Lot-et-Garonne Step back in Popular destination Lot-et-Garonne, in south-west France, is packed with plum orchards, pretty villages and a rich medieval history, as Paola Westbeek discovers timet’s easy to fall in love with Lot-et- Built in a characteristic grid pattern Garonne. The charming rural gem, with an arcaded main square where intersected by the two rivers that commercial activities took place, these give the department its name, ‘new towns’ (villes nouvelles) were boasts gently rolling landscapes established by French and English rulers Icharacterised by vineyards, plum orchards between 1152 and 1453 in order to assert and vast fields of towering sunflowers. authority, bring structure to the expanding A welcoming part of France where population and encourage trade. English is almost the second language, Lot-et-Garonne has the largest number the department is a favourite holiday of bastides in Nouvelle-Aquitaine (42 in destination and a popular area for retirees total) and Monflanquin is definitely one or those looking to invest in a second with plenty to offer. Not to be missed is home. Immerse yourself in its rich the annual Médiévales de Monflanquin, a medieval history, taste your way through dynamic two-day festival in mid-August a gastronomic paradise of deeply-rooted that brings the past to life through street culinary traditions and wander through theatre and parades with locals dressed in pretty villages that invite you to stop for a medieval costume, live music, banquets, local wine or a citron-pressé. daring fire performance and much more.