Ra Pport De Présen Tation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
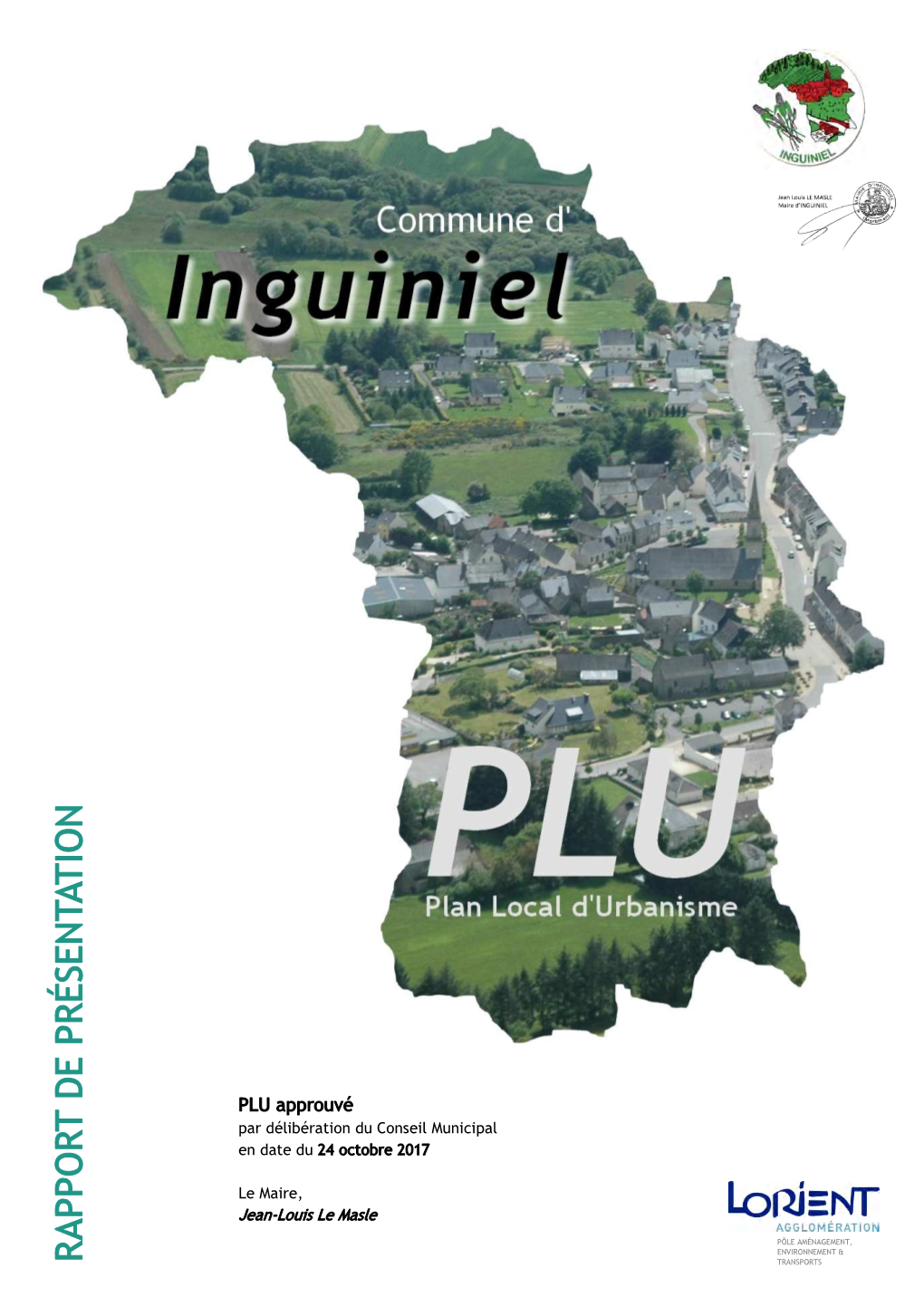
Load more
Recommended publications
-

Com103 Centralités-Économiques Mise En Page 1
Note de l'observatoire territorial N°103 Juin 2018 Les centralités commerciales du SCoT Environnement du pays de Lorient Habitat État des lieux 2018 Économie Le SCoT du pays de Lorient a été approuvé le 16 mai dernier. Un de ses axes majeur vise à donner la priorité aux centralités urbaines : centres-villes, cen- Sites d'Activités tres-bourgs et quartiers. Ces derniers constituent des lieux de vie et d’échanges et répondent aussi à de nouvelles aspirations : davantage de proxi- Emploi Formation mité, de services, d’économies d’énergies... Cette priorité aux centralités s’inscrit dans la volonté du territoire de lutter Déplacements contre l’étalement urbain, de favoriser l’économie d’espace et de limiter les déplacements. La question de l’attractivité commerciale est une des clés de la réussite dans ce domaine. Le commerce contribue en effet à l’animation de Tourisme la ville, à sa structuration, à la vitalité du cœur de ville. C’est pourquoi, afin de préserver cette fonction souvent dégradée par les mu- Démographie tations du commerce, l’essor trop fort de la périphérie, la périurbanisation..., le SCoT, par l’intermédiaire du DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et Dynamiques Sociales Commercial), accorde une priorité aux centralités commerciales qui devien- nent les lieux d’accueil privilégiés pour les nouveaux commerces. Agriculture Cette note a pour objectif, de dresser un état des lieux des centralités com- merciales du pays de Lorient, (SCoT*) du point de vue de leur composition com- merciale et de leur situation par rapport à l’évolution de la vacance commerciale. (*) : Schéma de cohérence territoriale Communication N° 103 - AudéLor - Juin 2018 1 > 9 centralités commerciales avec des densités commerciales supérieures à la moyenne Avec près de 1500 commerces et services com- Densités commerciales pour 1000 habitants dans merciaux actifs dans les centralités, le territoire les centralités commerciales en 2018 du SCoT affiche une densité commerciale moyenne de 6,8 commerces pour 1000 habi- tants. -

Le Scorff, Un Véritable Laboratoire De Recherche Sur Le Saumon
Le Scorff, un véritable laboratoire de recherche sur Edito le Saumon Quand passent les saumons … Le saumon atlantique est, sans aucun doute, le plus symbolique de nos Reproduction De novembre à janvier poissons migrateurs, ce qui lui vaut Cycle de vie sur les têtes de radier de faire l’objet de nombreuses études inspiré de Baglinière et recherches. Il doit également sa et al.,2008 Oeufs notoriété à l’intérêt que lui portent Emergence Géniteurs Mars-Avril les pêcheurs amateurs. Eclosion à 800 degrés jour La station de contrôle des salmonidés migrateurs du Moulin des Princes à Pont-Scorff, outil sans équivalent en RIVIERE Parr 0+ et 1+ France, est la clé de voûte du dispo- sitif de recherche scientifique mis en place sur le Scorff. L’originalité de ce programme s’ap- Smolts puie sur un suivi complet des migra- tions de saumon conjugué à diffé- Montaison des adultes Castillons de juin à novembre ESTUAIRE Dévalaison des juvéniles rentes études menées sur l’ensemble Saumons de printemps : de mars à juin Mars à mai du bassin. Il est le fruit d’une collabo- ration étroite entre l’Institut National de le Recherche Agronomique et les OCEAN structures associatives des pêcheurs amateurs, avec le concours de l’Office national de l’eau et des milieux aqua- Croissance tiques. De 1 à 3 ans Les données recueillies depuis 1994 Groenland (2ème été) ont permis de produire des méthodes et Iles Féroés (1er et 2ème hiver) d’évaluation de stocks extrapolables aux autres rivières bretonnes et ainsi de définir des mesures de gestion en fonction d’informations scientifiques La vie du saumon, entre eau douce et eau salée : objectives. -

Mesdames Et Messieurs Les Membres Du Conseil Municipal
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal CONVOCATION Le Conseil Municipal se réunira en mairie, en séance ordinaire, le mardi 17 septembre 2019 à 19 h 30 Je vous remercie de bien vouloir assister à cette réunion et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. Le 09 septembre 2019 Le Maire, Daniel MARTIN. À L’ORDRE DU JOUR ADMINISTRATION GÉNÉRALE - INTERCOMMUNALITÉ 1°) Présentation du schéma directeur intercommunal du numérique, 2°) Modification des statuts de Lorient Agglomération au 1er janvier 2020 : approbation du conseil municipal, 3°) Convention intercommunale d’attribution de logements sociaux : autorisation de signature, 4°) Changement de dénomination de l’école de Kerzo et du Centre, 5°) Atlas sur la biodiversité intercommunale de Lorient Agglomération : modification de la représentation au sein du groupe de travail, 6°) Création d’une commission extra-municipale « mise en valeur de la redoute de Kerzo » FINANCES – PATRIMOINE 7°) Budget 2019 : décision modificative budget annexe des mouillages, 8°) Cession de la parcelle du feu du Lohic par l’État à la ville de Port-Louis, 9°) Programme de logements sociaux rue Marcel Charrier : demande d’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, 10°) Projet d’accueil des femmes victimes de violence : demande de participation QUESTIONS DIVERSES Hôtel de Ville CS 40018 56290 PORT-LOUIS Tél. 02 97 82 59 59 [email protected] 1/26 Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 septembre 2019 Date de convocation : le 09 septembre -

Étang De Kerstraquel Place De L’Église 56150 Baud
vet la B e L e h c à la pê INFOS TOURISTIQUES POISSONS BLANCS / TRUITES ARC-EN-CIEL 12 CONTACT OFFICE DE TOURISME OÙ MANGER ? © JM Seveno vet la B Offi ce de Tourisme Crêperie Gourmande Ar Vadelen e Office de Tourisme de Baud Communauté La Madeleine route de Plouay Aménager L 56310 Bubry - Tél. : 02 97 51 31 26 Développer e Promouvoir Accueil estival (avril à octobre) www.facebook.com/arvadelen h Promenade des estivants - St-Nicolas-des-Eaux à c nature - patrimoine - tourisme - loisirs la pê 56930 Pluméliau Pizzeria À La Maison Syndicat de la Vallée du Blavet Tél. : 02 97 08 04 07 5 rue des Tilleuls 56310 Bubry [email protected] PARCOURS de FAMILLE de l’ www.tourisme-baud-communaute.fr Auberge de la Tourelle Place de l’Église 56310 Melrand Bureau d’Informations Touristiques (juillet et août) Tél. : 02 97 39 51 13 Étang de Kerstraquel Place de l’église 56150 Baud poissonst blancs et truite arc-en-ciel. ère Poissons recherchés :ave 1 caté- Correspondance (octobre à avril) l e gorie : ouverture du B 2 samedi de mars au troisième dimanche de Chemin de Kermarec - BP 35 56150 Baud e QUE VOIR ? septembre. SuperfiL cie : 2 ha. Profondeur moyenne : 1,5 m. Amé- nagements disponibles : 2 postese de pêche, un cheminement, h c une aire de pique-nique,à la sontpê accessibles à tous. Des toilettes, des Jardin d’Iris pelouses, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants complètent les QUE FAIRE ? Trévengard 56310 Bubry équipements disponibles.Gîte de pêche Tél. -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation
Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -

Sous-Préfecture De Lorient 1799
Archives départementales du Morbihan Sous-préfecture de Lorient 1799 - 1940 1 Z 1 à 247 par Marie-Laure KERVEGANT ; sous la direction de Yolaine COUTENTIN 1996, repris en 2020 Vannes IDENTIFICATION Référence de l'inventaire : FRAD056_0000001Z Référence service d'archives : Archives départementales du Morbihan Intitulé : Sous-préfecture de Lorient Dates extrêmes : 1799 - 1940 Niveau de description : fonds Nombre d'articles : 247 Métrage conservé (ml) : 15,6 CONTEXTE Nom du producteur : Sous-préfecture de Lorient Modalités d'entrée : Versement. CONTENU ET STRUCTURE Présentation du contenu : Les documents de ce fonds révèlent la variété des domaines d’intervention du sous-préfet de Lorient. Ils témoignent d’une part de l’application des décisions du préfet dans l’arrondissement, et d’autre part de la gestion des affaires courantes dans des secteurs d’activité extrêmement diversifiés (élections, police, santé publique, population, agriculture, affaires communales, enseignement, etc.). Ce fonds est donc composé de typologies documentaires riches (textes officiels, arrêtés, rapports, procès-verbaux, correspondance administrative, délibérations, télégrammes, tracts, plans, affiches, etc.) Il constitue ainsi un complément précieux à l’ensemble des autres séries modernes (M à Y) des Archives départementales. CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION Statut juridique : Archives publiques Modalités d'accès : Conformément au code du patrimoine en vigueur, les documents de ce fonds sont librement communicables. INDEXATION Géographique : Lorient (Morbihan, -
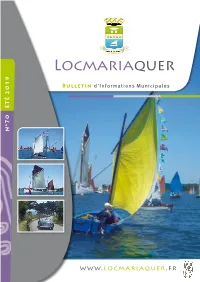
BM LOC N70.Pdf
d’Informations Municipales Locmariaquer Bulletin d’Informations Municipales BULLETIN ÉTÉ 2019 N°70 Splendida porro occulti www.locmariaquer.fr Directeur de la publication : Michel JEANNOT, Maire Conception : CRÉAPRINT-COMMUNICATION - Frédéric SUEUR Editeur : Commune de Locmariaquer - 02 97 57 32 32 06 07 08 67 10 - www.creaprint-communication.com www.locmariaquer.fr - [email protected] Tirage : 1800 exemplaires Crédits photos : Marie-Jo LE RUNIGO, Catherine LEPAGE, Fabienne LHEUREUX, MAIRIE DE Imprimé sur papier recyclé - Encre végétale Alain MARENNE, les associations, l’école, l’UFCV LOCMARIAQUER 02 97 57 32 32 PERMANENCES DES ELUS (SUR RDV) : ➔ Sommaire Évènement Page 4 et 5 Michel JEANNOT Communication information Page 6 à 8 • Maire de Locmariaquer • 1er Vice-Président du Syndicat Départemental Informations municipales Page 9 à 13 de l’Eau du Morbihan • Membre du bureau Etat civil Page 11 du Parc Naturel Régional • Conseiller communautaire Conseil des sages Page 14 Auray-Quiberon-Terre Atlantique • Délégué de la commission littoral Enfance & Jeunesse Page 15 à 17 du Morbihan auprès de l’association des Maires de France Médiathèque Pages 18 et 19 • Représentant des communes SOMMAIRE de + de 1500 habitants au conseil L’Echo de l’école Pages 20 et 21 d’administration de l’association des Maires du Morbihan Le Breton Pages 22 et 23 Permanences : Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h Bureau du port Page 24 Samedi de 9h à 12h Expression libre Page 25 Jean COUDRAY • 1er Adjoint au Maire La paroisse Page 25 CCAS - Personnel -
![[Conditions D'accès Aux Animations]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8836/conditions-dacc%C3%A8s-aux-animations-2288836.webp)
[Conditions D'accès Aux Animations]
[Conditions d’accès aux animations] 1 - Généralités Aspects pédagogiques : la participation aux animations proposées par Lorient Agglomération dans le cadre de son programme d’actions sur l’éducation au développement durable doit impérativement être articulée avec le contenu du programme pédagogique officiel. Ce lien doit apparaître dans la rubrique « Définition des motivations », afin de garantir la validation de la participation des classes inscrites par les instances éducatives régionales (Rectorat / Diocèse). Frais de déplacements : Lorient Agglomération prend à sa charge un déplacement maximum par classe pour les animations organisées à l’extérieur. Le déplacement devra rester dans les limites territoriales de l’agglomération, sauf cas particulier après accord. Le déplacement pour le rassemblement de fin d’année scolaire sera pris en charge financièrement par Lorient Agglomération. Réunion de lancement du projet : organisée à la mi-octobre, cette réunion est obligatoire. 2 – Spécificités par animation ECOL’EAU SCORFF Echelle d’implication demandée : projet de classe sur une année (6 demi-journées en classe et à l’extérieur + rassemblement en fin d’année scolaire). Niveaux admis : de la GS au CM2 + IME. Périmètre géographique d’intervention : animations réservées aux communes du SAGE SCORFF dont 14 communes présentes sur le territoire de Lorient Agglomération : Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gestel, Guidel, Inguiniel, Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Quéven. S EAU S BLAVET Echelle d’implication demandée : projet de classe sur une année (6 demi-journées en classe et à l’extérieur + rassemblement en fin d’année scolaire). Niveaux admis : de la GS au CM2 + IME. Périmètre géographique d’intervention : animations réservées aux 19 communes de Lorient Agglomération rattachées au territoire du bassin versant du Blavet : Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Lanvaudan, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plouay, Port-Louis, Quistinic et Riantec. -

Liste Elus Tit Suppl Coll 1 Coll 3 Et Tit Coll 2
ELECTIONS MSA des Portes de Bretagne - MORBIHAN Mandat 2020-2025 CANTONS DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS AURAY 1er collège DANET CLAUDINE - PLUNERET LE LABOUSSE JEAN NOEL - PLUNERET DE LEPINAUX ALIX - PLUNERET LE CHAPELAIN ANNE-MARIE - CRACH LE METOUR JULIE - CRACH 2ème collège KERGOZIEN ADELINE - AURAY LE BORGNE JEAN-PIERRE - PLUMERGAT LE CALVEZ DOMINIQUE - PLUMERGAT 3ème collège BLUMSTEIN GILLES - AURAY SARL JAN - PLUNERET Mandataire JAN CATHERINE GOURIN 1er collège KERSULEC LOUIS - GOURIN PERRENNEC GWENAELLE - LE SAINT LE BIHAN CLAUDE - CLEGUEREC JOUANNO ISABELLE - ST AIGNAN PERRET PATRICIA - PLOERDUT BERNARD CHRISTIANE - PLOERDUT GUIGUENO DANIEL - LOCMALO GAUDART JOEL - LE FAOUET 2ème collège ANDRE AUDREY - BERNE LE MORZADEC ELIANE - SEGLIEN LESSART FRANCOISE - LE FAOUET 3ème collège EARL BUQUEN - GUISCRIFF CUMA DEUZ BRO AR - PRIZIAC Mandataire : BUQUEN PASCAL Mandataire LE GUENIC GWENAELLE EURL RURAL SERVICE - MALGUENAC EARL DU MENHIR - LANVENEGEN Mandataire : CHAUVIRE CHANTAL Mandataire : HELOU ISABELLE GRAND CHAMP 1er collège DE KERSABIEC FRANÇOIS XAVIER - MOUSTOIR AC ROBIC FABIENNE - EVELLYS OLIVIERO XAVIER - GRAND CHAMP GAILLO ALAIN - LOCQUELTAS LE NY JEAN-FRANÇOIS - GRAND CHAMP CAINJO PHILIPPE - LOCMARIA GRAND CHAMP EONNET-JEAN FRANÇOIS - RADENAC TANGUY ALBERT - REGUINY 2ème collège AUDO DANIEL - CREDIN BRANDEHO GILDAS - LOCMINE HEBRARD OLIVIER - PLUMELIN 3ème collège LAINE CHRISTIAN - EVELLYS LE MABEC ROBERT - REGUINY GUER 1er collège JEHANNO RAYMOND - BEGANNE BARRE JACQUELINE - CARENTOIR MEHAT BERNARD - ST VINCENT -

Listesp-Etablissements-Scolaires.Pdf
ÉCOLES > BUBRY > LANVAUDAN Bubry................................................................... SP 302 Lanvaudan - Inguiniel........................................ SP 312 SP 303 > PLOEMEUR - JACQUES PREVERT > CAUDAN - JULES VERNE Plœmeur............................................................. SP 31 Caudan................................................................ SP 23 SP 37 SP 24 > PLOEMEUR - MARCEL PAGNOL > CLÉGUER - SAINT- GÉRAND - BRASSENS Guidel - Plœmeur............................................... SP 30 Cléguer................................................................ SP 51 SP 35 SP 52 Plœmeur............................................................. SP 31 SP 53 SP 32 > GESTEL - JEAN GUEHENNO SP 37 Pont-Scorff - Gestel............................................ SP 80 > PLOUAY > GUIDEL Plouay.................................................................. SP 306 Guidel.................................................................. SP 60 SP 307 SP 61 SP 401 SP 62 SP 402 SP 63 > PONT-SCORFF - SAINT AUBIN - MARC CHAGALL SP 64 Pont-Scorff......................................................... SP 50 > INZINZAC-LOCHRIST Pont-Scorff (retour uniquement)...................... SP 54 Inzinzac-Lochrist................................................ SP 44 > QUÉVEN - ANATOLE FRANCE SP 95 Quéven................................................................. SP 59 > LANESTER > QUISTINIC Lanester.............................................................. SP 20 SP 21 Quistinic............................................................. -

Avis D'enquete Publique
PREFET DU MORBIHAN AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE Une enquête publique unique en vue d’autoriser la restauration des bassins versants du Scave et du Scorff dans le cadre du Contrat Territorial Volet Milieux Aquatiques (CTMA) sera ouverte en mairies de Pont-Scorff (siège de l’enquête), Gestel, Saint-Caradec-Trégomel et Guidel dans le département du Morbihan et Rédéné dans le département du Finistère, pendant 16 jours consécutifs, du jeudi 13 août 2020 à 9h00 au vendredi 28 août 2020 à 17h00. Les communes concernées par le projet sont les suivantes : - Berné, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Le Croisty, Gestel, Guéméné sur Scorff, Guidel, Inguiniel, Kernascléden, Lanester, Langoëlan, Lignol, Locmalo, Lorient, Meslan, Persquen, Ploërdut, Plouay, Pont- Scorff, Quéven, Saint-Caradec-Trégomel dans le département du Morbihan, - Lescouët-Gouarec et Mellionnec dans le département des Côtes-d’Armor, - Arzano, Guilligomarc’h et Rédené dans le département du Finistère. Ce projet, présenté par Lorient Agglomération – Maison de l’Agglomération – Quai du Péristyle – CS 20001 - 56214 Lorient Cedex, porte sur les demandes suivantes : - autorisation environnementale au titre de l’article L181-1-1° du code de l’environnement ; - déclaration d’intérêt général. Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants : • l’arrêté d’ouverture d’enquête • 1 dossier produit par le bureau d'études Hydro Concept (autorisation environnementale et déclaration d’intérêt général) • l’avis de la DRAC Bretagne/UDAP des Côtes-d’Armor • le courriel du 7 août 2019 confirmant que le projet n’a pas à faire l’objet d’un examen au cas par cas. Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consultable en version papier et à partir d’un poste informatique en mairies de Pont-Scorff, Gestel, Saint-Caradec-Trégomel et Guidel dans le département du Morbihan et Rédéné dans le département du Finistère où toute personne pourra en prendre connaissance sur place, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de celles-ci. -

Bulletin Municipal N°67 (Hiver 2018)
d’Informations Municipales Locmariaquer Bulletin d’Informations Municipales BULLETIN HIVER 2018 N°67 Splendida porro occulti © Claude DOUCHEMENT www.locmariaquer.fr Directeur de la publication : Michel JEANNOT, Maire Conception : CRÉAPRINT-COMMUNICATION - Frédéric SUEUR Editeur : Commune de Locmariaquer - 02 97 57 32 32 06 07 08 67 10 - www.creaprint-communication.com www.locmariaquer.fr - [email protected] Tirage : 1800 exemplaires Crédits photos : Gaelle HEBERT, Catherine LEPAGE, Fabienne LHEUREUX, MAIRIE DE Imprimé sur papier recyclé - Encre végétale Alain MARENNE, Bernard LE PRIELLEC, les associations, UFCV LOCMARIAQUER 02 97 57 32 32 PERMANENCES DES ELUS (SUR RDV) : ➔ Communication information Page 4 à 6 Sommaire Michel JEANNOT Informations municipales Pages 8 et 9 • Maire de Locmariaquer • 1er Vice-Président du Syndicat Départemental Travaux communaux Page 10 de l’Eau du Morbihan • Membre du bureau Syndicat SIVU Page 11 du Parc Naturel Régional • Conseiller communautaire Auray-Quiberon-Terre Atlantique Informations sociales Page 12 • Délégué de la commission littoral du Morbihan auprès de l’association Conseil des sages Page 13 des Maires de France • Représentant des communes Locmariaquérois à l’honneur Pages 14 et 15 SOMMAIRE de + de 1500 habitants au conseil d’administration de l’association des Maires du Morbihan Nos jeunes entrepreneurs Page 16 Permanences : Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h Escales photos Page 17 Samedi de 9h à 12h Médiathèque Pages 18 et 19 Jean COUDRAY • 1er Adjoint au Maire Enfance &