Le Bulletin De La Bipedie Initiale Bipedia Bipedia N° 24
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cryptozoologicon: Volume I Online
PYrNA (Free and download) Cryptozoologicon: Volume I Online [PYrNA.ebook] Cryptozoologicon: Volume I Pdf Free John Conway, C. M. Kosemen, Darren Naish ePub | *DOC | audiobook | ebooks | Download PDF Download Now Free Download Here Download eBook #506077 in Books Darren Naish C M Kosemen John Conway 2013-11-07Original language:EnglishPDF # 1 8.50 x .26 x 8.50l, .44 #File Name: 1291621539102 pagesCryptozoologicon Volume I | File size: 48.Mb John Conway, C. M. Kosemen, Darren Naish : Cryptozoologicon: Volume I before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Cryptozoologicon: Volume I: 16 of 17 people found the following review helpful. Cryptozoology finally gets the treatment it deservesBy Cameron A. McCormickCryptozoology claims to be a lot of things — normally something along the lines of searching for "hidden" or "unexpected" animals — but effectively it's the art of taking anecdotes and even softer evidence way too seriously. For a practice purportedly focused on discovery, cryptozoology is ironically hyper-conservative and tends to rehash the same old information and hypotheses even if they've been shown to be improbable, wrong or fake. While cryptozoology has been stuck in a purgatory-like existence since the 1960's, people eschewing or unaware of that label have been going around discovering new and sometimes large and exciting species, even when initially starting from soft evidence like anecdotes.Just because cryptozoology is (largely) an unintentionally serious study of mythical creatures doesn't make it worthless. The thing is, lots of the cryptids are really compelling. Some of my favorite monsters are cryptozoological creations. -

The Biography of America's Lake Monster
REVIEWS] The Biography of America’s Lake Monster BENJAMIN RADFORD obert Bartholomew and his broth- er Paul grew up near the shores Rof Lake Champlain, which not The Untold Story of Champ: A Social History of America’s only sparked an early interest in the Loch Ness Monster. By Robert E. Bartholomew. lake monster said to dwell within the State University of New York Press, lake but also steeped them in the social Albany, New York, 2012. ISBN: 978-1-4384-4484-0. and cultural context of the mysterious 253 pp. Paperback, $24.95. beastie. In his new book, The Untold Story of Champ: A Social History of America’s Loch Ness Monster, Robert, a sociologist, Fortean investigator, and former broadcast journalist, takes a fresh look at Champ, long dubbed “America’s Loch Ness Monster.” Roy Mackal, and others who con- the Mansi photo, “New Information There have only been a handful of vened a 1981 conference titled, “Does Surfaces on ‘World’s Best Lake Mon- other books dealing in any depth or Champ Exist? A Scientific Seminar.” ster Photo,’ Raising Questions,” May/ scholarship with Champ, among them The intrigue between and among these June 2013.) Joe Zarzynski’s Champ: Beyond the Leg- researchers is interesting enough to fill Like virtually all “unexplained” phe- end, and of course Lake Monster Mys- several chapters. nomena, the history of Champ is in teries: Investigating the World’s Most There are several good books about part a history of hoaxes, and the book Elusive Creatures, coauthored by Joe the people involved in the search for examines several of them in detail, in- Nickell and myself. -

Good-Humored Adventure in the Congo
savior of Soviet agriculture. They pro- couraged as a plot by the bourgeoisie to Today, we find an American public ever moted him, disguised his failures, and enslave the peasant class. All question- more leery of the promise of science silenced his opponents. ing of method was deemed politically and technology to provide solutions to Lysenko brazenly declared that suspect. Academic inquiry and analysis complex global problems. The public, modern, Mendelian genetics was bunk were insults to the great Soviet people woefully ill-informed on the means, and propounded a theory that plants and consequently stifled. All progress in structure, and method of scientific and their unique genetic characteristics genetics, agriculture, and biology inquiry, readily embraces philosophies could be quickly "trained" to serve achieved in the West was dismissed as a and ideologies that seem to offer easy Soviet agricultural interests. Lysenko fraud. All independent biology and solutions. Unfortunately, the public's postulated that, through a process called genetics in the Soviet Union halted misguided acceptance—for example, "vernalization," plants could "learn" to unless it had Lysenko's approval. of the promises of untested alternative grow in any fashion that the Marxist At the peak of his power, Lysenko medicines and parapsychology—has state needed in its effort to revolutionize controlled the Soviet Academy of made it easy prey for those who, like Soviet agriculture. Where traditional Science and served as one of the chair- Lysenko, posit solutions without proof biologists and geneticists argued that men of the Supreme Soviet—the titular and who argue that Western scientific many generations and many years were rulers of the country. -
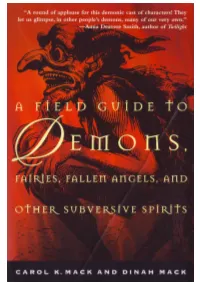
A-Field-Guide-To-Demons-By-Carol-K
A FIELD GUIDE TO DEMONS, FAIRIES, FALLEN ANGELS, AND OTHER SUBVERSIVE SPIRITS A FIELD GUIDE TO DEMONS, FAIRIES, FALLEN ANGELS, AND OTHER SUBVERSIVE SPIRITS CAROL K. MACK AND DINAH MACK AN OWL BOOK HENRY HOLT AND COMPANY NEW YORK Owl Books Henry Holt and Company, LLC Publishers since 1866 175 Fifth Avenue New York, New York 10010 www.henryholt.com An Owl Book® and ® are registered trademarks of Henry Holt and Company, LLC. Copyright © 1998 by Carol K. Mack and Dinah Mack All rights reserved. Distributed in Canada by H. B. Fenn and Company Ltd. Library of Congress-in-Publication Data Mack, Carol K. A field guide to demons, fairies, fallen angels, and other subversive spirits / Carol K. Mack and Dinah Mack—1st Owl books ed. p. cm. "An Owl book." Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-8050-6270-0 ISBN-10: 0-8050-6270-X 1. Demonology. 2. Fairies. I. Mack, Dinah. II. Title. BF1531.M26 1998 99-20481 133.4'2—dc21 CIP Henry Holt books are available for special promotions and premiums. For details contact: Director, Special Markets. First published in hardcover in 1998 by Arcade Publishing, Inc., New York First Owl Books Edition 1999 Designed by Sean McDonald Printed in the United States of America 13 15 17 18 16 14 This book is dedicated to Eliza, may she always be surrounded by love, joy and compassion, the demon vanquishers. Willingly I too say, Hail! to the unknown awful powers which transcend the ken of the understanding. And the attraction which this topic has had for me and which induces me to unfold its parts before you is precisely because I think the numberless forms in which this superstition has reappeared in every time and in every people indicates the inextinguish- ableness of wonder in man; betrays his conviction that behind all your explanations is a vast and potent and living Nature, inexhaustible and sublime, which you cannot explain. -

Partie 1/3 Nicolas FAIRISE
Partie 1/3 Nicolas FAIRISE THESE DE DOCTORAT VETERINAIRE Sujet : Le monstre du loch Ness ; entre science et folklore 1 2 3 4 A notre jury de thèse : Monsieur le Professeur DABERNAT Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse Praticien hospitalier Qui nous a fait l'honneur d'accepter de présider notre jury. Hommage respectueux et sincères remerciements. Monsieur le Professeur BODIN ROZAT DE MANDRES NEGRE Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse Pathologie générale, microbiologie et immunologie Qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter ce sujet de thèse. Pour sa patience, sa confiance et sa bienveillance si précieuses ; Qu'il daigne trouver ici l'expression de notre gratitude et de notre considération. Monsieur BRUGERE Maître de Conférences De l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse Sincères et amicaux remerciements pour son dynamisme, son soutien et sa gentillesse. 5 6 A tous ceux qui ont attendu cette thèse… La voici. A mes parents, qui ont toujours été là pour moi. Ce modeste travail leur est tout particulièrement dédié. Avec toute mon affection. A Roland et Fabienne, très affectueusement. A mes amis, notamment Caroline, Anne et Charlotte Sans qui la vie serait assurément plus terne. Ainsi qu’aux autres qui se reconnaîtront… A mes collègues et néanmoins amis Pour leur patience et leur soutien de tous les jours. Et plus généralement, à tous ceux qui ont su garder une âme d’enfant... 7 8 SOMMAIRE INTRODUCTION 11 I/ PRÉSENTATION DU LOCH NESS 13 1.1- Le loch Ness au sein des Highlands 13 1.2- Données géophysiques -

Book Reviews
142 MILLER ET AL. Vol. 84 BOOK REVIEW Cryptozoology: Interdisciplinary Jour- education, and for providing reliable in- nal of the International Society of Crypto- formation to appropriate authorities." zoology, edited by J. Richard Greenwell. Do we really need another journal? Membership at $25/year is available from Apparently so, for I cannot imagine estab- Secretary-Treasurer of ISC, Box 43070, lished scientific journals such as Copeia, Tucson, Arizona 85733. Includes Crypto- Journal of Mammalogy or Science publishing zoology annually and The ISC Newsletter articles based on hearsay and negative re- quarterly. sults as does volume one of Cryptozoology. The officers and board of directors of The rear cover of volume one states, the new society contain names familiar "The International Society of Cryptozool- to readers of fringe zoology. Bernard ogy serves as a focal point for the investiga- Heuvelmans, French author of On the Track tion, analysis, publication, and discussion of Unknown Animals, is president, and Roy of all matters related to animals of unex- Mackal of Loch Ness fame is vice presi- pected form or size, or unexpected occur- dent. Of the 12 board members, 6 are rence in time or space. The Society also overseas and many have substantial scien- serves as a forum for public discussion and tific reputations such as Grover Krantz, OhioJ. Sci. BOOK REVIEW 143 anthropologist and Bigfoot expert; George as a food source for this creature of un- Zug, herpetologist at the U.S. National known size, eating habits, and classifi- Museum, and Phillip Tobias, anatomist- cation; a task the authors admit is difficult. -

Notes on Sources and Monster Historiography
Notes on Sources and Monster Historiography Those who searched for manlike monsters in the twentieth century— not as metaphors, but as flesh and blood organisms—have gone largely overlooked by academic historians of science. This field, as with cryp- tozoology in general, became the domain of independent amateur chroniclers producing a range of works of varying quality.1 An excel- lent explanation of what cryptozoology attempts to do is found in Chad Arment’s Cryptozoology: Science and Speculation.2 Since the 1960s, scholarly works on anomalous primates, and cryptids in gen- eral, look to place them in the realm of legend and myth: creations of the human mind rather than of evolution.3 These works tend to fall under what Jeffrey Cohen called “monster theory.”4 Works taking an empirical, physical anthropology approach include Gill, Meldrum, and Bindernagel.5 Recent writings have begun to address the lives of the monster hunters, but follow the tradition of focusing on the folkloric and pop culture nature of Bigfoot rather than on the natural history element, and not on the place of cryptozoology in the context of the history of science. This category tends to lean to the exposé or dismissive side.6 Of use to the discussion of monsters in general are scholarly works that attempt to put studies of human monsters into the history of biological systemization and classification.7 A number of methodological issues need to be addressed in the historiography of anomalous primate studies. There are papers col- lections of leading researchers. Grover Krantz, Bernard Heuvelmans, and Ivan Sanderson have accessible materials, as do Carleton Coon and George Agogino. -

LOCH NESS MONSTER Download Free Ebooks At
LOCH NESS MONSTER download free ebooks at www.magus-turris.blogspot.com 1 This ebook is a gift from the literary blog www.magus-turris.blogspot.com download free ebooks at www.magus-turris.blogspot.com 2 Loch Ness Monster In Scottish folklore, the Loch Ness Monster or Nessie is a creature said to inhabit Loch Ness Monster Loch Ness in the Scottish Highlands. It is often described as large in size with a long neck and one or more humps protruding from the water. Popular interest and belief in the creature has varied since it was brought to worldwide attention in 1933. Evidence of its existence is anecdotal, with a few disputed photographs and sonar readings. The scientific community regards the Loch Ness Monster as a phenomenon without biological basis, explaining sightings as hoaxes, wishful thinking, and the misidentification of mundane objects.[2] Contents The "surgeon's photograph" of 1934, now known to have been a hoax[1] Name Similar Champ (folklore), Origins creatures Ogopogo, Mokele- History mbembe, Altamaha-ha Saint Columba (565) D. Mackenzie (1871 or 1872) Other Nessie, Niseag George Spicer (1933) name(s) Hugh Gray (1933) Country Scotland Arthur Grant (1934) "Surgeon's photograph" (1934) Region Loch Ness, Scottish Taylor film (1938) Highlands William Fraser (1938) Sonar readings (1954) Peter MacNab (1955) Dinsdale film (1960) "Loch Ness Muppet" (1977) Holmes video (2007) download free ebooks at www.magus-turris.blogspot.com Sonar image (2011) George Edwards photograph (2011) David Elder video (2013) Apple Maps photograph (2014) -
Ogopogo the Chameleon
Ogopogo the Chameleon Lake Okanagan’s resident lake monster has undergone many transformations over the centuries. Will the real Ogopogo please rise up? BENJAMIN RADFORD hen Joe Nickell and I began our search for Ogopogo, the famous monster of Lake Okanagan, W in British Columbia, Canada, I had an idea of what to look for: a creature thirty to seventy feet long, with dark skin and a characteristic series of humps. Though I went in search of one monster, in a way I found three. Ogopogo seems to have several distinct incarnations: as an Indian legend, as an elusive biological beast, and as a lovable local mascot. N’ha-a-itk of Indian Myths Because the evidence for lake monsters rests almost entirely on ambiguous sightings, fuzzy photographs, and a lakeful of supposition, native Indian tales have been used to suggest SKEPTICAL INQUIRER January / February 2006 41 to the rocky headland. Suddenly, the lake demon arose from his lair and whipped up the surface of the lake with his long tail. Timbasket, his family and his canoe were sucked under by a great swirl of angry water (Quoted in Moon 1977, 25). This was modus operandi for N’ha-a-itk: it would use its mighty tail to lash the lake’s waters into a fierce storm that would drown its victims. The white settlers apparently followed the Indians’ warnings. Yet white men also lapsed at times and had to be reminded of the wrath N’ha-a-itk could wreak. In 1854 or 1855, a settler named John MacDougall is said to have neglected the sacrifice. -
Bibliography of Occult and Fantastic Beliefs Vol.1: a - D
Bruno Antonio Buike, editor / undercover-collective „Paul Smith“, alias University of Melbourne, Australia Bibliography of Occult and Fantastic Beliefs vol.1: A - D © Neuss / Germany: Bruno Buike 2017 Buike Music and Science [email protected] BBWV E27 Bruno Antonio Buike, editor / undercover-collective „Paul Smith“, alias University of Melbourne, Australia Bibliography of Occult and Fantastic Beliefs - vol.1: A - D Neuss: Bruno Buike 2017 CONTENT Vol. 1 A-D 273 p. Vol. 2 E-K 271 p. Vol. 3 L-R 263 p. Vol. 4 S-Z 239 p. Appr. 21.000 title entries - total 1046 p. ---xxx--- 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. Im Gegenteil: Das Biest fügt immer wieder neue Fehler ein, wo vorher keine waren! 1. This is a scientific project without commercial interests, that is not in bookstores, but free in Internet. 2. Financial and legal claims against this project, will result in the contribution and the name of contributor in the next edition canceled. 3. This project has been sponsored by the Federal Republic of Germany, Department for Social Benefits, city of Neuss. 4. Correct spelling and orthography is subject of a constant fight between me and my computer – AND THE SOFTWARE in use – and normally the other side is the winning party! Editor`s note – Vorwort des Herausgebers preface 1 ENGLISH SHORT PREFACE „Paul Smith“ is a FAKE-IDENTY behind which very probably is a COLLCETIVE of writers and researchers, using a more RATIONAL and SOBER approach towards the complex of Rennes-le-Chateau and to related complex of „Priory of Sion“ (Prieure de Sion of Pierre Plantard, Geradrd de Sede, Phlippe de Cherisey, Jean-Luc Chaumeil and others). -

David Castro, Rachel Witter Cole, Hiromi Cota, Erykah Fassett, Elliott Freeman, David Fuller, Jim Gardner, Violet Green, James Mendez Hodes, Danielle Lauzon, Spider B
Sample file DAVID CASTRO, RACHEL WITTER COLE, HIROMI COTA, ERYKAH FASSETT, ELLIOTT FREEMAN, DAVID FULLER, JIM GARDNER, VIOLET GREEN, JAMES MENDEZ HODES, DANIELLE LAUZON, SPIDER B. PERRY, MONICA SPECA, H. ULRICH CREDITS Developer: Monica Speca Scion Lead Developer: Neall Raemonn Price Writers: David Castro, Rachel Witter Cole, Hiromi Cota, Erykah Fassett, Elliott Freeman, David Fuller, Jim Gardner, Violet Green, James Mendez Hodes, Danielle Lauzon, Spider B. Perry, Monica Speca, H. Ulrich Editor: Heather Rigby Artists: Shen Fei, Sam Denmark, Felipe Gaona, Niko Pope, Andrea Payne, Michele Giorgi Art Director: Mike Chaney Creative Director: Rich Thomas SPECIAL THANKS Thank you for buying this product. If you found it through some illicit means online, we hope you like it well enough to purchase a copy. REQUIRES THE USE OF SCION ORIGIN AND SCION HERO Sample© 2020 Onyx Path Publishing. All rights reserved. References tofile other copyrighted material in no way constitute a challenge to the respective copyright holders of that material. “Scion” and all characters, names, places, and text herein are copyrighted by Onyx Path Publishing. Keep up to date with Onyx Path Publishing at theonyxpath.com. 2 TITANOMACHY HOMECOMING 6 Su Dáji 43 The White Eyebrow, Betrayer of Shaolin 45 INTRODUCTION 10 Birthrights 46 Before We Begin 11 TITANS OF THE TEŌTL 47 Citlali, Tzitzimime from Behind the Stars 47 CHAPTER ONE: THE TITANS 12 Coyolxāuhqui, Who Gathered the Four Hundred 48 The Taxonomy of a Titan 13 Tenoch, Quinametzin of the First Sun 49 Titan Callings -
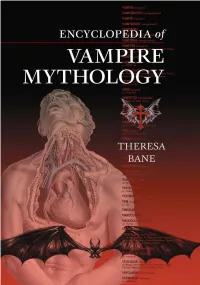
Encyclopedia of Vampire Mythology This Page Intentionally Left Blank Encyclopedia of Vampire Mythology
Encyclopedia of Vampire Mythology This page intentionally left blank Encyclopedia of Vampire Mythology THERESA BANE McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and London LIBRARY OF CONGRESS CATALOGUING-IN-PUBLICATION DATA Bane, Theresa, ¡969– Encyclopedia of vampire mythology / Theresa Bane. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-7864-4452-6 illustrated case binding : 50# alkaline paper ¡. Vampires—Encyclopedias. I. Title. GR830.V3B34 2010 398.21'003—dc22 2010015576 British Library cataloguing data are available ©2010 Theresa Bane. All rights reserved No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Cover illustration by Joseph Maclise, from his Surgical Anatomy, 1859 Manufactured in the United States of America McFarland & Company, Inc., Publishers Box 6¡¡, Je›erson, North Carolina 28640 www.mcfarlandpub.com To my father, Amedeo C. Falcone, Noli nothi permittere te terere. This page intentionally left blank Table of Contents Preface 1 Introduction 7 THE ENCYCLOPEDIA 13 Bibliography 155 Index 183 vii This page intentionally left blank Preface I am a vampirologist—a mythologist who specializes in cross- cultural vampire studies. There are many people who claim to be experts on vampire lore and legend who will say that they know all about Vlad Tepes and Count Dracula or that they can name several different types of vampiric species. I can do that, too, but that is not how I came to be a known vam- pirologist. Knowing the “who, what and where” is one thing, but knowing and more impor- tantly understanding the “why” is another.