MARATHON : Une Épopée, Une Histoire, Une Course… MARATHON : MARATHON
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Todos Los Medallistas De Los Campeonatos De Europa
TODOS LOS MEDALLISTAS DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA HOMBRES 100 m ORO PLATA BRONCE Viento 1934 Christiaan Berger NED 10.6 Erich Borchmeyer GER 10.7 József Sir HUN 10.7 1938 Martinus Osendarp NED 10.5 Orazio Mariani ITA 10.6 Lennart Strandberg SWE 10.6 1946 Jack Archer GBR 10.6 Håkon Tranberg NOR 10.7 Carlo Monti ITA 10.8 1950 Étienne Bally FRA 10.7 Franco Leccese ITA 10.7 Vladimir Sukharev URS 10.7 0.7 1954 Heinz Fütterer FRG 10.5 René Bonino FRA 10.6 George Ellis GBR 10.7 1958 Armin Hary FRG 10.3 Manfred Germar FRG 10.4 Peter Radford GBR 10.4 1.5 1962 Claude Piquemal FRA 10.4 Jocelyn Delecour FRA 10.4 Peter Gamper FRG 10.4 -0.6 1966 Wieslaw Maniak POL 10.60 Roger Bambuck FRA 10.61 Claude Piquemal FRA 10.62 -0.6 1969 Valeriy Borzov URS 10.49 Alain Sarteur FRA 10.50 Philippe Clerc SUI 10.56 -2.7 1971 Valeriy Borzov URS 10.26 Gerhard Wucherer FRG 10.48 Vassilios Papageorgopoulos GRE 10.56 -1.3 1974 Valeriy Borzov URS 10.27 Pietro Mennea ITA 10.34 Klaus-Dieter Bieler FRG 10.35 -1.0 1978 Pietro Mennea ITA 10.27 Eugen Ray GDR 10.36 Vladimir Ignatenko URS 10.37 0.0 1982 Frank Emmelmann GDR 10. 21 Pierfrancesco Pavoni ITA 10. 25 Marian Woronin POL 10. 28 -080.8 1986 Linford Christie GBR 10.15 Steffen Bringmann GDR 10.20 Bruno Marie-Rose FRA 10.21 -0.1 1990 Linford Christie GBR 10.00w Daniel Sangouma FRA 10.04w John Regis GBR 10.07w 2.2 1994 Linford Christie GBR 10.14 Geir Moen NOR 10.20 Aleksandr Porkhomovskiy RUS 10.31 -0.5 1998 Darren Campbell GBR 10.04 Dwain Chambers GBR 10.10 Charalambos Papadias GRE 10.17 0.3 2002 Francis Obikwelu POR 10.06 -

NUTS NOTES Vol
NUTS NOTES Vol. 18 No.3 June 1980 Editor: Tim Lynch-Staunton, Meadowbank, Eydens Avenue, Walton-on-Thamee, Surrey KT12 3 JP. This is the third issue of NUTS NOTES to go on sale to the general public* For the last twenty or so years it has been available to members of the NUTS on a quarterly basis, thanks mainly to the untiring efforts of Andrew Huxtable, who was editor for many years until last year. We hope this issue will be of interest to athletics fans, in particular those who like athletics' statistics, although it will not in future be entirely a statistical newsletter, and will encourage those who compile lists and other data for their own amusement to submit compilations for consideration for inclusion in future issues. T.L-S. BRITISH BEST PERFORMANCES OF ALL-TIME - 10 MILES (ROAD) One of the most frequently contested yet least documented distance events is the 10 miles. So far as I am aware, no one has previously attempted to produce an all- time list for road performances. There are, of course, certain inherent problems. It's an event which, like the marathon, is subject to considerable variation in the severity of courses; and it is sometimes difficult to establish for sure the accuracy of distance for races advertised as being at 10 miles. But there are several very good reasons for establishing a statistical record of the event. First, almost all top-class distance-runners contest it during their career. Second, it brings together trackmen, cross-country runners and marathoners. Third, it has also produced a significant number of performers who have not achieved major recognition in other events. -
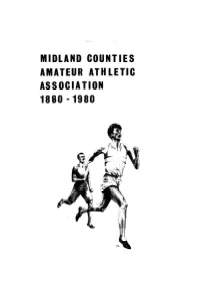
MCAA Centenary Booklet 1880 to 1980.Pdf
0 INTRODUCTION I have attempted to write this article about the Association during its first 100 years in a manner which I hope will be found interesting. I have not used bibliographic indications, but have included a bibliography as an aid for anyone who might wish to write a more detailed history of the Association. Principal events in the Association's history, some of them serious, some of them less serious are mentioned. The main primary source material used has been the Minutes of the Association's meetings. Unfortunately the Minutes of the first 20 years and for the period from 1939 until 1954 are missing and therefore I was unable to comment in detail about these periods. From reading this article you will see that it was the policy of the Association to improve the management of athletic meetings and suppress the abuses which were very prevalent in its early years and to keep the sport within the amateur ranks. From this base the Association is now firmly established, I have no doubt there will be omissions and the occasional mistake of fact and for these I apologise. ROY MITCHELL HON. SECRETARY Date: March 1980 1 FOREWORD This History written to record the first 100 years of the Midland Counties Amateur Athletic Association has not been uneventful, in a sport which covers over 20 disciplines and caters for all. The fat, the thin, the short, the tall, any class, creed, politics or colour, a truly all embracing pastime for all. This admirable history compiled over many hours of work by Roy Mitchell shows not only the evolution of the sport in the Midlands, but the very beginnings of the Modern Olympic ideals from the observing of the Much Wenlock Olympics which had been running for over 150 years before the advent of modern athletics which we know today. -

LE STATISTICHE DELLA MARATONA 1. Migliori Prestazioni Mondiali Maschili Sulla Maratona Tabella 1 2. Migliori Prestazioni Mondial
LE STATISTICHE DELLA MARATONA 1. Migliori prestazioni mondiali maschili sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 1) 2h03’38” Patrick Makau Musyoki KEN Berlino 25.09.2011 2) 2h03’42” Wilson Kipsang Kiprotich KEN Francoforte 30.10.2011 3) 2h03’59” Haile Gebrselassie ETH Berlino 28.09.2008 4) 2h04’15” Geoffrey Mutai KEN Berlino 30.09.2012 5) 2h04’16” Dennis Kimetto KEN Berlino 30.09.2012 6) 2h04’23” Ayele Abshero ETH Dubai 27.01.2012 7) 2h04’27” Duncan Kibet KEN Rotterdam 05.04.2009 7) 2h04’27” James Kwambai KEN Rotterdam 05.04.2009 8) 2h04’40” Emmanuel Mutai KEN Londra 17.04.2011 9) 2h04’44” Wilson Kipsang KEN Londra 22.04.2012 10) 2h04’48” Yemane Adhane ETH Rotterdam 15.04.2012 Tabella 1 2. Migliori prestazioni mondiali femminili sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 1) 2h15’25” Paula Radcliffe GBR Londra 13.04.2003 2) 2h18’20” Liliya Shobukhova RUS Chicago 09.10.2011 3) 2h18’37” Mary Keitany KEN Londra 22.04.2012 4) 2h18’47” Catherine Ndereba KEN Chicago 07.10.2001 1) 2h18’58” Tiki Gelana ETH Rotterdam 15.04.2012 6) 2h19’12” Mizuki Noguchi JAP Berlino 15.09.2005 7) 2h19’19” Irina Mikitenko GER Berlino 28.09.2008 8) 2h19’36’’ Deena Kastor USA Londra 23.04.2006 9) 2h19’39’’ Sun Yingjie CHN Pechino 19.10.2003 10) 2h19’50” Edna Kiplagat KEN Londra 22.04.2012 Tabella 2 3. Evoluzione della migliore prestazione mondiale maschile sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 2h55’18”4 Johnny Hayes USA Londra 24.07.1908 2h52’45”4 Robert Fowler USA Yonkers 01.01.1909 2h46’52”6 James Clark USA New York 12.02.1909 2h46’04”6 -
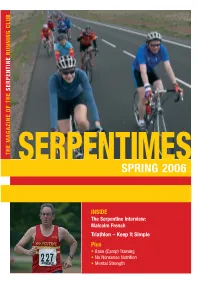
Serpentimes Newsletter V7
UNNING CLUB R SERPENTINE HE MAGAZINE OF THE HE MAGAZINE OF THE T SERPENTIMES SPRING 2006 INSIDE The Serpentine Interview: Malcolm French Triathlon – Keep It Simple Plus • Base (Camp) Training • No Nonsense Nutrition • Mental Strength THE EDITOR SPEAKS Several of you contacted me to say that With the advent of colour, we’ve been able you couldn’t help with design but would to include a lot more of your photographs. like to help and I must thank all contributors As usual I must thank David Knight for his new and old. The range of subjects in this great pictures, but thanks also go to issue goes to prove what a diverse and everyone who happily sent me their interesting group of people the Serpies are. photos. Now that so many more people Serpentimes editor abandoned I’m sure you’ll find Douglas Gurr’s close have digital cameras and camera phones, on iceberg (photo: random penguin) encounter with a large and hungry polar sending pictures in for Serpentimes is bear as fascinating as I did. I was also something that lots of you could think A lot has changed for me since the last issue particularly pleased that Malcolm French, about doing. If you’ve taken a great shot of Serpentimes. I no longer spend my days who already gives so much of his time to of an event, or your mum or granny got in meetings and I can run and swim during the club, agreed to give up a little more to the perfect picture of you crossing the the day. -

2020 Virgin Money London Marathon 2020 Virgin Money London Marathon 1
2020 Virgin Money London Marathon 2020 Virgin Money London Marathon 1 CONTENTS 01 MEDIA INFORMATION Page 5 ELITE MEN 42 The Events & Start Times 6 Entries 42 Media Team Contacts 6 Awards & Bonuses 42 Media Facilities 6 Preview 43 Press Conferences 6 Biographies 44 The London Marathon Online 7 Olympic Qualifying Standard 54 Essential Facts 8 What’s New in 2020 10 ELITE WHEELCHAIR PREVIEW 55 The Course 11 Wheelchair Athletes 56 Stephen Lawrence Charitable Trust 11 Abbott World Marathon Elite Race Route Map 12 Majors Accumulator 56 Pace Guide 13 T54 Women Entries 56 Running a Sustainable Marathon 14 Biographies 57 London Marathon Events Limited 15 T54 Men Entries 59 Biographies 60 02 THE 40TH RACE 16 How It All Began 17 05 ABBOTT WORLD Four Decades of Marathon Moments 19 MARATHON MAJORS 65 The Ever Presents 23 How It Works 66 Qualifying Races 67 03 CHARITIES, FUNDRAISING AbbottWMM Wanda Age Group & THE TRUST 25 World Championships 67 Charities & Fundraising 26 The Abbott World Marathon 2020 Charity of the Year – Mencap 27 Majors Races 68 The London Marathon Charitable Trust 33 Abbott World Marathon Majors Series XIII (2019/20) 74 04 ELITE RACES 31 Abbott World Marathon Majors Wheelchair Series 76 ELITE WOMEN 32 Entries 32 Awards & Bonuses 32 Preview 33 Biographies 34 CONTENTS CONTINUED >> 2020 Virgin Money London Marathon 2 06 THE MASS EVENT 79 BRITISH MARATHON STATISTICS 119 Starters & Finishers 80 British All-Time Top 20 119 2020 Virgin Money British Record Progression 120 London Marathon Virtual Race Stats 81 The Official Virgin Money -

Source : Bibliothèque Du CIO / IOC Library BASKETBALL COMMITTEE
In the semi-finals competition stiffened. In the same group were now the U.S.A. and the U.S.S.R., neither of whom had so far been fully extended. But first the other group. Here only one match was won by a handsome margin; in none of the others was the winner more than 9 points ahead. Uruguay played two heated, furious matches, losing by two The basketball matches were played in two different arenas: the eliminating matches and points to France with only three Uruguayans on the court when the match ended. The the opening round of the tournament in the Tennis Palace in the heart of the city, where referee had to be carried to a dressing room after a regrettable scene. The other ended in two courts had been available for practice, and the semi-finals and finals in Messuhalli II, Uruguay's favour, Argentine, who had played the best basketball in the first round, losing adjacent to the Olympic Stadium. by one point. Bulgaria's awkward style seemed to keep France puzzled, with the result Dressing rooms, showers and the practice courts made the Tennis Palace a very good that she failed to make the top final group. The French players were curiously slack in venue, but unfortunately there was little space for the public. In Messuhalli II, again, the this match. Argentine defeated France by nine goals and Uruguay Bulgaria by eight. In barriers of the spectator stands at the two ends were perilously close to the play-area. The her match with Bulgaria Argentine piled up 100 goals. -

Club Name Club Member Club Division Total /Tri Club Denmark 1
Club Name Club Member Club Division Total /tri club denmark 1 Eva Hammerby II Trilife.ru 3 Vitaliy Trenkenshu II Marina Eliseeva II Ilnar Ismagilov II Wingman Multisport 1 Andro Theart IV temptraining.ru 7 Yury Buylov III Vladimir Rybakov III Konstantin Kapustin III Ekaterina Samoylova III Artem Shestov III Anna Savina III Aleksandr Zinovyev III Altai3race 5 Sergey Ivanov V Sem Nikiforov V Ilya Kopylov V Ilya Butylski V Grigory Alekhin V ASD Varese Triathlon S.B.R. 1 Ivan Negrato V Sapik Team 2 Ruslan Saulko IV Iryna Bondarenko IV Yoska Tri A New Life 3 Sridhar Venkataraman II Mohit Sharma II Abhinav Gupta II Ironteam Tannury 5 Vadim Chshannikov V Sholpan Bassibekova V Dmitriy Holodilov V Bolat Yeskender V Adil Nurmukanov V Wattie Ink. 1 Benjamin Atkinson I BODRYE 6 Rouslan Grabar IV Oleg Yurpalov IV Konstantin Medvedev IV Evgenii Morozov IV Evgenii Ivanov IV DMITRIY TRETYAKOV IV Peninsula Triathlon Club UK 1 June McMinn V Triclub NOMAD 5 Zhassulan Malkenov V Saniya Aitzhanova V Olzhas Akan V Medgat Olzhayev V ?????? ???????? V ????RUN????? 5 Yerlan Shulkadirov V Vitaliy Kozlov V Nuraly Kenzhebekov V Nailya Abdukhalikova V Ernur Smailov V Team Zoot 1 Lisa Johnson I Iron City Kokshetau 1 ???????? ???????? V QTRI (Qatari Triathlon) 2 Khalid Alyafei V Essa Al-Maadeed V SAMiGONCHIKI 4 Bulat Valeev V ALEXEY NIKULIN V ?????? ???????? V ?????? ??????? V Astana Triathletes 3 Gulnar Matybayeva V Evgeniya Gorobets V ????? ??????? V Beijing Team 3 1 Corinna Heinrich IV Los Vathros 2 Evangelos Charatsis V Dimitrios Sois V Mika training, z.s. 1 Michal Hanzl V Tri Belles UAE 2 Louisa Fagan V Jessica Verstegen V CycleON 1 Anton Kharchenko V JusTTri (RU) 1 Alexey Kamynin IV RadStrong Tri 2 Vaidya Dr. -

Issue No: 390 October/November 2019 Editor
Issue No: 390 October/November 2019 Editor: Dave Ainsworth CENTURIONS' SOCIAL WALK, EPPING FOREST, SATURDAY 19 OCTOBER We will meet at Loughton rail station at 10.00 am for a 6 miles' stroll around Epping Forest. The walk will be led by local resident Richard Howard and conclude with a visit to a tea room, back near Loughton High Street. Toilets are available at the station (Central Line), which has an NCP car park - cost for Saturday is £3. Any questions, phone Steve Kemp on 07860-617899. Adds Hon Ed: It's open to all, not just Centurions, plus family members and friends. It's an enjoyable social walk - not a race! It's also an opportunity for our local Essex/Home Counties' race walking scene to come together for an enjoyable social day out. Let's see a good turnout - as all are welcome! Loughton Rail Station post code is IG10 4PD. Bus routes to Loughton Station: 20 (Walthamstow Central-to-Debden taking in Leyton/Whipps Cross/Woodford Green), 167 (Ilford-to-Loughton Station taking in Gants Hill/BarkingsideGrange Hill/Chigwell/Buckhurst Hill) and 397 (Debden-to- Crooked Billet taking in Buckhurst Hill/Woodford Wells/Chingford). INTER-COUNTIES DOOM AND GLOOM Twice race walking has been thrown out of your annual CAU Inter-Counties' Championship meeting, owing to dismal turnouts. Pity, as our walks are part of a major track and field meeting before a crowd. Each time, we were then off the programme for some time, only being re- admitted after vigorous campaigning by Peter Cassidy, Laurie Kelly, Peter Marlow, Roger Mills and others. -
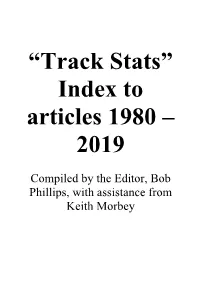
Track Stats Index
“Track Stats” Index to articles 1980 – 2019 Compiled by the Editor, Bob Phillips, with assistance from Keith Morbey Note: this Index lists every 11. Book Reviews notable mention in text of names 12. Editorials and subjects. Apologies for not giving page numbers! Any additions or amendments would be welcomed by the Editor, [email protected] Volume Numbers: 1. Athletes/Coaches 18, 1980; 19, 1981; 20, 1982; 21, 1983; 22, 1984; 23, 1985; Included in this Index are athletes who are (i) 24, 1986; 25, 1987; 26, 1988; the subject of a specific article; or (ii) are prominently featured in an article; or 27, 1989; 28, 1990; 29, 1991; (iii) are featured in a “Brief” article. All GB 30, 1992; 31, 1993; 32, 1994; unless otherwise stated. Athletes mentioned in 33, 1995; 34, 1996, 35, 1997; passing in articles or appearing only in 36, 1998, 37, 1999, 38, 2000; ranking-lists are not included. 39, 2001, 40, 2002, 41, 2003; B Brief reference only (separate item) 42, 2004, 43, 2005, 44, 2006; * Personal interview by the author or article 45, 2007; 46, 2008; 47, 2009; written or composed by the subject 48, 2010; 49, 2011; 50, 2012; 51, Aaron, Frank 48-2 2013; 52, 2014; 53, 2015; 54, Abraham, Arthur (Ger) 57-1 B Abrahams, Harold 29-1, 36-3, 36-4, 37-1, 49-3, 2016; 55, 2017, 56, 2018, 57, 2019. 49-4, 50-1 B, 50-2, 50-3, 51-2 B Achon, Julius (Uga) 55-4 Index Titles: Adams, Platt (USA) 57-3 B Adcocks, Bill 38-2, 38-3, 54-1* Adedoyin, Prince Adegboyega 36-1, 56-2 1. -

Victorian Marathon Club Newsletter
# V VMC ROAD RUNNERS NEWSLETTER SEPTEMBER 1982 PRICE $1.00 SEPTEMBER 1982 PRICE $1.00 ANDY LLOYD on his way to take EMIL ZATOPEK 10,000 m. VMC CHAMPIONSHIP December, 1981. Triple Winner of BIG “M” MELBOURNE MARATHON, October 1979, 1980 and 1981. Who will win this October and December? Registered for posting as periodical VBH0488. THE V.M.C.ROAD RUNNERS NEWSLETTER is published for the Information of umbers of the V.M.C.BOAD RUNNERS and is covered by the payment of the Annual Membership Fee. It is issued four times a year* SPRING(September) SUMMER(December) ATTTUMN(March) WlNTKh(June) • All athletes. Irrespective of age or sex, are invited to contribute letters, results, comments, criticisms,etc., to the Editor, 1 Golding St.,CANTERBURY, 3126, Viotoria* PLEASE NOTE that material submitted for publication SHOULD BE on single-spaced, typed A 4 sheets, Irrespective of length, to facilitate lay-out* Articles should not exceed one and a half pages of A 4, preferably half that. Articles for publication MUST BE aooompaMed by the name and address of the contributor, together with his or her signature* The author of the article shall retaih full responsibility for the content of such article. DEADLINE FOR COPY is the 10th day of the month preceding the month of publication, we ask contributors to aim for the 1st day of that month to make editing less rushed* M CHANGES U INTERSTATE LIMES OP COMMUNICATIONS : UA.A.U. of AUSTRALIA: Rick PABNELL, Olympic Park Wo.1,Swan St,MELBOURNE 3002,(03)429 5077 NSW A.A.A.x Clive LEE, P.O.Box N101 ,Grosvenor St,SYDNET 2001, (02) 241 35 38 IIV.A.A. -

Rotherham Runner Rotherham Harriers & AC March 2007 Ser 4 No 32
Rotherham Runner Rotherham Harriers & AC March 2007 Ser 4 No 32 National Cross-country Steve Gaines reports: U17s Make Yorkshire History Cian Scothern After a good and supportive cross- RHAC Under-17s made history on Saturday by being the first Yorkshire club Stef Burns also had her best result of the season finishing country season Cian had a morn- ever to retain a title won the previous year, thereby joining the four previous 6th in the U15 race. This follows her 4th in the area, and ing out at the Treeton event. successes– Sale, Bedford, Leicester and Aldershot. 8th in the intercounties. An excellent season with great In fact he was prepared to run the results at the highest level of domestic competition. 5k but entry rules didn’t allow! This was another good day for the club, with tremendous individual and team On the organisational side; Thanks to Janice & Keith Bar- results. The weather was on the wild side, and would have undoubtedly been nes for organising the overnight stay and trip, thanks to hard work for the runners. It was harder for the tent erection team, and even Dave Johnson for driving the minibus, and (since he didn't harder on the tent, which had to be retired from the event with injury before the have to go through Bradford) not getting lost. Thanks to senior men's race had started. Apologies to the band of supporters who be- Pete Shaw, Pete Neal, & Nigel for their help with the tent. came destitute, but thankfully it never rained. I gave some rudimentary instruc- tion on how to avoid hypothermia (Huddle together wrapped in the ground- Thanks to all the coaches and parents for their support for sheet facing someone with their feet in your armpits, and vice versa), but one the athletes, and their help hanging on to the tent.