Rapport De Synthese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

VEGETALE : Semences De Riz
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ********* UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI DIRECTION NATIONALE DE L’AGRICULTURE APRAO/MALI DNA BULLETIN N°1 D’INFORMATION SUR LES SEMENCES D’ORIGINE VEGETALE : Semences de riz JANVIER 2012 1 LISTE DES ABREVIATIONS ACF : Action Contre la Faim APRAO : Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest CAPROSET : Centre Agro écologique de Production de Semences Tropicales CMDT : Compagnie Malienne de Développement de textile CRRA : Centre Régional de Recherche Agronomique DNA : Direction Nationale de l’Agriculture DRA : Direction Régionale de l’Agriculture ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics IER : Institut d’Economie Rurale IRD : International Recherche Développement MPDL : Mouvement pour le Développement Local ON : Office du Niger ONG : Organisation Non Gouvernementale OP : Organisation Paysanne PAFISEM : Projet d’Appui à la Filière Semencière du Mali PDRN : Projet de Diffusion du Riz Nérica RHK : Réseau des Horticulteurs de Kayes SSN : Service Semencier National WASA: West African Seeds Alliancy 2 INTRODUCTION Le Mali est un pays à vocation essentiellement agro pastorale. Depuis un certain temps, le Gouvernement a opté de faire du Mali une puissance agricole et faire de l’agriculture le moteur de la croissance économique. La réalisation de cette ambition passe par la combinaison de plusieurs facteurs dont la production et l’utilisation des semences certifiées. On note que la semence contribue à hauteur de 30-40% dans l’augmentation de la production agricole. En effet, les semences G4, R1 et R2 sont produites aussi bien par les structures techniques de l’Etat (Service Semencier National et l’IER) que par les sociétés et Coopératives semencières (FASO KABA, Cigogne, Comptoir 2000, etc.) ainsi que par les producteurs individuels à travers le pays. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Bamako, Le 5 Avril 2017 Adama SISSOUMA Chevalier De L'ordre
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI TERRITORIAL, DE LA DECENTRALISATION Un Peuple-Un But-Une Foi ET DE LA REFORME DE L'ETAT *************** ******************* SECRETARIAT GENERAL ******************* LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ENSEIGNANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR ORDRE DE MERITE Session de 2017 NIVEAU :ENSEIGNEMENT NORMAL SPECIALITE : Anglais PRENOMS NOM SEXE RANG REGION CENTRE SALLE PLACEN° LIEU_NAISS DATE_NAISS 1 9 Souleymane FOMBA M 00/00/1985 Decnekoro GS JEAN RICHARS 5 1 2 7 Moussa Hassane SIDIBE M Vers 1989 Ansongo GAO 10 2 Fe Bamako, Le 5 Avril 2017 P/MINISTRE P.O Le Secrétariat Général Adama SISSOUMA Chevalier de l'Ordre National Concours direct de recretement d' enseignants dans la fonction publique des collectivites territoriales, Enseignement Normal Anglais session 2017 1/1 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI TERRITORIAL, DE LA DECENTRALISATION Un Peuple-Un But-Une Foi ET DE LA REFORME DE L'ETAT *************** ******************* SECRETARIAT GENERAL ******************* LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ENSEIGNANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR ORDRE DE MERITE Session de 2017 NIVEAU :ENSEIGNEMENT NORMAL SPECIALITE : Arabe PRENOMS NOM SEXE RANG REGION CENTRE SALLE PLACEN° LIEU_NAISS DATE_NAISS 1 9 Mahamadou KONTA M 20/05/1987 Bamako GS JEAN CHICHARD 7 25 2 9 Abdoul Hamid BENGALY M 00/001982 Kléla GS JEAN CHICHARD 7 5 3 9 Mouna Aïcha HAIDARA M 20/03/1984 BAMAKO GS JEAN CHICHARD -

Programme National De Developpement Des Plateformes Multifonctionnelles Pour La Lutte Contre La Pauvrete 2017 - 2021
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME RÉPUBLIQUE DU MALI DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SECRETARIAT GENERAL PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 2017 - 2021 Durée : 5 ans (2017 - 2021) Couverture géographique : Territoire National Coût de réalisation: 55 497 925 000 FCFA • Contribution du gouvernement : 8 558 525 000 FCFA • Contribution des bénéficiaires : 2 500 000 000 FCFA • Financements et Partenariats à rechercher : 44 439 400 000 FCFA Novembre 2016 Table des matières Sigles et Abréviations .......................................................................................................................................... 4 RESUME DU PROGRAMME ................................................................................................................... 6 Résumé exécutif .................................................................................................................................................. 7 1.2. Problématiques et enjeux ......................................................................................................................... 13 1.3. Objectifs de développement et cadrage politique .................................................................................... 14 II. STRATEGIES ET POLITIQUES NATIONALES ET SECTORIELLES ........................................................................... 15 2.1. Stratégies et Politiques nationales ............................................................................................................ -

MINISTERE DE L'environnement REPUBLIQUE DU MALI ET DE L
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE/UN BUT/UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DU 24 AU 26 JANVIER 2012 SELON LE SATTELITE MODIS Latitudes Longitudes Villages Communes Cercles Régions 11.5010000000 -8.4430000000 Bingo Tagandougou Yanfolila Sikasso 11.2350000000 -7.7150000000 Nianguela Kouroumini Bougouni Sikasso 10.3860000000 -8.0030000000 Ouroudji Gouandiaka Yanfolila Sikasso 13.5840000000 -10.3670000000 Oualia Oualia Bafoulabé Kayes 13.7530000000 -11.8310000000 Diangounte Sadiola Kayes 13.7500000000 -11.8160000000 12.8310000000 -9.1160000000 12.9870000000 -11.4000000000 Sakola Sitakily Kéniéba Kayes 12.9400000000 -11.1280000000 Gouluodji Baye Kéniéba 12.9370000000 -11.1100000000 12.9330000000 -11.1170000000 12.6190000000 -10.2700000000 Kouroukoto Kouroukoto Kéniéba Kayes 12.4730000000 -9.4420000000 Kamita Gadougou2 Kita Kayes 12.4690000000 -9.4490000000 12.1210000000 -8.4200000000 Ouoronina Bancoumana Kati Koulikoro 12.1090000000 -8.4270000000 12.3920000000 -10.4770000000 Madina Talibé Sagalo 12.4750000000 -11.0340000000 Koulia Faraba 12.4720000000 -11.0160000000 12.2010000000 -10.6680000000 Sagalo Sagalo 12.1980000000 -10.6480000000 Kéniéba Kayes 12.1990000000 -10.6550000000 12.4560000000 -10.9730000000 Koulia Faraba 12.4530000000 -11.0060000000 12.4670000000 -10.9820000000 13.2250000000 -10.2620000000 Manatali Bamafélé Bafoulabé Kayes 13.2340000000 -10.2350000000 Toumboubou Oualia 13.2300000000 -10.2710000000 -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

PROGRAMME ATPC Cartographie Des Interventions
PROGRAMME ATPC Cartographie des interventions Agouni !( Banikane !( TOMBOUCTOU Rharous ! Ber . !( Essakane Tin AÎcha !( Tombouctou !( Minkiri Madiakoye H! !( !( Tou!(cabangou !( Bintagoungou M'bouna Bourem-inaly !( !( Adarmalane Toya !( !( Aglal Raz-el-ma !( !( Hangabera !( Douekire GOUNDAM !( Garbakoira !( Gargando Dangha !( !( G!(ou!(ndam Sonima Doukouria Kaneye Tinguereguif Gari !( .! !( !( !( !( Kirchamba TOMBOUCTOU !( MAURITANIE Dire .! !( HaÏbongo DIRE !( Tonka Tindirma !( !( Sareyamou !( Daka Fifo Salakoira !( GOURMA-RHAROUS Kel Malha Banikane !( !( !( NIAFOUNKE Niafunke .! Soumpi Bambara Maoude !( !( Sarafere !( KoumaÏra !( Dianke I Lere !( Gogui !( !( Kormou-maraka !( N'gorkou !( N'gouma Inadiatafane Sah !( !( !( Ambiri !( Gathi-loumo !( Kirane !( Korientze Bafarara Youwarou !( Teichibe !( # YOUWAROU !( Kremis Guidi-sare !( Balle Koronga .! !( Diarra !( !( Diona !( !( Nioro Tougoune Rang Gueneibe Nampala !( Yerere Troungoumbe !( !( Ourosendegue !( !( !( !( Nioro Allahina !( Kikara .! Baniere !( Diaye Coura !( # !( Nara Dogo Diabigue !( Gavinane Guedebin!(e Korera Kore .! Bore Yelimane !( Kadiaba KadielGuetema!( !( !( !( Go!(ry Youri !( !( Fassoudebe Debere DOUENTZA !( .! !( !( !(Dallah Diongaga YELIMANE Boulal Boni !( !(Tambacara !( !( Takaba Bema # # NIORO !( # Kerena Dogofiry !( Dialloube !( !( Fanga # Dilly !( !( Kersignane !( Goumbou # KoubewelDouentza !( !( Aourou !( ## !( .! !( # K#onna Borko # # #!( !( Simbi Toguere-coumbe !( NARA !( Dogani Bere Koussane # !( !( # Dianwely-maounde # NIONO # Tongo To !( Groumera Dioura -

Sikasso and the District Geographic Coverage of Bamako (Cities and Or Countries)
USAID/MALI SELECTIVE INTERATED READING ACTIVITY (SIRA) Annual Report October 01, 2018 to September 30, 2019 Submission Date: October 30, 2019 Contract Number: AID-688-TO-16-0005 under IDIQC No. AID-OAA-I-14-00053 Activity Start Date and End Date: 02/08/2016 to 02/07/2021 COR: Binta Bocoum Submitted by: Thelma Khelghati, Chief of Party Adwoa Atta-Krah, Project Director Emails: [email protected]/ [email protected] Education Development Center Rue 209, Porte 45 Hamdallaye ACI 2000, Bamako Tel: (223) 2029 0018 July 2008 1 1. PROGRAM OVERVIEW/SUMMARY USAID Mali/SIRA (Selective Integrated Reading Activity) Program Name: Activity Start Date And End February 8, 2016 to February 7, 2021 Date: Name of Prime Education Development Center Implementing Partner: [Contract/Agreement] AID-688-TO-16-0005 under IDIQC No. AID-OAA-I-14-00053 Number: Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES), Save the Children, Name of Subcontractors School to School International, Cowater Sogema Total Estimated Cost $50,238,635.59 Major Counterpart Ministry of National Education (MEN) Organizations Mali: Administrative regions of Koulikoro, Ségou, Sikasso and the District Geographic Coverage of Bamako (cities and or countries) October 1, 20181 through September 30, 2019 Reporting Period: 1.1. TABLE OF CONTENTS 1. Program Overview/Summary .......................................................................... 0 1.1. Table of Contents .............................................................................................. 1 1.2. List of Acronyms ............................................................................................... -

Resultats Definitifs De La 2 Session Faculte Des Sciences Humaines (S.E.D.)
Résultats définitifs de la deuxième Session - Licence SED MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Un Peuple -Un But - Une Foi ******************* ******************* UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO (ULSHB) ème ******************* RESULTATS DEFINITIFS DE LA 2 SESSION FACULTE DES SCIENCES HUMAINES (S.E.D.) ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION (FSHSE) ******************* DER/SCIENCES DE L'EDUCATION (SED) Année Universitaire : 2014 - 2015 CLASSE : LICENCE CAS DE FRAUDE DOMINANTES OBLIGATOIRES S. D. O UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 Total Observ. N° N° Matricule Nouveau MLE Prénom (S) Nom sexeStatut Scol Politiq Planif. Méth. de Recher. Psy Elab. Socio Anth UV Moy Moy éduc. éduc. cours T P Moy scol Rapp, Educ. Educ 1 ABAR0000921100 11F1F27831D Arafa ABBAS F Rég Red 1 12 8 12 10 12 8 10 8 12 10 4 Déro 2 ABNA0609961200 12E1F12127J Nana Safi ABDEL KADER F Rég Pas 10 10 2 11 6,5 6 6 6 9 11 10 3 Redouble 3 ABHA0110941200 12R1F07714Z Hamsatou ABDOU F Rég Pas 10 8 9 11 10 10 15 12,5 6 10,5 8,25 3 Redouble 4 ABMA0101941200 12J1M04551K Mahamadou ABDOU M Rég Pas 15 11 12 12 12 12 8 10 10 14 12 5 Admis 5 ABOM2606921200 12E1M03855X Omorou ABDOU M Rég Pas 16 13 12,5 11 11,75 12 15,5 13,75 12 13,5 12,75 5 Admis 6 ABMO0000921200 12Q1F02430K Moussa ABDOUL WAHID F Rég Pas 13,5 11 12,5 17 14,75 11 15,5 13,25 11 12,75 11,88 5 Admise 7 ABAL0000931200 12J1M04553M Alpha Sidaly ABDOULAYE M Rég Pas 11 11 10,5 11 10,75 11 12 11,5 10 10 10 5 Admis 8 ABHA1209921000 10F1M15325P Halidou ABDOULAYE M Rég Pas 17 16 14,5 8 11,25 13 12 12,5 13,5 12 12,75 5 Admis 9 ABMA1003931100 11F1M27479U Mahamane ABOUBACRINE M Rég Pas 5 10 2 6 4 11,5 15 13,25 10 12 11 3 Redouble 10 ABOU0000921200 12E1M12122O Ousmane ABOUBACRINE M Rég Pas 10 11 10 12 11 11,5 14,5 13 12 10,75 11,38 5 Admis 11 ADFA2002921100 11F1F27850O Fatoumata A. -

Admis Bt2 Aebrg 2020
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI MEN Un Peuple - Un But - Une Foi ******************* GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO ******************* ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BAMAKO RIVE GAUCHE ******************* LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BREVET DE TECHNICIEN 2ème PARTIE SESSION DE NOVEMBRE 2020 CENTRE DE CORRECTION DE BAMAKO RIVE GAUCHE SPECIALITE : DOUANES N° PRENOMS NOM DATE NAISS Lieu_Nais ETABLIS MENTION PLACE SEXE 42 Habi BAH F 07/07/1992 BAMAKO ISTCC PASSABLE 114 Drissa CAMARA M 14/07/1989 Bamako I.S-S.A ASSEZ-BIEN 306 Lamine COULIBALY M 06/05/1998 BAMAKO ISFIC ASSEZ-BIEN 334 Naman COULIBALY M 01/03/1991 Bamako CL/AE PASSABLE 369 Taboure COULIBALY M 01/01/1997 KOGONI STATION CFTC ASSEZ-BIEN 489 Kolon DIABATE M 21/08/1994 Badjila I.S-S.A ASSEZ-BIEN 529 Karamoko DIAKITE M 13/06/1993 Dioïla CFPA-MAGASSA PASSABLE 563 Aïssatou DIALLO F 23/03/1993 Bamako INSFED PASSABLE 579 Djibril DIALLO M 23/06/1995 Bamako INTEC-B BIEN 632 Zoumana DIAO M 19/06/1992 Bamako INTEC-B ASSEZ-BIEN 656 Assitan DIARRA F 26/04/1984 BAMAKO ISTCC PASSABLE 736 Modibo DIARRA M 16/08/1996 BAMAKO CF-TALIB PASSABLE 876 Fadimata DOUMBIA F 01/11/1990 Bamako I.S-S.A PASSABLE 900 Moussa DOUMBIA M 16/10/1998 Bamako INTEC-B BIEN 921 Mahamadou DRAME M 12/02/1991 BAMAKO ISTCC PASSABLE 999 Oumar HAIDARA M 22/09/1995 Bamako I.S-S.A PASSABLE 1002 Hamsa HASSANE F Vers 1998 Badji- Gourma INTEC-B ASSEZ-BIEN 1268 Alima KONATE F 17/11/1993 Bamako ESCAE PASSABLE 1289 Massaran KONATE F 01/01/1996 Yorosso CFPA-MAGASSA PASSABLE 1290 Namory KONATE M 10/02/1994 KITA CF-TALIB -
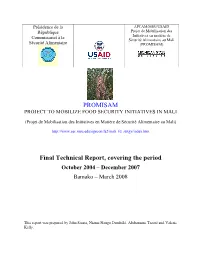
PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period
Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ...............................................................................................