Introduction Et Invasion De L'algue Tropicale Caulerpa Taxifolia En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Caulerpa Brownii
Caulerpa brownii 50.650 (C Agardh) Endlicher MACRO tubular forked Techniques needed and plant shape PLANT (dichot- omous) Classification Phylum: Chlorophyta; Order: Bryopsidales; Family: Caulerpaceae *Descriptive name spiny caulerpa; §Brown’s caulerpa” Features 1. plants green to dark green, 30-400mm tall 3. upright parts arise from a horizontal runner covered with short, soft spines 4. upright parts cylindrical, 6mm in diameter, simple or forked 1-2 times 5. upright parts densely covered in short, soft “spines” (= ultimate branches or ramuli) forked at their bases Variations branches may be more robust on rough water coasts Special requirements view the “spines” (ramuli) on the upright parts to find the forking at the base Occurrences from S W Australia to Victoria, Tasmania, Lord Howe I., and New Zealand Usual Habitat on hard surfaces just below low water level to 42m deep, often in large patches Similar Species the species has distinctive plant and ramuli shapes. Description in the Benthic Flora Part I, pages 261, 263, 264 Details of Anatomy 1. 2. 1, 2. Caulerpa brownii from Corny Point, S Yorke Peninsula, S Australia 1. specimen approximately life size, showing the spine covered runner with rhizoids beneath and upright branches with rows of forked, spiny ultimate branches (ramuli). 2. magnified view with the basal forking of a ramulus arrowed * Descriptive names are inventions to aid identification, and are not commonly used § name used in Edgar, G. Australian Marine Life, 2nd Ed. (2008) “Algae Revealed” R N Baldock, S Australian State Herbarium, September 2003 Caulerpa brownii (C Agardh) Enlicher from S Australia 3. at Port Elliot, growing in a characteristic mass in shallow water 4. -

Fingerprinting Marine Macrophytes in Blue Carbon Habitats
Fingerprinting Marine Macrophytes in Blue Carbon Habitats Thesis by Alejandra Ortega In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Bioscience King Abdullah University of Science and Technology Thuwal, Kingdom of Saudi Arabia November, 2019 2 EXAMINATION COMMITTEE PAGE The thesis of Alejandra Ortega is approved by the examination committee. Committee Chairperson and Thesis Supervisor: Prof. Carlos M. Duarte Committee Members: Prof. Mark Tester, Prof. Takashi Gojobori, and Prof. Hugo de Boer [External] 3 © November, 2019 Alejandra Ortega All Rights Reserved 4 ABSTRACT Fingerprinting Marine Macrophytes in Blue Carbon Habitats Alejandra Ortega Seagrass, mangrove, saltmarshes and macroalgae - the coastal vegetated habitats, offer a promising nature-based solution to climate change mitigation, as they sequester carbon in their living biomass and in marine sediments. Estimation of the macrophyte organic carbon contribution to coastal sediments is key for understanding the sources of blue carbon sequestration, and for establishing adequate conservation strategies. Nevertheless, identification of marine macrophytes has been challenging and current estimations are uncertain. In this dissertation, time- and cost-efficient DNA-based methods were used to fingerprint marine macrophytes and estimate their contribution to the organic pool accumulated in blue carbon habitats. First, a suitable short-length DNA barcode from the universal 18S gene was chosen among six barcoding regions tested, as it successfully recovered degraded DNA from sediment samples and fingerprinted marine macrophyte taxa. Second, an experiment was performed to test whether the abundance of eDNA represents the content of organic carbon within the macrophytes; results supported this notion, indicating a positive correlation (R2 = 0.85) between eDNA and organic carbon. -

Natural Products of Marine Macroalgae from South Eastern Australia, with Emphasis on the Port Phillip Bay and Heads Regions of Victoria
marine drugs Review Natural Products of Marine Macroalgae from South Eastern Australia, with Emphasis on the Port Phillip Bay and Heads Regions of Victoria James Lever 1 , Robert Brkljaˇca 1,2 , Gerald Kraft 3,4 and Sylvia Urban 1,* 1 School of Science (Applied Chemistry and Environmental Science), RMIT University, GPO Box 2476V Melbourne, VIC 3001, Australia; [email protected] (J.L.); [email protected] (R.B.) 2 Monash Biomedical Imaging, Monash University, Clayton, VIC 3168, Australia 3 School of Biosciences, University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010, Australia; [email protected] 4 Tasmanian Herbarium, College Road, Sandy Bay, Tasmania 7015, Australia * Correspondence: [email protected] Received: 29 January 2020; Accepted: 26 February 2020; Published: 28 February 2020 Abstract: Marine macroalgae occurring in the south eastern region of Victoria, Australia, consisting of Port Phillip Bay and the heads entering the bay, is the focus of this review. This area is home to approximately 200 different species of macroalgae, representing the three major phyla of the green algae (Chlorophyta), brown algae (Ochrophyta) and the red algae (Rhodophyta), respectively. Over almost 50 years, the species of macroalgae associated and occurring within this area have resulted in the identification of a number of different types of secondary metabolites including terpenoids, sterols/steroids, phenolic acids, phenols, lipids/polyenes, pheromones, xanthophylls and phloroglucinols. Many of these compounds have subsequently displayed a variety of bioactivities. A systematic description of the compound classes and their associated bioactivities from marine macroalgae found within this region is presented. Keywords: marine macroalgae; bioactivity; secondary metabolites 1. -

A Literature Review on the Poor Knights Islands Marine Reserve 30
4. Marine flora There is a rich abundance and diversity of macroalgae at the Poor Knights Islands with 121 species of algae recorded from the islands. A thorough taxonomic survey of the macroalgae of the Poor Knights Islands has not been conducted, and therefore this is likely to be a conservative estimate of the number of macroalgal species present. Some of the lushest kelp beds in New Zealand can be found at Nursery Cove and Cleanerfish Bay and subtidal reefs are covered with the golden seawrack, Carpophyllum angustifolium, the strap kelp, Lessonia variegata, and the common kelp, Ecklonia radiata (Ayling & Schiel, 2003). The marine flora of the Poor Knights Islands is an unusual mixture of species common to northeastern New Zealand such as C. angustifolium and Gigartina alveata, subtropical species such as Pedobesia clavaeformis, Microdictyon umbilicatum, and Palmophyllum umbracola, and southern New Zealand species, such as Durvillea antarctica and Caulerpa brownii. Bull kelp (D. antarctica) is a common species in southern New Zealand, but is not found in the North Island between North Cape and East Cape with the exception of some exposed offshore islands including the Poor Knights Islands. It is possible that at high levels of wave exposure D. antarctica can withstand higher water temperatures (Creese & Ballantine, 1986). Several rare species of macroalgae are found at the Poor Knights Islands. In 1994 the rare, endemic red alga, Gelidium allanii, was discovered with a sample of Pterocladia capillacea taken from the Poor Knights Islands in 1978. Prior to 1994 G. allanii had only been recorded from the type locality in the Bay of Islands. -
Marine Drugs
marine drugs Review Natural Products of Marine Macroalgae from South Eastern Australia, with Emphasis on the Port Phillip Bay and Heads Regions of Victoria James Lever 1 , Robert Brkljaˇca 1,2 , Gerald Kraft 3,4 and Sylvia Urban 1,* 1 School of Science (Applied Chemistry and Environmental Science), RMIT University, GPO Box 2476V Melbourne, VIC 3001, Australia; [email protected] (J.L.); [email protected] (R.B.) 2 Monash Biomedical Imaging, Monash University, Clayton, VIC 3168, Australia 3 School of Biosciences, University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010, Australia; [email protected] 4 Tasmanian Herbarium, College Road, Sandy Bay, Tasmania 7015, Australia * Correspondence: [email protected] Received: 29 January 2020; Accepted: 26 February 2020; Published: 28 February 2020 Abstract: Marine macroalgae occurring in the south eastern region of Victoria, Australia, consisting of Port Phillip Bay and the heads entering the bay, is the focus of this review. This area is home to approximately 200 different species of macroalgae, representing the three major phyla of the green algae (Chlorophyta), brown algae (Ochrophyta) and the red algae (Rhodophyta), respectively. Over almost 50 years, the species of macroalgae associated and occurring within this area have resulted in the identification of a number of different types of secondary metabolites including terpenoids, sterols/steroids, phenolic acids, phenols, lipids/polyenes, pheromones, xanthophylls and phloroglucinols. Many of these compounds have subsequently displayed a variety of bioactivities. A systematic description of the compound classes and their associated bioactivities from marine macroalgae found within this region is presented. Keywords: marine macroalgae; bioactivity; secondary metabolites 1. -
Caulerpa Taxifolia Conference Proceedings
UC San Diego Conference Proceedings Title International Caulerpa taxifolia Conference Proceedings Permalink https://escholarship.org/uc/item/16c6578n Authors Williams, Erin Grosholz, Edwin Publication Date 2002-12-31 eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California International Caulerpa taxifolia Conference Proceedings January 31 – February 1, 2002 San Diego, California, U.S.A. This publication was supported in part by the National Sea Grant College Program of the U.S. Department of Commerce’s National Oceanic Published by the California Sea Grant and Atmospheric Administration under NOAA College Program Grant #NA06RG0142, project number A/P-1, University of California, San Diego through the California Sea Grant College La Jolla, California 92093 Program. The views expressed herein do not www.csgc-ucsd.edu necessarily reflect the views of any of those 2002 organizations. Cover photo by A. Meinesz International Caulerpa taxifolia Conference Proceedings January 31–February 1, 2002 San Diego, California U.S.A. Hosted by the University of California Cooperative Extension With Support From: California Department of Fish & Game California Sea Grant College Program U.S. Fish & Wildlife Service, Aquatic Nuisance Species Task Force Proceedings Assistance Provided by: California Sea Grant College Program Edited by: Erin Williams Outreach Coordinator Department of Environmental Science & Policy University of California, Davis Edwin Grosholz Associate Specialist in Cooperative Extension Department of Environmental Science & Policy University of California, Davis California Sea Grant College Program University of California La Jolla, California 92093-0232 www-csgc.ucsd.edu Publication No. T-047 ISBN 1-888691-11-5 Acknowledgments First, we would like to thank the scientists, managers, and educators for their participation during the workshop and for the considerable time invested both before and after the workshop. -
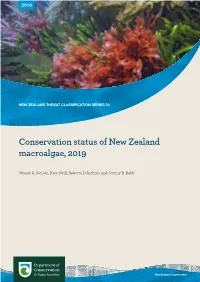
Conservation Status of New Zealand Macroalgae, 2019
2019 NEW ZEALAND THREAT CLASSIFICATION SERIES 30 Conservation status of New Zealand macroalgae, 2019 Wendy A. Nelson, Kate Neill, Roberta D’Archino and Jeremy R. Rolfe Cover: Red, brown and green marine algae photographed subtidally at Port Pegasus, Stewart Island. Photo: Roberta D’Archino. New Zealand Threat Classification Series is a scientific monograph series presenting publications related to the New Zealand Threat Classification System (NZTCS). Most will be lists providing NZTCS status of members of a plant or animal group (e.g. algae, birds, spiders), each assessed once every 5 years. From time to time the manual that defines the categories, criteria and process for the NZTCS will be reviewed. Publications in this series are considered part of the formal international scientific literature. This report is available from the departmental website in pdf form. Titles are listed in our catalogue on the website, refer www.doc.govt.nz under Publications. © Copyright August 2019, New Zealand Department of Conservation ISSN 2324–1713 (web PDF) ISBN 978–1–98–851497–0 (web PDF) This report was prepared for publication by the Publishing Team; editing and layout by Lynette Clelland. Publication was approved by the Director, Terrestrial Ecosystems Unit, Department of Conservation, Wellington, New Zealand. Published by Publishing Team, Department of Conservation, PO Box 10420, The Terrace, Wellington 6143, New Zealand. In the interest of forest conservation, we support paperless electronic publishing. CONTENTS Abstract 1 1. Summary 2 1.1 Trends 3 2. Conservation status of New Zealand macroalgae, 2019 4 3. Acknowledgements 31 4. References 32 Conservation status of New Zealand macroalgae, 2019 Wendy A. -

A Critical Survey of the Marine Algae of Southern Australia
A CRITICAL SURVEY OF THE MARINE ALGAE OF SOUTHERN AUSTRALIA I. CHLOROPHYTA [LVanuscript received January 16, 19561 Summary This paper is a survey of all the known marine Chlorophyta of southern Australia, from the south-west corner of Western Australia to about the Victoria- New South Wales border, and including Tasmania. Full references to each species are given, all established synonomy, the type locality of each species and where the type specimen is deposited, and a summary of the known distribution. Critical notes on many species are given also. The need for a critical survey of the marine algae of southern Australia has been obvious for many years. The lists of Lucas (1912, 1913) of the marine algae of Australia were little more than an extraction from De Toni's "Sylloge Algarum" (De Toni 1889), without references, and with distribution records summarized so much as to be of little value. Lucas's (1928) list of Tasmanian algae has the same limitations, while his (1936) account of the marine algae of South Australia gives no references and is now very incomplete. May (1938 and later papers) has given a better account of many of the New South Wales species, but a complete survey of the known species of both the eastern and western coasts of Australia, as well as the north, is needed. In many cases it is still necessary to refer to Harvey's "Phycologia Australica" (1858-1863) for a reasonable account of any species. Some years ago the writer compiled a card index of all names that have been applied to southern Australian algae, with all references and distribution records. -

Abundance and Diversity of Molluscs Associated with Caulerpa (Chlorophyta) Beds of Solong-On, Siquijor Island, Philippines 1Billy T
Abundance and diversity of molluscs associated with Caulerpa (Chlorophyta) beds of Solong-on, Siquijor Island, Philippines 1Billy T. Wagey, 2Ariane C. Pacarat, 2Lilibeth A. Bucol 1 Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University, Jln. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, North Sulawesi, Indonesia; 2 Negros Oriental State University, Dumaguete City 6200, Philippines. Corresponding author: B. T. Wagey, [email protected] Abstract. Molluscs are one of the dominant taxa inhabiting Caulerpa communities, serving as an important link to the food web. These organisms utilize Caulerpa communities as their feeding ground, shelter, breeding habitat and serve as their protection from predators. This paper surveyed the abundance and diversity of molluscs found in the Caulerpa beds of Solong-on embayment in northwestern Siquijor Island, central Philippines for four consecutive months (October 2017 to January 2018). Sampling methods used included 0.28 m2 ring quadrats (N = 10 per transect) deployed in three transects. A total of 32 species of molluscs (26 species of gastropods, 6 species of bivalves) was recorded in this study. Among the sampling months, the highest number of species was recorded in January with 28 species, followed by December with 25 recorded species and lowest recorded number of species was obtained in October with only 20 species. Shannon-Wiener diversity index (H’) values ranged from 2.135 to 2.688. Among sampling months, December has the highest obtained H’ value (2.688) while the lowest H’ (2.135) was recorded in November. The obtained H’ values in this study indicate high diversity of molluscs in Solong-on Bay, Tambisan, Siquijor. -

A&MLR NRM Algae
Biodiversity and Conservation of Macroalgae in the Adelaide and Mount Lofty Ranges NRM Region, including an assessment of biodiversity and distribution of macroalgae in the Gulf St Vincent Bioregion A report prepared by Janine L. Baker and Dr C. Frederico D. Gurgel for the Adelaide and Mount Lofty Ranges Natural Resources Management Board May 2011 BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF MACROALGAE IN THE ADELAIDE & MT LOFTY RANGES NRM REGION including an assessment of biodiversity and distribution of macroalgae in the Gulf St Vincent Bioregion REPORT TO ADELAIDE AND MT LOFTY RANGES NATURAL RESOURCES MANAGEMENT BOARD © J. Baker Janine L. Baker1 and Dr C. Frederico D. Gurgel2 1 J. L. Baker, Marine Ecologist: [email protected] 2 School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide ([email protected]); South Australia State Herbarium, Department of Environment and Natural Resources; and South Australia Research and Development Institute, Aquatic Sciences. AUGUST 2010 (Updated MAY 2011) 1 CONTENTS Executive Summary ........................................................................................................... 3 List of Tables ...................................................................................................................... 4 List of Figures .................................................................................................................... 5 Acknowledgments ............................................................................................................. 7 1. Introduction -

Macro Algae As Microhabitat
MACRO ALGAE AS MICROHABITAT: SEAWEED TRAITS AND WAVE ACTION AS PREDICTORS OF INVERTEBRATE EPIFAUNAL DIVERSITY by COLIN ROBERT BATES 1 B.Sc, Simon Fraser University, 1997 M.Sc., University of New Brunswick Fredericton, 2002 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Botany) The University of British Columbia October 2007 © Colin Robert Bates, 2007 ABSTRACT In many coastal environments, anthropogenic stressors yield changes in seaweed biodiversity. Here, I describe three studies addressing how such floristic changes might affect provision of habitat by seaweeds for small mobile invertebrate epifauna. In chapter 2, I used observational and manipulative (transplant) experiments to test how changes in seaweed biodiversity influenced, biodiversity of associated invertebrates. I found that invertebrate epifaunal richness and abundance were not affected by changes in seaweed biodiversity. Invertebrate assemblage structure was, in most cases, not influenced by changes in seaweed composition; only when algal assemblages were composed of monocultures of species with 'foliose' morphologies did I observe a change in invertebrate assemblage structure. Correlations between algal functional composition and invertebrate assemblage structure were observed, but not between algal species composition and invertebrate assemblage structure. These results suggest that changes in seaweed biodiversity will have implications for invertebrate epifauna only under specific scenarios of algal change. In Chapter 3, I tested the performance of host taxonomic relatedness and functional (i.e. morphological) group affiliation as predictors of associated invertebrate epifauna. Neither general framework performed well; invertebrate assemblages found on congeneric host species were as similar as those found on hosts classified in different kingdoms, and taxon richness and abundance of invertebrates varied substantially within seaweed functional groups.