Sommaire Mot De La Présidente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cercles De Silence En France
Cercles de silence en France Ce tableau à titre informatif est encore incomplet au 27 janvier 2010, si vous avez connaisance d’information non indiquée ici, merci de nous en faire part. http://cercledesilence.info Cercle de silence ponctuel pour les villes indiquées en italique REGION Département Date (fréquence) et horaire Lieu de rassemblement pour le Cercle de silence Ville ALSACE 67- Bas-Rhin Haguenau Tous les 30 du mois de 18h à 19h au Forum Place de la République - Zone piétonne de Haguenau Selestat Dernier samedi du mois de 14h à 15h Place de la Victoire Strasbourg Tous les 30 du mois de 18h à 19h Place Kléber 68- Haut-Rhin Colmar Tous les 30 du mois de 18h à 19h Place d’Unterlinden Guebwiller Dernier samedi du mois à 17h Place de l’Hôtel de Ville Mulhouse Dernier samedi du mois à 16h30 Place de la Réunion AQUITAINE 24- Dordogne Périgueux 2e jeudi du mois Place Francheville 33- Gironde Bordeaux Dernier mardi du mois de 18h30 à 19h30 Place Pey-Berland 40- Landes Mont-de-Marsan Le dernier mercredi du mois à 17h30 Place de la Mairie 47- Lot-et-Garonne Agen Le 3e vendredi du mois de 18h à 18h30 Place Wilson Villeneuve-sur-Lot Le 2e vendredi du mois de 18h30 à 19h Rond-Point de la porte d’Agen, devant le mur des fusillés 64- Pyrénées-Atlantiques Bayonne Le 1e vendredi du mois de 18h à 19h Place de la Liberté, devant la Mairie Hendaye rassemblement à l’initiative de Bayonne devant le centre de rétention Pau Dernier mardi du mois de 18h à 19h Place Clémenceau AUVERGNE 03- Allier Moulin le 19 septembre 2009 de 11h à 11h30 Place de la Déportation -

The Theology of the French Reformed Churches Martin I
The Theology of the French Reformed Churches REFORMED HISTORICAL-THEOLOGICAL STUDIES General Editors Joel R. Beeke and Jay T. Collier BOOKS IN SERIES: The Christology of John Owen Richard W. Daniels The Covenant Theology of Caspar Olevianus Lyle D. Bierma John Diodati’s Doctrine of Holy Scripture Andrea Ferrari Caspar Olevian and the Substance of the Covenant R. Scott Clark Introduction to Reformed Scholasticism Willem J. van Asselt, et al. The Spiritual Brotherhood Paul R. Schaefer Jr. Teaching Predestination David H. Kranendonk The Marrow Controversy and Seceder Tradition William VanDoodewaard Unity and Continuity in Covenantal Thought Andrew A. Woolsey The Theology of the French Reformed Churches Martin I. Klauber The Theology of the French Reformed Churches: From Henri IV to the Revocation of the Edict of Nantes Edited by Martin I. Klauber Reformation Heritage Books Grand Rapids, Michigan The Theology of the French Reformed Churches © 2014 by Martin I. Klauber All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any man ner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. Direct your requests to the publisher at the following address: Reformation Heritage Books 2965 Leonard St. NE Grand Rapids, MI 49525 6169770889 / Fax 6162853246 [email protected] www.heritagebooks.org Printed in the United States of America 14 15 16 17 18 19/10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [CIP info] For additional Reformed literature, request a free book list from Reformation Heritage Books at the above regular or e-mail address. -

The Synod of Dort, the Westminster Assembly, and the French Reformed Church, 1618-431 MICHAEL DEWAR
The Synod of Dort, the Westminster Assembly, and the French Reformed Church, 1618-431 MICHAEL DEWAR The European Background In an age of ecumenical councils, from 'Edinburgh, 1910' and 'Amsterdam, 1948' to 'Vatican II', and beyond, it is often forgotten that the Reformers, insular and continental, were no less 'ecumenically' minded in the sixteenth and seventeenth centuries. Richard Baxter wrote, 'The Christian world, since the days of the Apostles, had never a Synod of more excellent divines, taking one thing with another, than this [of Westminster] and the Synod of Dort. '2 These were the nearest to the Council of Trent that Protes tantism was to see. Yet earlier correspondence between Geneva and Canterbury shows that closer union might have been possible three generations before. Calvin had written to Cranmer, 'if I can be of any service, I shall not shrink from crossing ten seas, if need be for that object' ,3 (that is, of uniting the Reformed Churches). This was in 1552, the 'high tide' of Anglican Reformation, with Melanchthon and Bull inger for Cranmer's 'Lambeth Confere~e· also. It is tragic that this ideal, so broadly based on international and eirenic lines, came to nothing until Protestantism at home and abroad was hopelessly divided. For it cannot be urged that the 'Dordrace nists' and the Westminster Fathers were other than polemical in their intentions, and divisive in their results. The sixteenth century left the Reformed Churches inclusive and international. The seventeenth century left them enfeebled but embattled, exclusive and nationalistic. The Synod of Dort, 1618 Inevitably Calvinism was closely equated with Netherlands National ism. -

HISTORY of the STUDY of THEOLOGY [Pt
HISTOEY OF THE STUDY OF THEOLOGY BY CHARLES AUGUSTUS gRIGGS D.D., D.LITT. Prepared for Publication by his Daughter EMILIE GRACE BRIGGS, B.D. VOL. II. NEW YORK CHARLES SCRIBNER'S SONS 1916 Published igt6 All rights reserved CONTENTS PART I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE MIDDLE AGES CHAP. PA01 I. THE STUDY OF THEOLOOT IN THE NINTH AND TENTH .1 CENTURIES ...... 1 II. THE STUDY OF THEOLOGY IN THE ELEVENTH AND TWELFTH CENTURIES . .17 III. THE ORIGIN AND GROWTH OF THE UNIVERSITIES IN THE TWELFTH AND THIRTEENTH CENTURIES . 40 IV. THE DECLINE OF SCHOLASTICISM IN THE FOURTEENTH AND FIFTEENTH CENTURIES . .61 PART II THE MODERN AGE L THE REVIVAL OF LEARNING . .82 IL THE REFORMATION ..... 105 III. THE STUDY OF THEOLOGY IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES .... 143 IV. THB STUDY OF THEOLOGY IN THE NINETEENTH CENTURY ...... 184 BIBLIOGRAPHY ...... 213 INDEX ....... 219 PART I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE MIDDLE AGES CHAPTER I THE STUDY OF THEOLOGY IN THE NINTH AND TENTH CENTURIES 1. A palace school was established by the Franks for the training of princes and nobles ; when Charlemagne ap pointed Alcuin as its superintendent, it rapidly became a great centre of learning. The palace school was founded by one of the pre decessors of Charlemagne for the training of the sons of princes and nobles. As a court school it moved about with the monarch from place to place. Charlemagne himself was trained there.1 He had some knowledge of Greek as well as Latin, and studied with the grammarian, Peter of Pisa ; possibly also with Paul the Deacon (t 797), a Benedictine monk and noted Lombard scholar, who taught Greek at his court for a time, and afterwards wrote a history of the Lombards. -

The Huguenot Influence on English Furniture 1660-1714
THE HUGUENOT INFLUENCE ON ENGLISH FURNITURE 1660-1714 LECTURE TO THE 4 TH INTERNATIONAL HUGUENOT CONFERENCE EMDEN, GERMANY Friday 15 th September, 2006 Based on a dissertation by JAMES GOODWIN, MA, MBA MA History of Art Birkbeck College University of London September 2003 © 2010 James Goodwin INTRODUCTORY SLIDE – James Goodwin, MA, MBA – Arts & Culture Lecturer at Maastricht University - Study based on MA History of Art dissertation at Birkbeck College, University of London 2003 SLIDE - ‘Any church that teaches and encourages the painting of God, encourages idolatry. To paint God is the greatest devotional crime there can be’ Daniel Chamier 1618 - Wrote Daniel Chamier (1565-1621), one of my Huguenot ancestors in 1618, a leading French preacher, who studied with Theodore Beza in Geneva, and played a prominent part in drawing up the 1598 Edict of Nantes. - Ironically, considering the subject of my thesis, his Catholic grandfather, Gonet Chamier, was a painter of religious pictures, who lived in sixteenth century Avignon - The Chamiers’ (later Chamier-Deschamps) departed in 1691 from Dauphine via Neuchatel to London - Another branch of the family moved to Germany - Their emigration typified that of other Huguenots, leading to an exchange of family working custom for English public service, in government and the armed forces - My great grandfather served in the British army in South Africa, India, Hong Kong/China, Japan, and Ireland SLIDE – Sir Anthony Chamier by Sir Joshua Reynolds 1777 - Most notable among them was Sir Anthony Chamier (1725-80), -

International Calvinism and the Making of Puritan New England ( インターナショナル・カルヴィニズムと ピューリタン・ニューイングランドの形成 )
David D. Hall International Calvinism and the Making of Puritan New England ( インターナショナル・カルヴィニズムと ピューリタン・ニューイングランドの形成 ) David D. Hall* Christianity is a religion that has been restlessly expansive ever since it originated in ancient Palestine. The fi rst phase of that expansion saw it spread from Palestine to Asia Minor and the eastern Mediterranean. Several centuries later, it was taking root in western Europe and parts of Africa. Yet another major phase of expansion accompanied the age of exploration that began c. 1450, a period that saw Christianity implanted in the Americas and parts of Asia. Up to this point, Christianity in the west was synonymous with Roman Catholicism; indeed, to this day, Catholicism remains the most visible version of Christianity as a world-spanning religion. But ever since the fracturing of Christianity between Catholics and Protestants in the sixteenth century, Catholicism has had to compete against three main versions of Protestantism: Lutheran, Reformed, and “radical” or Free. Of these three, the Reformed has had a special signifi cance in British North America. Before any of its adherents arrived in the New World, the Reformed had come to power in several Swiss city-states or federations, most famously, Geneva, in much of Rhineland Germany, and in the northern provinces of the Low Countries that broke off from the Spanish empire and became an independent country at the end of the sixteenth century (the United Provinces or the Netherlands). Always subordinate to Catholicism in France, it became the official form of Christianity in Scotland as a consequence of the Scottish Reformation (c. -

Lux Benigna, Being the History of Orange Street Chapel : Otherwise
^BXOliX Ox ORANGE STREHT CHAP iji RICHARD W> PR THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES v^r. I *' - ^ / : J) LUX BENIGNA. gloom."— Lead, kindly Light, amid the encircling H. Newman. A Chapel long endeared to the rehgious circle by its interesting associations.— Rev. S. Luke, Sep. 28th, 1847. This temple of the Most High has long resounded with the songs of Zion. Holy men whose praise is in all the churches, and whose names are embalmed in the me- mories and affections of the people of God, have preached the truths of the everlasting Gospel, and proclaimed a full and free salvation within its walls.—i^^-^or^ of Committee of Orange Street Chape!, 1853. Heartily shall we rejoice to see a day, when, on a spot hallowed by so many sacred recollections of bygone days, there shall arise a new and more commodious edifice in which the worship of God may be perpetuated.— /Z^. 1857. : Lux Bemgna, BEING THE HISTORY OF ORANGE STREET CHAPEL. OTHERWISE CALLED LEICESTER FIELDS CHAPEL, OCCUPIED 1693— 1776 BV THE FRENCH REFUGEE CHURCH FOUNDED IN GLASSHOUSE STREET IN 1688; 1776— 1787 BY MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND; 1787—1888 BY CONGREGATIONAL DISSENTERS; RICHARD W. FREE, M.A., Minister of the Chapel. IDiDct ct proviDct. " Blessed is the man that endureth temptation : for when he is tried he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him.'' !JLon^o^ W. B. WHITTINGHAM & CO., 91, Gracechurch St. 1SS8. [All Rights Reserved.] W. B. WHITTINGHAM & CO., PRINTERS, " THE CHARTERHOUSE PRESS," 91, OEACECHURCH STREET, E.C. -

History and Religion Religionsgeschichtliche Versuche Und Vorarbeiten
History and Religion Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten Herausgegeben von Jörg Rüpke und Christoph Uehlinger Band 68 History and Religion Narrating a Religious Past Edited by Bernd-Christian Otto, Susanne Rau and Jörg Rüpke with the support of Andrés Quero-Sánchez ISBN 978-3-11-044454-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-044595-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-043725-6 ISSN 0939-2580 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ∞ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com TableofContents Historyand Religion 1 Section I Origins and developments Introduction 21 Johannes Bronkhorst The historiography of Brahmanism 27 Jörg Rüpke Construing ‘religion’ by doinghistoriography: The historicisation of religion in the Roman Republic 45 Anders Klostergaard Petersen The use of historiography in Paul: Acase-study of the instrumentalisation of the past in the context of Late Second Temple Judaism 63 Ingvild Sælid Gilhus Flirty fishing and poisonous serpents: Epiphanius of Salamis inside his Medical chestagainstheresies 93 Sylvie Hureau Reading sutras in biographies of Chinese Buddhist monks 109 Chase F. Robinson Historyand -

H-France Review Volume 17 (2017) Page 1
H-France Review Volume 17 (2017) Page 1 H-France Review Vol. 17 (January 2017), No. 10 Olivier Fatio, Louis Tronchin: Une transition calvinienne. Paris: Classiques Garnier, 2015. 1,143 pp. Collection: Histoire des temps modernes, 2. Bibliography and index nominum. 83.00 € (pb) IBSN 978-2- 8124-4622-1. Review by Michaël Green, University of Cordoba. Professor Olivier Fatio is a distinguished theologian from the University of Geneva. Throughout his academic career, he has focused on early modern theology, which is also the subject of the present book. As Fatio states in his preface, this book is the fruit of thirty years of work. Indeed, it is a remarkable achievement, as its 1,143 pages are dense with information on the seventeenth-century Genevan theologian and professor Louis Tronchin. As the title suggests, the main purpose of the author is to elucidate the transition and the development of Tronchin’s theological ideas. Louis Tronchin was born on 4 December 1629 to the pastor and theologian Theodore Tronchin, professor at the Academy of Geneva, a tough father, but a man of theological reputation. His mother, Theodora Rocca, came from a family of religious refugees from Piedmont. Louis studied theology at the academy where his father taught, became a pastor, and then embarked on a Grand Tour, which included London and Leiden. He continued his studies at the renowned Huguenot academy of Saumur, where at the time the principal was Moses Amyraut. After returning to Geneva in 1662, Tronchin served as pastor and then as rector of the Genevan Academy until 1668. -
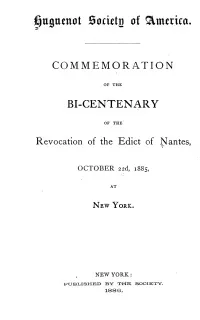
The Edict of Nantes and Its Recall
: §ttgtten0t Socktg of America. COMMEMORATION OF THE BI-CENTENARY OF THE Revocation of the Edict of Nantes, OCTOBER 22d, 1885, AT New York, NEW YORK PUBLISHED BY THE SOCIETY. 18S6,. : OFFICERS OF THE SOCIETY, 1885. President : Hon. JOHN JAY. Vice-Presidents : Edward F. de Lancey, for the City of New Yprk. Hon. Chauncey M. Depew, for Staten Island, N. Y. Henry M. Lester, for New Rochelle, N. Y. Hon. Alphonse T. Clearwater, for New Paltz, N. Y. Hon. Robert C. Winthrop, LL.D. , for Boston, Mass. Hon. Richard Olney, for Oxford, Mass. William Ely, for Narragansett, R. I. Charles M, du Puy, for Pennsylvania. Hon. Thomas F. Bayard, LL.D., for Delaware. Daniel Ravenel, for Charleston, S. C. Secretary : The Rev. Alfred V. Wittmeyer. Treasurer MoREY Hale Bartow. Executive Committee : The Rev. Benjamin F. re Costa, D.D., The Rev. Ashbel G. VermilYsE, D.D., Josiah H. Gautier, M.D., Peter M. Gallaudet, ^ Frederick J. de Peyster, And the President, Vice-Presidents, Secretary, and Treasurer, ex-officio. COMMEMORATION. Early in the beginning of the present year, the Executive Com- mittee of the Huguenot Society of America determined to com- memorate the Bi-Centenary Anniversary of the Revocation of the Edict of Nantes, which fell on the 22d day of October, 1885, by religious services, and an oration and addresses proper for the occasion. Desiring that all those of Huguenot origin, residing in the United States, whether members of the Society or not, should be represented at, and take part in, the commemoration, the Society, through its Executive Committee, directed the following invitation to be sent to gentlemen living in the original Huguenot centres or settlements : New York City, June, 1885. -
Memorials of the Huguenots in America
MEMORIALS OF THE HUGUENOTS IN AMERICA By Rev. A. Stapleton 1901 CHAPTER I Extending From the Beginning of the French Reformation to the Promulgation of the Edict of Nantes--1510--1598 [Page 1-10] "Great truths are dearly bought, Not found by chance; Nor wafted in the breath of summer dream, But grasped in the great struggle of the soul, Hard buffeting with adverse wind and stream." --Anon. The sixteenth century is one of the most notable periods of all history. The discovery of America, the invention of the art of printing and other elements had awakened a spirit of universal inquiry and independence of thought throughout the world. The great masses began to realize that their consciences were dominated by the priests, while their lords regarded them as vassals and mere chattels. No particular country can be said to be the cradle of the Reformation. The time for which Providence paved the way was ripe, and, like a mighty torrent, broke away from human restraint and flooded the world with the blessings of the pure gospel. 1 When Martin Luther nailed his ninety-five proposition on the Schloss Kirche at Wittemberg in 1517, the gates of the reservoir were opened, where before the waters had, so to speak, only overflowed the banks. Our aim will be simply to trace, in brief, the Reformation in France, leaving the reader to seek information concerning the work in other countries from other sources. Reformation Begins at Meaux The Reformation in France first established itself in the department of Meaux, and from thence spread rapidly. -

Impact Amid Absence: the Synod of Dordt and the French Huguenots
In die Skriflig / In Luce Verbi ISSN: (Online) 2305-0853, (Print) 1018-6441 Page 1 of 6 Original Research Impact amid absence: The Synod of Dordt and the French Huguenots Author: This contribution investigates the reasons behind the absence of delegates from the French 1 Karin Maag Reformed (Huguenot) churches at the Synod of Dordt, setting the reasons for their absence in Affiliation: the broader political and religious context of the times. I argue that the connections between H. Henry Meeter Center the French Reformed church and the Synod of Dordt were significant both before and after the for Calvin Studies, synod met, but that the Huguenots had a rather different project in mind (religious reconciliation Calvin Theological Seminary, among Reformed Protestants and even possibly between Reformed and Lutheran Christians) United States when they considered the possibility of an international gathering of Reformed theologians. Corresponding author: Although the Huguenot delegates were not present at Dordt and therefore could not directly Karin Maag, affect the course of the synod’s meeting, their alternate vision for the meeting still persisted [email protected] even via correspondence during the gathering. At the same time, the synod itself had an Dates: impact on the Huguenot church, given that the Canons of Dordt were ratified by the French Received: 14 Dec. 2017 national synods already by 1620. Accepted: 04 May 2018 Published: 18 July 2018 How to cite this article: Introduction Maag, K., 2018, ‘Impact amid On 13 November 1618 the delegates at the Reformed Synod of Dordt gathered for their opening absence: The Synod of Dordt and the French Huguenots’, session ‘in the name and in the fear of the Lord’ (Sinnema, Moser & Selderhuis 2015:3).