CILPR 2013 Actes 9 Beiträge Actes Electronique Sbu.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Publications
Year Journal Volume Page Title PMID Authors Rapid non-uniform adaptation to Xue, Jenny Y; Zhao, Yulei; Aronowitz, Jordan; Mai, Trang T; Vides, Alberto; conformation-specific KRAS(G12C) Qeriqi, Besnik; Kim, Dongsung; Li, Chuanchuan; de Stanchina, Elisa; Mazutis, 2020 Nature 577 421-425 inhibition. 31915379 Linas; Risso, Davide; Lito, Piro Amor, Corina; Feucht, Judith; Leibold, Josef; Ho, Yu-Jui; Zhu, Changyu; Alonso- Curbelo, Direna; Mansilla-Soto, Jorge; Boyer, Jacob A; Li, Xiang; Giavridis, Theodoros; Kulick, Amanda; Houlihan, Shauna; Peerschke, Ellinor; Friedman, Senolytic CAR T cells reverse Scott L; Ponomarev, Vladimir; Piersigilli, Alessandra; Sadelain, Michel; Lowe, 2020 Nature 583 127-132 senescence-associated pathologies. 32555459 Scott W Ruscetti, Marcus; Morris 4th, John P; Mezzadra, Riccardo; Russell, James; Leibold, Josef; Romesser, Paul B; Simon, Janelle; Kulick, Amanda; Ho, Yu-Jui; Senescence-Induced Vascular Fennell, Myles; Li, Jinyang; Norgard, Robert J; Wilkinson, John E; Alonso- Remodeling Creates Therapeutic Curbelo, Direna; Sridharan, Ramya; Heller, Daniel A; de Stanchina, Elisa; 2020 Cell 181 424-441.e21 Vulnerabilities in Pancreas Cancer. 32234521 Stanger, Ben Z; Sherr, Charles J; Lowe, Scott W Uckelmann, Hannah J; Kim, Stephanie M; Wong, Eric M; Hatton, Charles; Therapeutic targeting of preleukemia Giovinazzo, Hugh; Gadrey, Jayant Y; Krivtsov, Andrei V; Rücker, Frank G; cells in a mouse model of NPM1 Döhner, Konstanze; McGeehan, Gerard M; Levine, Ross L; Bullinger, Lars; 2020 Science (New York, N.Y.) 367 586-590 mutant acute myeloid leukemia. 32001657 Vassiliou, George S; Armstrong, Scott A Ganesh, Karuna; Basnet, Harihar; Kaygusuz, Yasemin; Laughney, Ashley M; He, Lan; Sharma, Roshan; O'Rourke, Kevin P; Reuter, Vincent P; Huang, Yun-Han; L1CAM defines the regenerative origin Turkekul, Mesruh; Emrah, Ekrem; Masilionis, Ignas; Manova-Todorova, Katia; of metastasis-initiating cells in Weiser, Martin R; Saltz, Leonard B; Garcia-Aguilar, Julio; Koche, Richard; Lowe, 2020 Nature cancer 1 28-45 colorectal cancer. -
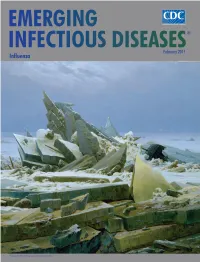
Adobe Photoshop
Peer-Reviewed Journal Tracking and Analyzing Disease Trends pages 167–336 EDITOR-IN-CHIEF D. Peter Drotman Managing Senior Editor EDITORIAL BOARD Polyxeni Potter, Atlanta, Georgia, USA Dennis Alexander, Addlestone Surrey, United Kingdom Senior Associate Editor Timothy Barrett, Atlanta, GA, USA Brian W.J. Mahy, Bury St. Edmunds, Suffolk, UK Barry J. Beaty, Ft. Collins, Colorado, USA Associate Editors Martin J. Blaser, New York, New York, USA Paul Arguin, Atlanta, Georgia, USA Christopher Braden, Atlanta, GA, USA Charles Ben Beard, Ft. Collins, Colorado, USA Carolyn Bridges, Atlanta, GA, USA Ermias Belay, Atlanta, GA, USA Arturo Casadevall, New York, New York, USA David Bell, Atlanta, Georgia, USA Kenneth C. Castro, Atlanta, Georgia, USA Corrie Brown, Athens, Georgia, USA Louisa Chapman, Atlanta, GA, USA Charles H. Calisher, Ft. Collins, Colorado, USA Thomas Cleary, Houston, Texas, USA Michel Drancourt, Marseille, France Vincent Deubel, Shanghai, China Paul V. Effl er, Perth, Australia Ed Eitzen, Washington, DC, USA David Freedman, Birmingham, AL, USA Daniel Feikin, Baltimore, MD, USA Peter Gerner-Smidt, Atlanta, GA, USA Kathleen Gensheimer, Cambridge, MA, USA Stephen Hadler, Atlanta, GA, USA Duane J. Gubler, Singapore Nina Marano, Atlanta, Georgia, USA Richard L. Guerrant, Charlottesville, Virginia, USA Martin I. Meltzer, Atlanta, Georgia, USA Scott Halstead, Arlington, Virginia, USA David Morens, Bethesda, Maryland, USA David L. Heymann, London, UK J. Glenn Morris, Gainesville, Florida, USA Charles King, Cleveland, Ohio, USA Patrice Nordmann, Paris, France Keith Klugman, Atlanta, Georgia, USA Tanja Popovic, Atlanta, Georgia, USA Takeshi Kurata, Tokyo, Japan Didier Raoult, Marseille, France S.K. Lam, Kuala Lumpur, Malaysia Pierre Rollin, Atlanta, Georgia, USA Stuart Levy, Boston, Massachusetts, USA Ronald M. -

Lista Președinților Birourilor Electorale Ale Secțiilor De Votare
Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, desemnați la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 NR. CRT. NR. SECȚIE ȚARA LOCALITATE ADRESĂ NUME PRENUME FUNCȚIE BAZA MILITARĂ HAMID KARZAI INTERNATIONAL 1 1 AFGANISTAN KABUL AIRPORT ILIEȘ CIPRIAN COSTEL PREȘEDINTE BAZA MILITARĂ HAMID KARZAI INTERNATIONAL 2 1 AFGANISTAN KABUL AIRPORT ȘINCARI PETRICĂ CRINU LOCȚIITOR BAZA MILITARĂ 3 2 AFGANISTAN KANDAHAR KANDAHAR AIRFIELD ANTON VALERIU PREȘEDINTE BAZA MILITARĂ 4 2 AFGANISTAN KANDAHAR KANDAHAR AIRFIELD ILINCA IONUȚ RAUL LOCȚIITOR STRADA JUSTICE MAHOMED, 877 BROOKLYN, 0181, CĂSUȚA POȘTALĂ 11295, HATFIELD 0028, 5 3 AFRICA DE SUD PRETORIA PRETORIA ALEXANDRU IONEL PREȘEDINTE Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86 www.roaep.ro, e-mail: [email protected] 1 Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, desemnați la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 NR. CRT. NR. SECȚIE ȚARA LOCALITATE ADRESĂ NUME PRENUME FUNCȚIE STRADA JUSTICE MAHOMED, 877 BROOKLYN, 0181, CĂSUȚA POȘTALĂ 11295, HATFIELD 0028, 6 3 AFRICA DE SUD PRETORIA PRETORIA DIACONU CRISTIAN LOCȚIITOR 24 HIGHWICK DRIVE 7708 KENILWORTH, CAPE 7 4 AFRICA DE SUD CAPE TOWN TOWN ZAHARESCU NICOLAE PREȘEDINTE 24 HIGHWICK DRIVE 7708 KENILWORTH, CAPE 8 4 AFRICA DE SUD CAPE TOWN TOWN EREMIA ELENA GABRIELA LOCȚIITOR STR. PANDELI EVANGJELI REPUBLICA NR. 15, TIRANA, COD 9 5 ALBANIA TIRANA 1003 SAVU ALEXANDRU PREȘEDINTE STR. PANDELI EVANGJELI REPUBLICA NR. 15, TIRANA, COD POMPILIA PAULA 10 5 ALBANIA TIRANA 1003 LAKO DORIANA LOCȚIITOR 24, RUE ABRI AREZKI, 11 6 ALGERIA ALGER HYDRA, 16035 ALGER NIȚĂ LIVIU ADRIAN PREȘEDINTE Str. -

Revista Istorică
REVISTA ISTORICĂ SERIE NOUĂ TOMUL XXV, NR. 5–6 septembrie – decembrie 2014 SUMAR CONSTITUIREA ŞI CONSOLIDAREA ŢĂRILOR ROMÂNE ŞERBAN PAPACOSTEA, Istorie şi geopolitică: geneza statului în trecutul românesc. II .............. 421 PUTERE ŞI CONTROL MIHAI MĂLĂERU, Dreptul divin de a guverna – legitimarea expansiunii neo-asiriene................ 437 VIRGIL CIOCÎLTAN, Problema Strâmtorilor în politica sultanului Baiazid I (1389–1402)........... 447 EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE RAMONA CARAMELEA, Concursul, practică de selecţie a profesorilor secundari din România (1864–1898)......................................................................................................................... 467 CRISTIAN VASILE, Towards a New Law on Education: Some Reflections Regarding the Communist Educational Policies under the Ceauşescu Regime........................................... 493 BOGDAN RENTEA, Reprezentări ale Daciadei în ziarul „Sportul” ............................................... 503 MINORITĂŢI – ASPECTE ŞI PROBLEME CĂTĂLIN TURLIUC, Emancipation and Modernization: Minorities in Romanian Trade during the Second Half of the Nineteenth Century.......................................................................... 521 VENERA ACHIM, Particularităţi în aplicarea legii de emancipare a ţiganilor din Ţara Românească (8/20 februarie 1856)............................................................................................................ 533 SURSE ŞI IZVOARE RADU TUDORANCEA, „Cuba – Da, Yankeii – Nu!” Atacul asupra Legaţiei SUA de la Bucureşti -

Hungary: the Assault on the Historical Memory of The
HUNGARY: THE ASSAULT ON THE HISTORICAL MEMORY OF THE HOLOCAUST Randolph L. Braham Memoria est thesaurus omnium rerum et custos (Memory is the treasury and guardian of all things) Cicero THE LAUNCHING OF THE CAMPAIGN The Communist Era As in many other countries in Nazi-dominated Europe, in Hungary, the assault on the historical integrity of the Holocaust began before the war had come to an end. While many thousands of Hungarian Jews still were lingering in concentration camps, those Jews liberated by the Red Army, including those of Budapest, soon were warned not to seek any advantages as a consequence of their suffering. This time the campaign was launched from the left. The Communists and their allies, who also had been persecuted by the Nazis, were engaged in a political struggle for the acquisition of state power. To acquire the support of those Christian masses who remained intoxicated with anti-Semitism, and with many of those in possession of stolen and/or “legally” allocated Jewish-owned property, leftist leaders were among the first to 1 use the method of “generalization” in their attack on the facticity and specificity of the Holocaust. Claiming that the events that had befallen the Jews were part and parcel of the catastrophe that had engulfed most Europeans during the Second World War, they called upon the survivors to give up any particularist claims and participate instead in the building of a new “egalitarian” society. As early as late March 1945, József Darvas, the noted populist writer and leader of the National Peasant -

2021 EBFF Amateur Bodybuilding Championships
European Bodybuilding & Fitness Federation 2021 EBFF Amateur Bodybuilding Championships 12-17 May, 2021, Santa Susanna, Spain O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S Men's Games Classic Bodybuilding, Open RD2x PLACE BORN BW/ BH RD1 RD3 RD4 Score No NAME COUNTRY 2 1 45 Bogdan Vaipan Romania 1983 86.2/183.7 10 18 8 0 26 2 49 Igor Sikora Serbia 1993 93/188 13 24 10 0 34 3 44 Siim Savisaar Estonia 1988 72.8/176.5 9 24 16 0 40 4 40 Aleksandar Cvetkovic Serbia 1982 76.4/176 23 46 25 0 71 5 50 Cosmin Iancu Romania 1987 69.2/170 26 50 22 0 72 6 41 Jeve Ojala Finland 1991 89/185.5 30 50 28 0 78 7 47 Dragos Enuta Romania 1982 74/174.4 32 0 0 0 0 8 42 Radoslaw Dykowski Poland 1980 84/181.4 44 0 0 0 0 9 39 Ramil Lipp Estonia 1980 77.1/179.5 45 0 0 0 0 10 38 Leo Polkki Finland 1993 82.2/178.8 50 0 0 0 0 11 37 Jozsef Nyircsak Hungary 1999 77.5/178.5 55 0 0 0 0 12 36 Olivier Pieters Belgium 1995 72.3/177 62 0 0 0 0 13 48 Ondrej Janus Czech Republic 1999 82.8/187 65 0 0 0 0 14 43 Mario Impens Belgium 1983 78.8/183.1 67 0 0 0 0 15 46 Michael Laschitz Austria 1989 75.8/179.5 72 0 0 0 0 Σ=15 Men's Wheelchair Bodybuilding Open RD1x PLACE BORN BW/ BH RD2 RD3 RD4 Score No NAME COUNTRY 2 1 90 Andrei Cimpan Romania 2000 / 12 6 0 0 18 2 89 Gilles Sagnard France / 18 9 0 0 27 Σ=2 Men's Physique up to 170 cm PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 RD3 RD4 Score 1 223 Ruslan Podopryhora Ukraine 1995 /168.2 8 7 0 0 7 2 222 Vitalii Salata Ukraine 1993 /165 9 10 0 0 10 3 218 Sebastian Jansson Sweden 1991 /166 14 15 0 0 15 4 215 Francisco Garcia Spain 1991 /168.5 -

The Holocaust in South-Eastern Europe
THE HOLOCAUST IN SOUTH -EASTERN EUROPE HISTORIOGRAPHY , ARCHIVES RESOURCES AND REMEMBRANCE EDITED BY ADINA BABE Ş – FRUCHTER STATE ARCHIVES OF BELGIUM / CENTRE FOR HISTORICAL RESEARCH AND DOCUMENTATION ON WAR AND CONTEMPORARY SOCIETY , BELGIUM AND ANA BĂRBULESCU ELIE WIESEL NATIONAL INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE HOLOCAUST IN ROMANIA SERIES IN WORLD HISTORY Copyright © 2021 by the Authors. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright holder and Vernon Art and Science Inc. www.vernonpress.com In the Americas: In the rest of the world: Vernon Press Vernon Press 1000 N West Street, Suite 1200, C/Sancti Espiritu 17, Wilmington, Delaware 19801 Malaga, 29006 United States Spain Series in World History Library of Congress Control Number: 2020947139 ISBN: 978-1-62273-398-9 Product and company names mentioned in this work are the trademarks of their respective owners. While every care has been taken in preparing this work, neither the authors nor Vernon Art and Science Inc. may be held responsible for any loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by the information contained in it. Every effort has been made to trace all copyright holders, but if any have been inadvertently overlooked the publisher will be pleased to include any necessary credits in any subsequent reprint or edition. Cover image: The picture shows the assemble of the local Jews of Odessa following the city occupation by the Romanian authorities in October, 1941. -

Cover Page.Ai
CULTURAL CONSTRUCTIONS: DEPICTIONS OF ARCHITECTURE IN ROMAN STATE RELIEFS Elizabeth Wolfram Thill A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics. Chapel Hill 2012 Approved by: Dr. Monika Truemper Dr. Sheila Dillon Dr. Lidewijde de Jong Dr. Mary Sturgeon Dr. Richard Talbert ABSTRACT ELIZABETH WOLFRAM THILL: Cultural Constructions: Depictions of Architecture in Roman State Reliefs (Under the direction of Monika Truemper) Architectural depictions are an important window into crucial conceptual connections between architecture and culture in the Roman Empire. While previous scholarship has treated depictions of architecture as topographic markers, I argue that architectural depictions frequently served as potent cultural symbols, acting within the broader themes and ideological messages of sculptural monuments. This is true both for representations of particular historic buildings (identifiable depictions), and for the far more numerous depictions that were never meant to be identified with a specific structure (generic depictions). This latter category of depictions has been almost completely unexplored in scholarship. This dissertation seeks to fill this gap, and to situate architectural depictions within scholarship on state reliefs as a medium for political and ideological expression. I explore the ways in which architectural depictions, both identifiable and generic, were employed in state-sponsored sculptural monuments, or state reliefs, in the first and second centuries CE in and around the city of Rome. My work is innovative in combining the iconographic and iconological analysis of architectural depictions with theoretical approaches to the symbolism of built architecture, drawn from studies on acculturation (“Romanization”), colonial interactions, and imperialism. -

Signature Redacted Author
Automated, highly scalable RNA-seq analysis ARCHNES M ASSA HUSETS INS ITUTE by Rory Kirchner RSEP 24 2015 B.S., Rochester Institute of Technology (1999) LIBRARIES Submitted to the Department of Health Sciences and Technology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Health Sciences and Technology at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY September 2015 D Massachusetts Institute of Technology 2015. All rights reserved. Signature redacted Author. Department of Health S ences and Technology Septem 2015 Signature redacted Certified by... Martha Constantine-Paton Professor of E rain and Cognitive Science Thesis Supervisor Signature redacted Acrented by ...... ........ Emery N. Brown Director, Harvard- Program in Health Sciences and Technology Professor of Computational Neuroscience and Health Sciences and Technology F Automated, highly scalable RNA-seq analysis by Rory Kirchner Submitted to the Department of Health Sciences and Technology on September 1, 2015, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Health Sciences and Technology Abstract RNA-sequencing is a sensitive method for inferring gene expression and provides ad- ditional information regarding splice variants, polymorphisms and novel genes and isoforms. Using this extra information greatly increases the complexity of an analysis and prevents novice investigators from analyzing their own data. The first chapter of this work introduces a solution to this issue. It describes a community-curated, scal- able RNA-seq analysis framework for performing differential transcriptome expres- sion, transcriptome assembly, variant and RNA-editing calling. It handles the entire stack of an analysis, from downloading and installing hundreds of tools, libraries and genomes to running an analysis that is able to be scaled to handle thousands of samples simultaneously. -

Romania from Fascism to Communism in the BBCM Reports
Romania from Fascism to Communism in the BBCM Reports Dan Stone, Royal Holloway, University of London During the years 1938–1948 Romania went through a series of remarkable changes. From a parliamentary democracy and monarchy to a fascist regime-cum-military dictatorship to a communist satellite of the Soviet Union, Romania was not simply caught between the machinations of the superpowers, as many historians of the country like to put it. Certainly the Romanian decision to ally itself with Nazi Germany — taken before Ion Antonescu came to power — was made out of fear that this represented the only chance of retaining some independence and having the possibility of regaining lands ceded to the USSR (Northern Bukovina and Bessarabia) and Hungary (Northern Transylvania) in June and August 1940 respectively. But the fact that the choice was Hitler’s Germany rather than Stalin’s Soviet Union tells something about the country’s political culture: monarchist, nationalist, xenophobic, antisemitic and, despite Bucharest’s interwar cosmopolitanism, by 1938 moving decisively into Germany’s orbit. In short order, the country lost a third of its territory, following which King Carol II, under German pressure, was forced to offer dictatorial powers to General Antonescu and then to abdicate in favour of his son Mihai. At first Antonescu shared power with the Iron Guard, with the Guard’s leader, Horia Sima, appointed Deputy Prime Minister when the ‘National Legionary State’ was declared on 14 September 1940. After a few chaotic months, characterised by Iron Guard violence, culminating in the Bucharest pogrom of January 1941 in which 120 Jews were murdered, Antonescu dissolved the National Legionary State on 14 February and established a new government which offered less wayward rule, a more stable partnership with Germany, and, in Antonescu’s eyes at least, a stronger likelihood of regaining northern Transylvania. -

European Parliament
19.9.2013 EN Official Journal of the European Union C 270 E / 1 IV (Notices) NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES EUROPEAN PARLIAMENT WRITTEN QUESTIONS WITH ANSWER Written questions by Members of the European Parliament and their answers given by a European Union institution (2013/C 270 E/01) Contents Page E-005440/12 by Andreas Mölzer to the Commission Subject: Preparations for an intensification of the euro crisis Deutsche Fassung .............................................................................................................................................................. 13 English version .................................................................................................................................................................. 19 E-005827/12 by Mario Borghezio to the Commission Subject: Switzerland is preparing for the end of the euro; what about European banks? Versione italiana ................................................................................................................................................................ 14 English version .................................................................................................................................................................. 19 E-005850/12 by Mario Borghezio to the Commission Subject: Measures in relation to the Greek default Versione italiana ............................................................................................................................................................... -

STAES Bart OFFICE Dear Member of the European Parliament, Please
STAES Bart OFFICE From: Inga Jesinghaus <[email protected]> Sent: 25 September 2013 14:01 Subject: Postponement of the decision in the European Parliament on the TPD Attachments: ABNR_letter_postponement TPD.pdf; ABNR_Positionen_7_2013_english.pdf Dear Member of the European Parliament, please find attached a letter of the German Smoke-Free Alliance (Aktionsbündnis Nichtrauchen - ABNR) concerning the postponement of the decision of the European Parliament on the Tobacco Products Directive (TPD) as well as the Tobacco industry lobbyism. Please find enclosed also our detailed “Position on the Proposal for the Tobacco Products Directive” as presented in March 2013. Best Regards, Inga Jesinghaus Inga Jesinghaus Referentin Aktionsbündnis Nichtrauchen e.V. (ABNR) c/o Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG) Heilsbachstr. 30 D-53123 Bonn Telefon: +49 (0 ) 228 987 27 18 Fax: +49 (0) 228 64 200 24 Mobile: +49 (0) 151 17 22 78 99 [email protected] www.abnr.de 1 STAES Bart OFFICE From: Office DGP Berlin <[email protected]> Sent: 24 September 2013 14:35 To: QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve; DARTMOUTH William; ABELA BALDACCHINO Claudette; AGNEW John Stuart; ALBRECHT Jan Philipp; ALFANO Sonia; ALFONSI François; ALLAM Magdi Cristiano; ALVARO Alexander; ALVES Luís Paulo; ANDERSDOTTER Amelia; ANDERSON Martina; ANDREASEN Marta; ANDRES BAREA Josefa; ANDRIEU Eric; ANDRIKIENE Laima Liucija; ANGELILLI Roberta; ANGOURAKIS Charalampos; ANTINORO Antonello; ANTONESCU Elena Oana; ANTONIOZZI Alfredo; ARIAS ECHEVERRIA Pablo; ARLACCHI Pino;