Journées Parlementaires 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Décision N° 2013-672 DC Du 13 Juin 2013
Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 (Loi relative à la sécurisation de l’emploi) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, le 15 mai 2013, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Patrick BALKANY, Xavier BERTRAND, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Yves CENSI, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. François FILLON, Yves FROMION, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Mme Valérie LACROUTE, M. Jacques LAMBLIN, Mmes Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, MM. Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mme Geneviève LEVY, MM. Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Mme Valérie PÉCRESSE, MM. Bernard PERRUT, Jean- Frédéric POISSON, Mmes Bérangère POLETTI, Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Jean- Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Philippe VITEL et Michel VOISIN, députés ; Et le même jour, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. -

Par Sophie Pierson, Legal Counsel, Ethics & Human Rights, TOTAL
Par Sophie Pierson, Legal Counsel, Ethics & Human Rights, TOTAL & Stéphane Brabant, Avocat, Herbert Smith Freehills Paris LLP 27 AVRIL 2017 ©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs 53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79 http://www.uda.fr – e-mail : [email protected] SOMMAIRE Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre Décision n°2017-750 DC du 23 mars 2017 du Conseil constitutionnel Les principes directeurs — Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme — IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers Exemple de document d’information — Document d’information de Total sur les droits de l’Homme (2016) Liste des documents utiles UDA – Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques – Tous droits réservés – avril 2017 28 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 99 LOIS LOI no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (1) NOR : ECFX1509096L L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2017-750 DC du 23 mars 2017 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé : « Art. L. -
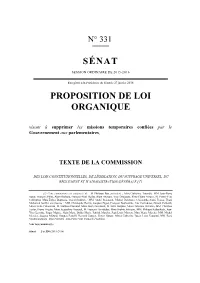
TA Suppr Missions Temp
N° 331 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2016 PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires , TEXTE DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES , DE LÉGISLATION , DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1) (1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean- Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . Voir le(s) numéro(s) : Sénat : 3 et 330 (2015-2016) - 3 - PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE VISANT À SUPPRIMER LES MISSIONS TEMPORAIRES CONFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT AUX PARLEMENTAIRES Article 1 er I. – Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L.O. 144 est abrogé ; 2° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ». -
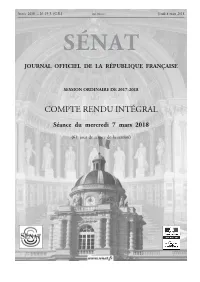
Et Au Format
o Année 2018. – N 19 S. (C.R.) ISSN 0755-544X Jeudi 8 mars 2018 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du mercredi 7 mars 2018 (61e jour de séance de la session) 1974 SÉNAT – SÉANCE DU 7 MARS 2018 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE DALLIER Article additionnel avant l’article 1er A (p. 1990) o Secrétaires : Amendement n 9 de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait. Mme Agnès Canayer, M. Yves Daudigny. Article 1er A (nouveau) – Adoption. (p. 1990) 1. Procès-verbal (p. 1976) Article 1er (supprimé) (p. 1990) 2. Rappel au règlement (p. 1976) Amendement no 1 rectifié de M. Franck Montaugé. – Rejet. Mme Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE ; L’article demeure supprimé. M. Philippe Bas, président de la commission des lois ; Mme Nathalie Goulet ; M. Olivier Dussopt, secrétaire Article 1er bis (nouveau) – Adoption. (p. 1991) d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ; M. Marc Daunis : M. Jean-Claude Requier, Article 1er ter (nouveau) (p. 1992) président du groupe du RDSE ; M. Philippe Bas, prési- dent de la commission des lois ; M. le président. Mme Élisabeth Lamure Suspension et reprise de la séance (p. 1978) Amendement no 10 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption. 3. Qualité des études d’impact des projets de loi. – Discussion d’une proposition de loi organique dans le texte de la Adoption de l’article modifié. commission (p. 1978) Article 2 (p. 1993) Discussion générale : M. Franck Montaugé M. Franck Montaugé, auteur de la proposition de loi organique Amendement no 7 de M. -

Sénat Proposition De Résolution
N° 202 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION, relative à la filière industrielle nucléaire française, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du groupe UMP (1), apparentés (2) et rattachés (3), Sénateurs (1) Ce groupe est composé de : MM. Pierre André, Gérard Bailly, Philippe Bas, René Beaumont, Christophe Béchu, Michel Bécot, Joël Billard, Jean Bizet, Pierre Bordier, Mme Natacha Bouchart, MM. Joël Bourdin, François-Noël Buffet, François Calvet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Noël Cardoux, Jean-Claude Carle, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard César, Pierre Charon, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Gérard Cornu, Raymond Couderc, Jean-Patrick Courtois, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, MM. Robert del Picchia, Francis Delattre, Mmes Catherine Deroche, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Michel Doublet, Alain Dufaut, André Dulait, Ambroise Dupont, Louis Duvernois, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Mme Jacqueline Farreyrol, MM. André Ferrand, Louis-Constant Fleming, Michel Fontaine, Alain Fouché, Bernard Fournier, Jean-Paul Fournier, Christophe-André Frassa, Pierre Frogier, Yann Gaillard, René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Jean-Claude Gaudin, Jacques Gautier, Patrice Gélard, Bruno Gilles, Mme Colette Giudicelli, MM. Alain Gournac, Francis Grignon, François Grosdidier, Charles Guené, Pierre Hérisson, Michel Houel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Jean-Jacques Hyest, Mmes Sophie Joissains, Chantal Jouanno, Christiane Kammermann, M. Roger Karoutchi, Mme Fabienne Keller, M. Marc Laménie, Mme Élisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Daniel Laurent, Jean-René Lecerf, Antoine Lefèvre, Jacques Legendre, Dominique de Legge, Jean-Pierre Leleux, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Jean-Louis Lorrain, Roland du Luart, Michel Magras, Philippe Marini, Pierre Martin, Jean-François Mayet, Mme Colette Mélot, MM. -

Conseil Constitutionnel
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2013 > 2013−679 DC Décision n° 2013−679 DC du 04 décembre 2013 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le 6 novembre 2013, par MM. Jean−Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie−Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François−Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean−Pierre CANTEGRIT, Jean−Noël CARDOUX, Jean−Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean−Pierre CHAUVEAU, Marcel−Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Jean−Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Gérard DERIOT, Mme Catherine DEROCHE, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Louis DUVERNOIS, Jean−Paul ÉMORINE, Louis−Constant FLEMING, Jean−Paul FOURNIER, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD−MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean−François HUSSON, Jean−Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean−René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean−Pierre LELEUX, Jean−Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON−MARET, MM. -

Formation Du Parlement À La Charge Du Gouvernement
N° 317 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 février 2018 RAPPORT FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d’impact des projets de loi, Par M. Jean-Pierre SUEUR, Sénateur (1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François- Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc, vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt, secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled. Voir les numéros : Sénat : 610 rect. (2016-2017) et 318 (2017-2018) - 3 - SOMMAIRE Pages LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ....................................................... 5 EXPOSÉ GÉNÉRAL .................................................................................................................. 7 I. LES LIMITES ET INSUFFISANCES DE L’OBLIGATION D’ASSORTIR LES PROJETS DE LOI D’UNE ÉTUDE D’IMPACT ................................................................. -

Mercredi 30 Octobre 2013
MERCREDI 30 OCTOBRE 2013 Retraites (Procédure accélérée – Suite) SOMMAIRE HOMMAGE À UNE DÉLÉGATION DU BUNDESRAT ................................................................... 1 RETRAITES (Procédure accélérée – Suite) ................................................................................. 1 Mise au point au sujet d’un vote 1 Discussion des articles (Suite) 1 ARTICLE 3 (Suite) 1 ARTICLE 4 2 Mme Éliane Assassi 2 M. Georges Labazée 2 Mme Laurence Cohen 2 Mme Isabelle Pasquet 3 ACCORDS EN CMP ........................................................................................................................ 5 RETRAITES (Procédure accélérée – Suite) ................................................................................. 5 Discussion des articles (Suite) 5 ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L’ARTICLE 4 5 ARTICLE 4 BIS 9 ARTICLE 5 10 Mme Brigitte Gonthier-Maurin 10 M. Alain Milon 10 M. Dominique Watrin 10 Mme Laurence Cohen 10 M. Claude Domeizel 10 Mme Gisèle Printz 10 M. Roland Courteau 10 M. Jean-Yves Leconte 11 M. Philippe Bas 11 M. Gérard Longuet 11 ARTICLE ADDITIONNEL 15 ARTICLE 5 BIS 15 Mme Brigitte Gonthier-Maurin 15 ARTICLE 6 17 M. Dominique Watrin 17 Mme Annie David 17 Mme Laurence Cohen 17 N° 20 mercredi 30 octobre 2013 Retraites SÉANCE (Procédure accélérée – Suite) du mercredi 30 octobre 2013 M. le président. – L’ordre du jour appelle la suite 20e séance de la session ordinaire 2013-2014 du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de PRÉSIDENCE DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, retraites. VICE-PRÉSIDENT SECRÉTAIRES : Mise au point au sujet d’un vote M. FRANÇOIS FORTASSIN, M. JACQUES GILLOT. M. Jean-Pierre Godefroy. – Hier je souhaitais La séance est ouverte à 14 h 30. m’abstenir sur l’amendement de suppression de l’article 2. -

Conseil Constitutionnel
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2016 > 2016-736 DC Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sous le numéro 2016-736 DC, le 21 juillet 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Michel BOUVARD, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, M. Gérard CÉSAR, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, M. Louis DUVERNOIS, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Benoît HURE, Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, M. Guy-Dominique KENNEL, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. -

TERRITOIRES Urbains N°141 - La Lettre Hebdomadaire De France Urbaine Publié Sur France Urbaine – Métropoles, Agglos Et Grandes Villes (
TERRITOIRES Urbains N°141 - La lettre hebdomadaire de France urbaine Publié sur France urbaine – métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net) # 141 Jeudi 06 septembre 2018 A la Une La 18e Conférence des Villes inscrite à l'agenda du Premier Ministre Edouard Philippe Le 19 septembre se tiendra la 18e édition de La Conférence des Villes, à l’Hôtel de Ville de Paris. En présence du Premier ministre Édouard Philippe, La Conférence des Villes sera l’occasion pour les élus des territoires urbains d‘échanger avec les membres du gouvernement et de grands témoins autour de questions d’actualité et des relations entre l’Etat et les collectivités. Ce premier grand rendez-vous politique de la rentrée permettra notamment de revenir sur les contrats financiers, qui ont été signés au début de l’été. France urbaine a réalisé ces dernières semaines une enquête auprès de ses membres, pour faire le bilan de leur mise en œuvre. Une synthèse de cette étude sera disponible à La Conférence des Villes. Nos demandes de modifications et d’améliorations du dispositif y seront clairement formulées, et feront l’objet d’un dialogue avec le gouvernement. Page 1 sur 10 TERRITOIRES Urbains N°141 - La lettre hebdomadaire de France urbaine Publié sur France urbaine – métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net) Retrouvez ici le programme Inscriptions obligatoires avant le 14 septembre pour des raisons de sécurité. CONTACT FRANCE URBAINE Nathalie Fragner - [email protected] CONTACT COMMUNICATION Jilliane Pollak - [email protected] -

Interpelle Ton Sénateur !
Interpelle ton sénateur ! Par téléphone, joignez votre sénateur via le standard du Sénat au 01 42 34 20 00 Feuille1 Nom N Dpt Département Gpe Pol emails Sylvie Goy-Chavent 1 Ain UC [email protected] Rachel Mazuir 1 Ain SOC [email protected] Patrick Chaize 1 Ain LR [email protected] Antoine Lefèvre 2 Aisne LR [email protected] Yves Daudigny 2 Aisne SOC [email protected] Pascale Gruny 2 Aisne LR [email protected] Gérard Dériot 3 Allier LR [email protected] Claude Malhuret 3 Allier RTLI [email protected] Jean-Yves Roux 4 Alpes-de-Haute-Provence SOC [email protected] Patricia Morhet-Richaud 5 Hautes-Alpes LR [email protected] Colette Giudicelli 6 Alpes-Maritimes LR [email protected] Dominique Estrosi Sassone 6 Alpes-Maritimes LR [email protected] Marc Daunis 6 Alpes-Maritimes SOC [email protected] Jean-Pierre Leleux 6 Alpes-Maritimes LR [email protected] Henri Leroy 6 Alpes-Maritimes LR [email protected] Mathieu Darnaud 7 Ardèche LR [email protected] Jacques Genest 7 Ardèche LR [email protected] Marc Laménie 8 Ardennes LR [email protected] Benoît Huré 8 Ardennes LR [email protected] Alain Duran 9 Ariège SOC [email protected] Philippe Adnot 10 Aube NI [email protected] Évelyne Perrot 10 Aube NI [email protected] Roland Courteau 11 Aude SOC [email protected] Gisèle Jourda 11 Aude SOC [email protected] Jean-Claude Luche 12 Aveyron UC [email protected] Alain Marc 12 Aveyron RTLI [email protected] Samia Ghali 13 Bouches-du-Rhône SOC [email protected] Bruno Gilles 13 Bouches-du-Rhône LR [email protected] Jean-Noël -

La Jeunesse Et Les Sports Ont Un Ministre, Mais Sont Séparés Des Ministères À Géométrie Variable
Politique La jeunesse et les sports ont un ministre, mais sont séparés Des ministères à géométrie variable a liste des ministères et des secrétariats d’État est flottante en France ; elle change pratiquement à chaque nouveau gouvernement. Bien entendu, les intitulés révèlent les préoccupations d’une L époque mais ne disent rien des actions réellement conduites. Comme la Ve République a déjà connu dix-huit Premiers ministres différents et trente-quatre gouvernements successifs, il est bien difficile d’établir la liste des ministres ayant eu telle ou telle responsabilité. Tentons néanmoins l’expérience, tout d’abord avec la jeunesse, les sports et la vie associative. La Jeunesse et les Sports… et avatars Sous la Ve République, la jeunesse et les sports ont souvent constitué un ministère autonome. Ce n’est plus le cas. En novembre 2010, Luc Chatel est ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, et il bénéficie d’une secrétaire d’État pour la Jeunesse et la Vie associative (Jeannette Bougrab). Par ailleurs, Chantal Jouanno, ancienne karatéka, est Luc Chatel ministre des Sports. Ayant choisi de se consacrer à son mandat de sénatrice, celle-ci est remplacée, en septembre 2011, par David Douillet, double cham- pion olympique et quadruple champion du Monde de judo. Celui-ci était entré au gouvernement quelques mois plus tôt comme secrétaire d’État chargé des Chantal Jouanno Français de l’étranger… Sous son premier gouvernement (mai 2007), François Fillon avait choisi de ne plus avoir un ministère autonome pour la jeunesse et les sports. Roselyne Bachelot-Narquin est d’abord ministre de la Santé, puis… de la Jeunesse et David Douillet des Sports.