Critique De 20 Films)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Before the Forties
Before The Forties director title genre year major cast USA Browning, Tod Freaks HORROR 1932 Wallace Ford Capra, Frank Lady for a day DRAMA 1933 May Robson, Warren William Capra, Frank Mr. Smith Goes to Washington DRAMA 1939 James Stewart Chaplin, Charlie Modern Times (the tramp) COMEDY 1936 Charlie Chaplin Chaplin, Charlie City Lights (the tramp) DRAMA 1931 Charlie Chaplin Chaplin, Charlie Gold Rush( the tramp ) COMEDY 1925 Charlie Chaplin Dwann, Alan Heidi FAMILY 1937 Shirley Temple Fleming, Victor The Wizard of Oz MUSICAL 1939 Judy Garland Fleming, Victor Gone With the Wind EPIC 1939 Clark Gable, Vivien Leigh Ford, John Stagecoach WESTERN 1939 John Wayne Griffith, D.W. Intolerance DRAMA 1916 Mae Marsh Griffith, D.W. Birth of a Nation DRAMA 1915 Lillian Gish Hathaway, Henry Peter Ibbetson DRAMA 1935 Gary Cooper Hawks, Howard Bringing Up Baby COMEDY 1938 Katharine Hepburn, Cary Grant Lloyd, Frank Mutiny on the Bounty ADVENTURE 1935 Charles Laughton, Clark Gable Lubitsch, Ernst Ninotchka COMEDY 1935 Greta Garbo, Melvin Douglas Mamoulian, Rouben Queen Christina HISTORICAL DRAMA 1933 Greta Garbo, John Gilbert McCarey, Leo Duck Soup COMEDY 1939 Marx Brothers Newmeyer, Fred Safety Last COMEDY 1923 Buster Keaton Shoedsack, Ernest The Most Dangerous Game ADVENTURE 1933 Leslie Banks, Fay Wray Shoedsack, Ernest King Kong ADVENTURE 1933 Fay Wray Stahl, John M. Imitation of Life DRAMA 1933 Claudette Colbert, Warren Williams Van Dyke, W.S. Tarzan, the Ape Man ADVENTURE 1923 Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan Wood, Sam A Night at the Opera COMEDY -
Summer Classic Film Series, Now in Its 43Rd Year
Austin has changed a lot over the past decade, but one tradition you can always count on is the Paramount Summer Classic Film Series, now in its 43rd year. We are presenting more than 110 films this summer, so look forward to more well-preserved film prints and dazzling digital restorations, romance and laughs and thrills and more. Escape the unbearable heat (another Austin tradition that isn’t going anywhere) and join us for a three-month-long celebration of the movies! Films screening at SUMMER CLASSIC FILM SERIES the Paramount will be marked with a , while films screening at Stateside will be marked with an . Presented by: A Weekend to Remember – Thurs, May 24 – Sun, May 27 We’re DEFINITELY Not in Kansas Anymore – Sun, June 3 We get the summer started with a weekend of characters and performers you’ll never forget These characters are stepping very far outside their comfort zones OPENING NIGHT FILM! Peter Sellers turns in not one but three incomparably Back to the Future 50TH ANNIVERSARY! hilarious performances, and director Stanley Kubrick Casablanca delivers pitch-dark comedy in this riotous satire of (1985, 116min/color, 35mm) Michael J. Fox, Planet of the Apes (1942, 102min/b&w, 35mm) Humphrey Bogart, Cold War paranoia that suggests we shouldn’t be as Christopher Lloyd, Lea Thompson, and Crispin (1968, 112min/color, 35mm) Charlton Heston, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad worried about the bomb as we are about the inept Glover . Directed by Robert Zemeckis . Time travel- Roddy McDowell, and Kim Hunter. Directed by Veidt, Sydney Greenstreet, and Peter Lorre. -
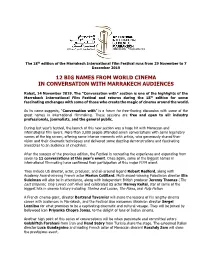
12 Big Names from World Cinema in Conversation with Marrakech Audiences
The 18th edition of the Marrakech International Film Festival runs from 29 November to 7 December 2019 12 BIG NAMES FROM WORLD CINEMA IN CONVERSATION WITH MARRAKECH AUDIENCES Rabat, 14 November 2019. The “Conversation with” section is one of the highlights of the Marrakech International Film Festival and returns during the 18th edition for some fascinating exchanges with some of those who create the magic of cinema around the world. As its name suggests, “Conversation with” is a forum for free-flowing discussion with some of the great names in international filmmaking. These sessions are free and open to all: industry professionals, journalists, and the general public. During last year’s festival, the launch of this new section was a huge hit with Moroccan and internatiojnal film lovers. More than 3,000 people attended seven conversations with some legendary names of the big screen, offering some intense moments with artists, who generously shared their vision and their cinematic techniques and delivered some dazzling demonstrations and fascinating anecdotes to an audience of cinephiles. After the success of the previous edition, the Festival is recreating the experience and expanding from seven to 11 conversations at this year’s event. Once again, some of the biggest names in international filmmaking have confirmed their participation at this major FIFM event. They include US director, actor, producer, and all-around legend Robert Redford, along with Academy Award-winning French actor Marion Cotillard. Multi-award-winning Palestinian director Elia Suleiman will also be in attendance, along with independent British producer Jeremy Thomas (The Last Emperor, Only Lovers Left Alive) and celebrated US actor Harvey Keitel, star of some of the biggest hits in cinema history including Thelma and Louise, The Piano, and Pulp Fiction. -

Fiction and Documentary) Films On/In Africa (In Alphabetical Order, by Film Title
Marie Gibert [email protected] (Fiction and Documentary) Films on/in Africa (in alphabetical order, by film title) J. Huston (1951), The African Queen, starring Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley et al. A. Sissako (2006), Bamako, starring Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré et al. C. Denis (1999), Beau Travail, starring Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire Colin et al. R. Scott (2001), Black Hawk Down, starring Josh Hartnett, Eric Bana, Ewan McGregor et al. E. Zwick (2006), Blood Diamond, starring Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou et al. C. Denis (1988), Chocolat, starring François Cluzet, Isaach De Bankolé, Giulia Boschi et al. T. Michel (2005), Congo River, Beyond Darkness (documentary). F. Mereilles (2005), The Constant Gardener, starring Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Koundé et al. B. Tavernier (1981), Coup de Torchon, starring Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle et al. R. Attenborough (1987), Cry Freedom, starring Denzel Washington, Kevin Kline, Penelope Wilton et al. S. Samura (2000), Cry Freetown (documentary). R. Bouchareb (2006), Days of Glory, starring Jamel Debbouze, Samy Naceri, Sami Bouajila et al. R. Stern and A. Sundberg (2007), The Devil Came on Horseback, starring Nicholas Kristof, Brian Steidle et al. S. Jacobs (2008), Disgrace, starring Eriq Ebouaney, Jessica Haines, John Malkovich et al. N. Blomkamp (2009), District Nine, starring Sharlto Copley, Jason Cope, David James et al. Z. Korda (1939), The Four Feathers, starring John Clements, June Duprez, Ralph Richardson et al. B. August (2007), Goodbye Bafana, starring Dennis Haysbert, Joseph Fiennes, Diane Kruger et al. T. George (2004), Hotel Rwanda, starring Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix et al. -

Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 3
Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 3 Film Soleil D.K. Holm www.pocketessentials.com This edition published in Great Britain 2005 by Pocket Essentials P.O.Box 394, Harpenden, Herts, AL5 1XJ, UK Distributed in the USA by Trafalgar Square Publishing P.O.Box 257, Howe Hill Road, North Pomfret, Vermont 05053 © D.K.Holm 2005 The right of D.K.Holm to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may beliable to criminal prosecution and civil claims for damages. The book is sold subject tothe condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated, without the publisher’s prior consent, in anyform, binding or cover other than in which it is published, and without similar condi-tions, including this condition being imposed on the subsequent publication. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 1–904048–50–1 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 Book typeset by Avocet Typeset, Chilton, Aylesbury, Bucks Printed and bound by Cox & Wyman, Reading, Berkshire Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 5 Acknowledgements There is nothing -

Marco Ferreri Retrospective 1 – 14 December at Ciné Lumière
press release nov 06 Marco Ferreri Retrospective 1 – 14 December at Ciné lumière About the Retrospective The Italian Cultural Institute and the Institut français, London, in collaboration with Cinecittà Holding are delighted to present a fortnight-long tribute to maverick Italian director Marco Ferreri. The retrospective features a representative selection of 13 films from all four decades of his filmmaking career, and showcases impressive (and surprising) performances from some of European cinema’s finest actors, including Marcello Mastroianni, Roberto Benigni, Gérard Dépardieu, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Michel Piccoli and Ugo Tognazzi. A highlight of the season will be the two screenings of Ferreri’s masterpiece La Grande Bouffe (Blow-Out) on a newly-restored print provided by Cinecittà especially for the occasion. As many of Ferreri’s films received no, or very limited, UK release, this season represents a valuable opportunity for film fans to assess or re-asses the work of one of Italian – and world – cinema’s most singular talents. L’Ape regina (The Queen Bee) • La Donna scimmia (The Ape Woman) • Dillinger è morto (Dillinger is Dead) • L’Udienza (The Audience) • La Cagna (Love to Eternity) • La Grande Bouffe (Blow-Out) • Touche pas à la femme blanche (Don’t Touch the White Woman!) • La Dernière Femme (The Last Woman) • Ciao Maschio (Bye Bye Monkey) • Chiedo asilo (Pipicacadodo) • Storie di ordinaria follia (Tales of Ordinary Madness) • La Carne (The Flesh) • Diario di un vizio (Diary of a Maniac) Venue: Ciné lumière at the Institut français, 17 Queensberry Place, London SW7 2DT Tickets: £7, conc. £5; double bills £9, conc. -

AFI PREVIEW Check for Updates
THE AMERICAN FILM INSTITUTE GUIDE Oct. 29-Dec. 30, 2004 ★ TO THEATRE AND MEMBER EVENTS VOLUME 1 • ISSUE 14 AFIPREVIEW European Union Film Showcase Oct 29-Nov 7 Plus: HEARTS AND MINDS EASY RIDER THE BIG RED ONE HEAVEN’S GATE George Stevens Centennial 50th Anniversary! Also: New Films from the Czech Republic, Tribute to Elia Kazan, ON THE WATERFRONT New 35mm Restoration Yuletide Classics, Washington Jewish Film Festival Much More! NOW PLAYING FEATURED FILMS Features 30th Anniversary! “HEARTS AND New Academy-Restored 2 HEARTS AND MINDS, Restored MINDS is not only 35mm Print! the best documentary 2EASY RIDER Academy Award-Winning 3 THE BIG RED ONE, Restored Documentary! I have ever seen, 3 ON THE WATERFRONT, 50th it may be the best Anniversary Restoration HEARTS AND MINDS movie ever... a film Film Festivals Opens Friday, October 22 that remains every bit “The ultimate victory will depend on the hearts and as relevant today. 4 EU SHOWCASE Required viewing for 13 Washington Jewish Film Festival: minds of the people.”—Lyndon Baines Johnson. Four films plus THE DIARY OF ANNE Documentarian Peter Davis (THE SELLING OF THE anyone who says, FRANK (p.11) PENTAGON) combined newsreel clips, TV reports, and ‘I am an American.’” striking color footage shot here and in a still war-torn —MICHAEL MOORE Film Series Vietnam, eschewing narration to let raw footage paint (2004) its own vivid portrait of the South and North 7 George Stevens Centennial Vietnamese, the Americans engineering the war here and abroad—and its critics. The 11 New from the Czech Republic -

American Auteur Cinema: the Last – Or First – Great Picture Show 37 Thomas Elsaesser
For many lovers of film, American cinema of the late 1960s and early 1970s – dubbed the New Hollywood – has remained a Golden Age. AND KING HORWATH PICTURE SHOW ELSAESSER, AMERICAN GREAT THE LAST As the old studio system gave way to a new gen- FILMFILM FFILMILM eration of American auteurs, directors such as Monte Hellman, Peter Bogdanovich, Bob Rafel- CULTURE CULTURE son, Martin Scorsese, but also Robert Altman, IN TRANSITION IN TRANSITION James Toback, Terrence Malick and Barbara Loden helped create an independent cinema that gave America a different voice in the world and a dif- ferent vision to itself. The protests against the Vietnam War, the Civil Rights movement and feminism saw the emergence of an entirely dif- ferent political culture, reflected in movies that may not always have been successful with the mass public, but were soon recognized as audacious, creative and off-beat by the critics. Many of the films TheThe have subsequently become classics. The Last Great Picture Show brings together essays by scholars and writers who chart the changing evaluations of this American cinema of the 1970s, some- LaLastst Great Great times referred to as the decade of the lost generation, but now more and more also recognised as the first of several ‘New Hollywoods’, without which the cin- American ema of Francis Coppola, Steven Spiel- American berg, Robert Zemeckis, Tim Burton or Quentin Tarantino could not have come into being. PPictureicture NEWNEW HOLLYWOODHOLLYWOOD ISBN 90-5356-631-7 CINEMACINEMA ININ ShowShow EDITEDEDITED BY BY THETHE -

MARIN KARMITZ and MK2 April 6 - 17, 1989
The Museum of Modern Art For Immediate Release April 1989 MARIN KARMITZ AND MK2 April 6 - 17, 1989 A ten-day international retrospective of films by Marin Karmitz, French film director, producer, exhibitor, and distributor, opens on April 6 at The Museum of Modern Art. MARIN KARMITZ AND MK2 presents twelve features and two short films produced by the filmmaker between 1965 and 1988, including the New York premieres of Claude Chabrol's A Story of Women (1988) and Masques (1986) and Etienne Chatiliez's Life Is a Long Quiet River (1988). Through his commitment to supporting high quality and original work, Karmitz has helped to rejuvenate the French film industry and enrich world cinema. The series features works by major international directors, including Jean-Luc Godard, Every Man for Himself (1980); Alain Resnais, M61o (1986); Theo Angelopoulos, The Beekeeper (1986); Ken Loach, Looks and Smiles (1981); and Yilmaz Guney, The Wall (1983). Sabine Azema, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, and Jean-Louis Trintignant are among those actors appearing in the films. Films directed by Karmitz include two politically oriented works, Comrades (1970) and Blow for Blow (1972), and two short films, ComSdie (1965), based on a screenplay by Samuel Beckett, and Dark Night Calcutta (1964), based on a story by Marguerite Duras. Many of the films produced by Karmitz and MK2 have won strong critical recognition, including fifty-two awards and prizes, among them thirteen from the Cannes Film Festival, seven from the Venice Film Festival, and eighteen C6sars (the French equivalent of the Oscar). -more- 11 West 53 Street, New York, N.Y. -

SHSU Video Archive Basic Inventory List Department of Library Science
SHSU Video Archive Basic Inventory List Department of Library Science A & E: The Songmakers Collection, Volume One – Hitmakers: The Teens Who Stole Pop Music. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume One – Dionne Warwick: Don’t Make Me Over. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume Two – Bobby Darin. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume Two – [1] Leiber & Stoller; [2] Burt Bacharach. c2001. A & E Top 10. Show #109 – Fads, with commercial blacks. Broadcast 11/18/99. (Weller Grossman Productions) A & E, USA, Channel 13-Houston Segments. Sally Cruikshank cartoon, Jukeboxes, Popular Culture Collection – Jesse Jones Library Abbott & Costello In Hollywood. c1945. ABC News Nightline: John Lennon Murdered; Tuesday, December 9, 1980. (MPI Home Video) ABC News Nightline: Porn Rock; September 14, 1985. Interview with Frank Zappa and Donny Osmond. Abe Lincoln In Illinois. 1939. Raymond Massey, Gene Lockhart, Ruth Gordon. John Ford, director. (Nostalgia Merchant) The Abominable Dr. Phibes. 1971. Vincent Price, Joseph Cotton. Above The Rim. 1994. Duane Martin, Tupac Shakur, Leon. (New Line) Abraham Lincoln. 1930. Walter Huston, Una Merkel. D.W. Griffith, director. (KVC Entertaiment) Absolute Power. 1996. Clint Eastwood, Gene Hackman, Laura Linney. (Castle Rock Entertainment) The Abyss, Part 1 [Wide Screen Edition]. 1989. Ed Harris. (20th Century Fox) The Abyss, Part 2 [Wide Screen Edition]. 1989. Ed Harris. (20th Century Fox) The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: [1] documentary; [2] scripts. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: scripts; special materials. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: special features – I. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: special features – II. Academy Award Winners: Animated Short Films. -

Family & Domesticity in the Films of Steven Spielberg
Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2017 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2017 Why Did I Marry A Sentimentalist?: Family & Domesticity in the Films of Steven Spielberg Emmet Dotan Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017 Part of the Other Film and Media Studies Commons, and the Theory and Criticism Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. Recommended Citation Dotan, Emmet, "Why Did I Marry A Sentimentalist?: Family & Domesticity in the Films of Steven Spielberg" (2017). Senior Projects Spring 2017. 232. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017/232 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. Why Did I Marry A Sentimentalist?: Family & Domesticity in the Films of Steven Spielberg Senior Project Submitted to The Division of Arts of Bard College by Emmet Dotan Annandale-on-Hudson, New York May 2017 Acknowledgements I want to thank my advisor, Ed Halter, for pushing me to understand why I love the films that I love. I would also like to thank Natan Dotan for always reminding me why I do what I do. -

Cinema Studies: the Key Concepts
Cinema Studies: The Key Concepts This is the essential guide for anyone interested in film. Now in its second edition, the text has been completely revised and expanded to meet the needs of today’s students and film enthusiasts. Some 150 key genres, movements, theories and production terms are explained and analysed with depth and clarity. Entries include: • auteur theory • Black Cinema • British New Wave • feminist film theory • intertextuality • method acting • pornography • Third World Cinema • War films A bibliography of essential writings in cinema studies completes an authoritative yet accessible guide to what is at once a fascinating area of study and arguably the greatest art form of modern times. Susan Hayward is Professor of French Studies at the University of Exeter. She is the author of French National Cinema (Routledge, 1998) and Luc Besson (MUP, 1998). Also available from Routledge Key Guides Ancient History: Key Themes and Approaches Neville Morley Cinema Studies: The Key Concepts (Second edition) Susan Hayward Eastern Philosophy: Key Readings Oliver Leaman Fifty Eastern Thinkers Diané Collinson Fifty Contemporary Choreographers Edited by Martha Bremser Fifty Key Contemporary Thinkers John Lechte Fifty Key Jewish Thinkers Dan Cohn-Sherbok Fifty Key Thinkers on History Marnie Hughes-Warrington Fifty Key Thinkers in International Relations Martin Griffiths Fifty Major Philosophers Diané Collinson Key Concepts in Cultural Theory Andrew Edgar and Peter Sedgwick Key Concepts in Eastern Philosophy Oliver Leaman Key Concepts in