Des Hommes Tourmentés
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cindy Mollo, Ace Editor
CINDY MOLLO, ACE EDITOR FEATURES PINK- ALL I KNOW SO FAR Michael Gracey Amazon Studios DEADWOOD (Additional Editor) Daniel Minahan HBO Nominated, Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie, Emmy Awards (2019) JUANITA Clark Johnson Netflix / Mandalay Entertainment BROKEN CITY Allen Hughes New Regency / Emmett/Furla Films THE BOOK OF ELI Hughes Brothers WB / Alcon Entertainment THE BREAKUP GIRL (Shared Credit) Stacy Sherman Billy Ray / Cambodia Productions TEXAS KILLING FIELDS Ami Canaan Mann Anchor Bay Films Official Selection, Festival de San Sebastian (2011) Official Selection, Venice Film Festival (2011) NEW YORK, I LOVE YOU Allen Hughes Vivendi Entertainment / Plum Pictures THE SENTINEL Clark Johnson Fox / Regency Entertainment PANIC (Shared Credit) Henry Bromell Artisan Entertainment SERIES OZARK (Seasons 1, 2, 3, & 4) Jason Bateman & Various MRC / Netflix Winner, Best Edited Drama Series for Non-Commercial TV, ACE Awards (2021) Nominated, Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series, Emmy Awards (2020) Nominated, Best Edited Drama Series for Non-Commercial TV, ACE Awards (2019) Nominated, Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series, Emmy Awards (2019) SHUT EYE Johan Renck & Various Hulu / Sony HOUSE OF CARDS (Seasons 2, 3 & 4) James Foley & Robin Wright MRC / Netflix Nominated, Outstanding Editing--TV, HPA Award (2015) Nominated, Outstanding Editing--TV, HPA Award (2014) MAD MEN Various AMC / Lionsgate Nominated, Outstanding Single-Camera Picture Editing, Emmy’s (2009) JOHN FROM CINCINNATI Various HBO / David Milch HOMICIDE: LIFE ON THE STREET Various NBC / Levinson / Fontana Company Eddie Nomination, Best Edited One-Hour Series for TV, ACE (1996) OZ (Supervising Editor) Various HBO / Levinson / Fontana Company PILOTS DR. -

Completeandleft
MEN WOMEN 1. Adam Ant=English musician who gained popularity as the Amy Adams=Actress, singer=134,576=68 AA lead singer of New Wave/post-punk group Adam and the Amy Acuff=Athletics (sport) competitor=34,965=270 Ants=70,455=40 Allison Adler=Television producer=151,413=58 Aljur Abrenica=Actor, singer, guitarist=65,045=46 Anouk Aimée=Actress=36,527=261 Atif Aslam=Pakistani pop singer and film actor=35,066=80 Azra Akin=Model and actress=67,136=143 Andre Agassi=American tennis player=26,880=103 Asa Akira=Pornographic act ress=66,356=144 Anthony Andrews=Actor=10,472=233 Aleisha Allen=American actress=55,110=171 Aaron Ashmore=Actor=10,483=232 Absolutely Amber=American, Model=32,149=287 Armand Assante=Actor=14,175=170 Alessandra Ambrosio=Brazilian model=447,340=15 Alan Autry=American, Actor=26,187=104 Alexis Amore=American pornographic actress=42,795=228 Andrea Anders=American, Actress=61,421=155 Alison Angel=American, Pornstar=642,060=6 COMPLETEandLEFT Aracely Arámbula=Mexican, Actress=73,760=136 Anne Archer=Film, television actress=50,785=182 AA,Abigail Adams AA,Adam Arkin Asia Argento=Actress, film director=85,193=110 AA,Alan Alda Alison Armitage=English, Swimming=31,118=299 AA,Alan Arkin Ariadne Artiles=Spanish, Model=31,652=291 AA,Alan Autry Anara Atanes=English, Model=55,112=170 AA,Alvin Ailey ……………. AA,Amedeo Avogadro ACTION ACTION AA,Amy Adams AA,Andre Agasi ALY & AJ AA,Andre Agassi ANDREW ALLEN AA,Anouk Aimée ANGELA AMMONS AA,Ansel Adams ASAF AVIDAN AA,Army Archerd ASKING ALEXANDRIA AA,Art Alexakis AA,Arthur Ashe ATTACK ATTACK! AA,Ashley -
1 Dead, 1 Hurt in 2 A.M. Crash Driver Injured, Passenger Killed When Pickup Flips on US 441 Early Saturday
A3 SUNDAY, NOVEMBER 25, 2018 | YOUR COMMUNITY NEWSPAPER SINCE 1874 | $2 Lake City Reporter LAKECITYREPORTER.COM SUNDAY + PLUS >> Friday Bustling The odd morning Black story of rollover Deborah Friday Pittman bargains 1C Opinion/4A Big plans for mill 2A See 2A 1 dead, 1 hurt in 2 a.m. crash Driver injured, passenger killed when pickup flips on US 441 early Saturday. From staff reports Renovation site a A Lake City man died treasure trove of Saturday morning after a pick- Lake City history. up truck he was traveling in flipped over on US Highway 441, according to a Florida By CARL MCKINNEY Highway Patrol press release. [email protected] Dead is Andrew Powell III, Glass shards form a sheet on the the release said. ground as Benny Smollack sifts At about 1:57 a.m. Saturday, a through what the crew unearthed 2008 Ford F-350 pickup driven in the past couple weeks. by John Ray Beasley, 29, of Lake A miracle cure purchased at the City, was traveling north on 441, MORE drug store that approaching the intersection INSIDE used to be down the n of County Road 240, when it Blanche street, old soda bot- left roadway onto the shoulder, renovation update, 1D. tles from back when striking multiple objects, includ- Lake City still had a ing a culvert, which caused the Coca-Cola plant — there’s no tell- truck to overturn and land on ing what other secrets lie below the its roof. Blanche Hotel. Beasley suffered serious “What is that?” Smollack says, injuries and is being treated picking up a rectangular piece of at Shands UF Health at the debris. -
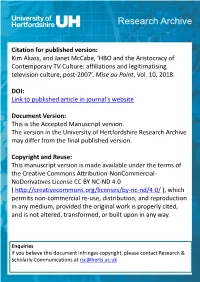
Accepted Manuscript Version
Research Archive Citation for published version: Kim Akass, and Janet McCabe, ‘HBO and the Aristocracy of Contemporary TV Culture: affiliations and legitimatising television culture, post-2007’, Mise au Point, Vol. 10, 2018. DOI: Link to published article in journal's website Document Version: This is the Accepted Manuscript version. The version in the University of Hertfordshire Research Archive may differ from the final published version. Copyright and Reuse: This manuscript version is made available under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives License CC BY NC-ND 4.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. Enquiries If you believe this document infringes copyright, please contact Research & Scholarly Communications at [email protected] 1 HBO and the Aristocracy of TV Culture : affiliations and legitimatising television culture, post-2007 Kim Akass and Janet McCabe In its institutional pledge, as Jeff Bewkes, former-CEO of HBO put it, to ‘produce bold, really distinctive television’ (quoted in LaBarre 90), the premiere US, pay- TV cable company HBO has done more than most to define what ‘original programming’ might mean and look like in the contemporary TV age of international television flow, global media trends and filiations. In this article we will explore how HBO came to legitimatise a contemporary television culture through producing distinct divisions ad infinitum, framed as being rooted outside mainstream commercial television production. In creating incessant divisions in genre, authorship and aesthetics, HBO incorporates artistic norms and principles of evaluation and puts them into circulation as a succession of oppositions— oppositions that we will explore throughout this paper. -

This Is a Test
‘GOODNIGHT FOR JUSTICE: QUEEN OF HEARTS’ PRODUCTION BIOS LUKE PERRY (Executive Producer) – In 1989, Luke Perry was chosen for a starring role on the internationally popular television series “Beverly Hills 90210,” in which he portrayed the brooding but sensitive Dylan McCay. The highly-rated program won a Golden Globe Award for Best Dramatic Television series in 1991. Perry made his feature film debut in a starring role in “8 Seconds,” the remarkable account of champion bull rider Lane Frost, which he co-produced. His serious devotion to the inspirational legend of Lane Frost led him to train vigorously for 18 months in order to master the techniques of bull riding and to be able to perform many of his own stunts during production. Other film credits include Columbia’s “Fifth Element”, directed by Luc Besson, “Riot for Showtime,” “Normal Life,” “American Strays” and “The Florentine,” in which he co-starred with Chris Penn, Jim Belushi, Michael Madsen and Mary Stuart Masterson. Perry made his debut on Broadway in the critically acclaimed musical The Rocky Horror Picture Show, where he portrayed Brad, the character originally played by Barry Bostwick in the cult film classic. In 2004, Perry appeared onstage in London opposite Allyson Hannigan in When Harry Met Sally. Not one to be typecast because of his work on “90210,” Perry’s television credits include a myriad of roles, including a lead in the NBC drama “Windfall,” HBO’s “John From Cincinnati,” starring for two seasons on “Jeremiah,” the Showtime Network sci-fi series, a multi-episode arc on HBO’s critically acclaimed series “Oz,” in which he portrayed a televangelist convicted of fraud, as well as roles in Hallmark Channel productions “Johnson County War,” “Supernova,” “A Gunfighter’s Pledge” and “Angel and the Badman.” Perry starred in “Goodnight for Justice,” Hallmark Movie Channel’s highest rated movie of all time. -
HIT, Ski Team Celebrate Miller's Winter Magic
Call (906) 932-4449 Ironwood, MI Sunday Night Football Packers fall to Vikings Redsautosales.com 17-24 SPORTS • 9 DAILY GLOBE Monday, November 26, 2018 Few snow showers yourdailyglobe.com | High: 20 | Low: 13 | Details, page 2 THE FACE OF WINTER HIT, ski team celebrate Miller’s winter magic By RALPH ANSAMI formula of skiers riding big [email protected] mountains on plenty of IRONWOOD – It was powder, died in January at fitting that the Warren age 93 at his home on Miller tribute movie “The Orcas Island in Puget Face of Winter” on Satur- Sound, near Seattle. day kicked off a week of It was the fourth year of Jack Frost Festival events, Warren Miller movies as sticky snow was falling being featured at the the- across the Gogebic Range. ater and last year’s movie The tribute to the man brought out 435 people. It who made winter magic on appeared that the energetic film was released in Octo- Saturday night crowd ber, directed by Chris Pat- might eclipse that mark. terson. It premiered Satur- Theater-goers received day night on the big screen promotional winter litera- Ralph Ansami/Daily Globe at the Historic Ironwood A GOGEBIC Range Trail Authority groomer parked outside the Histotic Ironwood Theatre pays tribute to the late Theatre. Warren Miller on Saturday evening. The downtown theater quickly filled for the premier of “Face of Winter,” a Miller, using a movie tribute to the film-maker who died in January. MILLER — page 5 ALL TOGETHER NOW ICORE looks to raise funds for land acquisition By RICHARD JENKINS Traczyk said the event, “They don’t have to give [email protected] from 3:30 to 6 p.m., will money right away, but HURLEY – Supporters feature a menu of salad, we’re asking them to of the effort to develop pizza, pasta and dessert. -

Production Biographies
PRODUCTION BIOGRAPHIES MIKE O’MALLEY (Executive Producer & Showrunner, Writer- 201, 207, 210) Truly a multi-hyphenate, Mike O’Malley got his start in front of the camera hosting Nickelodeon’s “Get the Picture” and the iconic game show “Guts”. His success continued in television with standout roles in “Yes Dear”, “My Name Is Earl”, “My Own Worst Enemy”, “Justified”, and his Emmy®-nominated, groundbreaking performance as ‘Burt Hummel’ on the hit show “Glee”. Mike’s feature work includes roles in Eat Pray Love, Cedar Rapids, Leatherheads, Meet Dave, 28 Days, and the upcoming Untitled Concussion Project starring Will Smith which will be released Christmas 2015. Also an accomplished writer, Mike wrote and produced the independent feature Certainty which he adapted from his own play. In television, Mike has served as a Consulting Producer on “Shameless” and is in his second season as creator and Executive Producer of “Survivor’s Remorse” for Starz. LEBRON JAMES (Executive Producer) LeBron James is widely considered one of the greatest athletes of his generation. James’ extraordinary basketball skills and dedication to the game have won him the admiration of fans across the globe, and have made him an international icon. Prior to the 2014-2015 season, James returned to his hometown in Ohio and rejoined the Cleveland Cavaliers in their mission to bring a championship to the community he grew up in. James had previously spent seven seasons in Cleveland after being drafted out of high school by his hometown team with the first overall pick in the 2003 NBA Draft. James led the Cavaliers to five straight NBA playoff appearances and earned six All-Star selections during his first stint in Cleveland. -

NADINE HADERS Costume Designer
NADINE HADERS Costume Designer official website FEATURES (partial list) THE WATER MAN Harpo Films Dir: David Oyelowo *RUN SWEETHEART RUN Blumhouse Productions Dir: Shana Feste **DON’T LET GO Blumhouse Productions Dir: Jacob Estes ***GET OUT Blumhouse Productions Dir: Jordan Peele Trailer MIRACLES AND LIGHT Glossy Pictures Dir: Kirk Woodward Nelson (Short) O (Asst. Costume Designer) Lionsgate Films Dir: Tim Blake Nelson PAY IT FORWARD Warner Bros. Pictures Dir: Mimi Leder (Costumer) *2020 Sundance Film Festival Official Selection *2020 SXSW Film Festival Official Selection **2019 Sundance Film Festival World Premiere ***2018 Costume Designers Guild Award Nominee – Excellence in Contemporary Film ***2018 Academy Award Nominee – Best Motion Picture of the Year TELEVISION (partial list) LEVERAGE 2.0 (Season 1) Electric Entertainment Creators: Chris Downey, John Rogers BIG SHOT (Season 1) Disney + Creators: David E. Kelley, Dean Lorey MACGYVER (Season 1) CBS Creators: Peter M. Lenkov, Lee David Zlotoff INTO THE BADLANDS (Season 1) AMC Creators: Alfred Gough, Trailer Miles Millar COMPLICATIONS (Season 1) USA Creator: Matt Nix LEGENDS (Season 1) TNT Creator: Howard Gordon RAISING HOPE (Season 4) Fox Creator: Greg Garcia LEVERAGE (Seasons 1-5) TNT Creator: Dean Devlin Trailer RAISING THE BAR (Season 1) TNT Creator: Steven Bocho, David Feige JOHN FROM CINCINNATI HBO Creators: David Milch, (Season 1) Kem Nunn DEADWOOD HBO Creator: David Milch (Asst. Costume Designer) (Season 3) SIX FEET UNDER HBO Creator: Alan Ball (Asst. Costume Designer) (Seasons 4-5) . -

Andy Gowan Music Supervisor
ANDY GOWAN MUSIC SUPERVISOR Music Supervision: FEATURE FILM LARRY GAYE: RENEGADE MALE Ted Kroeber, Michael Roiff, prods. FLIGHT ATTENDANT Sam Friedlander, dir. Night and Day Pictures THE PRETTY ONE Steven J. Berger, Robin Schorr, prods. Provenance Pictures / RCR Pictures Jenee LaMarque, dir. LIBERAL ARTS Brica Dal Farra, Claude Dal Farra, Jesse BCDF Pictures / IFC Films Hara, Lauren Munsch, Josh Radnor, prods. Josh Radnor, dir. DETACHMENT Bingo Gubelmann, Benji Kohn, Carl Lund, Paper Street Films / Tribeca Film Chris Papavasiliou, Greg Shapiro, Austin Stark, prods. Tony Kaye, dir. HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE Jesse Hara, Benji Kohn, Chris Paper Street Films / Anchor Bay Papavasiliou, Austin Stark, prods. Josh Radnor, dir. CATS DANCING ON JUPITER Jordan Alan, prods. Evolution Entertainment Jordan Alan, dir. THE BAYTOWN OUTLAWS Bill Perkins, Robert Teitel, prods. Lleuju Productions Barry Battles, dir. THE LITTLE THINGS Jacob Livermore, Neil McGregor, prods. A Family Affair Productions Neil McGregor, dir. WHEN WE WERE PIRATES Independent Production TELEVISION IT’S ALWAYS SUNNY IN Charlie Day, Glenn Howerton, Rob PHILADELPHIA (series) McElhenney, Nick Frenkel, exec. prods. Fox HAPPYLAND (series) Jill Cargerman, Neil Meron, Craig Zadan, exec. prods. MTV Productions The Gorfaine/Schwartz Agency, Inc. (818) 260-8500 1 ANDY GOWAN MUSIC SUPERVISOR BOJACK HORSEMAN (series) Will Arnett, Raphael Bob-Waksberg, Noel Netflix Bright, Steven Cohen, Aaron Paul, exec. prods. WE ARE MEN Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum, prods. CBS Rob Greenberg, dir. THE MINDY PROJECT Michael Spiller, Mindy Kaling, Howard NBC Uni Studios / Fox Klein, Charles McDougall, Matt Warburton, exec. prods. MADE IN JERSEY Dana Calvo, Kevin Falls, Julia Franz, Sony Television / CBS Jamie Tarses, Jessica Tuchinsky, Mark Waters, Jan Nash, exec. -

The False Start of QUBE
Interactive TV Too Early: The False Start of QUBE Amanda D. Lotz The Velvet Light Trap, Number 64, Fall 2009, pp. 106-107 (Article) Published by University of Texas Press DOI: 10.1353/vlt.0.0067 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/vlt/summary/v064/64.article01_sub24.html Access provided by University of Michigan @ Ann Arbor (14 Mar 2014 14:25 GMT) 76 Perspectives on Failure THE EDITORS Dossier: Perspectives on Failure edia history is lined with failures, flops, success. But the economics of television place the failure and false starts across the areas of aesthet- threshold much higher, as most series only turn profitable ics and style, technology, social and politi- after multiple seasons, making failure a nearly universal M cal representation, media studies’ methods condition by the only measures that matter to the televi- and models, and industry and business. We approached sion industry. a number of well-known media scholars working in From a creative perspective, failure is much more a variety of fields and asked them to discuss a favorite, muddy. Many programs that have turned a profit via overlooked, or particularly important instance of failure in the magical realm of syndication are viewed by critics one of these five arenas. Their thought-provoking answers and creators with scorn—sure, programs like Gilligan’s complement and extend the concerns raised elsewhere Island, Empty Nest, and Coach could be seen as successes, in this issue, covering a range of topics from submarine with long, profitable runs both on- and off-network, movies to PowerPoint presentations and from telephonic but it would be hard to find a serious defense of their cats to prepositions. -

Dirty Words in Deadwood
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln University of Nebraska Press -- Sample Books and Chapters University of Nebraska Press Spring 2013 Dirty Words in Deadwood Melody Graulich Nicolas S. Witschi Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/unpresssamples Graulich, Melody and Witschi, Nicolas S., "Dirty Words in Deadwood" (2013). University of Nebraska Press -- Sample Books and Chapters. 206. https://digitalcommons.unl.edu/unpresssamples/206 This Article is brought to you for free and open access by the University of Nebraska Press at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in University of Nebraska Press -- Sample Books and Chapters by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Dirty Words in Deadwood Buy the Book Postwestern Horizons General Editor William R. Handley University of Southern California Series Editors José Aranda Rice University Melody Graulich Utah State University Thomas King University of Guelph Rachel Lee University of California, Los Angeles Nathaniel Lewis Saint Michael’s College Stephen Tatum University of Utah Buy the Book Dirty Words in Deadwood Literature and the Postwestern edited by melody graulich and nicolas s. witschi University of Nebraska Press § Lincoln and London Buy the Book © 2013 by the Board of Regents of the University of Nebraska. Chapter 2, “Last Words in Deadwood,” by Brian McCuskey, originally appeared as “Last Words in Deadwood: Literacy and Mortality on the Frontier” in The Journal of Popular Culture (2011) Wiley Online Library. http://online library.wiley.com/doi/10.1111/ j.1540-5931.2011.00876.x/pdf. All rights reserved Manufactured in the United States of America Library of Congress Cataloging- in-Publication Data Dirty words in Deadwood: literature and the postwestern / edited by Melody Graulich and Nicolas S. -

MARK MANOS, ACE Editor
MARK MANOS, ACE Editor PROJECTS DIRECTORS STUDIOS/PRODUCERS UNDER THE BANNER OF HEAVEN David Mackenzie IMAGINE TV / FX PRODUCTIONS / FX Limited Series Michael Weiss, Dustin Lance Black THE HOT ZONE Daniel Perceval TOUCHSTONE / SCOTT FREE Season 2 John Fawcett NATIONAL GEOGRAPHIC Brian Peterson, Kelly Souders Carina Sposato SWAGGER Reggie Rock Bythewood IMAGINE ENTERTAINMENT / CBS Season 1 Alex Hall STUDIOS/ APPLE TV+ Michael Weiss, Reggie Rock Bythewood INTERROGATION Ernest Dickerson CBS ALL ACCESS Series Patrick Cady Anders Weidemann, John Makiewicz WHAT/IF Phillip Noyce NETFLIX Pilot & Series Mike Kelly, Melissa Loy, Robert Zemeckis SEAL TEAM Christopher Chulack CBS Pilot Chris Chulak, Ed Redlich Carl Beverly, Sarah Timberman LIMITLESS Doug Aarniokoski CBS Series Aaron Lipstadt Craig Sweeny Leslie Libman Edward Ornelas Rich Lee EXTANT Matt Early Beesley CBS Series Dan Lerner Greg Walker, Justin Falvey Paul McCrane Darryl Frank, Steven Spielberg Kevin Dowing VEGAS James Mangold CBS Pilot & Series Gary Fleder Greg Walker, Nick Pileggi Duane Clark NYC22 James Mangold CBS / TRIBECCA PRODS Pilot Richard Price A GIFTED MAN Jonathan Demme CBS Pilot Recut & Series Sarah Timberman, Carl Beverly CALIFORNICATION Seith Mann SHOWTIME Series Eric Stoltz Tom Kapinos CASTLE Rob Bowman ABC Pilot & Series Andrew Marlowe, Army Bernstein Laurie Zaks LAST OF THE NINTH Carl Franklin HBO Pilot David Milch, Carolyn Strauss JOHN FROM CINCINNATI Gregg Fienberg HBO Series Ed Bianchi David Milch, Carolyn Strauss Jesse Bochco Daniel Minahan DAMAGES Jon Amiel 20th CENTURY FOX TV Pilot Jonathan Lisco INNOVATIVE-PRODUCTION.COM | 310.656.5151 .