Maincy, Etude Val D'ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Melun Rubelles Le Mee-Sur-Seine Vaux-Le-Penil
B Horaires valables du 31 Août 2020 au 04 Juillet 2021 VAUX-LE-PENIL MELUN RUBELLES LE MEE-SUR-SEINE Foch 11 Novembre C. Cial Almont URSSAF André Malraux Santé Pôle Montagne du Mée Sorbiers Gare du Mée B VAUX LE PENIL FOCH 11 NOVEMBRE MELUN ALMONT SANTÉ PÔLE GARE DU MÉE B GARE DU MÉE FOCH 11 NOVEMBRE Rubelles Beauregard Saint£ Exupéry André Malraux Meuniers £ Santé Pôle £ 3 Horloges Europe Saint-Nicolas Maincy £ £ £ Champ de Foire £ R. Cassin £ Patton Montaigu Branly £ £ £ £ Lycée Centre Commercial D 306 Léonard de Vinci Carmes £ Cosec Pompiers £ £ de Saint-Exupéry A. Collège Avenue de MeauxC. Cial Bd Avenue de Corbeil Frédéric Chopin Rue des£ Mézereaux Lycée de Vert-Saint-Denis Jacques Amyot C. Cial Almont Collège £ l'Almont R.Schuman Collège Brossolettes A Jacques Amyot £ Lycée v . Juin Clemenceau Route de G. Sand £ Le Mée-sur-Seine d e Voisenon l Rue du a Li Bir Hakeim Maréchal Juin Vaux- Molière Bréau Sorbiers b £ é Foch Niepce le-Pénil £ £ £ Collège r Melun £ a Croix Blanche t Elsa Triolet i £ o Saint Just Einstein n Centre hospitalier £ Av. du Vercors Marc Jacquet 18 Juin R. Saint-Just Av. £ CES Jean de la Fontaine M. Dauvergne Collège Saint Just Clemenceau £ J. de la Fontaine Maison Moustier de l'Agriculture Gare du Mée Foch 11 Novembre $ 6 min Fenez Vercors Montagne du Mée Collège de la Mare aux£ Champs N £ £ £ Lycée polyvalent Acacias 400 m 07.19 © OSM Simone Signoret £ ZONE 5 ZONE 5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES JOURS FÉRIÉS 2020-2021 Les horaires sont calculés dans des conditions normales de circulation Toussaint dimanche 1er novembre 2020 et sont sujets à ses aléas. -

Note De Presentation
33 NOTE DE PRESENTATION OBJET - RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT Dans le cadre de sa compétence en matière Assainissement, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine est maître d’ouvrage de plusieurs systèmes d’assainissement : · Celui regroupant les communes de l’agglomération centrale : Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Boissettes, Dammarie-les-Lys, Melun, Montereau-sur-le-Jard, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Livry- sur-Seine, Saint-Germain-Laxis, Rubelles, Vaux-le-Pénil et Voisenon, confié par DSP à la Société des eaux de Melun (SEM) · Celui de : Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port confié par DSP à la société des eaux de l’Essonne. (SEE) L’exercice de cette compétence implique l’élaboration d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. En effet, l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement destiné notamment à l’information des usagers ». Le rapport annuel 2016 regroupe l’analyse du prix et de la qualité du service public d’assainissement de ces systèmes d’assainissement. Ce rapport est disponible sur le portail intranet des élus de la Communauté Melun Val de Seine : https://antares.camvs.fr/ox6/ox.html# Dépôt de données → 05 Conseil Communautaire → 11 décembre 2017 Il est demandé au Conseil Communautaire d’émettre un avis sur ledit rapport annuel. -

Tirage Au Sort Des Panneaux D'affichage
PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE Tirage au sort des panneaux d’affichage BOISSISE-LA-BERTRAND Numéro de Nom de la liste panneau AVEC VOUS, BOISSISE DEMAIN 1 M. DELMER Olivier BOISSISE-LE ROI Numéro de Nom de la liste panneau NOUVEL HORIZON 1 Mme CHAGNAT Véronique 2 VILLAGES, 1 COMMUNE 3 M.BRIAND Eric BOISSISE-ORGENOY NOUVELLE ENERGIE 2 M. BERTRY Alain CESSON Numéro de Nom de la liste panneau UNION POUR CESSON 1 M. CHAPLET Olivier NOUVEAU DEPART POUR CESSON 2 M. BOSQUILLON Christophe LE CHÂTELET-EN-BRIE Numéro de Nom de la liste panneau VIVRE AU CHÂTELET EN BRIE 3 Mme TORCOL Patricia BIEN VIVRE ENSEMBLE 2 Mme ANESA Françoise AGIR ET INNOVER 1 M. BETTANCOURT François CHAUMES-EN-BRIE Numéro de Nom de la liste panneau UNIS POUR CHAUME 2 M. VENANZUOLA François CHAUMES : REUSSIR AVEC VOUS 1 M. ARLANDIS Mathieu COMBS-LA-VILLE Numéro de Nom de la liste panneau AGISSONS POUR COMBS 2 M. SAINSARD Philippe TOUS ENSEMBLE POUR COMBS-LA-VILLE 1 M. GEOFFROY Guy Combs , A GAUCHE, ECOLOGIQUE ET CITOYENNE 3 M. ROUSSAUX Daniel COUBERT Numéro de Nom de la liste panneau « COUBERT DE TOUTES NOS FORCES » 1 M. SAOUT Louis Marie DAMMARIE-LES-LYS Numéro de Nom de la liste panneau UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE-LES-LYS 2 M. DESCOLIS Wilfried DAMMARIE CITOYENNE 3 M. BENOIST Vincent DAMMARIE MA VILLE 1 M. BATTAIL Gilles EVRY-GREGY-SUR-YERRES Numéro de Nom de la liste panneau PRÉSERVER EVRY-GREGY ET SES HAMEAUX 1 M. POIRIER Daniel FONTAINE-LE-PORT Numéro de Nom de la liste panneau FONTAINE, L’AVENIR AVEC VOUS 1 M. -
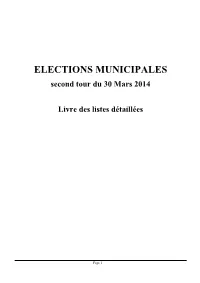
Inventaire Des Candidatures Arrdt Melun +1000
ELECTIONS MUNICIPALES second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Page 1 Elections municipales second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 77 - SEINE ET MARNE Candidat au conseil communautaire 77 SEINE ET MARNE 022 - Barbizon 01 ENSEMBLE PLUS LOIN POUR BARBIZON 1 M. BEDOUELLE Pierre Oui 2 Mme BONED Valérie Oui 3 M. ROMAN Jacques 4 Mme ANDRY Florence 5 M. BRECOURT David 6 Mme DAVID Valérie 7 M. LEROY Christophe Oui 8 Mme TRUCHON BARTES Nathalie Oui 9 M. HUGONNENC Gérard 10 Mme GABRIELLI Katherine 11 M. BOUILLOT Jean-Sébastien 12 Mme CAMARA Nathalie 13 M. OUF Olivier 14 Mme GUTIERREZ Martha 15 M. MONTILLOT Stéfan 02 AGIR POUR LES BARBIZONNAIS 1 M. ELLEBOODE Gérard Oui 2 Mme COURCHAMP Anne Oui 3 M. SANCHEZ Patrick Oui 4 Mme BARON Florelle Oui 5 M. SZWIMER Alain 6 Mme PIED Claudine 7 M. MARTEAU Christian 8 Mme PAYET Anne-Gaëlle 9 M. TIZON Daniel 10 Mme LUKAS Gaëlle 11 M. MANIGAULT Pierre 12 Mme LAMMERTYN Candice 13 M. GERLES Nicolas 14 Mme CARDOT-ELLEBOODE Catherine 15 M. CORBEL Michel 03 UNE EQUIPE POUR BARBIZON 1 M. DOUCE Philippe Oui 2 Mme DETOLLENAERE Brigitte Oui 3 M. SCHOPPHOFF Klaus Oui 4 Mme GENOT Dominique Oui 5 M. PETITHORY Charles 6 Mme VERGE Janine 7 M. THIEVIN Gérard 8 Mme BOUVARD Christiane 9 M. SOUDAIS Pierre 10 Mme JOSEPH Chantal 11 M. LATOUR René 12 Mme BESSES Marie 13 M. BOETHAS Marcel 14 Mme DEGEYTER Liliane 15 M. CHAUSSARD Jean Page 2 Elections municipales second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 77 - SEINE ET MARNE Candidat au conseil communautaire 039 - Boissise-la-Bertrand 01 BOISSISE EN ACTION 1 M. -

Rankings Municipality of Maincy
9/27/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / ILE DE FRANCE / Province of SEINE ET MARNE / Maincy Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Achères-la-Forêt Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Forfry AdminstatAmillis logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Forges Amponville FRANCIA Fouju Andrezel Fresnes- Annet-sur-Marne sur-Marne Arbonne- Frétoy la-Forêt Fromont Argentières Fublaines Armentières- en-Brie Garentreville Arville Gastins Aubepierre- Germigny- Ozouer-le-Repos l'Évêque Aufferville Germigny- sous-Coulombs Augers-en-Brie Gesvres- Aulnoy le-Chapitre Avon Giremoutiers Baby Gironville Bagneaux- Gouaix sur-Loing Gouvernes Bailly- Romainvilliers Grandpuits- Bailly-Carrois Balloy Gravon Bannost- Villegagnon Gressy Barbey Gretz- Armainvilliers Barbizon Grez-sur-Loing Barcy Grisy-Suisnes Bassevelle Grisy-sur-Seine Bazoches- lès-Bray Guérard Beauchery- Guercheville Saint-Martin Guermantes Beaumont- Guignes du-Gâtinais Gurcy-le-Châtel Beautheil-Saints Hautefeuille Beauvoir Héricy Bellot Hermé Bernay-Vilbert Hondevilliers Beton-Bazoches Ichy Bezalles Isles- Powered by Page 3 Blandy les-Meldeuses L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Blennes Isles-lès-Villenoy Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Bois-le-Roi FRANCIAIverny -

Rubelles Flash Infos Juillet/Aout 2021
RUBELLES FLASH INFOS JUILLET/AOUT 2021 COVID-19 1 MANIFESTATIONS MUNICIPALES CINEMA EN PLEIN AIR Séance gratuite : La séance de cinéma en plein air avec comme thème «Soirs de fête sous les étoiles... » aura lieu le vendredi 10 septembre à 20h30 au Parc Saint Exupéry, rue de Solers. Le film qui sera projeté est « Happy Feet 2 » de George Miller. En cas d’intempéries la projection aura lieu à la salle Emile Trélat à 20h30. Renseignements : 01.60.68.24.49. VIDE-GRENIERS Après une interruption en 2020 due à la pandémie COVID19, le vide- greniers de Rubelles va reprendre cette année. Celui-ci se tiendra le dimanche 19 Septembre de 8h à 18h rue de la Faïencerie, avenue du Château et place Henri Guy. Les inscriptions se feront en mairie du 12 juillet au 15 septembre inclus, le dossier d’inscription sera alors téléchargeable sur le site internet de la mairie. Les tarifs sont inchangés par rapport à 2019 : Rubellois : 10€ l’emplacement de 4 mètres non divisible Extérieurs : 15€ l’emplacement de 4 mètres non divisible Professionnels : 50€ l’emplacement de 4 mètres non divisible 2 LA FOULÉE RUBELLOISE Pour la première fois cette année la commune organise une course à pied dans Rubelles. Cette manifestation se déroulera le dimanche matin 3 octobre. Départ et arrivée au kiosque des 3 Noyers Deux parcours seront identifiés, un pour les enfants de 6 à 12 ans de 2 km, le deuxième pour les adolescents et les adultes, de 5 km. Les renseignements et informations détaillés vous seront communiqués dans le prochain flash info de septembre et sur le site de la mairie à partir du 6 septembre. -

Saint-Germain-Laxis N'a Jamais Été Écrite
5AINT-GERMAIN-LAXLS Le village qui m"a vu naître L'origine du nom, Son présent, son passé, Ses anciens seigneurs, Son hameau de Pouilly-Gallerand. par Bernard/CARON Préface de René JA CQUELOT, ancien Maire EDITIONS AMATTEIS - 77190 DAMMARIE-LES-LYS - 1984 - A la mémoire de mes grands-parents et de mon père IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE 600 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS DE 1 A 600 SUR COUCHÉ CALYPSO CONSTITUANT L'ÉDITION ORIGINALE Photo couverture : Peinture à l'huile sur toile de Pierre NIVERT PRÉFACE Depuis longtemps, les études d'histoire locale sont à l'honneur dans notre pays briard. La plupart des villages environnants possè- dent leur notice historique grâce à des personnes dévouées et pas- sionnées. L'histoire de Saint-Germain-Laxis n'a jamais été écrite. Il a fallu qu'un enfant du village se passionne de cette étude pour que l'on connaisse mieux son passé. Ainsi, pendant plusieurs années, Bernard Caron avec une patience de bénédictin a longuement et attentivement parcouru les archives communales, départementales, nationales, les archives d'Auxerre et ecclésiastiques de l'évêché de Meaux puis interrogé les anciens et les archéologues avec intelligence, méthode et conscience. Il a ainsi réuni dans cet ouvrage près de 130 thèmes allant du Moyen Age à nos jours. Saint-Germain-Laxis a bien sûr subi la poussée irrésistible de la civilisation moderne. C'est l'image difficile et interrogative de nos anciens, celle de la cœxistence du rural et de la vie urbaine. L'accélération du progrès, de la vie moderne motive à elle seule ce livre qui nous rappelle notre passé local, Bernard Caron l'a écrit avec tout son cœur, voici le fruit de son travail. -

Sur Les Pas De Paul Cézanne
Le pont de Maincy Le pont de Maincy, rendu célèbre par le peintre Cézanne (1839-1906), est situé dans le bas de Trois Moulins, il franchit l’Almont, marquant la limite des communes de Maincy et Melun. Paul Cézanne a peint cet endroit alors qu’il séjournait à Melun en 1879. L’œuvre est importante car elle marque un tournant décisif dans l’expression de l’artiste qui rompt avec l’impressionnisme. Elle est Voir carte IGN n° 2415 OT aujourd’hui exposée au musée d’Orsay. Ce n’est qu’en 1950 qu’un professeur de dessin reconnait le lieu et Départ : Maincy intervient pour que ce tableau retrouve son vrai Place des Fourneaux GPS : Lat. Long. : 48.550,2.701 nom : « Pont de Maincy » nommé auparavant « Pont de UTM : 31U 0477910 5377470 Maincy Mennecy » en raison probablement de l’accent méridional de son auteur. Sur les pas de Paul Accès : Maincy, située à 3 km de Melun et à environ 60 km de Paris. Cézanne Informations pratiques : 1 épicerie, 1 boulangerie Dénivelé positif : 90 m Charte du randonneur • Ne vous écartez pas des chemins balisés. • En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur le descriptif. Maincy : Pont Cézanne – Photo FD ® • Respectez la nature et la propriété privée. La ruelle du ru et les moulins • N'abandonnez pas de détritus. L’eau détient une place prépondérante dans l’histoire et • Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse l’économie de la commune. Si le village s’est développé sur (renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des un coteau de l’Almont, c’est pourtant le ru très discret chasseurs de Seine et Marne). -

La Prairie Malécot
5 La Prairie Malécot Département de Seine-et-Marne • Direction de la communication • En couverture photo : Maxime Briola • Carte : Beaurepaire • Juillet 2019 • Juillet • Carte : Beaurepaire Briola photo : Maxime couverture de la communication • En • Direction Département de Seine-et-Marne Le Département de Seine-et-Marne se développe au rythme de la Métropole francilienne tout en conservant une grande diversité naturelle et paysagère. Forêts, marais, prairies humides ou pelouses sèches constituent un patrimoine fragile. Le Département protège et valorise ces sites naturels afin que tous les Seine-et- Marnais puissent en profiter. Emplacement actuel de l’ENS En 1992, l’espace naturel sensible de la prairie Malécot est créé puis étendu en 1993, an de garantir le maintien d’un site préservé en bordure de Seine, à proximité du centre ancien de Boissise-le-Roi. Ce site périurbain, associé à la vallée de la Seine, fait partie de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais*, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial des sites naturels, en novembre 1998. Situé au nord-est de Boissise-le-Roi, sur le Plateau de la Brie, il s’étend en rive gauche de la Seine sur un peu plus d’un kilomètre et ore un point de vue idéal pour admirer les nombreuses péniches qui animent le paysage. LE SITE Emplacement actuel de l’ENS Plan d’intendance des paroisses de Saint-Sauveur, Pringy, Montgermont, Brainville et Orgenoy (XVIIIe siècle). Photo : Archives Département de Seine-et-Marne Jusqu’au XIXe siècle, le site fait partie Fontainebleau, entre Chailly-en-Bière de la propriété du château, l’actuel Hôtel et Bois-le-Roi. -

L'unité De Production De Boissise-La-Bertrand
tectes I h C L’unité de production d’eau potable de Melun située à Boissise-la-Bertrand a été retenue parmi les 100 bâtiments de l’année 2006 par la revue eyron Ar eyron d’architecture « Le Moniteur Architecture AMC ». C Ce résultat récompense, outre la qualité de l’architecture, l’attention portée au caractère « développement durable » du projet. on Afin de mieux intégrer l’imposante structure des deux bâtiments de l’usine et de limiter leur visibilité, les façades principales ont été habillées d’un bardage en demi-rondins de bois et de polycarbonate translucide, sur lequel a été posée une fresque en aluminium découpé qui évoque l’eau. - Crédit photo : M - Crédit : photo Unité de production d’eau potable de Melun Site de Boissise-la-Bertrand Agence de Melun 198, rue Foch Z.I. Vaux le Pénil - BP 576 77016 Melun Cedex > Sécurisation de l’alimentation et amélioration de la qualité de l’eau distribuée > Les étapes de traitement 1 L’eau est prélevée dans la 2 L’unité est composée de 12 filtres 3 L’eau est désinfectée en 4 Une fois désinfectée, l’eau est nappe du Champigny grâce fermés contenant du charbon passant sur des lampes stockée dans une bâche de à 4 forages situés en forêt actif en grains, qui capte les émettant des ultra-violets 2750 m3. Avant distribution, de Boissise-la-Bertrand. pesticides contenus dans l’eau. qui ont un pouvoir virulicide elle est chlorée. Elle est acheminée par une et bactéricide fort. canalisation de 2,5 km jusqu’à l’unité de potabilisation où elle va suivre un traitement d’élimination des pesticides. -

Saint-Germain-Laxis
Concession de Saint-Germain-Laxis Rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application du IV de l’article 6 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures 1 - Description du titre minier La concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Saint-Germain-Laxis » est détenue à 100% par la société Geopetrol S.A. La concession de Saint-Germain-Laxis avait été accordée par décret ministériel du 13 septembre 1991 (Journal officiel du 28 septembre 1991) au profit des sociétés Triton France et Total Exploration, conjointes et solidaires, pour une durée de 25 ans et sur une superficie de 20 km² environ portant sur partie du territoire des communes de Blandy-les-Tours, Crisenoy, Fouju, Maincy, Moisenay et Saint-Germain-Laxis, toutes situées dans le département de la Seine-et-Marne. Par décret du 27 novembre 1996 (Journal Officiel du 4 décembre 1996), la mutation du titre minier était autorisée au profit de la société Geopetrol S.A. Par décret du 2 février 2018 (Journal Officiel du 4 février 2018), la concession de Saint-Germain-Laxis a été prolongée jusqu’au 28 septembre 2031 sur une surface inchangée. 2 - Description du gisement exploité dans le périmètre du titre minier Les hydrocarbures exploités sur la concession de Saint-Germain-Laxis proviennent des niveaux géologiques du Norien (grès de Chaunoy), datés du Trias Supérieur (environ 215 millions d’années). Ces formations présentent des propriétés pétrophysiques bonnes à excellentes. Les porosités varient de 10 à 20% et les perméabilités vont de quelques millidarcys à plusieurs centaines de millidarcys. -

La Demande De Logement
IMPLANTATION DU PATRIMOINE FSM La demande Moussy-le-Neuf St-Pathus Oissery de logement Longperrier Juilly EN LIGNE Antenne de Bussy-St-Georges Meaux Trilport Nanteuil-lès-Meaux Courtry Carnetin Dampmart Pomponne Thorigny Coupvray Bouleurs Vaires-sur-Marne Lagny-sur-Marne St-Germain-sur-Morin Torcy Montévrain Magny-le-Hongre Champs-sur-Marne Noisiel Serris Bailly-Romainvilliers Lognes Bussy- Émerainville Croissy- St-Georges Beaubourg Villeneuve-le-Comte Pontault-Combault Roissy-en-Brie Gretz- Lésigny Armainvilliers Antenne Tournan-en-Brie Chevry-Cossigny de Provins Brie-Comte-Robert Combs-la-Ville Évry-Grégy Lieusaint Moissy-Cramayel Savigny-le-Temple Réau Nandy Vert-St-Denis Voisenon Cesson Rubelles Provins Seine-Port Melun Nangis St-Loup- Maincy de-Naud Poigny Le Mée-sur-Seine Vaux-le-Pénil La Chapelle-Gauthier Savins Dammarie-lès-Lys Livry-sur-Seine Agence Bois-le-Roi Val de Seine Samois-sur-Seine Héricy Grisy-sur-Seine & Sénart Fontaine- Avon Villenauxe- Fourches Mousseaux- la-Petite Fontainebleau lès-Bray Grez-sur-Loing Agence de Fontainebleau Crédit photos : Fotolia.com : © goodluz - Istockphoto.com : © Kristian Seculic, © Squaredpixels – Jupiterimages - Atelier BLM – Ne pas jeter sur la voie publique sur la voie BLM – Ne pas jeter - Atelier – Jupiterimages © Kristian © Squaredpixels Seculic, © goodluz - Istockphoto.com : Fotolia.com : photos : Crédit Entreprise sociale pour l’Habitat Siège social 14, avenue Thiers 77000 Melun 01 64 14 43 30 www.fsm.eu Vous allez saisir votre demande de logement sur le site www.fsm.eu. VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER une demande de logement ? Une fois votre demande validée, vous recevrez sous un mois, un NUMÉRO UNIQUE RÉGIONAL qui vous sera demandé lors de toutes correspondances.