Et Khartoum (Soudan), Étude Comparée
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
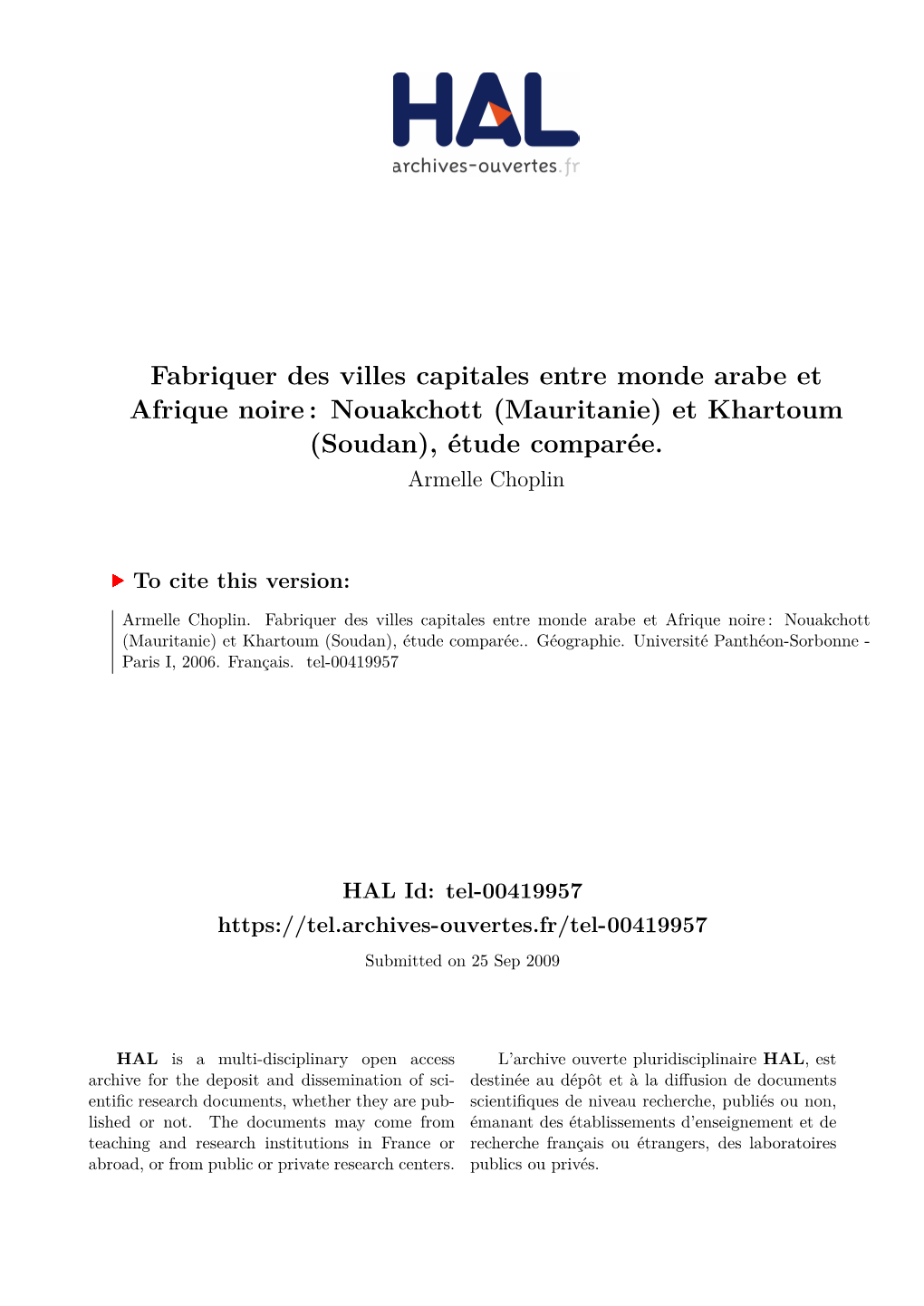
Load more
Recommended publications
-

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

Etudes Techniques Du Reseau Cible
ETUDES TECHNIQUES DU RESEAU CIBLE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 7. Etude technique du réseau cible 1 7.1 Contexte 1 7.2 Objectifs 1 7.3 Contexte actuel, contexte engagé (moyen terme) du système de transport et choix techniques en vigueur 1 7.3.1 Objectifs et critères d’analyse 1 7.3.1.1 Objectifs 1 7.3.1.2 Critères 2 7.3.2 Analyse de la situation existante 2 7.3.2.1 Lignes 3 7.3.2.2 Calculs de répartition à la pointe de charge 6 7.3.2.3 Calculs de court-circuit 9 7.3.2.4 Calculs de stabilité transitoire 10 7.3.2.5 Situation au creux de charge 14 7.3.2.6 Conclusion 15 7.4 Projets annoncés (projets SOMELEC et OMVS) 15 7.4.1 Projets supposés engagés 15 7.4.1.1 Projets d’extension de réseau 15 7.4.1.2 Projets de production d’électricité 16 7.4.2 Projets moins certains 16 7.5 Rappels du contexte futur: Prévisions de la demande et plan de production long terme 17 7.5.1 Prévisions de la demande 17 7.5.1.1 Charge des localités des Réseaux Autonomes (RA ou "Réseaux Araignées") 17 7.5.1.2 Charge des localités du Réseau Interconnecté (RI) 18 7.5.1.3 Charge de Nouakchott et Nouadhibou 18 7.5.2 Année de raccordement des autres grandes localités 19 7.5.3 Plan de production 19 7.6 Projets "Plan Directeur" : calculs de répartition 20 7.6.1 Variantes envisageables 20 7.6.2 Plan de tension et compensation de la puissance réactive 22 7.6.3 Niveau de charge des lignes et transformateurs 25 7.6.4 Pertes à la pointe en 2030 25 7.6.5 Introduction -

JWSR V10n3-Complete Issue
Expansions And Contractions: World-Historical Change And The Western Sudan World-System (1200/1000 B.C.–1200/1250 A.D.)* Ray A. Kea part one: history, chronologies, and the new archaeology Introduction By the 12t century a.d. the principal trading centers of the Western Sudan world-system—including Kawkaw/Gao, Tadmakka, Koumbi Saleh, and Tegdaoust/Awdaghast—possessed, in the words of the archaeologist Timothy Insoll, an “Islamic character.” He elaborates on this phenomenon: “Their plans indicate that they exhibit many of the characteristics of the Islamic city or town as is found within the wider Islamic world” (Insoll 1996: 43; also Mauny 1967). What history accounts for the Islamic character of these places, and what pro- cesses, events, and relations generated their development? Recent archaeologi- cal research in West Africa provides some answers. The present study offers a re-interpretation of Western Sudan history based on the recent archaeologi- cal research. Recent archaeology has generated a tremendous amount of new information pertaining to the cultural, economic, political, and social aspects of this history (Bedaux 1972; Vallées du Niger 1993; McIntosh 1995; Pelzer 2000; Ray A. Kea Department of History University of California at Riverside [email protected] http://history.ucr.edu/ * Th is article is a revision of a paper presented at a workshop of the University of California Multi-Campus Research Unit in World History, February –, , abstract: University of California, Irvine. I wish to thank the anonymous reviewer for her/his Archaeological evidence from West of a West African state system played a comments and suggestions. In addition, I wish to extend my gratitude to Ms Linda Africa suggests a process of relatively generative role in the world-historical Bobbitt for preparing the maps. -

The Global Context: Asia, Europe, and Africa in the Early Modern Era
Chapter Two: The Global Context: Asia, Europe, and Africa in the Early Modern Era Contents 2.1 INTRODUCTION .............................................................................................. 30 2.1.1 Learning Outcomes ....................................................................................... 30 2.2 EUROPE IN THE AGE OF DISCOVERY: PORTUGAL AND SPAIN ........................... 31 2.2.1 Portugal Initiates the Age of Discovery ............................................................. 31 2.2.2 The Spanish in the Age of Discovery ................................................................ 33 2.2.3 Before You Move On... ................................................................................... 35 Key Concepts ....................................................................................................35 Test Yourself ...................................................................................................... 36 2.3 ASIA IN THE AGE OF DISCOVERY: CHINESE EXPANSION DURING THE MING DYNASTY 37 2.3.1 Before You Move On... ................................................................................... 40 Key Concepts ................................................................................................... 40 Test Yourself .................................................................................................... 41 2.4 EUROPE IN THE AGE OF DISCOVERY: ENGLAND AND FRANCE ........................ 41 2.4.1 England and France at War .......................................................................... -

W Ai-Zei P Aper
WAI-ZEI PAPER WAI-ZEI Ablam Benjamin Akoutou, Rike Sohn, Matthias Vogl, Daniel Yeboah (eds.) Migration and Civil Society as Development Drivers - a Regional Perspective No. 23 2015 Nana Asantewa Afadzinu is Executive Director of the West Africa Civil Society Institute (WACSI) in Accra, Ghana. Ablam Benjamin Akoutou is Project Coordinator at WAI for the WAI-ZEI cooperation project. Mariama Awumbila is Associate Professor at the Department of Geography and Resource Deve- lopment and Centre for Migration Studies, University of Ghana Yaw Benneh is Senior Lecturer at Faculty of Law, and Senior Research Fellow at the Centre for Migration Studies, University of Ghana. Stefan Fröhlich is Professor of International Politics at the University of Erlangen-Nürnberg in Germany. Ludger Kühnhardt is Director at the Center for European Integration Studies (ZEI) and Professor of Political Science at Bonn University, Germany. Matthias Lücke is Senior Researcher at the Kiel Institute for the World Economy (IfW) and Adjunct Professor at Kiel University, Germany. Olawale I. Maiyegun is Director of the Department of Social Affairs of the African Union Commis- sion in Addis Ababa, Ethopia. Abdarahmane Ngaïde is Associate Researcher at the Pan-African Institute for Strategies (UCAD) in Dakar, Senegal, and teaches at University Cheikh Anta Diop of Dakar. Rike Sohn is Junior Fellow at ZEI and Project Coordinator for the WAI-ZEI cooperation project. Joseph Kofi Teye is Senior Lecturer at the Department of Geography and Resource Develop- ment, and Senior Research Fellow at the Centre for Migration Studies, University of Ghana. Djénéba Traoré is Managing Director at the West Africa Institute (WAI) in Praia, Cape Verde. -

THE GHANA EMPIRE West Africa’S First Major State
7 THE GHANA EMPIRE West Africa’s First Major State 1110L BY DAVID BAKER, ADAPTED BY NEWSELA In West Africa, the “human experiment” proceeded independently for many centuries. West Africans developed agriculture and large, complex states before getting caught up in the “unification of the world zones.” THE START OF WEST AFRICAN STATES West Africa had formed large urban centers and small kingdoms. But to the north and east, the Romans had already established a sprawling empire, as had the Greeks and Agriculture arose independently in West Africa, as it had in the Fertile Crescent be- Egyptians before them. The same goes for the mighty Persian Empire in the Middle fore. Around 3000 BCE, West Africans had begun the “energy bonanza” — a food sys- East and the Akkadians, Assyrians, and Sumerians before them. tem that supports many more people in a given land area than foraging. While the rest of sub-Saharan Africa did not begin adopting agriculture until 1000 BCE or later, West The earliest states in the world arose around 3500 BCE in Mesopotamia. At that time, Africa began the process around the same time as the Americas. It began to develop agriculture was getting its independent start in West Africa. Farming in the Fertile agrarian civilizations around the same time as well. Crescent, meanwhile, began to appear in approximately 10,000 to 8000 BCE. The Fer- tile Crescent and its descendant powers thus had a head start on West Africa by many This contradicts the myth that Africa was always “disadvantaged” or “primitive” in thousands of years. -

Exchange of Sacrifices: West Africa in the Medieval World of Goods
Exchange of Sacrifices: West Africa in the Medieval World of Goods Sarah M. Guérin The Medieval Globe, Volume 3, Issue 2, 2017, pp. 97-123 (Article) Published by Arc Humanities Press For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/758477 [ Access provided at 29 Sep 2021 15:15 GMT with no institutional affiliation ] 97 EXCHANGE OF SACRIFICES: WEST AFRICA IN THE MEDIEVAL WORLD OF GOODS SARAH M. GUÉRIN Où vergier mainte bone espice, In that orchard, many a spice: Cloux de girofle et requelice, Studded cloves and liquorice, Graine de paradis novele, Grain of paradise, newly come, Citoal, anis, et canele, Zedoary, anise, cinnamon; Et mainte espice délitable, And many a spice delectable1 Que bon mengier fait après table. Good for eating after table. Roman de la Rose Towards The beGinninG of the , Guillaume de Lorris (ca. 1200– ca. 1240) describes the marvellous garden of love, where apple trees grow pomegranates, nut trees sprout nutmegs, and where almond, fig, and date trees flourish within the cloistered walls. These fruits of the orient were joined by every imaginable spice good for cleansing the palate after a meal: cloves, licorice, zedoary, anise, cinnamon, and an exotic new spice, grains of paradise (“Graine de paradis novele”). Written in the third decade of the thirteenth century, Guillaume’s poem marks one of the first instances when this peppery seed (related to the Aframomum melegueta 2 ginger plant) is recorded in western Europe. Also known as melegueta pep- per, remained an extremely popular spice at French and Burgundian courts for approximately two centuries. -

The View from Awdaghust: War, Trade and Social Change in the Southwestern Sahara, from the Eighth to the Fifteenth Century Author(S): E
The View from Awdaghust: War, Trade and Social Change in the Southwestern Sahara, from the Eighth to the Fifteenth Century Author(s): E. Ann McDougall Source: The Journal of African History, Vol. 26, No. 1 (1985), pp. 1-31 Published by: Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/181836 Accessed: 03/10/2010 21:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=cup. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of African History. http://www.jstor.org 3ournal of African History, 26 (I985), pp. -

For the Mande Bala Todd G. Martin A
TOWARD A PEDAGOGY OF "PLAY" FOR THE MANDE BALA TODD G. MARTIN A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN MUSIC YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO APRIL, 2017 © Todd Martin, 2017 ABSTRACT A theoretical model is proposed that posits "play" as both the long-term goal of bala learning, and as the means through which the short-term steps toward that goal can best be achieved. Play is defined in two different ways. In the first sense it is an orchestrating of means and ends in which means are at the centre of interest. In this sense, play is a goal of bala learning. In the second sense, play is defined (using the framework of Applied Behaviour Analysis) as: activities that (a) are inherently reinforcing (and not inherently punishing), and (b) do not eventuate extinction, escape, or avoidance. In this sense, play is conceived as one possible means through which to achieve pedagogical goals. The case is made that owing to its intrinsic (musical) characteristics—in particular, the inherent scalability of pattern density—Mande bala music is especially well suited to a pedagogy of "play." Although the model proposed is supported by empirical evidence and has a strong rational underpinning, the model itself is not tested in the present study, but rather, is herein articulated (via illustrative case studies depicting the learning of various bala patterns through digitally mediated means—books, CDs, DVDs, etc.) An argument is built to support the notion that in comparison with traditional, immersion- based pedagogical modalities, the digital mediation of bala teaching eventuates a pedagogical loss, but that this pedagogical loss can be attenuated through a more "playful" pedagogical approach. -

1 Walther and Retaillé Mapping the Sahelian Space Olivier J. Walther1
Mapping the Sahelian Space Olivier J. Walther1 and Denis Retaillé2 Revised draft, 8365 words, 1 May 2017 Abstract This chapter examines the geographical meaning of the Sahel, its fluid boundaries, and its spatial dynamics. Unlike other approaches that define the Sahel as a bioclimatic zone or as an ungoverned area, it shows that the Sahel is primarily a space of circulation in which uncertainty has historically been overcome by mobility. The first part of the paper discusses how pre-colonial empires relied on a network of markets and cities that facilitated trade and social relationships across the region and beyond. The second part explores changing regional mobility patterns precipitated by colonial powers and the new approach they developed to control networks and flows. The third part discusses the contradiction between the mobile strategies adopted by local herders, farmers and traders in the Sahel and the territorial development initiatives of modern states and international donors. Particular attention is paid in the last section to how the Sahel was progressively redefined through a security lens. Acknowledgements The authors thank the OECD for their permission to use some of the maps of the Atlas of the Sahara-Sahel, and Al Howard for his useful comments on an earlier version of the chapter. Indivisible Sahel and Sahara Located far away from the seaports of the Gulf of Guinea and separated from North Africa by the world’s largest desert, the Sahel has often been envisioned as an arid strip of land in which sedentary and nomadic peoples clash periodically. The global humanitarian response that followed the famines of the 1970s and 1980s temporarily brought the Sahel into international headlines and initiated a durable investment in food security and new forms of nongovernmentability (Mann 2014) but the region remained a peripheral area of interest in the scholarly community. -

Africans: the HISTORY of a CONTINENT, Second Edition
P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 This page intentionally left blank ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 africans, second edition Inavast and all-embracing study of Africa, from the origins of mankind to the AIDS epidemic, John Iliffe refocuses its history on the peopling of an environmentally hostilecontinent.Africanshavebeenpioneersstrugglingagainstdiseaseandnature, and their social, economic, and political institutions have been designed to ensure their survival. In the context of medical progress and other twentieth-century innovations, however, the same institutions have bred the most rapid population growth the world has ever seen. The history of the continent is thus a single story binding living Africans to their earliest human ancestors. John Iliffe was Professor of African History at the University of Cambridge and is a Fellow of St. John’s College. He is the author of several books on Africa, including Amodern history of Tanganyika and The African poor: A history,which was awarded the Herskovits Prize of the African Studies Association of the United States. Both books were published by Cambridge University Press. i P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 african studies The African Studies Series,founded in 1968 in collaboration with the African Studies Centre of the University of Cambridge, is a prestigious series of monographs and general studies on Africa covering history, anthropology, economics, sociology, and political science. -

Cerd/C/Mrt/8-14
United Nations CERD/C/MRT/8-14 International Convention on Distr.: General 20 February 2017 the Elimination of All Forms English of Racial Discrimination Original: French English, French and Spanish only Committee on the Elimination of Racial Discrimination Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Eighth to fourteenth periodic reports of States parties due in 2008 Mauritania* [Date received: 7 February 2017] * The present document is being issued without formal editing. GE.17-02680 (E) 280317 060417 CERD/C/MRT/8-14 Contents Page Introduction ................................................................................................................................... 3 Part I: General presentation of the Islamic Republic of Mauritania — General information ........ 3 A. Demographic and socioeconomic characteristics ................................................................. 3 B. Constitutional and judicial institutions ................................................................................. 5 C. General framework for the protection and promotion of human rights ................................ 7 D. Obstacles to the fulfilment of international human rights obligations .................................. 15 E. Reporting process ................................................................................................................. 16 F. Follow-up to concluding observations of human rights treaty bodies .................................. 16 G. Measures to ensure wide