Leçons D'un Centenaire De Xavier De Maistre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Count XAVIER DE MAISTRE
count XAVIER DE MAISTRE (Chamberg 1763 - St. Petersburg 1852) The Departure & The Farewell one signed ‘X de Maistre’ (lower centre) oil on paper laid on panel, a pair both 23.5 x 30.5 cm (9¼ x 12 in) (2) N THIS PAIR OF COASTAL SCENES COUNT XAVIER DE Maistre conveys two very different moods and atmospheres.The Farewell is shrouded in a dense, dank mist. The scene feels sombre and eerie, as the viewer struggles to penetrate the thick fog that has rolled in from the sea. A gentleman is being rowed to the ship that is anchored in the ibay, and he stands, waving farewell to his loved ones, as they remain on the shore. For one woman the parting is overwhelming, and she has turned away, head in hands. In the centre of the work a figure strolls along the beach with his dog, warmly dressed against the coastal winds, seemingly oblivious to the emotional scene behind him. The human elements of the scene are, however, of secondary importance, to de Maistre’s rendering of the murky sky, which dominates the composition. It is a skilful and studied depiction of a dark cloudy sky, through which the bright glare of the sun struggles to break through, and the sense of muggy drizzle is palpable. The gloom enveloping the landscape accords with the sadness of the farewell. In contrast The Departureis bathed in warm sunshine, as the dark clouds Ivan Konstantinovich Aivazovsky, The Bay of Naples on a Misty Morning, of The Farewell drift off to the right-hand side. -

Russian Museums Visit More Than 80 Million Visitors, 1/3 of Who Are Visitors Under 18
Moscow 4 There are more than 3000 museums (and about 72 000 museum workers) in Russian Moscow region 92 Federation, not including school and company museums. Every year Russian museums visit more than 80 million visitors, 1/3 of who are visitors under 18 There are about 650 individual and institutional members in ICOM Russia. During two last St. Petersburg 117 years ICOM Russia membership was rapidly increasing more than 20% (or about 100 new members) a year Northwestern region 160 You will find the information aboutICOM Russia members in this book. All members (individual and institutional) are divided in two big groups – Museums which are institutional members of ICOM or are represented by individual members and Organizations. All the museums in this book are distributed by regional principle. Organizations are structured in profile groups Central region 192 Volga river region 224 Many thanks to all the museums who offered their help and assistance in the making of this collection South of Russia 258 Special thanks to Urals 270 Museum creation and consulting Culture heritage security in Russia with 3M(tm)Novec(tm)1230 Siberia and Far East 284 © ICOM Russia, 2012 Organizations 322 © K. Novokhatko, A. Gnedovsky, N. Kazantseva, O. Guzewska – compiling, translation, editing, 2012 [email protected] www.icom.org.ru © Leo Tolstoy museum-estate “Yasnaya Polyana”, design, 2012 Moscow MOSCOW A. N. SCRiAbiN MEMORiAl Capital of Russia. Major political, economic, cultural, scientific, religious, financial, educational, and transportation center of Russia and the continent MUSEUM Highlights: First reference to Moscow dates from 1147 when Moscow was already a pretty big town. -

Boston College School of Theology and Ministry French Revolution As Felix Culpa? Conceptions of Providence in the Wake of the Fr
Boston College School of Theology and Ministry French Revolution as Felix Culpa? Conceptions of Providence in the Wake of the French Revolution A Thesis Submitted to Boston College School of Theology and Ministry in Candidacy for the Degree of Licentiate in Sacred Theology Concentration in Systematic, Historical, and Liturgical Theology by Nathaniel A. Sanders Boston, Massachusetts 2 April 2021 Feria VI in Passione Domine 1 Copyright 2021 by Nathaniel A. Sanders All rights reserved 2 Abstract The French Revolution presented the Catholic Church with her greatest political crisis since the Reformation. The crises presented by the Revolution (including: the Civil Constitution of the Clergy, the death of the king, the Reign of Terror, war throughout Europe, and the imprisonment of the pope) also gave new urgency the theological problems of divine providence, the permission of evil, and the nature of predestination. However, even before the Revolution, such issues were at the heart of intra-Catholic theological debates. Beginning with the De Auxiliis controversy, and continuing with the growth of Jansenism and the Catholic Enlightenment, ideas of providence and predestination were hardly settled before the Revolution. But, such debates shed light on how theologians attempted to understand the Revolution. Two prominent Catholic thinkers in the wake of the Revolution were Joseph de Maistre and Félicité Lamennais. Both saw the Revolution as the natural result of theological errors and in keeping with divine providence. Maistre, a convinced Molinist, provides the most robust account of the Revolution as a felix culpa, an event that God permitted to happen in order to cleanse the Church of laxity and error, punish France for theological errors, and rid the world of Enlightenment philosophy. -

The Case of Machado De Assis
Around My Room and Around Life Antonio Candido Translated by K. David Jackson Abstract. It is argued in this essay that Xavier de Maistre, who adopted many of the mannerisms of Sterne but who was indeed the one who used dotted chapters, could have influenced Machado de Assis as much as or even more than Sterne, to judge by some indications. Therefore, from Maistre ’s Voyage antour de ma chambre much of the free technique could have passed to Memdrias Postumas de Bras Cubas, prompting a diffuse work; indeed, even some fictional situations may have been transmitted. Everyone remembers the note “To the Reader” that opens The Posthumous Memoirs ofBras Cubas\ The truth is that it’s a question ol a scattered work where I, Bras Cubas, have adopted the free-form of a Sterne or a Xavier de Maistre. I’m not sure, but I may have put a few fretful touches of pessimism into it. It’s possible. (5) In the “Prologue to the Third Edition,” commenting on Antonio Joaquim de Macedo Soares’ observation that the book reminded him of Viagens na minha terra by Almeida Garrett, Machado concluded, after citing the above passage attributed to his main character: “All those people traveled: Xavier de Maistre around his room, Garrett in his land, Sterne in other people’s lands. It might be said of Bras Gubas that he traveled around life” (3). Sterne is famous in world literature; Garrett is famous in the literatures of the Portuguese-speaking world; Xavier de Maistre is obscure even in French 200 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 13/14 literature. -
Patrie, Contrerévolution, Romantisme. Xavier De Maistre Et La Savoie Perdue
PRZEMYSŁAW KOSSAKOWSKI Université de Gdańsk Salut au nom des cieux, des monts et des rivages Où s’écoulèrent tes beaux jours, Voyageur fagué qui reviens sur nos plages Demander à tes champs leurs anques ombrages, A ton cœur ses premiers amours !1 Alphonse de Lamarne Patrie, contrerévolution, romantisme. Xavier de Maistre et la Savoie perdue ’est ainsi qu’Alphonse de Lamar��ne salue Xavier C de Maistre, son parent lointain, son ami personnel, en 1826, lorsque ce dernier revient vers sa Savoie natale après presque trente ans d’exil en Russie. Une lecture approfondie du poème de Lamarne indique que son auteur a fort bien connu son dédicataire qu’il n’avait jusqu’ici contacté que par écrit. Dans Le Retour l’on re ‐ trouve tout Xavier de Maistre, nostalgique et senmental, toujours amoureux de la Savoie, de la montagne et de la nature de son pays natal. Lorsqu’il l’a quié, encore à la fin du XVIIIe siècle, le sol en était foulé par des armées françaises. Les forces armées de la Révoluon ont quasiment anéan l’armée savoisienne, occupé le Duché de Savoie et le Piémont2. La patrie de X. de Maistre, « dont la moié m’avait elle‐même abandonné »3, écrira‐t‐il dans son Expédi��on nocturne 1 A. de Lamarne, « Le Retour », Harmonies poéyques et religieuses, Paris, Hachee, 1918, p. 184. 2 A. Berthier, Xavier de Maistre. Étude lizéraire et biographique, Lyon – Paris, Librairie Catholique Emmanuel Vie, 1921, p. 68. 3 X. de Maistre, « Expédion nocturne autour de ma chambre », [dans :] Idem, Œuvres complètes du comte Xavier de Maistre, Paris, Garnier Frères, 1889, p. -

CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE DE JOSEPH DE MAISTRE REVISÃO (Historiográfica) E TRADUÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE DE JOSEPH DE MAISTRE REVISÃO (historiográfica) E TRADUÇÃO José Miguel Nanni Soares Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em História. Orientador: Prof. Dr. Modesto Florenzano São Paulo 2009 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE DE JOSEPH DE MAISTRE REVISÃO (historiográfica) E TRADUÇÃO José Miguel Nanni Soares Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em História. São Paulo 2009 2 Alla venerata memoria di Michele Nanni (1909-1996) 3 AGRADECIMENTOS À maestrina Genoária Nanni, minha mãe, pelo inexaurível zelo educador e apoio nos momentos difíceis. Ao meu orientador, professor Modesto Florenzano, pela lhaneza, confiança, paciência e imprescindível ajuda na pesquisa e redação desta dissertação. Muito do que aqui se encontra, exceto os possíveis erros, deve-se às suas observações eruditas e sensatas. Com seu exemplo, reinventei-me como pessoa. Ao professor Richard Allen Lebrun que, à distância e com uma generosidade ímpar, disponibilizou materiais para a pesquisa, orientou e corrigiu nossas idéias e permitiu nossa participação em um importante colóquio internacional sobre Joseph de Maistre. -

Joseph De Maistre As a Writer
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by St Andrews Research Repository TThhee NNeeww eennffaanntt dduu ssiièèccllee:: JJoosseepphh ddee MMaaiissttrree aass aa WWrriitteerr Edited by Carolina Armenteros and Richard A. Lebrun St Andrews Studies in French History and Culture ST ANDREWS STUDIES IN FRENCH HISTORY AND CULTURE The history and historical culture of the French-speaking world is a major field of interest among English-speaking scholars. The purpose of this series is to publish a range of shorter monographs and studies, between 25,000 and 50,000 words long, which illuminate the history of this community of peoples between the end of the Middle Ages and the late twentieth century. The series covers the full span of historical themes relating to France: from political history, through military/naval, diplomatic, religious, social, financial, cultural and intellectual history, art and architectural history, to literary culture. Titles in the series are rigorously peer-reviewed through the editorial board and external assessors, and are published as both e-books and paperbacks. Editorial Board Dr Guy Rowlands, University of St Andrews (Editor-in-Chief) Professor Andrew Pettegree, University of St Andrews Professor Andrew Williams, University of St Andrews Dr David Culpin, University of St Andrews Dr David Evans, University of St Andrews Dr Linda Goddard, University of St Andrews Dr Alexander Marr, University of St Andrews Dr Bernhard Struck, University of St Andrews Dr Stephen Tyre, University of St Andrews Dr Malcolm Walsby, University of St Andrews Professor James McMillan, University of Edinburgh Dr David Parrott, University of Oxford Professor Rafe Blaufarb, Florida State University Professor Darrin McMahon, Florida State University Dr Simon Kitson, University of London Institute in Paris Professor Eric Nelson, Missouri State University The New enfant du siècle: Joseph de Maistre as a Writer Edited by CAROLINA ARMENTEROS and RICHARD A. -
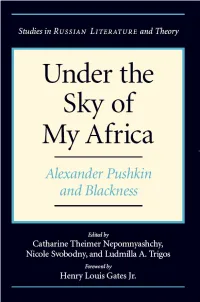
Alexander Pushkin and Blackness
Under the Sky of My Africa Northwestern University Press Studies in Russian Literature and Theory Founding Editor Gary Saul Morson General Editor Caryl Emerson Consulting Editors Carol Avins Robert Belknap Robert Louis Jackson Elliott Mossman Alfred Rieber William Mills Todd III Alexander Zholkovsky Under the Sky of My Africa ALEXANDER PUSHKIN AND BLACKNESS Edited by Catharine Theimer Nepomnyashchy, Nicole Svobodny, and Ludmilla A. Trigos Foreword by Henry Louis Gates Jr. NORTHWESTERN UNIVERSITY PRESS / EVANSTON, ILLINOIS STUDIES OF THE HARRIMAN INSTITUTE Northwestern University Press Evanston, Illinois 60208-4170 Copyright © 2006 by Northwestern University Press. Foreword copyright 2006 by Henry Louis Gates Jr. Published 2006. All rights reserved. Printed in the United States of America 10987654321 ISBN 0-8101-1970-6 (cloth) ISBN 0-8101-1971-4 (paper) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Under the sky of my Africa : Alexander Pushkin and blackness / edited by Catharine Theimer Nepomnyashchy, Nicole Svobodny, and Ludmilla A. Trigos ; foreword by Henry Louis Gates Jr. p. cm.— (Studies in Russian literature and theory) (Studies of the Harriman Institute) Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8101-1971-4 (pbk. : alk. paper)—ISBN 0-8101-1970-6 (cloth : alk. paper) 1. Pushkin, Aleksandr Sergeevich, 1799–1837—Knowledge—Race awareness. 2. Pushkin, Aleksandr Sergeevich, 1799–1837—Family. 3. Racially mixed people—Race identity—Russia. 4. Blacks in literature. 5. Race awareness in literature. 6. Pushkin family. 7. Russia—Ethnic relations. I. Nepomnyashchy, Catharine Theimer. II. Svobodny, Nicole. III. Trigos, Ludmilla A. IV. Series. V. Series: Studies of the Harriman Institute. PG3358.R33.U53 2005 891.71'3—dc22 2005016715 The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1992. -
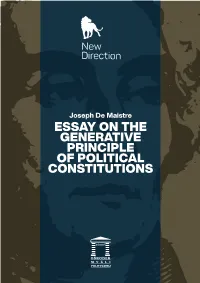
ESSAY on the GENERATIVE PRINCIPLE of POLITICAL CONSTITUTIONS Joseph De Maistre
Joseph De Maistre ESSAY ON THE GENERATIVE PRINCIPLE OF POLITICAL CONSTITUTIONS Joseph De Maistre Essay on the Generative Principle of Political Constitutions New Direction | OMP Essay on the generative principle of political constitutions is based on the edition published: Boston, Little and Brown, 1847. MMXX CONTENTS Founded by Margaret Thatcher in 2009 as the intellectual hub of European Conservativism, New Direction has established academic networks across Europe and research partnerships throughout the world. Introduction: Tomasz Poręba MEP 7 Preface: Jacek Kloczkowski 11 Essay on the Generative Principle of Political Constitutions 29 Notice by the Translator 31 Preface 33 New Direction is registered in Belgium as a not-for-profit organisation and is partly funded by the European Parliament. Registered Office: Rue du Trône, 4, 1000 Brussels, Belgium President: Tomasz Poręba MEP Executive Director: Witold de Chevilly Essay on the Generative Principle of Political Constitutions 43 The European Parliament and New Direction assume no responsibility for the opinions expressed in this publication. Sole liability rests with the author. 7 INTRODUCTION Tomasz Poręba MEP onservatism is primarily associated with opposition to sudden political changes. Such an image is undoubtedly influenced C by the fact that its origins, as a separate ideological-political trend, are commonly sought in the actions against the slogans and practices of the French Revolution of 1789, especially in the criticism of the radicalization of revolutionary governments after they were taken over by the Jacobins. Indeed, it was then that with both great talent and extraordinary power of persuasion, the revolutionary theories and practices were attacked by high-class thinkers, like Edmund Burke, Joseph de Maistre, and Louis de Bonald, who laid the foundations for a conservative reflection on reality. -

Pdf Acerca De Una Traducción Española De Xavier De Maistre
ACERCA DE UNA TRADUCCIóN ESPAÑOLA DE XAVIER DE MAISTRE CONCEPCIóN PALAcios BERNAL UNIVERSIDAD DE MURCIA La obra de Xavier de Maistre (1763-1852) ocupa un pequeño lugar en la historia de la literatura francesa y por ende en la universal, como pequeño lo fue también el que ocupó en la dilatada vida del autor, desde una perspectiva no exclusivamente vital sino también cuantitativa. Militar por oficio y amateur de la literatura más que auténtico escritor, su primera y más conocida obra, Voyage autour de ma chambre, es un relato publicado en 1794, en Turin y dos años después en Paris en pleno periodo revolucionario .' Su nacimiento en la región de la alta Saboya, en Chambéry, condicionará la vida de este francés por espiritu, saboyano por nacimiento -en unos tiempos en los que esta región era un ducado autónomo vinculado al reino de Cerdeña- y ruso de adopción y por casamiento -mas de la mitad de su vida transcurrió en este ultimo pais- . No es, pues, de extrañar que, exceptuando sus tres primeras obras, Voyage autour de ma chambre, Expédition nocturne autour de ma chambre y Le Lépreuxde la cíté dAoste, el resto de su escasa producción -La Jeune S¡bér¡.enne y Les Prisonniers du Caucase'- tenga como escenario las estepas rusas y siberianas y sus personajes estén inspirados en modelos conocidos de ese pais del Este. Yes más, sus relatos serán editados prontamente en Rusia, donde gozó de gran admiración. Le Lépreux de la cité dAoste, vio la luz por primeravez en 18 11 en San Petersburgo, en una edición cuidadosamente publicada por su hermano Joseph de Maistrc y precedida de la reedición del Voyage autour de ma cbambre.' ' En realidad esta primera edición de Turín, sin nombre de imprenta ni de librería, no fue publicada en la actual ciudad itallana, sino en 1795 y en Lausana donde residía por aquel entonces Joseph de Maistre. -

The Life of Monsieur De Molière
The Life of Monsieur de Molière Mikhail Bulgakov Translated by Mirra Ginsburg ALMA CLASSICS ALMA CLASSICS an imprint of: ALMA BOOKS LTD 3 Castle Yard Richmond TW10 6TF United Kingdom www.almaclassics.com The Life of Monsieur de Molière first published in Russian as Zhizn’ gospodina de Mol’era in 1962 This translation originally published by Funk & Wagnalls, Inc., in 1970 Reissued clothbound and as New Directions Paperbook 601 in 1986 First published by Alma Classics in 2009 This new edition first published by Alma Classics in 2017 Translation © 1970 by Funk & Wagnalls, Inc. and © 1986 by Mirra Ginsburg Background material © Alma Classics, 2009 Printed and bound in UK by CPI Group (UK) Ltd, Croydon CR0 4YY ISBN: 978-1-84749-473-3 All the pictures in this volume are reprinted with permission or presumed to be in the public domain. Every effort has been made to ascertain and acknowledge their copyright status, but should there have been any unwitting oversight on our part, we would be happy to rectify the error in subsequent printings. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of the publisher. This book is sold subject to the condition that it shall not be resold, lent, hired out or otherwise circulated without the express prior consent of the publisher. Contents Translator’s Preface ix The Life of Monsieur de Molière 1 Extra Material 163 Mikhail Bulgakov’s Life 165 Mikhail Bulgakov’s Works 178 Select Bibliography 194 Appendix 197 List of Plays 199 The Life of Monsieur de Molière Prologue My Conversation with a Midwife What can prevent me from laughingly telling the truth? Horace Molière was a famous writer of French comedies during the reign of Louis XIV. -

Anecdote Trouvée Dans Les Papiers D'un Inconnu / Benjamin Constant
TITRE Adolphe - Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu / Benjamin Constant / Jacques-Henry Bornecque Affaires de Rome - Des maux de l'Église et de la société / Félicité,de Lamennais Anthologie poétique française du XVIe siècle. Tome I - Poèmes choisis ; Maurice Allem Anthologie poétique française du XVIe siècle. Tome II - Poèmes choisis / Maurice Allem Anthologie poétique française du XVIIe siècle. Tome I - Poèmes choisis ; Maurice Allem Anthologie poétique française du XVIIe siècle. Tome II - Poèmes choisis / Maurice Allem Anthologie poétique française du XVIIIe siècle - Poèmes choisis / Maurice Allem Armance / Stendhal ; Henri Martineau Atala suivi de René et des Aventures du dernier Abencérage - Œuvres complètes, 3 / François- René,de Chateaubriand ; Fernand Letessier Aventures burlesques / Charles,Coypeau,d' Assoucy / Émile Colombey Béatrix / Honoré,de Balzac ; Maurice Regard Bel-Ami / Guy,de Maupassant ; Daniel Leuwers Boule de suif et autres contes normands / Guy,de Maupassant ; Marie-Claire Bancquart Bouvard et Pécuchet - Œuvre posthume / Gustave Flaubert ; Édouard Maynial, Jacques Suffel Bradamante suivie des Juifves / Robert Garnier ; Marcel Hervier Carmen / Prosper Mérimée ; Maxime Revon Catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la religion universelle / Auguste Comte / Pierre- Félix Pécaud Causeries du lundi. Tome I / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome II / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome III / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome IV / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome IX / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome V / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome VI / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome VII / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi. Tome VIII / Charles-Augustin Sainte-Beuve Causeries du lundi.