Notice Sur La Chartreuse D'arvieres En Valromey
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inventaire Des Archives
Département de l’Ain Commune de Seyssel Inventaire des archives ____ 1286 – 2015 Réalisé par Jordi Rubió Service Archives du Centre de gestion de l’Ain 2017 Crédits photographiques : L’image de garde correspond au parchemin coté AA4, Lettres patentes du duc Charles III. (1528). Les images intérieures ont fait l’objet d’un tableau des illustrations annexé dans cet inventaire. La numérisation a été réalisée par le Centre de gestion de l’Ain. Remerciements : L’étude et analyse des pièces d’Ancien Régime a été réalisé avec l’aide de Florence Beaume, directrice des Archives départementales de l’Ain, de Jérôme Dupasquier, archiviste aux Archives départementales de l’Ain et de Jean-Marcel Bourgeat, archiviste au Centre de gestion de la FPT de l’Ain. Les sources complémentaires ont été enrichies avec l’aide de Cédric Mottier, chercheur associé à l’Université de Savoie – Mont-Blanc et au CNRS/EHESS. Diffusion des données à caractère personnel : En conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour occulter les données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux données à caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de consultation par le grand public. Centre de gestion de la FPT de l’Ain 145, chemin de Bellevue, 01960 Péronnas Service archives Tel : 04 74 32 13 86 Fax : 04 74 21 76 44 [email protected] Site : http://www.cdg01.fr/ Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/ Introduction Présentation et intérêt du fonds Evolution de l’appartenance du territoire de Seyssel, à cheval sur le duché de Savoie et le Royaume de France. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°01-2020-103 Publié Le 10 Juillet
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°01-2020-103 AIN PUBLIÉ LE 10 JUILLET 2020 1 Sommaire 01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain 01-2020-07-07-002 - Arrêté portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de PERON (2 pages) Page 3 01_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ain 01-2020-07-07-001 - Microsoft Word - Arret IA mesures RS20 CDEN 2020.07.03.doc (3 pages) Page 6 01_Pref_Préfecture de l’Ain 01-2020-07-09-002 - Médaille honneur agricole promotion 14 juillet 2020 (4 pages) Page 10 01-2020-07-09-003 - Médaille honneur régionale départementale et communale promotion du 14 juillet 2020 (6 pages) Page 15 01-2020-07-09-001 - Médaille travail promotion 14 juillet 2020 (61 pages) Page 22 2 01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain 01-2020-07-07-002 Arrêté portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de PERON 01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2020-07-07-002 - Arrêté portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de PERON 3 Direction départementale des territoires Service Agriculture et Forêt Unité suivi des entreprises agricoles et foresières A R R E T É portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de PERON Le Préfet de l'Ain Vu les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 portant délégation -

St-Rambert- -En-Bugey
------- ---- CARTE BUREAU DE GÉOLOGIQUE R~CHERCHES GEOLOGIQUES DE LA FRANCE ET MINIERES A 1/50000 ST-RAMBERT- -EN-BUGEY 3230 ST-RAMBERT- -EN-BUGEY La carte géologique à 1/50 000 ST-RAMBERT-EN-BUGEY est recouverte par la coupure NANTUA (N° 160j de la carte géologique de la Fronce à 1IBO 000. M!NISTËRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE BUREAU Of RECHERCHES GÉOlOGIOUES ET MINIÈRES SERVICE GËOLOGIQUE NATIONAL Boile poslalo 6009 - 45060 Orléans Cedex - France NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY A 1/50 000 par R. ENAY 1982 SOMMAIRE AVANT-PROPOS 5 INTRODUCTION 5 SITUA TlON GÉOGRAPHIQUE 0 'ENSEMBLE •.•••••••••••••••...•.•. 5 PRÉSENTA TlON DE LA FEUILLE •••..•••••.••••.•••••........... 5 HISTOIRE GÉOLOGIQUE •••••.•••••••••••••••••...••.......• 6 DESCRIPTION DES TERRAINS 10 TERRAINS NON AFFLEURANTS ..••.••.•••••....••••.•......... 10 TERRAINS AFFLEURANTS ••••.••.••••••••••.••••••..••...... 11 Formations sédimentaires secondaires 11 Formations tertiaires du Jura et de la bordure bressanne 37 Terrains alluviaux et résiduels quaternaires 39 STRUCTURE ET MORPHOLOGIE •••••••••••••••••••••••••.••.•...• 41 DESCRIPTION TECTONIQUE ••..•••••••••••••..•••.••........• 41 Failles: directions et relations avec les plis 44 Str'Jctures faillées majeures 44 Unités structurales du Jura interne 46 Unités structurales du Jura externe 50 Chevauchement sur le fossé tertiaire ..... 54 HYDROLOGIE ET FORMES DU RELIEF •••..•••••••••..•........... 56 Hydrologie superficielle et souterraine 56 Formes du relief ... .................................. 59 -

Commune De CORBONOD
Commune de CORBONOD DEPARTEMENT DE L’AIN ARRONDISSEMENT DE BELLEY CANTON DE HAUTEVILLE LOMPNES Compte rendu du Conseil Municipal en date du 05 juillet 2018 Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 juin 2018 Président : Monsieur Joseph TRAVAIL, Maire de CORBONOD. Etaient présents Joseph TRAVAIL, Jean-Louis GENY, Sandrine TASSET, Pierre BRUN, Estelita LACHENAL, Marie-Claude BERNARD, Laurent BERNARD, Nicolas BOTTERI, Patrick CHAPEL, Jean COLLIN, Régis MOLLEX, Nadia POIRIER. Absents Floriane CLARY, Géraldine GREMERET Secrétaire de séance Sandrine TASSET Conseillers en exercice : 14 Présents : 12 Votants : 12 1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal en date du 31 mai 2018 Le conseil municipal approuve sans observation et à l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal en date du 31 mai 2018. 2. Contrôle règlementaires électriques des équipements et bâtiments communaux Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, la nécessité réglementaire de de faire vérifier annuellement l’état des installations électriques des équipements et bâtiments communaux. Il donne lecture de la proposition financière qui a été faite par la Sté APAVE. Le conseil municipal souhaite que d’autres propositions puissent être faites avant de prendre une décision. 3. Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor L’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour l’exercice 2018, sera de 488.55 € et versée à 100% conformément à la délibération n° 2014-051. 4. Tarifs pour le remplacement du matériel cassé par les utilisateurs de la salle d’animation Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : - de fixer le barème tarifaire du matériel à remplacer en cas de détérioration, casse, ou perte, conformément au tableau ci-dessous. -

D'alimentation En Eau Potable
PRÉFET DE L’AIN Observatoire des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans l’Ain ... ibution Distr Co nso mm at ion • Organisation au 31 décembre 2011 ... • Tarifi cations au 1er janvier 2010 • Indicateurs techniques 2009 • Rappels de règlementation Epuration ... Direction départementale des Territoires de l’Ain - Service Protection et Gestion de l’Environnement - 23 rue Bourgmayer - CS 90410 - 01012 Bourg-en-Bresse Cedex ” Avant - Propos Dans l’Ain, les compétences en matière d’eau potable, jour l’inventaire des services, anime l’Observatoire, assiste les d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif étaient collectivités pour la saisie des données, et veille à leur cohérence assurées, au 31 décembre 2011, par 652 services émanant de avant publication. 412 collectivités distinctes, dont 76 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 336 communes. Le présent rapport constitue la première synthèse départementale issue des données de l’Observatoire. Il décrit l’organisation Cette diversité d’organisation se retrouve au niveau national, et c’est administrative des services au 31 décembre 2011, présente les pourquoi la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a confi é à l’Offi ce tarifs applicables au 1er janvier 2010 ainsi que certains indicateurs national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) la mise en de l’exercice 2009. Il rappelle aussi quelques informations place de l’Observatoire national des services publics d’eau et réglementaires. d’assainissement. Initié en novembre 2009, l’Observatoire est un outil destiné : Ce document constitue une base de communication intéressante pour la réfl exion sur les orientations organisationnelles des services • aux collectivités locales et leurs opérateurs pour piloter leurs sur notre département. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N° 84-2019-007
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N° 84-2019-007 RÉGION AUVERGNE- PUBLIÉ LE 12 FÉVRIER 2019 RHÔNE-ALPES Sommaire 38_REC_Rectorat de l'Académie de Grenoble 84-2019-02-05-005 - arrêté de composition de jury VAE BTS maintenance des systèmes optionsystèmes de production (2 pages) Page 5 84-2019-02-06-008 - arrêté de composition de jury VAE BTS management des unités commerciales (2 pages) Page 7 84-2019-02-05-006 - arrêté de composition de jury VAE BTS négociation et relation client (2 pages) Page 9 84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 84-2019-01-29-018 - Portant renouvellement de l’autorisation du Foyer d’Accueil Médicalisé « La Passerelle » n° FINESS 070002928 à Antraigues sur Volane.SAS La Passerelle (3 pages) Page 11 84-2019-02-08-006 - Arrêté 2019-16-0014 du 8 février 2019 portant désignation des représentants d'usagers dans la commission des usagers (CDU) du centre hospitalier du Gier - Saint Chamond (Loire) (2 pages) Page 14 84-2019-02-08-007 - Arrêté 2019-16-0015 du 8 février 2019 portant désignation des représentants d'usagers dans la commission des usagers (CDU) de l'hôpital local de Buis les Baronnies (Drôme) (2 pages) Page 16 84-2019-01-18-004 - Arrêté n° 2019-01-0003 portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires dans l'AIN par la SARL AMBULANCE PONT DE VAUX (3 pages) Page 18 84-2019-01-18-005 - Arrêté n° 2019-01-0004 portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires suite à AMS pour la SARL AMBULANCES DES PAYS DE L'AIN à HAUTEVILLE LOMPNES (4 pages) Page -
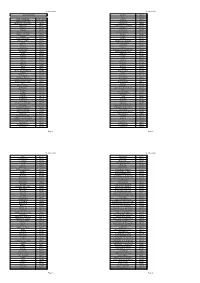
01 Ouest-Ain Page 1 Ouest-Ain (01) Nom Commune Code Insee
01_Ouest-Ain 01_Ouest-Ain Ouest-Ain (01) Civrieux 01105 Cize 01106 Nom_commune Code_Insee Coligny 01108 Ambérieu-en-Bugey 01004 Condeissiat 01113 Ambérieux-en-Dombes 01005 Confrançon 01115 Ambronay 01007 Cormoranche-sur-Saône 01123 Ambutrix 01008 Cormoz 01124 Arbigny 01016 Corveissiat 01125 Ars-sur-Formans 01021 Courmangoux 01127 Asnières-sur-Saône 01023 Courtes 01128 Attignat 01024 Crans 01129 Bâgé-Dommartin 01025 Crottet 01134 Bâgé-le-Châtel 01026 Cruzilles-lès-Mépillat 01136 Balan 01027 Curciat-Dongalon 01139 Baneins 01028 Curtafond 01140 Beaupont 01029 Dagneux 01142 Beauregard 01030 Dompierre-sur-Chalaronne 01146 Béligneux 01032 Dompierre-sur-Veyle 01145 Bény 01038 Domsure 01147 Béréziat 01040 Douvres 01149 Bettant 01041 Drom 01150 Bey 01042 Druillat 01151 Beynost 01043 Faramans 01156 Birieux 01045 Fareins 01157 Biziat 01046 Feillens 01159 Blyes 01047 Foissiat 01163 Bohas-Meyriat-Rignat 01245 Francheleins 01165 Boissey 01050 Frans 01166 Bouligneux 01052 Garnerans 01167 Bourg-en-Bresse 01053 Genouilleux 01169 Bourg-Saint-Christophe 01054 Gorrevod 01175 Boyeux-Saint-Jérôme 01056 Grand-Corent 01177 Boz 01057 Grièges 01179 Bresse Vallons 01130 Guéreins 01183 Bressolles 01062 Hautecourt-Romanèche 01184 Buellas 01065 Illiat 01188 Cerdon 01068 Jassans-Riottier 01194 Certines 01069 Jasseron 01195 Ceyzériat 01072 Jayat 01196 Chalamont 01074 Journans 01197 Chaleins 01075 Joyeux 01198 Challes-la-Montagne 01077 Jujurieux 01199 Chaneins 01083 L'Abergement-Clémenciat 01001 Chanoz-Châtenay 01084 L'Abergement-de-Varey 01002 Charnoz-sur-Ain 01088 -

Calendrier Des Animations Juin | Juillet | Août | Septembre
NAVIGUEZ EN TERRE DOUCE 20 19 CALENDRIER DES ANIMATIONS JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE 1 SOMMAIRE Au fil de l’été p.6 Juin p.10 Juillet p.18 Août p.24 Septembre p.31 Expositions p.33 Vide-greniers p.36 Concours de pétanque p.37 Carte de situation p.38 BIENVENUE DANS LE HAUT-RHÔNE ! Vous trouverez dans ce guide toutes les animations estivales. Ici, la nature est omniprésente ! Laissez-vous tenter par nos activités de plein air comme le canoë-kayak, le pédalo, le vélo à assistance électrique, le paddle et bien d’autres encore. Lors de votre séjour, prenez le temps de découvrir notre histoire. Laissez-vous tenter par nos châteaux, musées et autres patrimoines culturels. Gourmets, gourmands, épicuriens, éveillez vos papilles, vous êtes ici chez vous. Laissez-vous tenter par nos vins AOC, mais aussi nos fromages, notre chocolat et autres produits du terroir. L’équipe de Haut-Rhône Tourisme vous accueillera dans ses locaux de Seyssel et de Frangy pour vous proposer tous les bons plans pour que vous puissiez naviguer en terre douce. Pour situer les animations du territoire, reportez-vous au code indiqué sur chaque encart puis consultez la carte en fin de document. PICTOGRAMMES Activité pleine nature Musique Patrimoine Document non contractuel. Les prix mentionnés, le sont à titre indicatif. Les informations nous ont été communiquées par les associations, prestataires, collectivités et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Haut-Rhône Tourisme. Guide des animations FR/EN/ALL, Haut-Rhône Tourisme 2019. Tiré à 10 000 ex. Éditeur : Haut-Rhône Tourisme. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N° 84-2020-053 Publié Le 28 Avril
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N° 84-2020-053 RÉGION AUVERGNE- PUBLIÉ LE 28 AVRIL 2020 RHÔNE-ALPES Sommaire 69_Rectorat de Lyon 84-2020-04-28-001 - Arrêté n°2020-22 du 28 avril 2020 portant délégation de signature aux personnels d’encadrement du rectorat de l’académie de Lyon. (4 pages) Page 3 84_DRAAF_Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes 84-2020-04-24-003 - 2020 04 24 AP modificatif zonage ICHN RAA (73 pages) Page 7 Lyon, le 28 avril 2020 Arrêté n°2020-22 portant délégation de signature aux personnels d’encadrement du rectorat de l’académie de Lyon Le recteur de la région académique Rectorat Auvergne-Rhône-Alpes Recteur de l’académie de Lyon Direction Chancelier des universités des affaires juridiques 92 rue de Marseille Vu le code de l’éducation, notamment les articles D222-20 et R911-88 ; BP 7227 69354 Lyon CEDEX 07 Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon ; www.ac-lyon.fr Vu l’arrêté du 10 février 2020 portant nomination de M. Olivier Curnelle dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Lyon à compter du 20 février 2020 ; ARRETE Article 1er : Délégation est donnée à M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l'académie de Lyon, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances, concernant : - l’organisation et le fonctionnement des services académiques et des établissements scolaires de l’académie ; - l’ouverture, le fonctionnement -

Livret Des Comptages Routiers 2018
Trafic routier Bilan 2018 www.ain.fr 2 Conseil départemental de l’Ain - Trafics routiers - Bilan 2018 Le Département Comptages routiers 2018 de l’ Ain gère et entretient En tant que gestionnaire de la route, le Département de l’Ain un réseau routier dresse annuellement le bilan des comptages routiers. de 4 450 kilomètres La fréquence de renouvellement des comptages est de : • 5 ans, pour un trafic supérieur à 5000 véhicules par jour • 6 ans, de 2500 à 5000 véhicules par jour • 8 ans, de 1000 à 2500 véhicules par jour • 10 ans, de 300 à 1000 véhicules par jour • 12 ans pour un trafic inférieur à 300 véhicules par jour Depuis cette année 2018, 25 stations automatisées comptent en permanence les véhicules motorisés. La moitié d’entre elles sont alimentées en énergie par des panneaux solaires. Elles transmettent toutes les heures leurs données de comptage à un serveur central, ce qui contribue à réduire les déplacements des agents sur place et à vérifier à distance leur fonctionnement. De plus, 14 compteurs sont installés en permanence le long des routes départementales moins circulées. En 2018, on constate une hausse du trafic de 1,6 % par rapport à 2017, sur l’ensemble du réseau routier départemental. trafic - bilan 2018 Le bilan trafic RD 2018 est complété par les données relatives au trafic sur les autoroutes traversant l’Ain. Ce bilan annuel est un 3 outil d’aide à la définition de notre politique routière : investissement, entretien, maintenance du réseau... Je remercie les 300 agents des routes pour leur travail quotidien au service des usagers, sur les 4 450 km de routes. -

European Commission
C 180/18 EN Offi cial Jour nal of the European Union 29.5.2020 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2020/C 180/12) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘EMMENTAL DE SAVOIE’ EU No: PGI-FR-0179-AM03 – 10.1.2020 PDO ( ) PGI (X) 1. Name(s) ‘Emmental de Savoie’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Emmental de Savoie’ is a cooked pressed cheese made from cow's milk used in its raw state. It has a regular, wheel-like shape and a diameter ranging from 72 to 80 cm. It is more or less convex and has no edges or projecting parts. Its height varies from 14 cm (minimum vertical height at the outer rim) to 32 cm (maximum vertical height at the highest point). The wheel must weigh at least 60 kg after maturation. The finished product has a fat content of at least 28 %. The total dry extract, measured on a rindless part, is at least 62 % on the 75th day. -

Vos Élus De La Chambre D'agriculture De L'ain
Vos élus de la chambre d’agriculture de l’Ain Nicolas André Séverine Copier Catherine Perillat Matthieu Troiano Céréalier-éleveur Viriat Bourg-en-Bresse Porc, céréales, vente Christian Fauvre Joëlle Morandat bovin viande, (SCEA Guillemot) directe Ceyzériat Céréales Foissiat St-Martin-du-Mont St-Jean-le-Vieux (GAEC SN2A) (GAEC de L’Orme) Samuel Pertreux Denis Lorin Stéphanie Artaud-Bertet Bovins lait, AOP Comté, Bourg-en-Bresse Éleveuse laitière, Vieu-d’Izenave Curciat Gilles Brenon Oyonnax (GAEC de la Combe du Val) Sermoyer Dongalon (GAEC du Chatonnax) Vernoux Porc, céréales, vente Vescours directe Jean-Yves Bertschi Hugo Danancher Arbigny Saint- Trivier Courtes St-Martin-Du-Mont Echenevex Alexis Paoli St Bénigne -de-Courtes St-Nizier (GAEC de L’Orme) (EARL des Belles Clies) St-Bénigne le-Bouchoux Beaupont Ceyzériat Chavannes Pont-de-Vaux sur Mantenay Domsure Montlin Reyssouze Reyssouze Servignat Cormoz Vesancy Divonne- Gorrevod St-Jean Lescheroux les-Bains Marie-Dominique Pelus St-Etienne sur St-Julien Coligny Boz sur Reyssouze Pirajoux Mijoux Xavier Fromont Reyssouze Reyssouze GEX St-Didier d’Aussiat Jean-Claude Laurent 361 Ozan Foissiat Bovin Allaitant, céréalier (GAEC de l’Espérance) Asnières/S. Chevroux Bernard Ponthus Izernore Grilly Jayat Salavre Confrançon 69 Béréziat Tossiat (GAEC du Voix) Marboz Villemotier Echenevex Cessy (EARL de Recornet) Manziat Boissey Verjon Sauverny Vésines x Pouillat Bâgé Marsonnas Malafretaz Etrez Versonnex Dortan Crozet Segny la-Ville Dommartin Montrevel Bresse Gontran Benier Feillens Chevry Ornex St -en-Bresse Vallons Bény Cras-sur- Courmangou Germagnat Lélex Thoiry Sulpice Reyssouze t Bâgé-le-Châtel a Arbent St-Didier St-GenisPrévessin St-Laurent Replonges St-Martin Chavannes Ferney- d'Aussiat Sergy Pouilly Moëns / Saône St-André de-B.