Cahiers D'ethnomusicologie, 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Overview of Russia's Late Mediaeval Musical
Journal of the International Society for Orthodox Church Music Vol. 4 (1), Section II: Conference papers, pp. 183–197 ISSN 2342-1258 https://journal.fi/jisocm An Overview of Russia’s Late Mediaeval Musical Culture, and the “New Repertoires”: Demestvenny, Put and Strochnóe Singing and Notations Nikita Simmons [email protected] Part I. Znamenny Chant and Stolp Notation1 In the primary tradition of Znamenny singing, almost all chant books of the Russian liturgical tradition used Stolp (Znamenny) notation. The Slavonic word stolp (pillar) describes the eight-week cycle of the Octoechos, while the Slavonic term znamya means “mark”, “note”, or “neume”. Slavic Stolp notation (along with early chant repertoire) has been in use since the tenth century (having been derived from Coislin B Palaeobyzantine notation), and in its latest stage of development it is still used by Russian Old Ritualists up to the present time. Beyond the basic level of neume-by-neume notation, Stolp chanting includes three methods of presenting complex melodic features: popévki, litsá and fíty, each of which were traditionally memorized by singers. (Popévki, also called kokízy2, are established sequences of neumes which are the essential “building blocks” of Znamenny chants, while litsa and fity are more lengthy and complex melodic patterns.) These contextual groups of symbols are usually referred to as “múdrye stróki” (“wise lines” or short- hand), indicating the use of “tainozamknénnost” (“secret-closure” or encryption). Stolp chanting, like its Byzantine parent, is organized according to the system of eight Tones, and each Tone (Slavonic: glas) contains a repertoire of popevki, fity and 1 Among the ranks of musicologists who have contributed significantly to the recovery of Russia’s late medieval musical traditions, we are most indebted to М.В. -

Chapter 5 Tour of Usa in 1968
CHAPTER 5 TOUR OF USA IN 1968 A dynamic shift in India’s foreign policy occurred with the advent of Indira Gandhi, who took over the reins of the government in January 1966.1 India had by then been through two wars – the war that India was not successful in winning – the Sino – Indian War of October 19622 and the Indo – Pak War of 1965,3 which India won. The first war was during the time of India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru while the second war took place during the tenure of India’s third Prime Minister, Lal Bahadur Shastri. As mentioned in Chapter 2, during Nehru’s tenure, soft power was emphasized on, as with the legacy of poverty, left behind by the British, India was not really in a position to invest in hard power, and Nehru sought to develop relations between India and other nations essentially through various treaties of friendship. "Where Nehru had articulated India's national interests in high-flown phrases of world peace and cooperation, Indira stressed security, territory, and prestige…In contrast to her father's alleged "moralism," Indira Gandhi's actions are described as 'pragmatic".4 Given 1 https://www.pmindia.gov.in/en/former_pm/smt-indira-gandhi/ (Accessed: 15-03-2019) 2 Joseph R. Stauffer, "Sino-Indian Border Dispute—1962," Naval War College Review 19, no. 9 (1967): 81-117, accessed March 15, 2019, url: http://www.jstor.org/stable/44640979 3 The Indo – Pak War of 1965, url: http://www.indiandefencereview.com/spotlights/indo-pak-war-of-1965/ 4 Arthur G. -

From Neumes to Notation: a Thousand Years of Passing on the Music by Charric Van Der Vliet
From Neumes to Notation: A Thousand Years of Passing On the Music by Charric Van der Vliet Classical musicians, in the terminology of the 17th and 18th century musical historians, like to sneer at earlier music as "primitive", "rough", or "uncouth". The fact of the matter is that during the thousand years from 450 AD to about 1450 AD, Western Civilization went from no recording of music at all to a fully formed method of passing on the most intricate polyphony. That is no small achievement. It's attractive, I suppose, to assume the unthinking and barbaric nature of our ancestors, since it implies a certain smugness about "how far we've come." I've always thought that painting your ancestors as stupid was insulting both to them and to yourself. The barest outline of a thousand year journey only hints at the difficulties our medieval ancestors had to face to be musical. This is an attempt at sketching that outline. Each of the sub-headings of this lecture contains material for lifetimes of musical study. It is hoped that outlining this territory may help shape where your own interests will ultimately lie. Neumes: In the beginning, choristers needed reminders as to which way notes went. "That fifth note goes DOWN, George!" This situation was remedied by noting when the movement happened and what direction, above the text, with wavy lines. "Neume" was the adopted term for this. It's a Middle English corruption of the Greek word for breath, "pneuma." Then, to specify note's exact pitch was the next innovation. -

Plainchant Tradition*
Some Observations on the "Germanic" Plainchant Tradition* By Alexander Blachly Anyone examining the various notational systems according to which medieval scribes committed the plainchant repertory to written form must be impressed both by the obvious relatedness of the systems and by their differences. There are three main categories: the neumatic notations from the ninth, tenth, and eleventh centuries (written without a staff and incapable, therefore, of indicating precise pitches);1 the quadratic nota tion in use in Italy, Spain, France, and England-the "Romanic" lands from the twelfth century on (this is the "traditional" plainchant notation, written usually on a four-line staff and found also in most twentieth century printed books, e.g., Liber usualis, Antiphonale monasticum, Graduale Romanum); and the several types of Germanic notation that use a staff but retain many of the features of their neumatic ancestors. The second and third categories descended from the first. The staffless neumatic notations that transmit the Gregorian repertory in ninth-, tenth-, and eleventh-century sources, though unlike one another in some important respects, have long been recognized as transmitting the same corpus of melodies. Indeed, the high degree of concordance between manuscripts that are widely separated by time and place is one of the most remarkable aspects the plainchant tradition. As the oldest method of notating chant we know,2 neumatic notation compels detailed study; and the degree to which the neumatic manuscripts agree not only • I would like to thank Kenneth Levy, Alejandro Plan chart, and Norman Smith for reading this article prior to publication and for making useful suggestions for its improve ment. -
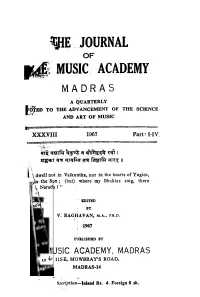
T>HE JOURNAL MUSIC ACADEMY
T>HE JOURNAL OF Y < r f . MUSIC ACADEMY MADRAS A QUARTERLY IrGHTED TO THE ADVANCEMENT OF THE SCIENCE ' AND ART OF MUSIC XXXVIII 1967 Part.' I-IV ir w > \ dwell not in Vaikuntha, nor in the hearts of Yogins, ^n- the Sun; (but) where my Bhaktas sing, there L ^ Narada ! ” ) EDITED BY v. RAGHAVAN, M.A., p h .d . 1967 PUBLISHED BY 1US1C ACADEMY, MADRAS a to to 115-E, MOWBRAY’S ROAD, MADRAS-14 bscription—Inland Rs. 4. Foreign 8 sh. X \ \ !• ADVERTISEMENT CHARGES \ COVER PAGES: Full Page Half Page i BaCk (outside) Rs. 25 Rs. 13 Front (inside) 99 20 .. 11. BaCk (Do.) 30 *# ” J6 INSIDE PAGES: i 1st page (after Cover) 99 18 io Other pages (eaCh) 99 15 .. 9 PreferenCe will be given (o advertisers of musiCal ® instruments and books and other artistic wares. V Special positions and speCial rates on appliCation. t NOTICE All correspondence should be addressed to Dr. V. Ragb Editor, Journal of the MusiC ACademy, Madras-14. Articles on subjects of musiC and dance are accepte publication on the understanding that they are Contributed to the Journal of the MusiC ACademy. f. AIT manuscripts should be legibly written or preferabl; written (double spaced—on one side of the paper only) and be sigoed by the writer (giving his address in full). I The Editor of the Journal is not responsible for tb expressed by individual contributors. AH books, advertisement moneys and cheques du> intended for the Journal should be sent to Dr. V, B Editor. CONTENTS Page T XLth Madras MusiC Conference, 1966 OffiCial Report .. -

A Conductor's Guide to the Music of Hildegard Von
A CONDUCTOR’S GUIDE TO THE MUSIC OF HILDEGARD VON BINGEN by Katie Gardiner Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music, Indiana University July 2021 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music Doctoral Committee ______________________________________ Carolann Buff, Research Director and Chair ______________________________________ Christopher Albanese ______________________________________ Giuliano Di Bacco ______________________________________ Dominick DiOrio June 17, 2021 ii Copyright © 2021 Katie Gardiner iii For Jeff iv Acknowledgements I would like to acknowledge with gratitude the following scholars and organizations for their contributions to this document: Vera U.G. Scherr; Bart Demuyt, Ann Kelders, and the Alamire Foundation; the Librarian Staff at the Cook Music Library at Indiana University; Brian Carroll and the Indiana University Press; Rebecca Bain; Nathan Campbell, Beverly Lomer, and the International Society of Hildegard von Bingen Studies; Benjamin Bagby; Barbara Newman; Marianne Pfau; Jennifer Bain; Timothy McGee; Peter van Poucke; Christopher Page; Martin Mayer and the RheinMain Hochschule Library; and Luca Ricossa. I would additionally like to express my appreciation for my colleagues at the Jacobs School of Muisc, and my thanks to my beloved family for their fierce and unwavering support. I am deeply grateful to my professors at Indiana University, particularly the committee members who contributed their time and expertise to the creation of this document: Carolann Buff, Christopher Albanese, Giuliano Di Bacco, and Dominick DiOrio. A special debt of gratitude is owed to Carolann Buff for being a supportive mentor and a formidable editor, and whose passion for this music has been an inspiration throughout this process. -

THE UDA Y SHANKAR HINDU DANCERS and MUSICIANS
1968 Ninetieth Season 1969 UNIVERSI TY MUSICAL SOCIETY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN Charles A. Sink, President Gail W. Rector, Executive Director Lester McCoy, Conductor Third Program First Annual Dance Series Complete Series 3629 THE UDA Y SHANKAR HINDU DANCERS and MUSICIANS TUESDAY EVENING, OCTOBER 29, 1968, AT 8:30 HILL AUDITORIUM, ANN ARBOR, MICHIGAN Dancers UDAY SHANKAR SANTI BOSE SADHAN GUHA DHURJATI SEN RANGOPAL BHATTACHARYA SHARMISTHA GUHA JHARNA DUTTA SREEMATI DUTT SUNANDA SEN GUPTA PRAl~ATI SEN GUPTA SHIKHA MUKHERJEE PALl SANYAL SHIKHA MITRA ANUPAMA DAS ANJU NATH SHEFALI GHOSH TAPATI MUKHERJEE JANA GUPTA BHAYA Musicians KAMALESH MAITRA BARUN DUTT KISHOR GHOSH VISHNU DAS SADHUKHAN RAMESH CHANDRA GOLAK SEAL RANJITMULL KANKARIA BHUDEB SHANKAR KRISHNA GUPTA SARA LA DEVI KANKARIA A R S LON G A V I T A BREVIS PROGRAM Musical Introduction-Raga: Mohan-Kosh (Evening Melody) Soloist: Kamalesh Maitra (Sarod). Assisted by: Barun Dutt (Drum) j Kishor Ghosh (Sitar) j Vishnudas Sadbukhan (Flute) j Ramesh Chandra (Esraj) j Miss Krishna Gupta (Vocal and Percussion ) j Golak Seal (Gong and Percussion) Deva-Dasis-Dance of the Temple Girls from South India Traditional. Dance arranged by: Guru Gyanaprakasam of Uday Shankar India Culture Centre. Anupama Das, Shikha Mitra, Pali Sanyal, Jana Gupta Bhaya, Anju Nath, Shefali Ghosh, Tapati Mukherjee Madia-Aboriginal Folk Dance of Central India Sad han Guha, Dhurjati Sen, Sharmistha Guha, Su nanda Sen Gupta, Sreemati Dutt, Shikha Mukherjec, Jharna Dutta Kartikeya ............................................... .......................... ..................... SANTI BOSE The golden son of Shiva, born to command the army of Suras (demi go ds) and slay the demon Taraka, comes to make obeisance to his parents and other gods to win their blessin O's before the fight with the demon. -

Cahiers D'ethnomusicologie, 14
Cahiers d’ethnomusicologie Anciennement Cahiers de musiques traditionnelles 14 | 2001 Le geste musical Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/70 ISSN : 2235-7688 Éditeur ADEM - Ateliers d’ethnomusicologie Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2001 ISBN : 2-8257-07-61-9 ISSN : 1662-372X Référence électronique Cahiers d’ethnomusicologie, 14 | 2001, « Le geste musical » [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 06 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/70 Ce document a été généré automatiquement le 6 mai 2019. Tous droits réservés 1 Seuls la musique des sphères, la harpe éolienne et quelques instruments électroniques récents se passent de l'homme pour être mis en vibration. C'est finalement au corps humain que revient le rôle d'agitateur, de stimulateur et d'organisateur de la matière sonore. Au plus intime du corps naît la voix. A l'origine cachée du chant, un mouvement intérieur se traduit en geste phonatoire. La danse n'est pas loin : les pieds, les mains, spontanément, répondent à ce surgissement dont l'oreille assure le relais. Comment naît le geste vocal ? Comment vient la danse ? Comment l'instrument accueille-t-il celui qui en joue, comment s'adapte-t-il à la physiologie humaine ? A quelles impulsions obéissent le souffle, la voix, les mains, les doigts ou les pieds lorsqu'ils se meuvent pour produire des sons, et quelle est la part des automatismes dans le geste "intérieur" - geste "antérieur" au son - qui conduit le jeu du musicien ? Telles sont, parmi d’autres, les questions qui se posent lorsqu’on pense aux mouvements de la musique dans l’homme, lorsqu’on réfléchit aux gestes de l’homme musicien. -

A Morphology of Medieval Notations in the Optical Neume Recognition Project
K. HELSEN – I. BEHRENDT – J. BAIN, OPTICAL NEUME RECOGNITION, ARMUD6 48/2 (2017) 241-266 241 A MORPHOLOGY OF MEDIEVAL NOTATIONS IN THE OPTICAL NEUME RECOGNITION PROJECT KATE HELSEN UDK / UDC: 781.24:004.352.242 DOI: htt p://doi.org/10.21857/94kl4cxpqm Don Wright Faculty of Music Izvorni znanstveni rad / Research Paper Western University Primljeno / Received: 10. 5. 2017. Talbot College, Room 210 Prihvaćeno / Accepted: 16. 11. 2017. LONDON, Ontario, Canada, N6A 3K7 INGA BEHRENDT Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rott enburg-Stutt gart St.-Meinrad-Weg 6 72108 ROTTENBURG, Germany Eberhard Karls Universität Tübingen Musikwissenschaftliches Institut Schulberg 2 72070 TÜBINGEN, Germany JENNIFER BAIN Fountain School of Performing Arts Dalhousie University 6101 University Avenue HALIFAX, NS, B3H 4R2, Canada 242 K. HELSEN – I. BEHRENDT – J. BAIN, OPTICAL NEUME RECOGNITION, ARMUD6 48/2 (2017) 241-266 Abstract The study of medieval notations depends ume tables help scholars to understand the use on eff ective categorization of individual signs of medieval neumes in the same way a linguist in order to facilitate a comprehensive under- understands the morphology of words. This standing of their musical meaning. Over the article presents the principles on which this past century, chant scholars have developed new kind of neume table has been developed several kinds of neume tables which arrange and suggests the ways in which this new way and contextualize neumes either according to of thinking might inform the discipline in the graphical type, chronology, or scribal tradition. future. Some neume tables contain longer strings of neumes that link certain notation conventions Keywords: neume table, morphology of with performance traditions. -

Towards a Classification of Western Chant Notations* John Caldwell Jesus College the University of Oxford
Towards a Classification of Western Chant Notations* John Caldwell Jesus College The University of Oxford Taking as accepted the usual modern use of the word This hardly amounts to a classification at all, and it is also ‘neume’ to denote the notational symbols of chant notation, a confusing in teaching, since the terminology does not adequately classification of chant notations must nevertheless embrace distinguish between essential and incidental features. My alphabetical notations as well, partly because of their intrinsic suggested classification does this by distinguishing first between importance, but also because they are often found in conjunction alphabetical notations and neumatic notations: the latter (in the with neumes, ultimately and decisively in the form of clefs at the West) work by indicating, to a greater or lesser extent, the contour beginning of the four-line staff. of the melody in visual terms. A third category lists a number of Current systems of classification, if they can be called that, notational methods and uses that require separate mention. tend to ignore or minimize the significance of alphabetical The listing of methods in the first and third categories affords systems, and in describing neumes use a terminology based no particular difficulty, but the further classification of neumes largely on inconsistent and non-compatible geographical or (the second category) is more problematic. My approach is to liturgical descriptors (St Gall, Aquitanian, French, German, make distinctions according to the semantic range envisaged by Beneventan, Ambrosian, Mozarabic, etc.). These may be used side the notator, using the indication of pitch as the defining factor. An by side with visually or conceptually descriptive terms, sometimes analogy may be made with linguistic alphabets. -

Melodic Function and Modal Process in Gregorian Chant
MELODIC FUNCTION AND MODAL PROCESS IN GREGORIAN CHANT by RICHARD PORTERFIELD A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The City University of New York 2014 ii © 2014 RICHARD PORTERFIELD All Rights Reserved iii This manuscript has been read and accepted by the Graduate faculty in Music in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy Codex hic lectus acceptusque est William Rothstein ____________________ ___________________________________ Date Chair of Examining Committee Norman Carey ____________________ ___________________________________ Date Acting Executive Officer Ruth DeFord ___________________________________ Anne Stone ___________________________________ Joseph Straus ___________________________________ iv Abstract MELODIC FUNCTION AND MODAL PROCESS IN GREGORIAN CHANT by RICHARD PORTERFIELD Advisor: Professor William Rothstein This study proposes a theory and method of analysis for voice leading in the melody of Gregorian chant. It draws on historical theories and practices, particularly those of the cantus tradition which 1) pre-dates the imposition on Western ecclesiastical chant of scale theories based in the Ancient Greek science of harmonics, 2) observes and predicts actual melodic behavior, and 3) remains basic to pedagogy through the centuries. Central to cantus-tradition doctrine is the investment of melodic tones with structural functions which articulate modes as melodic archetypes; idiomelic antiphons are analyzed according to five melodic functions derived from formulaic psalmody in a framework modally conditioned by the qualitative and intervallic relationship of final and tenor. Medieval sources put forward this functional dyad as essential to modal cognition—sometimes as the basis of modal construction—through a widespread mnemonic I call the “Re-la, re-fa” Rule; these dyads are also embedded in the ninth- century Noanoeane and eleventh-century Primum quaerite melodic prototypes. -

From Neumes to Notes: the Evolution of Music Notation Hope Strayer Cedarville University
Cedarville University DigitalCommons@Cedarville Music and Worship Student Presentations Student Scholarly Activity 4-11-2013 From Neumes to Notes: The volutE ion of Music Notation Hope R. Strayer Cedarville University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.cedarville.edu/ music_and_worship_student_presentations Part of the Music Performance Commons, and the Music Theory Commons Recommended Citation Strayer, Hope R., "From Neumes to Notes: The vE olution of Music Notation" (2013). Music and Worship Student Presentations. 14. http://digitalcommons.cedarville.edu/music_and_worship_student_presentations/14 This Conference Presentation is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Cedarville, a service of the Centennial Library. It has been accepted for inclusion in Music and Worship Student Presentations by an authorized administrator of DigitalCommons@Cedarville. For more information, please contact [email protected]. From Neumes to Notes: The Evolution of Music Notation Hope Strayer Cedarville University New things are often viewed as being better and more advanced than older counterparts. However, new does not denote superior. Music notation serves as one example of old methods that were as adequate as the new. Early forms of music notation may appear vague and ambiguous, but when combined with oral tradition the notation contained all the information required for a successful performance. Though these early notational forms seem insufficient when compared with contemporary forms, notation cannot be removed from the context in which it served. From the origin of neumes in the ninth century to the rhythmic developments of the Ars Nova period in the fourteenth century, each musical period collaborated with the foundation of oral tradition to create and adapt notational forms.