PPT Haut Giffre 122012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CARTE-VTT-AE CCMG 2021.Pdf
Le velo sous toutes ses formes les bonnes adresses et pour tous les gouts ! pour vos locations vttae, vtt... VVTiste chevronné amateur de sensations ? Famille à la recherche d’une balade en MIEUSSY SAMOENS vallée ? Traditionnel ou à assistance électrique, le vélo c’est une autre façon de découvrir Locaski Sommand : J’aime sport : VTTAE les richesses de la montagne… +33 (0)4 50 34 35 80 / locaski.com +33 (0)4 50 34 98 20 / jaimesport.fr vtt a assistance electrique En plus des sentiers, retrouvez la voie douce «Au Fil du Giffre», véritable fil d’Ariane, Sport Expérience : qui vous invite à la découverte de la vallée, dans un écrin de verdure… Au bord du TANINGES +33 (0)4 50 34 90 36 / sports-experiences.fr torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo Praz de Lys Sommand Tourisme : Anthonioz Ski : 4 parcours en vallee du giffre et les saisons, laissez-vous surprendre par ces 26 km de balade qui vous invite au +33 (0)4 50 34 25 05 / prazdelys-sommand.com +33 (0)4 50 34 93 67 / anthonioz-ski.com ressourcement. Cet itinéraire est ouvert aux piétons, cavaliers, cyclistes et notamment Super U Taninges : +33 (0)4 50 34 88 08 Mountain Spirit : ceux équipés d’un VTTAE. Go Sport Praz de Lys : +33 (0)4 50 89 51 39 +33 (0)4 56 12 78 39 / mountainspirit-sports.com go-sport.com Roland Gay SkiSet Ski Services : +2 Glisse Skiset Praz de Lys : +33 (0)4 50 34 42 44 / skiset.com +33 (0)4 50 34 38 57 / skiset.com X’Trême glisses : +33 (0)4 50 89 82 30 / la securite MORILLON xtremeglisses-samoens.com Précision Ski : SIXT-FER-A-CHEVAL +33 (0)4 50 96 05 61 / precisionski.fr Go Sport Montagne Narcisse Sports : Sport 2000 Morillon 1100 : Chacun est responsable de sa sécurité. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie
2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

Rapport D'orientation Budgétaire 2019
Rapport d’orientation budgétaire 2019 Le débat d’orientation budgétaire, qui s’appuie notamment sur le rapport d’orientation budgétaire, est une étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales et leurs établissements qui doit se tenir dans les deux mois précédents le vote du budget primitif. En application de l’Art. D. 2312-3.-A.- et du Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire, le rapport d’orientation budgétaire prévu à l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, présenté en appui du débat d’orientation budgétaire, comporte des informations concernant : - Les orientations budgétaires envisagées par la structure portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement (sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre le syndicat et ses membres) - Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise le syndicat pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, ainsi que les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. -

Sorties Parcours 2021
PARCOURS 2021 Mise à jour 21 Septembre 2021 Pour les départs de Sallanches, Vélo ou voiture, rendez-vous Parking de Saint-Martin, 241 route Impériale 74700 Sallanches. Pour les départs de Cluses, rendez-vous Parking Claude-Anthoine, Place Claude Anthoine 74300 Cluses. Pour les départs de Marignier, rendez-vous Parking de la zone artisanale à Marignier (début de la piste cyclable vers Bonneville), 270 route de chez Millet 74970 Marignier. L'horaire indiqué pour les sorties extérieures (journée) est celui du rendez-vous Parking de Saint-Martin. Lorsque le départ est prévu à 14h au parking Claude-Anthoine à Cluses, rendez-vous à 13h au parking de Saint-Martin à Sallanches pour ceux qui souhaitent rejoindre Cluses à vélo (une heure plus tôt). En rouge : Groupe 1 à la journée En vert : Groupe 2 à la journée PARCOURS SEPTEMBRE 2021 Date Gr Hor Départ Km Circuit OpenRunner Cluses, Marignier, L'Eponnet, Bonneville, Le Thuet, Mt Saxonnex, Marignier, 1 14h00 Cluses 65 Petit Châtillon, Cluses. mar./21/09/21 51km Cluses, Marignier, Mieussy, Quincy, Megevette, Onnion, St Jeoire, Cormand, 2 14h00 Cluses 6860175 806d Marignier, Cluses. Cluses Cluses, Châtillon, Les Gets, Lac de Montriond, Les Lindarets, Col de Joux Verte, 1 9h00 90 (Journée) Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtillon, Cluses. jeu./23/09/21 Cluses, Marignier, Cormand, St Jeoire, La Tour, Peillonex, Côte d'Hyot, 2 14h00 Cluses 60 Bonneville, Cluses. Cluses, Bonneville, St Pierre en Faucigny, Amancy, Cornier, La chapelle 1 14h00 Cluses 70 sam./25/09/21 Rambaud, La Roche, St Laurent, Bonneville, Cluses. 2 14h00 Sallanches 55 Sallanches, Chedde, Servoz, Vaudagne, Chamonix, lac des Gaillands, retour. -

Directions from Geneva Airport Via Thonon Les Bains
Directions from Geneva Airport via Thonon les Bains • From Geneva airport follow the signs for Geneva city centre (heading in the direction of the lake) and then for Evian. • Cross over the lake at the “Pont du Mont-Blanc”, following signs for Evian. • Take the N5 which follows the edge of the lake - keep following signs for Evian. • After 20 minutes and a small stretch of dual carriageway you will come to a roundabout. Turn right onto the D1005 – signposted Montreaux and Evian • Leave the D1005 at junction 1 (after about 5 minutes) – signposted Morzine. • At the top of the slip-road turn right – this is the D902 which will lead you all the way up the mountain to Saint Jean d'Aulps and Morzine. • After you pass through the 3rd tunnel on this road you will enter the outskirts of St Jean d’Aulps village. To get to La Vieille Ferme de la Moussiere • You will see a big information board on the right of the road showing what’s on in the village during the coming week. • Shortly after this, take the right turning (D293) signposted "St Jean d’Aulps Station" • Follow this road until it bends round to the left and you reach a small square with a church at the end. • This is “Place de la Moussiere”, and our chalet "La Vieille Ferme de la Moussiere" is the last building on the square - closest the church. There is a big Alpine Adventure banner on the balcony. • You can park anywhere on the square. To get to Chalet Lucioles • Stay on the D902. -

Au Fil Du Giffre” Vous Invite À La Découverte De La Vallée Dans Un Écrin De Verdure
Au Plus de 26 km fil du de piste pour Giffre vous déplacer... MON RETOUR AUX SOURCES tout en douceur Véritable fil d’Ariane, la voie douce “Au Fil du Giffre” vous invite à la découverte de la vallée dans un écrin de verdure... Au bord du torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo et les saisons, laissez-vous surprendre par ce site de balade qui vous invite au ressourcement. À l’écart des voitures, à pied, à vélo ou à cheval, en famille ou entre amis, chacun pourra découvrir à son rythme les merveilles des Montagnes du Giffre. Mieussy Le Giffre 26,5 km de Taninges au Cirque du Fer-à-Cheval Parcours facile, sécurisé, avec quelques passages tout terrain (Sixt) Accessible à pied, à vélo, à cheval D907 Revêtement de type chemin (matériaux compactés) Accès : aux points d'entrée de Taninges, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval Vue sur le Pic du Marcelly du lac vue direction ouest Vue sur le Giffre via la passerelle avec les montagnes en fond Vue sur le Pic Taninges (est et ouest) du Marcelly vue au nord D907 Chartreuse Lac des Conjuguer de Mélan Vernays Lac de Passerelle Le Giffre Flérier du Foron Vernay ART & HISTOIRE D4 de Brochère Verchaix SECTEUR TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE D154 La Rivière-Enverse Les Bois Lac de Flérier -> Les bois D907 Samoëns Lac Passerelle Passerelle 33 Bleu la R’Biolle 8,6 km 2h05 min du Verney Lac aux Cirque du Morillon D4 Dames D4 Fer-à-Cheval Partez “Au fil du Giffre” en débutant par la découverte de Passerelle Pont du Giffre du Clévieux la Chartreuse de Mélan et de son Parc d’œuvres contemporaines. -

Haute Savoie Sites Inscrits
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPES liste des sites inscrits département de la Haute-Savoie • 125 sites inscrits Date de protection, nom du site, communes concernées • 24/08/1937 Lac d’Annecy, Annecy / Annecy-le-Vieux / Veyrier-du-Lac / Menthon-Saint-Bernard / Talloires / Doussard / Duingt / Saint-Jorioz / Sévrier • 19/05/1939 Abords du Pont de la Caille, Allonzier-la-Caille / Cruseilles, • 20/04/1942 Ruines du château de Faucigny et leurs abords, Faucigny, • 15/09/1942 Le Bonnant et les deux ponts du Diable, Saint-Gervais-les-Bains, • 15/09/1942 Vues panoramiques de la RN 202, Saint-Gervais-les-Bains, • 23/09/1942 Col du Bonhomme et ses abords, Les Contamines-Montjoie, • 17/02/1943 Rives du Lac d’Annecy à Albigny, Annecy-le-Vieux • 17/03/1943 Abords de la RD 909 au lieu-dit “ la Tour ”, Annecy-le-Vieux, • 22/03/1943 Place du Bourg et ses abords, Alby-sur-Chéran, • 30/06/1943 Château de la Palud, Moye • 01/06/1943 Carrefour du Faubourg Saint-Martin, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Gorges de Mieussy, Mieussy, • 01/06/1943 Maisons anciennes rue Carnot et Place Saint-Jean, La Roche-sur-Foron, • 01/06/1943 Place Grenette et Hôtel de Ville, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Église Saint-Jean et rue des Fours, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Quartier du Plain-Château, La Roche-sur-Foron, • 09/06/1943 Rampe du Crétet, La Roche-sur-Foron, • 30/06/1943 Colline de Chappay, Le Val-de-Fier, • 30/06/1943 Pont de Lornay et ses abords, Le Val-de-Fier, • 05/11/1943 Place de la Mairie, Rumilly, • 16/11/1943 Château de Monthoux et son parc, Pringy • 02/12/1943 Gorges du Fier, Lovagny, • 14/01/1944 Étroit d’Enté et ses abords, Mieussy, • 28/01/1944 Hameau de Trélechamps et ses abords, Chamonix-Mont-Blanc, • 02/02/1944Montagne d’Anterne, Passy, • 10/02/1944 Alpe des Chavannes, Les Gets, • 10/02/1944 Côteau en bordure sud de la RN 202, Les Gets, Direction régionale de l'environnement - RHONE-ALPES 208bis, rue Garibaldi – 69422 Lyon Cédex 03 tél. -

102 ANNEMASSE SIXT-FER-À-CHEVAL N’Oubliez Pas De Vous Reporter Aux Renvois Ci-Dessous
ANNEMASSE Gare routière ANNEMASSE Étoile ANNEMASSE SIXT-FER-À-CHEVAL ANNEMASSE VÉTRAZ-MONTHOUX Bas Monthoux Chapelle 102 N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous CRANVES-SALES Taninges 102 SIXT-FER-À-CHEVAL CRANVES-SALES La Bergue SIXT-FER-À-CHEVAL TITRES TARIFS BONNE Centre SAMOËNS Du 26 Avril 2021 BILLET UNITÉ 1,50 € MORILLON BONNE Sous Malan BILLET UNITÉ ENFANT –10 ANS 0,75 € VERCHAIX au 06 Juillet 2021 BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 0,75 € FILLINGES Pont de Fillinges TANINGES ZONE 1 BILLET UNITÉ 50 %* 0,75 € MIEUSSY VIUZ-EN-SALLAZ Brégny CARNET DE 10 TRAJETS 13,50 € SAINT-JEOIRE Pont du Risse VIUZ-EN-SALLAZ Office de tourisme CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 7,50 € ABONNEMENT MENSUEL 30,00 € SAINT-JEOIRE VILLE-EN-SALLAZ Café Duchosal VILLE-EN-SALLAZ BILLET UNITÉ 3,50 € VIUZ-EN-SALLAZ SAINT-JEOIRE Poste BILLET UNITÉ ENFANT –10 ANS 1,75 € VIUZ-EN-SALLAZ Brégny BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 1,75 € SAINT-JEOIRE Pont du Risse FILLINGES ZONE 2 BILLET UNITÉ 50 %* 1,75 € BONNE Sous Malan MIEUSSY Ancienne gare CARNET DE 10 TRAJETS 31,50 € BONNE CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 17,50 € MIEUSSY Chef Lieu CRANVES-SALES La Bergue ABONNEMENT MENSUEL 70,00 € MIEUSSY Les Vagnys CRANVES-SALES Taninges BILLET UNITÉ 6,00 € VÉTRAZ-MONTHOUX TANINGES Chef Lieu BILLET UNITÉ ENFANT –10 ANS 3,00 € ANNEMASSE VERCHAIX Office de tourisme BILLET UNITÉ DÉCLIC’ 50 % 3,00 € ZONE 3 BILLET UNITÉ 50 %* 3,00 € MORILLON CCAS CARNET DE 10 TRAJETS 54,00 € Brégny BONNE CARNET DE 10 TRAJETS DÉCLIC’ 30,00 € Taninges MIEUSSY MORILLON Télécabine La Bergue SAMOËNS TANINGES FILLINGES -

Indoor Activities
Nearby Samoëns... TANINGES MIEUSSY CHARTREUSE DE MÉLAN CHEESE DAIRY OF HAUT FLEURY – This site exists since 700 years. It has been CROQ’ALP GUIDED TOUR a monastery, a local orphanage and is now a Outside school holidays : On Wednesday morning, contemporary art center and concerthall. from 9am to 12pm. School holiday period : From Opened everyday from 10am to 12.30pm and Wednesday to Friday, from 9am to 12pm and from from 1.30pm to 6pm until the 30th of October. 3pm to 6pm. Visit with a guide on reservation. From Wednesday to Friday, guided tours at 9.15 am and cheese activity at 10.15am. Closed from the Avenue Mélan 2nd of November until the 19th of December. +33 (0)4 50 34 25 05 2 route de l’Etroit Denté - Chef-lieu de Mieussy HERITAGE HOUSE +33 (0)4 50 36 89 18 INDOOR The Heritage house will take you to the center of landscapes and customs of a traditional ARNO’S SNAIL FARM mountain village. Come meet Arnaud and his flock of horned animals Opened from Monday to Friday, from 3pm to 6pm. ACTIVITIES On Wednesday and Thursday from 10am to 12pm. For any information, please contact our residence counselors. 9 rue des Arcades Our suggestions +33 (0)4 50 89 46 21 +33 (0)6 03 07 80 11 CLUSES VIUZ-EN-SALLAZ NAUTICAL CENTER PEASANT MUSEUM Open Monday to Saturday: 3 time slots: Discover the exhibition in a playful way – 10.30am-12.30pm / 1.30pm-3.30pm / 4pm- suitable for everyone. 6pm. Closed on Sunday. -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of
16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -
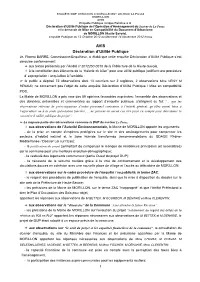
Avis Dup Morillon
Enquête DUP opération d’aménagement secteur La Pusaz MORILLON AVIS Enquête Publique Unique Relative à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération d’Aménagement du Secteur de La Pusaz et la demande de Mise en Compatibilité du Document d’Urbanisme de MORILLON (Haute-Savoie). Enquête Publique du 12 Octobre 2012 au Mercredi 14 Novembre 2012 inclus AVIS Déclaration d’Utilité Publique Je, Florent BARRÉ, Commissaire-Enquêteur, ai établi que cette enquête Déclaration d’Utilité Publique s’est déroulée conformément: ✳ aux textes présentés par l’Arrêté n°2012250-0010 de la Préfecture de la Haute-Savoie, ✳ à la constitution des éléments de la “théorie du bilan” pour une utilité publique justifiant une procédure d’ expropriation / acquisition à l’amiable : ➢ le public a déposé 72 observations dont 13 courriers sur 2 registres, 2 observations Mme VEISY, M RENAUD, ne concernent pas l’objet de cette enquête Déclaration d’Utilité Publique / Mise en compatibilité POS. La Mairie de MORILLON a pris note des 59 opinions favorables exprimées; l’ensemble des observations et des données, présentées et commentées au rapport d’enquête publique, s’intègrent au fait “... que les observations relevant de préoccupations d’ordre personnel contraires à l’intérêt général, qu’elles soient liées à l’agriculture ou à la seule spéculation foncière, ... ne peuvent en aucun cas être prise en compte pour déterminer le caractère d’utilité publique du projet”. ➢ La majeure partie des observations concerne la DUP du secteur La Pusaz: ✳ aux observations de l’Autorité Environnementale, -

Montagnes Du Giffre
Le magazine Montagnes N° 4 de la Communauté de Communes automne 2015 du Giffre INFOS des Montagnes du Giffre Dossier : les sentiers des Montagnes du Giffre une richesse exceptionnelle p 6-7 # 2 Ed i to Chers habitants des Montagnes du Giffre, l’année 2015 a été l’occasion pour notre Communauté de mettre en place de nouveaux services, d’inves- tir de façon conséquente au niveau des sentiers et des cloches semi-enterrées des ordures ménagères et également de poser les bases du schéma de mutualisation de notre territoire. Ainsi, depuis le 1er juillet la Communauté de Communes assure le service d’instruction du droit des sols, auparavant assuré par l’État au travers de la Direction Départementale des Territoires (DDT). D’autre part, le 1er marché groupé de voirie a été lancé concernant les enrobés et autres traitements des routes, offrant ainsi aux communes une réelle économie par rapport au coût des précédents marchés. Dans ce climat économique compliqué et renforcé par la baisse drastique des dotations, nous devons, dans l’intérêt de tous, renforcer la mutualisation des services, multiplier les marchés groupés sur les postes majeurs de dépenses de nos collectivités, investir dans des actions qui auront des leviers économiques importants. Nous devrons, avec les élus communautaires réaliser des arbitrages en priorisant les actions stratégiques et ayant le plus de retombées pour les Montagnes du Giffre. Il nous faudra également maîtriser les dépenses des services, notamment ceux déjà bien présents sur notre territoire. Une étude économique et financière de notre Communauté est actuellement menée par un cabinet privé.