09-MONOGRAPHIE-Montay.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tryptique Plateforme-Sante 2017.Pdf
ASSOCIATION ACTION : 7, rue du 19 mars 1962 SITUATION S DE S ANTÉ PRÉCAIRE ET /OU 59129 Avesnes les Aubert OB S TACLE S À L’EMPLOI : N ACCOMPAGNEMENT DAN S LA PRI S E Téléphone : 03.27.82.29.82 - Télécopie : 03.27.82.29.89 PROJET EMPLOI PLATEFORME SANTÉ U Courriel : [email protected] EN COMPTE ET LA RÉ S OLUTION . Site Internet : www.association-action.org La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Plateforme Santé - Territoire d'intervention 2017 LEGENDE : Limite de Communauté (Constitutions - 1946) Limite de Commune SOMMAING VENDEGIES UTPAS Cambrai Marcoing SUR ECAILLON HEM BERMERAIN AUBENCHEUL PAILLENCOURT UTPAS Avesnes- Solesmes LENGLET AU BAC FRESSIES SAINT MARTIN ESTRUN SAULZOIR CAPELLE UTPAS Caudry-Le Cateau SUR ECAILLON ACTION ABANCOURT BANTIGNY THUN VILLERS MONTRECOURT IWUY L'EVEQUE EN CAUCHIES ESCARMAIN BLECOURT THUN HAUSSY Réalisation CUVILLERS SAINT MARTIN ESWARS VERTAIN SANCOURT HAYNECOURT SAINT AUBERT CC du Pays du Solesmois RAMILLIES NAVES RIEUX SAILLY TILLOY ROMERIES SAINT LEZ CAMBRAI LEZ CAMBRAI SAINT-VAAST PYTHON RAILLENCOURT ESCAUDOEUVRES AVESNES-LES- STE OLLE NEUVILLE CAGNONCLES AUBERT SAINT-HILAIRE ST REMY LEZ CAMBRAI BEAURAIN SOLESMES FONTAINE CAUROIR BOUSSIERES NOTRE DAME CARNIERES CAMBRAI MOEUVRES BEVILLERS QUIEVY ANNEUX PROVILLE AWOINGT VIESLY BRIASTRE ESTOURMEL CANTAING CA de Cambrai BETHENCOURT /ESCAUT BOURSIES NOYELLES NIERGNIES BEAUVOIS /ESCAUT CATTENIERES NEUVILLY DOIGNIES RUMILLY FONTAINE AU BEAUMONT FLESQUIERES -

Compte – Rendu De Reunion
COMPTE – RENDU DE REUNION COMPTE – RENDU Réf.Doc CR-PPRI-SELLE : COCON N°4 DE REUNION (30/08/2011) Rédacteurs : W HALBECQ – M. DELBEC DATE DE REUNION : 30/08/2011 LIEU DE REUNION : Solesmes CLIENT : DDTM 59 OBJET DE LA REUNION : Réunion COCON n°4, présentation de la phase n°2 – Etude historique Ordre du jour 1. Présentation de l’analyse historique des crues de la Selle 2. Discussion Présentation M. NICOLLE (DDTM59) ouvre la réunion et rappelle l’état d’avancement de l’étude d’élaboration du PPRI de la Selle. M. HALBECQ (EASYRISQUES) présente sur la base d’un diaporama les principaux enseignements tirés à ce jour sur l’analyse historique des crues et inondations survenues depuis le 18 ème siècle, sur leur typologie et ampleur, et sur les mécanismes de leur formation. M. HALBECQ demande aux communes si elles ont des idées ou besoins particuliers concernant les outils de communication qui seront mis en place à la fin de la prochaine phase à destination du public. M. HALBECQ sollicite les communes pour faire remonter les photographies des crues anciennes (par exemple 1980 et 1939), et précise que la DDT59 lance un concours photo sur tout le département pour maximiser les chances de faire ressurgir ces éléments du passé importants pour la connaissance du risque d’inondation de la Selle. M. HALBECQ rappelle que les communes seront à nouveau contactées notamment dans le cadre de la recherche des informations sur l’évolution des ponts sur la Selle. Discussion M. WALLERAND (président de la communauté de communes du Pays Solesmois) revient sur le propos de W. -

Living with the Enemy in First World War France
i The experience of occupation in the Nord, 1914– 18 ii Cultural History of Modern War Series editors Ana Carden- Coyne, Peter Gatrell, Max Jones, Penny Summerfield and Bertrand Taithe Already published Carol Acton and Jane Potter Working in a World of Hurt: Trauma and Resilience in the Narratives of Medical Personnel in Warzones Julie Anderson War, Disability and Rehabilitation in Britain: Soul of a Nation Lindsey Dodd French Children under the Allied Bombs, 1940– 45: An Oral History Rachel Duffett The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the First World War Peter Gatrell and Lyubov Zhvanko (eds) Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War Christine E. Hallett Containing Trauma: Nursing Work in the First World War Jo Laycock Imagining Armenia: Orientalism, Ambiguity and Intervention Chris Millington From Victory to Vichy: Veterans in Inter- War France Juliette Pattinson Behind Enemy Lines: Gender, Passing and the Special Operations Executive in the Second World War Chris Pearson Mobilizing Nature: the Environmental History of War and Militarization in Modern France Jeffrey S. Reznick Healing the Nation: Soldiers and the Culture of Caregiving in Britain during the Great War Jeffrey S. Reznick John Galsworthy and Disabled Soldiers of the Great War: With an Illustrated Selection of His Writings Michael Roper The Secret Battle: Emotional Survival in the Great War Penny Summerfield and Corinna Peniston- Bird Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in the Second World War Trudi Tate and Kate Kennedy (eds) -
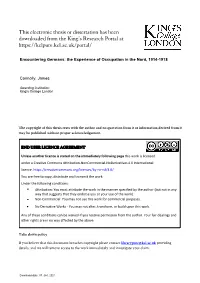
The Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Connolly, James Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Title: Author: James Connolly The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. -

La Monographie De Forest
Département du Nord Arrondissement d’Avesnes Monographie de Forest - 1900 1. Géographie physique 1. Situation astronomique de la commune, longitude, latitude, altitude - sa superficie territoriale - divisions territoriales - hameaux - fermes - lieux dits. La commune de Forest est située à 50° 8’ 30’’ de latitude nord et à 1° 14’ 3’’ de longitude est. L’altitude moyenne est assez élevée ; 143 mètres avant de descendre la cavée de Montay ; 141 mètres devant le Roé ; 136 mètres devant la brasserie de M. Danjou ; 87 mètres au moulin de Richemont. La superficie totale du territoire est de 887 hectares dont 691 hectares en terres labourables, 125 hectares en prés et herbages, 1 hectare en landes et terres incultes, 64 hectares en cultures diverses et 6 hectares en propriétés bâties. Trois hameaux dépendent de Forest : Follemprise était autrefois un hameau important ; il est même appelé seigneurie dans un acte de 1763. Aujourd’hui il ne se compose plus que d’une ferme. Richemont n’a que deux maisons dont un moulin à eau. Dans un acte de 1623, la maison et cense de Richemont est dite appartenir aux dames du Chastel en Cambrésies. La Croisette et Ovillers appartiennent aux communes de Solesmes et de Forest, mais Solesmes en possède la majeure partie. La ferme la plus ancienne est celle de Cantraine : Elle comprenait en 1590, une maison, granges, étables, pré et 40 muids de terres labourables en plus, pièces rendant par an en argent 406 livres tournois. Le tout constituait la seigneurie de Cantraine ; la plupart des bâtiments qui composaient l’ensemble de cette ferme ont été fort négligés pendant ce siècle ; il n’en reste en bon état que le corps d’habitation. -

The March on Paris and the Battle of the Marne, 1914
THE MARCH ON PARIS AND THE BATTLE OF THE MARNE, 1914 Kiililc-K'imit, Konigsberg, filwL ALEXANDER VON KLUCK THE MARCH ON PARIS AND THE BATTLE OF THE MARNE 1914 BY ALEXANDER VON KLUCK WITH PORTRAIT AND MAPS AND rOTES BY THE HISTORICAL SECTION (MILITARY BRANCH) OF THE COMMITTEE OF IMPERIAL DEFENCE LONDON EDWARD ARNOLD 1920 [All rights restrved] D AUTHOR'S PREFACE THE following review of events was completed on the 6th February, 1918. The books which have since been published on the period dealt with, such as Major Bircher's valuable contribution on the Battle of the Marne, that of Field-Marshal French (which appeared " in the summer of 1919), and General Maurice's Forty Days in 1914," have not been taken into account. The temptation to enter into the controversies raised by General Baumgarten-Crusius's work has been avoided, although it undoubtedly contains facts of great import- ance; so also with the books of Field-Marshal von Billow and General von Hausen. Only opinions formed at the time are recorded; those arrived at later have been omitted. These limitations seem most necessary in order that the appreciation of the situation as it appeared to the headquarters of the First Army in 1914 may be recorded, unaffected by other influences. With this in view, the more important orders and documents have been re- produced verbatim in the text. The point of view of the Army Commander as regards the dangers of a crossing of the Marne at the beginning of September, 1914, is set forth in the third part of this review. -

Avis Des Personnes Publiques Associées Sommaire
Schéma de cOhérence territ Oriale Sambre a veSnoiS PROJET ARRÊTÉ EN CONSEIL SYNDICAL DU 22 JUILLET 2013 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES SOMMAIRE 1 • 1- 21 10 13 ScOt avesnes avis etat • 45-délib1 aF amfroipret à Boulogne sur helpe • 2-21 10 13 ScOt avesnes avis etat annexe • 46-délib2 ad Bousies à Floyon • 3-avis région delib sgarifiee ScOt Sambreavesnois • 47-délib2 aF Bousignies sur roc à eccles • 4- 31 10 2013 ScOt avis conseil Général • 48-délib3 ad Frasnoy à hautmont • 5-22 10 2013 ScOt avis cdcea • 49-délib3 aF eclaibes à Fourmies • 6- avis Pnra 1 courrier Scot • 50-délib4 ad hon hergies à locquignol • 7- avis Pnra 2 - note avis ScOt envoi - Pnra • 51-délib4 aF Ghissignies à le Favril • 8- avis Pnra 3 - principes d'urbanisation • 52-délib5 ad maresches à St rémy chaussée • 9-23 10 2013 ScOt avis cci • 53-délib5 aF leval à maubeuge • 10 - réaction 2013 10 17 chambre d'agriculture • 54-délib6 ad St rémy du nord à Villereau • 11-05 11 2013 ScOt avis Pnra • 55-délib6 aF neuf mesnil à Poix du nord • 12-17 10 2013 ScOt avis chambre d'agriculture • 56-délib7 ad Villers Pol à cc mormal maroilles • 13-18 10 2013 ScOt avis conseil régional • 57-délib7 aF Pont sur Sambre à rousies • 14-21 10 13 ScOt avis etat annexe technique • 58-délib8 aF St aubin à taisnieres en thiérache • 15-21 10 13 ScOt avis etat • 59-délib9 aF Vendegies au Bois à Wattignies la Victoire • 16-22 10 2013 ScOt avis cdcea • 60-délib10 aF Wignehies à la capelle • 17-23 10 2013 ScOt avis cci • 61-délib11 aF la Groise à montay • 18-25 10 13 ScOt avis autorité environnementale -

Cambrésis-Sambre Avesnois
Organisation de la Caf du Nord - 2018 - Cambrésis - Sambre Avesnois Le territoire Cambrésis - Sambre Avesnois est constitué de 7 EPCI : les communautés d'agglomération de Cambrai et Maubeuge - Val de Sambre et les communautés de communes du Pays Solesmois, du Pays de Mormal, du Caudrésis et du Catésis, du CC du Pays de Mormal Coeur de l'Avesnois et du Sud Avesnois. CA Maubeuge Val de Sambre Ces 7 EPCI regroupent 267 communes. GUSSIGNIES VILLERS-SIRE-NICOLE HON-HERGIES BETTIGNIES VIEUX-RENG ETH BELLIGNIES BERSILLIES TAISNIERES-SUR-HON CC du Pays Solesmois BRY MAIRIEUX LA FLAMENGRIE JENLAIN ELESMES SAINT-WAAST MARESCHES WARGNIES-LE-PETIT BOUSSOIS BAVAY LA LONGUEVILLE JEUMONT PREUX-AU-SART ASSEVENT VILLERS-POL BERMERIES MAUBEUGE AUDIGNIES SEPMERIES FRASNOY AMFROIPRET RECQUIGNIES ROUSIES ORSINVAL MECQUIGNIES NEUF-MESNIL BOUSIGNIES-SUR-ROC SOMMAING RUESNES GOMMEGNIES OBIES VIEUX-MESNIL LOUVROIL CERFONTAINE COLLERET HARGNIES AUBENCHEUL-AU-BAC HEM-LENGLET BERMERAIN HAUTMONT ESTRUN LE QUESNOY VILLEREAU FRESSIES PAILLENCOURT CAPELLE BOUSSIERES-SUR-SAMBRE FERRIERE-LA-GRANDE SAULZOIR SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON COUSOLRE ABANCOURT IWUY BEAUDIGNIES PONT-SUR-SAMBRE AIBES JOLIMETZ SAINT-REMY-DU-NORD OBRECHIES VILLERS-EN-CAUCHIES GHISSIGNIES BEAUFORT HAUSSY ESCARMAIN SANCOURT THUN-L'EVEQUE DAMOUSIES BERELLES BLECOURT ESWARS LOUVIGNIES-QUESNOY LIMONT-FONTAINE CHOISIES VERTAIN RAUCOURT-AU-BOIS WATTIGNIES-LA-VICTOIRE SOLRINNES HESTRUD HAYNECOURT RAMILLIES SAINT-AUBERT SALESCHES AULNOYE-AYMERIES NAVES ECCLES DIMECHAUX SAILLY-LEZ-CAMBRAI ECLAIBES NEUVILLE-EN-AVESNOIS -

Jeudi 19 Septembre 2019 Visites Guidées En Cambrésis
Merci de ne pas marquer ce message comme SPAM, pour vous désabonner cliquez ici. Pour nous contacter, merci de ne pas répondre à ce message mais d'utiliser [email protected] Pour vous assurer de recevoir nos newsletters, nous vous conseillons d'ajouter [email protected] à votre carnet d'adresse. Sélection des manifestations du Cambrésis - Jeudi 19 septembre 2019 Bonjour, Newsletter Touristique du Cambrésis Ce sont les Journées Européennes du Patrimoine ce week-end : bon nombre d'animations vous sont proposées pour le seul Cambrésis !!! C'est le moment ou jamais de découvrir des endroits exceptionnels riches en histoire ! À la semaine prochaine. Visites guidées en Cambrésis Journées européennes du patrimoine en Cambrésis Pour cette 36ème édition, à travers le thème "Arts et divertissements", diverses animations sont proposées pour faire de chaque visite un moment exceptionnel et permettre aux visiteurs d'accéder, parfois pour la première fois, mais aussi de redécouvrir sous un nouveau jour des lieux qui leur semblaient familiers. Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, de nombreuses communes recensées dans le Cambrésis participent aux Journées Européennes du Patrimoine : Esnes, Cambrai, Caudry, Flesquières, Le Cateau-Cambrésis, Les Rues des Vignes, Villers-Outréaux : autant de lieux à découvrir et à apprécier. Le programme complet est à consulter sur : www.tourisme-cambresis.fr/agenda Attention, certaines visites nécessitent une réservation préalable. N'hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs concernés pour vérifier ! Visites Yog'Art Jeudi 19 septembre, de 10h à 11h, au Musée des Dentelles et Broderies, Place des Mantilles. Accompagné d'une médiatrice culturelle, suivez une séance de yoga parmi les oeuvres du musée. -

Histoire De Mazinghien
HISTOIRE DE MAZINGHIEN L. Baudchon, curé NOTA : eu égard au respect de l’auteur de cette monographie, lors de la transcription de ce manuscrit, j’en ai respecté l’orthographe, mais certains noms propres ou latins, peuvent avoir été mal orthographiés par moi-même. (Le transcripteur Marcel CARPENTIER) 1 Préface La monographie d’un modeste village, tel que Mazinghien, semble de prime abord ne présenter qu’un médiocre intérêt. C’était, avouons-le, notre opinion personnelle avant d’entreprendre ce travail. Mais nous avons eu l’agréable surprise de découvrir de précieux documents qui nous ont fourni la matière d’une étude assez intéressante. C’est en tout cas une œuvre sincère, car notre grande préoccupation a été de faire « de l’histoire » et non « des histoires » ; nous n’avons relaté que les faits reposants sur un témoignage authentique - melius est tacere quam falso proferre - et une œuvre impartiale, notre principal soin ayant été de bannir toute idée préconçue, tout jugement passionné dans l’appréciation des hommes et des choses. C’est aussi, avant tout, une œuvre d’obéissance, entreprise pour répondre au programme tracé par notre archevêque très aimé aux prêtres des paroisses. Nous sommes heureux d’offrir à la paroisse de Mazinghien ce témoignage de notre affectueux dévouement. Puissent nos chères ouailles nous savoir gré devant Dieu d’avoir exhumé, de la poussière des archives où ils étaient ensevelis, un grand nombre de faits qui les intéressent au premier chef, et puissent-elles retirer quelque profit des beaux exemples de fidélité au devoir, de patience courageuse et de résignation chrétienne que leurs ancêtres ont montré au milieu des plus dures épreuves. -

Avis D'ouverture D'enquête Publique Pour Le Plan De
PRÉFET DU NORD Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord Service Sécurité Risques et Crises Tel : 03 28 03 83 00 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA VALLEE DE LA SELLE Article L.562-3 et R.562-8 et 9 du code de l’environnement Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 une enquête publique aura lieu dans chacune des mairies concernées pendant 36 jours, du mardi 10 mai 2016 au mardi 14 juin 2016 inclus, sur le projet du plan de prévention des risques d’inondation par débordement de cours d'eau de la vallée de Selle intéressant les communes suivantes : BAZUEL, BRIASTRE, HAUSSY, HONNECHY, LE CATEAU-CAMBRÉSIS, MONTAY, MONTRECOURT, NEUVILLY, ORS, POMMEREUIL, SAINT-BÉNIN, SAINT-PYTHON, SAINT-SOUPLET, SAULZOIR, SOLESMES, VIESLY (ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI), DENAIN, DOUCHY-LES-MINES, HASPRES, LOURCHES ET NOYELLES- SUR-SELLE (ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES) ET FOREST-EN-CAMBRÉSIS (ARRONDISSEMENT D'AVESNES-SUR-HELPE). Le siège de l’enquête est fixé en mairie de SOLESMES (56 rue de la République, 59730 SOLESMES). La commission d’enquête désignée par décision du E16000009/59 du 02 février 2016 de Madame la Présidente du tribunal administratif de Lille, est composée comme suit : Président : Monsieur Hubert DERIEUX, géomètre-expert, à la retraite. Membres titulaires : Madame Josiane BROUET, clerc de notaire, à la retraite, Monsieur François DEBSKI, gérant d'entreprise, à la retraite. Membres suppléants : Monsieur Christian DELLOUE, animateur -

Résidence Le Trèfle D'argent
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE Résidence Le Trèfle d’Argent LE CATEAU CAMBRÉSIS • 59 Résidence ORPEA 16 rue de Fesmy 59360 LE CATEAU CAMBRESIS Le Trèfle Tél : 03 27 07 18 00 / Fax : 03 27 07 18 01 d’Argent Email : [email protected] Résidence Le Trèfle d’Argent INFORMATIONS ET ACCÈS ACCÈS PAR LA ROUTE TRANSPORTS EN COMMUN Juillet 2018 En provenance de Valenciennes : En train : prendre la D958, suivre Aulnoy lez Valenciennes, Gare TER du Cateau Cambrésis Solesmes, Montay et Le Cateau. • distance Le Cateau - Lille 1H40 En provenance de Cambrai : • distance Le Cateau - Reims 3h40 suivre la N43, direction Charleville Mézières. • distance Le Cateau - Paris 2h40 En provenance de Maubeuge : En bus : suivre la D932, traverser la Longueville, Bavais, Réseau de bus « arc-en-ciel », lignes 301 à 337 Englefontaine, Montay. Notre Résidence est un lieu de vie propice au bien-être des aînés. Etablissement alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité WWW.ORPEA.COM Le Trèfle d’Argent DES PRESTATIONS HOTELIÈRES DE QUALITÉ LE CATEAU CAMBRÉSIS . 59 Notre Résidence a été conçue pour être un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au bien-être de nos aînés. Les chambres individuelles ou pour couple, confortablement meublées - ou non - au choix des résidents, sont toutes équipées d’une salle de bain, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une télévision. Divers services vous sont par ailleurs proposés : UN CADRE DE VIE CHALEUREUX • Entretien du linge de corps (sauf textiles UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE ET CONVIVIAL délicats) et possibilité de pressing extérieur * • Linge de maison fourni.