Varages Essai2.Pub
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux
LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux de regroupement : porte sur un support de poste choisi dans l’ensemble des communes comprises dans le regroupement. Les regroupements de communes correspondent généralement aux circonscriptions des inspecteurs. Regroupement de BRIGNOLES Regroupement de DRAGUIGNAN COTIGNAC BRIGNOLES CABASSE AIGUINES AMPUS SILLANS LA CASCADE LA CELLE CORRENS TOURVES DRAGUIGNAN TRANS EN PROVENCE BAUDUEN SALERNES LES SALLES/VERDON LORGUES MONTFORT S/ARGENS CARCES VILLECROZE AUPS LE THORONET ENTRECASTEAUX REGUSSE ARTIGNOSC/VERDON CAMPS LA SOURCE CABASSE TOURTOUR FLAYOSC ST-ANTONIN DU VAR LE VAL BRAS VINS SUR CARAMY Regroupement de ST RAPHAEL – FREJUS (écoles ventilées sur deux circonscriptions) FREJUS SAINT RAPHAEL Regroupement de CUERS BELGENTIER COLLOBRIERES MEOUNES Regroupement de HYERES LA FARLEDE PIERREFEU du VAR BORMES-LES-MIMOSAS HYERES SOLLIES VILLE CUERS LA LONDE DES MAURES SOLLIES TOUCAS SOLLIES PONT Regroupement de LA SEYNE Regroupement de LA GARDE ( écoles ventilées sur deux circonscriptions ) CARQUEIRANNE LA GARDE LE PRADET LA CRAU LA SEYNE SAINT MANDRIER Regroupement de SIX FOURS SIX-FOURS-LES PLAGES OLLIOULES Regroupement de GAREOULT Regroupement LE MUY BESSE/ISSOLE CARNOULES FLASSANS/ISSOLE LES ARCS LE MUY GAREOULT FORCALQUEIRET LA ROQUEBRUSSANE LES MAYONS LE LUC GONFARON MAZAUGUES SAINTE ANASTASIE TARADEAU VIDAUBAN NEOULES NANS LES PINS SAINT ZACHARIE LE CANNET DES MAURE PIGNANS PLAN D’AUPS ROCBARON PUGET VILLE Regroupement de STE MAXIME Regroupement de ST MAXIMIN CAVALAIRE/MER COGOLIN LA CROIX VALMER -

Commune Var Termite.Xlsx
Infestation Termite Liste des communes répertoriées du Var Communes Type d'arrêté Niveau d'infestation Diagnostic Termite AIGUINES Infestation inconnue NON AMPUS Infestation inconnue NON ARTIGNOSC-SUR-VERDON Infestation inconnue NON ARTIGUES Infestation inconnue NON AUPS Arrêté préfectoral niveau faible OUI BAGNOLS-EN-FORET Infestation inconnue NON BANDOL Arrêté préfectoral niveau faible OUI BARGEME Infestation inconnue NON BARGEMON Infestation inconnue NON BARJOLS Arrêté préfectoral niveau faible OUI BAUDINARD-SUR-VERDON Infestation inconnue NON BAUDUEN Infestation inconnue NON BELGENTIER Arrêté préfectoral Infestation inconnue NON BESSE-SUR-ISSOLE Arrêté préfectoral niveau faible OUI BORMES-LES-MIMOSAS Arrêté préfectoral niveau faible OUI BRAS Infestation inconnue NON BRENON Infestation inconnue OUI BRIGNOLES Arrêté préfectoral niveau faible OUI BRUE-AURIAC Infestation inconnue NON CABASSE Arrêté préfectoral niveau faible OUI CALLAS Infestation inconnue NON CALLIAN Infestation inconnue NON CAMPS-LA-SOURCE Arrêté préfectoral Infestation inconnue NON CARCES Arrêté préfectoral niveau faible OUI CARNOULES Arrêté préfectoral niveau faible OUI Communes Type d'arrêté Niveau d'infestation Diagnostic Termite CARQUEIRANNE Arrêté préfectoral niveau faible OUI CAVALAIRE-SUR-MER Arrêté préfectoral niveau faible OUI CHATEAUDOUBLE Infestation inconnue NON CHATEAUVERT Infestation inconnue NON CHATEAUVIEUX Infestation inconnue NON CLAVIERS Infestation inconnue NON COGOLIN Arrêté préfectoral niveau faible OUI COLLOBRIERES Arrêté préfectoral niveau faible -

PAPI Complet De L'argens Et Des Côtiers De L'estérel
PAPI Complet de l'Argens et des côtiers de l'Estérel Cartographie Syndicat mixte de l'argens| [email protected]| www.syndicatargens.fr| 09.72.45.24.91 PAPI de l'Argens et des côtiers de l'Esterel Programme d'Actions de Prévention des Inondations Carte 2 2016 - 2022 Relief et principaux sous-bassins versants de l'Argens µ Régusse Moissac- Bellevue Montferrat Bargemon La Verdière Ampus Châteaudouble Aups La B La Nartuby r Claviers L es 'E qu a e Varages u Tavernes Tourtour S a Fox-Amphoux La Bresque lé L'Endre e L'Endre Saint-Paul- L'Eau Salée Figanières Callas en-Forêt Villecroze LeR Saint-Martin Sillans-la-Cascade ey Salernes ran et Barjols av Bl Bagnols-en Pontevès Flayosc e La Cassole Draguignan L -Forêt La Florieye Le Reyran L'Argens Source L L Saint-Antonin e a Cotignac La Le Le Blavet C F N La Motte Brue-Auriac -du-Var lo R a a ri é r Entrecasteaux è t G s y a u Seillons-Source e l Trans-en b s y r a -d'Argens o -Provence n Ollières l e Châteauvert Puget-sur d Le Real e La L'Argens Amont Lorgues -Argens La Meyronne GGrande Montfort- Le Muy a Correns Garoronne sur-Argens L'Argens Moyenne n Carcès n Côtiers Taradeau L'Argens Aval e Bras L'A Le Thoronet rg Les Arcs Saint- en s Raphaël Saint-Maximin Roquebrune- -la-Sainte-Baume La Ribeirotte sur-Argens Fréjus Le Val Vins-sur-Caramy Cabasse Le C o u n l l o Le o e r u n Le Cauron u r a Tourves Vidauban Couloubrier b u C r Le Fournel Brignoles i o e e F r Le L Le Caramy Le Cannet- lle Le Luc des-Maures Ai La Celle Le Caramy Flassans L' Nans- Camps- Rougiers -sur-Issole les-Pins -

Annexes Projet Éolien D'artigues Et D'ollières (Var
Annexes Projet éolien d’Artigues et d’Ollières (Var - 83) Défrichement aux lieux-dits « Carraire Ouest » et « Carraire Est » Annexes Liste des annexes : ANNEXE N° 1 : ANNEXE PAYSAGERE ......................................................................................................................................... 434 ANNEXE N° 2 : FICHE ZNIEFF ..................................................................................................................................................... 438 ANNEXE N° 3 : LISTE DE TOUTES LES ESPECES DE FLORE OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE LOCAL ............................................. 517 ANNEXE N° 4 : ESPECES PRESENTES SUR LES COMMUNES D’ARTIGUES ET OLLIERES D’APRES FAUNE PACA ........................... 520 ANNEXE N° 5 : ENSEMBLE DES ESPECES D’OISEAUX CONTACTEES SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE ................................... 520 ANNEXE N° 6 : LISTE DE TOUTES LES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE LOCAL (A GENCE VISU 2015) ........... 521 ANNEXE N° 7 : DE L’IMPACT GENERIQUE DES EOLIENNES SUR LES OISEAUX : APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE DU RISQUE DE COLLISION ........................................................................................................................................................................ 523 ANNEXE N° 8: ANALYSE DES SENSIBILITES DES OISEAUX AU RISQUE DE COLLISION ................................................................. 525 ANNEXE N° 9 : EXEMPLE D’UN SYSTEME DE DETECTION – SAFEWIND .................................................................................... -

La Voix Aurélienne
POURCIEUX Bulletin municipal N°56 La voix aurélienne SOMMAIRE Page 1 Clair-obscur au Parc. Page 2 Adieu Marc Brèves de conseil Page 3 Le mot du maire Pages 4 et 5 Travaux et rénovations La crèche sort de terre Renforcement du réseau d’eau Appel au civisme Page 6 et 7 Vie scolaire et municipale Rythmes scolaires Commémoration du 8 mai Un facteur guichetier Vide grenier CCFF Page 8 Agenda municipal Fa si la chanter La fête au village Etat Civil Mairie de POURCIEUX rue de l’Eglise 83470 POURCIEUX tel : 04 94 78 02 05 fax : 04 94 59 73 73 [email protected] www.pourcieux.fr ETE 2014 vie municipale Brèves de conseil Adieu Marc 22avril 2014 (budgets) Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2013 de la commune. Section de Fonctionnement : Dépenses réalisées : 1 059 207,07 € Recettes réalisées 1 077 998,04 € Excédent : 18 790,97 € Section d’Investissement : Dépenses réalisées : 247 651,56 € Recettes réalisées : 296 981,03 € Excédent : 49 329,47 € Résultat global de clôture : 68 120,44 € Reste à réaliser Investissement : Dépenses : 34 613,67 € Recettes : 16 700,00 € Résultat cumulé : Excédent : 50 206,77 € Monsieur le Maire se retire de la séance et donne la Marc COLONA a été adjoint présidence à Monsieur Claude PORZIO. Ce dernier au maire de 1983 à 1989, demande au Conseil Municipal s’il y a des remarques et puis conseiller municipal de procède au vote du Compte Administratif 2013. 1989 à 1995. Il est décédé le 15 mars dernier des suites Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve d’une longue maladie. -

Provence D'argens En Verdon
La Provence Verte appartient au réseau national Renseignements Villes et Pays d’art et d’histoire des Villes et Pays d’art et d’histoire Maison du Tourisme de la Provence Verte Le ministère de la Culture et de la Communication, direction Carrefour de l’Europe – 83170 Brignoles Le pays de la Provence Verte de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville Tél. : 04 94 72 04 21 et Pays d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent Site internet : www.provenceverte.fr leur patrimoine. Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et des guides conférenciers, Communauté de communes Provence d’Argens en Verdon Située dans le département du Var, la communauté de communes et la qualité de leurs actions. Provence d’Argens en Verdon est formée depuis le 27 décembre 2001. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et Elle compte 11 000 habitants sur neuf communes : Barjols, Bras, pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, Brue-Auriac, Esparron-de-Pallières, Pontevès, Saint-Martin-de- un réseau de 124 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute Pallières, Seillons Source d’Argens, Tavernes et Varages. la France. 58 avenue de Tavernes – 83670 Barjols Le service animation du patrimoine Tél. : 04 94 77 18 53 Il propose toute l’année des animations pour les habitants, visiteurs Site internet : www.cc-pav.fr et scolaires. À proximité Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles et le Pays du Comtat Venaissin bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire. -

Mag N°5 - a UTÉ DE CO MMUNES PROVENCE VERDON
PROVENCE VERDON L E MA GAZI NE DE 2019 LA CO AOÛT MMUN mag N°5 - A UTÉ DE CO MMUNES PROVENCE VERDON 2014 - 2019 6 ANNÉES D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES AU SERVICE DE CHAQUE HABITANT Saint-Julien Artigues Barjols Brue-Auriac Esparron de Pallières Fox-Amphoux Ginasservis La Verdière Montmeyan Pontevès Rians Saint Julien le Montagnier Saint Martin de Pallières Seillons Source d’Argens Tavernes Varages www.provenceverdon.fr 2 ÉDITO Communauté de communes Provence Verdon 2014-2019 Œuvre collective 3/7 VOUS SERVIR Nouvelles compétences Voilà 18 ans maintenant que ce territoire du haut Var a commencé à se construire Nouvelle intercommunalité un nouveau destin partagé, en donnant naissance à la Communauté de communes. Services au public Dix-huit ans, c’est l’âge mature où la croissance et l’apprentissage se stabilisent et ouvrent la voie à la valorisation et au « plein rendement » de l’organisation mise en place. 8/10 AMÉNAGER À ceux qui s’interrogent encore sur l’intérêt d’une telle structure, il faut juste expliquer que sans la Communauté de communes nos enfants n’auraient certainement pas 6 Aménagement du territoire Rénover l'habitat crèches pour les accueillir, établissements que les communes n’ont plus les moyens Haut débit - Numérique ni de créer, ni de financer seules. Il n’y aurait probablement pas deux maisons de services au public à Rians et à Barjols, mises à disposition de ses 23 000 habitants. Sans la communauté, plus de travaux lourds d’aménagement de nos forêts et de prévention contre les incendies. C’est elle également qui a permis d’offrir aux 12/15 ENTREPRENDRE communes des services mutualisés tels que l’instruction des actes d’urbanisme Soutenir l'économie ou le suivi des installations d’assainissement ; de même en matière de valorisation Nouvelle ère pour l'agriculture touristique et culturelle, les circuits de randonnée aménagés et les cheminements patrimoniaux si unanimement appréciés dans chacun de nos villages n’auraient jamais été conçus. -

Centre Médico-Psychologique Pour Enfants Et Adolescents, CATTP
En pratique Plans d’accès Centre Le CMP Enfants et Adolescents de St Maximin Médico-Psychologique fait partie de l’organisation du service public pour Enfants et sectorisé de psychiatrie. Il reçoit les patients de Adolescents, la zone Nord-Ouest du Var CATTP, Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin Hôpital de jour de Pierrefeu du Var. l’Oasis, Equipe Mobile Nord CMP/HDJ Les soins dispensés au CMP Adresse : 105 Chemin du Chevalier sont financés directement et en Secteurs géographiques : 83470 SAINT-MAXIMIN LA STE-BAUME totalité par la Sécurité sociale. Artigues, Barjols, Bras, Brue Auriac, Chateauvert, Horaire d’ouverture : Vous n'aurez donc pas à faire Esparron, Fox Amphoux, Ginasservis, La Roquebrussanne, La Verdière, Mazaugues, du Lundi au Vendredi l'avance des frais. Montmeyan, Nans les Pins, Ollieres, Plan d’aups, de 9h à 16h48 Ponteves, Pourcieux, Pourrières, Rians, Seillons, St Julien, St Martin, St Maximin, St Zacharie, Tavernes, CMP et CATTP : 04.94.59.98.03 Tourves, Varages, Vinon sur Verdon Hôpital de jour : 04.94.59.21.41 Equipe Mobile : 04.94.37.22.29 Fax : 04.94.59.96.24 Email : [email protected] Présentation Consultations Composition au CMP des équipes Le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents de St Maximin est une unité d’accueil et Sur rendez-vous au : de consultation qui propose une prise en charge pluri- Composition des équipes 04.94.59.98.03 disciplinaire . Composition des équipes Notre équipe organise des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à Premier rendez-vous au CMP > Chef de pôle : domicile. -
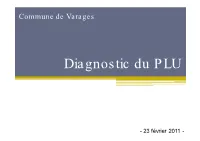
Diagnostic Du PLU
Commune de Varages Diagnostic du PLU - 23 février 2011 - Ière partie Données de cadrage Localisation Varages se situe dans le Nord- est du Var Elle s’inscrit dans le « Pays de la Provence Verte » (130 400ha) recouvrant : - 4 communautés de communes - 39 communes Elle appartient à la Communauté de communes « Provence Argens en Verdon » qui compte : - 11 communes - sur un territoire de 37 180 ha Structure de la commune 3521 ha 1085 habitants La Verdière Le centre villageois se situe sur une falaise de tufs dominant le « Ruisseau de Varages » Tavernes L’espace agricole est diffus St Martin L’ambiance dominante est collinaire et boisée Barjols Paysage* La commune de Varages appartient aux entités paysagères « Centre Var » et « Haut-Var » 5 unités remarquables identifiées: - la ripisylve - les grands domaines des secteurs orientaux - le plateau karstique au Nord-est -les coteaux agricoles de la dépression triasique - les secteurs urbanisés en périphérie du village * Source : Description des grandesunités remarquablessurlacommune deVarages – juin 2002 – BEGEAT et MJ Conseils Paysage* La structure villageoise correspond à celles des villages perchés du « Centre Var » Le paysage est modelé par les écoulements d’eaux issus du plateau de la Blaque et de la Verdière L’eau, omniprésente, est maîtrisée (canaux et industrie des faïences) Vue sur le village (Source : Frédéric D.) Vue sur le village (Source : BEGEAT) *Source : Atlas paysagerdela DIREN Bref historique Le quartier « Baou » témoigne de l’occupation médiévale par un bâti dense et compact. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code
Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Aiglun 04 04001 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Riez Allemagne-en-Provence 04 04004 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Saint-André-les-Alpes Allons 04 04005 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Saint-André-les-Alpes Allos 04 04006 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Saint-André-les-Alpes Angles 04 04007 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Puget-Théniers Annot 04 04008 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Archail 04 04009 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Forcalquier Aubenas-les-Alpes 04 04012 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Sisteron Aubignosc 04 04013 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Sisteron Authon 04 04016 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Auzet 04 04017 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Forcalquier Banon 04 04018 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Barcelonnette Barcelonnette 04 04019 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Barles 04 04020 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Barras 04 04021 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Saint-André-les-Alpes Barrême 04 04022 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Sisteron Bayons 04 04023 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Beaujeu 04 04024 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Saint-André-les-Alpes Beauvezer 04 04025 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Gap Bellaffaire 04 04026 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Sisteron Bevons 04 04027 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Digne-les-Bains Beynes 04 04028 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Castellane Blieux 04 04030 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Riez Bras-d'Asse 04 04031 Provence-Alpes-Côte-d'Azur Puget-Théniers Braux 04 04032 Provence-Alpes-Côte-d'Azur -

Pdf D’Éligibilité Des Dépenses Matérielles Du Projet
7.6.2_Noticedemande2021_v1 Volet « équipements pastoraux collectifs » Décembre 2020 NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES POTENTIELS DU DISPOSITIF 7.6.2 « AIDE AUX EQUIPEMENTS PASTORAUX COLLECTIFS ET AUX ETUDES PASTORALES » DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2014-2020 VOLET « EQUIPEMENTS PASTORAUX COLLECTIFS » Cette notice accompagne le formulaire de demande d’aide vous permettant de soumettre une demande de subvention au titre du dispositif du PDR Provence-Alpes-Côte d'Azur ci-dessus en réponse à l’Appel à Projets (AAP) en cours de validité (http://europe.maregionsud.fr/actualites/appels-en-cours/) Pour tout besoin d’assistance technique en lien avec cette notice, merci de vous rapprocher du Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) du Dispositif concerné, à savoir la DDT(M) du département du siège de votre activité, dont la liste des personnes à contacter est disponible à l’adresse suivante : http://europe.maregionsud.fr/outils-pratiques/des-equipes-a-votre-service/ ATTENTION : Tout dossier déposé après la date limite de dépôt sera déclaré irrecevable. Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part des financeurs publics de l’attribution d’une subvention. 1 7.6.2_Noticedemande2021_v1 Volet « équipements pastoraux collectifs » Décembre 2020 1. PRECISIONS SUR LE FORMULAIRE A COMPLETER version en cours de validité est disponible à l’adresse suivante 1.1 Destinataire de la demande d’aide : http://europe.maregionsud.fr/actualites/appels- Dûment complété, vous devez envoyer avant la en-cours/) ou auprès de votre GUSI. date limite : Rappel sur l’éligibilité temporelle de votre - un exemplaire original signé en format papier, projet : accompagné des pièces justificatives, par La date de dépôt de votre 1ère demande de courrier à l’adresse postale de votre GUSI (ou l’y subvention auprès de votre GUSI, mentionnée déposer en mains propres). -

VARAGES Et BARJOLS Compte-Rendu Par Michèle Lambinet, Mise En Page Et Illustration De Christian Lambinet
Société Hyéroise d'Histoire et d'Archéologie Dos siers de la Shha Conférences de la Shha Sorties de la Shha Sortie du samedi 24 mars 2007 VARAGES et BARJOLS Compte-rendu par Michèle Lambinet, mise en page et illustration de Christian Lambinet VARAGES Présentation du village : Varages est un village du Haut Var bâti sur une barrière de tuf créé par un dépôt millénaire de calcaire provenant d’une source abondante : "la Foux". Dès la préhistoire, les conditions naturelles ont permis l’implantation humaine sur le site (ossuaires chasséens retrouvés dans la grotte de la Ferrage). Au moyen âge, il fut successivement seigneurie des Pontevès, Vintimille, Castellane, Forbin…De cette période il reste aujourd’hui quelques bâtiments comme la chapelle Saint Photin. Ce saint est le patron du village et tous les ans à la fin du printemps il est célébré pendant une semaine. Au mois de mars l’huile nouvelle est, elle aussi, célébrée lors d’une journée festive. Au XVI ème siècle Varages était déjà célèbre pour son huile d’olive et ses poteries. Grâce à la présence de l’eau, du bois, de la terre et du soleil, de nombreux métiers se sont développés (la papeterie par exemple). Vers 1695 Etienne Armand et Joseph Clerissy sont les premiers maîtres-faïenciers du Var. C’est au XVIII ème siècle que l’industrie faïencière se développe pleinement. En 1789 on comptait : 8 faïenceries, 5 moulins à vernir et de nombreuses poteries. La mode de la porcelaine et la concurrence d’autres pays ont obligé Varages à s’adapter. Aujourd’hui, après trois siècles sans interruption de l’activité, les faïences de Varages sont toujours présentes, mais les temps sont de plus en plus difficiles.