Malte Début 12/05/06 11:29 Page 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gazzetta Tal-Gvern Ta' Malta
Nru./No. 20,452 Prezz/Price €4.14 Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta The Malta Government Gazette Il-Ġimgħa, 31 ta’ Lulju, 2020 Pubblikata b’Awtorità Friday, 31st July, 2020 Published by Authority SOMMARJU — SUMMARY Notifikazzjonijiet tal-Gvern ............................................................................................. 6525 - 6544 Government Notices ......................................................................................................... 6525 - 6544 Avviżi tal-Pulizija ............................................................................................................ 6544 - 6548 Police Notices .................................................................................................................. 6544 - 6548 Avviżi lill-Baħħara ........................................................................................................... 6548 - 6549 Notices to Mariners .......................................................................................................... 6548 - 6549 Opportunitajiet ta’ Impieg ................................................................................................ 6550 - 6574 Employment Opportunities .............................................................................................. 6550 - 6574 Avviżi tal-Gvern ............................................................................................................... 6574 - 6590 Notices ............................................................................................................................. -

Bibliography
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/41440 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Said-Zammit, G.A. Title: The development of domestic space in the Maltese Islands from the Late Middle Ages to the second half of the Twentieth Century Issue Date: 2016-06-30 BIBLIOGRAPHY Aalen F.H.A. 1984, ‘Vernacular Buildings in Cephalonia, Ionian Islands’, Journal of Cultural Geography 4/2, 56-72. Abela G.F. 1647, Della descrittione di Malta. Malta, Paolo Bonacota. Abela J. 1997, Marsaxlokk a hundred Years Ago: On the Occasion of the Erection of Marsaxlokk as an Independent Parish. Malta, Kumitat Festi Ċentinarji. Abela J. 1999, Marsaskala, Wied il-Għajn. Malta, Marsascala Local Council. Abela J. 2006, The Parish of Żejtun Through the Ages. Malta, Wirt iż-Żejtun. Abhijit P. 2011, ‘Axial Analysis: A Syntactic Approach to Movement Network Modeling’, Institute of Town Planners India Journal 8/1, 29-40. Abler R., Adams J. and Gould P. 1971, Spatial Organization. New Jersey, Prentice- Hall. Abrams P. and Wrigley E.A. (eds.) 1978, Towns in Societies: Essays in Economic History and Historical Sociology. Cambridge, Cambridge University Press. Abulafia D. 1981, ‘Southern Italy and the Florentine Economy, 1265-1370’, The Economic History Review 34/3, 377-88. Abulafia D. 1983, ‘The Crown and the Economy under Roger II and His Successors’, Dumbarton Oaks Papers 37, 1-14. Abulafia D. 1986, ‘The Merchants of Messina: Levant Trade and Domestic Economy’, Papers of the British School at Rome 54, 196-212. Abulafia D. 2007, ‘The Last Muslims in Italy’, Annual Report of the Dante Society 125, 271-87. -

Anatomies of Spanish Settlers in Malta Between 1580 and 1648: Their Family Stories Simon Mercieca [email protected]
Anatomies of Spanish Settlers in Malta between 1580 and 1648: Their Family Stories Simon Mercieca [email protected] Abstract: This paper will attempt to reconstruct the different identity kits of Spanish settlers in Malta between 1580 and 1648. The analysis shall use the Status Liberi documentation which is a series of Ecclesiastical Acts recording the assessment of foreigners by an ecclesiastical judge of those outsiders who wished to get married in Malta. This procedure was undertaken to verify whether the candidate was single or not, the former being and remains a sine qua non for marriage. The surviving documents recount the lives of these settlers before taking up permanent residence in Malta and highlight the reason behind their decision to settle down in Malta. The most fascinating aspect of these documents is that these stories are recounted by the protagonists themselves. They give insight to issues of identity and shared memory among the Spanish settlers. In the majority, they were simple folk without any pretensions or extraordinary expectations. Were it not for such a prerequisite their life histories would have been lost forever. Keywords: Malta, Spaniards, Status Liberi, marriage, seafaring, identity The Research Methodology n the following analysis I will attempt the reconstruction of what one might term to have been a ‘Spanish’ identity in Malta at a time Iwhen Europe was passing through widespread political turmoil as a result of the Wars of Religion. My historical-critical interpretation of this past migratory experience will be based on the patchy survival of court Symposia Melitensia Number 11 (2015) SYMPOSIA MELITENSIA NUMBER 11 (2015) records. -

The Largely Unsung History of Malta's Bells
14 Baroque Routes - 2014 / 15 The Largely Unsung History of Malta’s Bells By Noel Grima It was a lecture but then it was also an object fixed beam and are rung by moving the clapper lesson. as is typical in southern Sicily from where the tradition seems to have curiously derived. As the audience settled down to listen to the lecture on the bells of Malta in the hall that The more prevalent type of ringing in western forms part of the Birkirkara Collegiate Church, Europe is the swinging method which means the sonorous Birkirkara bells on top of us the bell is fixed to a beam which rotates on its began to solemnly peal the traditional ‘Mota tal- axle thus the actual bell is swung on its fittings Hamis’ which can be heard at around 7pm on hitting its clapper freely to produce a particular Thursdays in the mostly traditionalist parishes, sound effect. Malta can only boast of four along with the tolling of bells at three pm on swinging bells one of which is ironically the Fridays to commemorate the Last Supper and largest bell in Malta. Another three are to be the death of Christ respectively. found on Gozo. The International Institute for Baroque Studies The oldest bell in Malta was cast in Venice at the University of Malta held a public lecture in 1370 and until a few years ago it was still on ‘Maltese Bells and Bell Ringing in the in service at Mdina Cathedral. The bell was Baroque Age’ delivered by Kenneth Cauchi. -
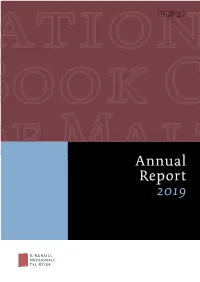
Annual Report 2019
i Annual Report 2019 Annual Report 2019 Annual Report 2019 Contents 2 3 Annual Report The Chairman’s Message 5 First published in 2020 by the National Book Council of Malta The National Writers’ Congress 8 2019 Central Public Library, Prof. J. Mangion Str., Floriana FRN 1800 The National Book Prize 10 ktieb.org.mt The Malta Book Festival 14 Printing: Gutenberg Press Foreign Work & Literary Exports 18 Design: Steven Scicluna Copyright text © Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb The Campus Book Festival 22 Copyright photos © Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb The Malta Book Fund 24 ISBN: 978-99957-939-1-3: Annual Report 2019 (Digital format) Audiovisual Productions 26 Other Contests 28 All rights reserved by the National Book Council This book is being disseminated free of charge and cannot be sold. It may be Other Initiatives 30 borrowed, donated and reproduced in part. It may not be reproduced, in whole or in part, in any form or by any means, without prior permission from the Financial Report 32 National Book Council. ISBN & ISMN 36 Public Lending Rights Payments 68 About the National Book Council The Chairman’s message 4 The National Book Council is a public entity Staff and contact details 2019 was an eventful and challenging year in is progressing very well thanks to sustained 5 that caters for the Maltese book industry which the Council kept growing, receiving as public funding support. Admittedly, I had Annual Report with several important services for authors Executive Chairman much as an 80 per cent increase in its public strong qualms about some decisions made by and publishers whilst striving to encourage Mark Camilleri reading and promote the book as a medium of funding for its recurrent expenditure over newly-appointed bureaucrats in the finance Deputy Chairman communication in all its formats. -

The Gozo Observer Printing: the Journal of the University of Malta - Gozo Campus
Contents Page Editorial: 2 Religious Art in Gozo (1500-1900): A Study on Patronage Patterns 3 Paul Muscat Alfons Maria Hili - A Gozitan Patriot 14 Geoffrey G. Attard The Gozo Airfield - Eisenhower’s Recollections 16 Roderick Pace A Pictorial Archive Waiting to be Discovered 19 Aaron Attard Hili Gozo During the Second World War - A Glimpse 24 Charles Bezzina Enhancing the Gran Castello’s Unique Selling Proposition 29 Godwin Vella Maltese for Counterscarp 34 Joseph Bezzina Recent Activities at the University of Malta - Gozo Campus 35 Joseph Calleja The Gozo Observer Printing: The Journal of the University of Malta - Gozo Campus. Portelli Print - Nadur, Gozo Published two times a year. Tel: (356) 21558232 Editorial Board: © University of Malta - Gozo Campus and individual Prof. Lino Briguglio, Mr Joseph Calleja, contributors, 2007 Prof. Maurice N. Cauchi, Ms Caroline Camilleri Rolls The views expressed in The Gozo Observer are not necessarily Editorial Office: those of the Board of the University of Malta - Gozo Campus or of the University of Malta University of Malta (Gozo Campus), Mġarr Road, Xewkija, XWK 1311, Gozo The Gozo Observer is distributed without charge, upon request, Tel: (356) 21564559; Fax: (356) 21564550; to interested readers. e-mail: [email protected] Web: www.um.edu.mt/ugc Front Cover Photo: Courtesy of Joseph Calleja. THE GOZO OBSERVER (No.21) - December 2009 1 Editorial: Unemployment and Tourism in Gozo The double-deficit that Gozo suffers from being a small in Malta itself, with highest unemployment being in island dependent on a bigger sister island has long been Cospicua (4.7%) and lowest in Lija (0.7%). -

Catania E La Valletta Nelle Planimetrie Ottocentesche Di Sebastiano Ittar
The city of Valletta in an eighteenth century map realized by Sebastiano Ittar. Giannantonio Scaglione Facolta' di lettere e filosofia, Universita' di Catania In this paper a virtually unknown cartographic representation will be analyzed: the planimetry of Valletta, which was realized in the late eighteenth century by the architect Sebastiano Ittar. Through the analysis of this map, the paper aims at reconstructing not only the cartographic techniques but also the representation and interpretation of the urban area: the map may serve to reconstruct the knowhow of a late eighteenth - early nineteenth century professional cartographer and the complex relationships between space and urban society. To date very little research activity about the architect and his works has been conducted1; the planimetry of Valletta, however, has been the subject of short essays by Albert Ganado2 and Giuseppe Dato3. Sebastiano Ittar was born in Catania in 1768. He was the son of Stefano Ittar4, an architect operating in Sicily and, since the second half of the 1700’s, in Malta where in 1783 the Grand Master of the Order of St. John of Jerusalem commissioned him to construct the new Library of Valletta5. After his father’s death (Jan 8th 1790), Sebastiano continued to attend to the construction of the new Library6 up to its conclusion, as it emerges from payment notes from April of the same year up to 1795. After June 1798, when Malta was invaded by Napoleonic troops heading to Egypt, Sebastiano and his father’s family were still on the island, but he soon fled to escape from the unrest and went to Rome where he studied architecture. -

The City-Fortress of Valletta in the Baroque Age
8 Baroque Routes - December 2013 The city-fortress of Valletta in the Baroque age Denis De Lucca The Baroque age is generally considered et Supellectillis Ecclesiasticae formulated to have begun in the last third of the at the Council of Trent. It was also by no sixteenth century and to have ended in the accident that the building of the magnificent mid-eighteenth, covering the period of time city-fortress of Valletta, the new abode of the between the Italian Renaissance (and its Knights “facing Jerusalem,” was undertaken Mannerist sequel) and Neo-classicism. In just after the Great Siege of 1565 to create Europe, the Baroque architectural expression a heavily fortified focal point overlooking was an integral component of an aristocratic the Grande Porto di Malta, which contained culture incorporating art and architecture, the precious war galleys and arsenal of the religious and philosophical attitudes, political, ‘Religion of Malta’.According to the astrolabe military and social structures, geographical of a mathematician from Siracusa called and scientific discoveries, literary Giovanni Antonio Inferrera, the foundation achievements and ceremonial and theatrical stone of the new city-fortress of Valletta had displays. Towards the end of the sixteenth been ceremoniously laid by Grand Master century these different aspects of human Jean de la Valette (1557-1568)1at forty-two endevour started interacting together to form minutes to noon on 28 March 1566. This the basis of a new Baroque lifestyle historic event had been held at the end of This happened at a time when Catholic a long ceremony that had seen de Valette Europe was vigorously reacting to the and his retinue of Hospitaller dignitaries Protestant reformation and to the threat of leaving Birgu and advancing in a truly Muslim infiltration posed by the Sultans of the Baroque procession to the site of the present Ottoman Empire, which reached its maximum church of Our Lady of Victories where, it is expansion in 1606. -

NEWSLETTER 234 September 2018
MALTESE E-NEWSLETTER 234 September 2018 DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI DEPARTMENT OF INFORMATION MALTA 1 MALTESE E-NEWSLETTER 234 September 2018 PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE SPEAKER Speaker Farrugia receives French Ambassador on a farewell visit Speaker of the House of Representatives Dr Anġlu Farrugia received a farewell visit by Ambassador of the French Republic, Ms Béatrice le Fraper du Hellen, whose term of office in Malta is coming to an end. Speaker Farrugia expressed his appreciation to Ambassador Le Fraper du Hellen for her diligent and hard work, during her tour of duty in Malta, which resulted in intensifying the very strong bilateral relations that exist between Malta and France. He also thanked the French authorities for showing solidarity in practice by taking a number of migrants who were brought to Malta on board the ships Aquarius and Lifeline. The two dignitaries referred to the Maltese community in France and Malta’s request to have observer status in the Organisation International de la Francophonie. They also discussed issues of mutual interest such as the situation in Europe vis-à-vis migrants, in Libya and Syria as well as the effect of fake news. Cooperation at Parliamentary level, with particular reference to the Parliamentary Friendship Group, also featured in the discussion. 3, CASTILLE PLACE, VALLETTA VLT 2000 Tel +(356) 2200 1700 Fax +(356) 2200 1775 www.doi.gov.mt Scott Morrison THE NEW PRIME MINISTER OF AUSTRALIA Scott Morrison has been sworn in as the country's 30th PM, after beating Peter Dutton in a vote 45-40. Josh Frydenberg has also been sworn in as Liberal deputy leader The leadership ballot was called after former prime minister Malcolm Turnbull agreed to the second leadership spill this week. -

January - March 2021
January - March 2021 JANUARY - MARCH 2010 Journal of Franciscan Culture Issued by the Franciscan Friars (OFM Malta) 135 Editorial EDITORIAL THE DEMOCRATIC DIMENSION OF AUTHORITY The Catholic Church is considered to be a kind of theocratic monarchy by the mass media. There is no such thing as a democratically elected government in the Church. On the universal level the Church is governed by the Pope. As a political figure the Pope is the head of state of the Vatican City, which functions as a mini-state with all the complexities of government Quarterly journal of and diplomatic bureaucracy, with the Secretariat of State, Franciscan culture published since April 1986. Congregations, Offices and the esteemed service of its diplomatic corps made up of Apostolic Nuncios in so many countries. On Layout: the local level the Church is governed by the Bishop and all the John Abela ofm Computer Setting: government structures of a Diocese. There is, of course, place for Raymond Camilleri ofm consultation and elections within the ecclesiastical structure, but the ultimate decisions rest with the men at the top. The same can Available at: be said of religious Orders, having their international, national http://www.i-tau.com and local organs of government. The Franciscan Order is also structured in this way, with the minister general, the ministers All original material is Copyright © TAU Franciscan provincial, custodes and local guardians and superiors. Communications 2021 Indeed, Saint Francis envisaged a kind of fraternity based on mutual co-responsibility. He did not accept the title of abbot or prior for the superiors of the Order, but wanted them to be “ministers and servants” of the brotherhood. -

National Museums in Malta Romina Delia
Building National Museums in Europe 1750-2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Peter Aronsson & Gabriella Elgenius (eds) EuNaMus Report No 1. Published by Linköping University Electronic Press: http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=064 © The Author. National Museums in Malta Romina Delia Summary In 1903, the British Governor of Malta appointed a committee with the purpose of establishing a National Museum in the capital. The first National Museum, called the Valletta Museum, was inaugurated on the 24th of May 1905. Malta gained independence from the British in 1964 and became a Republic in 1974. The urge to display the island’s history, identity and its wealth of material cultural heritage was strongly felt and from the 1970s onwards several other Museums opened their doors to the public. This paper goes through the history of National Museums in Malta, from the earliest known collections open to the public in the seventeenth century, up until today. Various personalities over the years contributed to the setting up of National Museums and these will be highlighted later on in this paper. Their enlightened curatorship contributed significantly towards the island’s search for its identity. Different landmarks in Malta’s historical timeline, especially the turbulent and confrontational political history that has marked Malta’s colonial experience, have also been highlighted. The suppression of all forms of civil government after 1811 had led to a gradual growth of two opposing political factions, involving a Nationalist and an Imperialist party. -

Disegni Di Progetto Per La Chiesa Di Santa Maria Di Porto Salvo a La Valletta
81 DISEGNI DI PROGETTO PER LA CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTO SALVO A LA VALLETTA. UN’IPOTESI ATTRIBUTIVA Armando Antista Dottorando, Università degli Studi di Palermo [email protected] Abstract Architectural drawings for the church of Santa Maria di Porto Salvo in La Valletta. An attributive hypothesis The drawings related to the Church of Santa Maria di Porto Salvo, preserved in the Archives of the Dominican Convent of Val- letta represent two alternatives for the facade of the church built in the early XIXth century. The high graphic qualities of the drawings and the compositive characteristics could be indicative of the work of a foreing architect, linked with the sicilian late- baroque architectural debate. The attribution to Stefano Ittar, who arrived in Malta in 1784 and worked for the Order of Saint John for the rest of his life, seems to be the most conceivable due to the similarities between the drawings and his previous Si- cilian projects, like the church of San Placido in Catania. Keywords Stefano Ittar, late-baroque architecture, ecclesiastical facade, Malta XVIIIth century, architectural drawing. L’archivio del convento domenicano de La Valletta custodisce tre disegni di progetto della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo annessa al complesso [fig. 1]. Il rinvenimento dei grafici spinge a riconsiderare le consolidate posizioni della storiografia sulla pater- nità del progetto della chiesa, costruita a partire dal 1804 sotto la direzione del capomastro maltese Antonio Cachia, univocamente ritenuto anche il pro- gettista. I disegni consistono in due versioni alterna- tive per la facciata [figg. 2-3] e una sezione longitudi- nale [fig.