Nouvelle-Calédonie • 12 •
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Their Botany, Essential Oils and Uses 6.86 MB
MELALEUCAS THEIR BOTANY, ESSENTIAL OILS AND USES Joseph J. Brophy, Lyndley A. Craven and John C. Doran MELALEUCAS THEIR BOTANY, ESSENTIAL OILS AND USES Joseph J. Brophy School of Chemistry, University of New South Wales Lyndley A. Craven Australian National Herbarium, CSIRO Plant Industry John C. Doran Australian Tree Seed Centre, CSIRO Plant Industry 2013 The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) was established in June 1982 by an Act of the Australian Parliament. ACIAR operates as part of Australia's international development cooperation program, with a mission to achieve more productive and sustainable agricultural systems, for the benefit of developing countries and Australia. It commissions collaborative research between Australian and developing-country researchers in areas where Australia has special research competence. It also administers Australia's contribution to the International Agricultural Research Centres. Where trade names are used this constitutes neither endorsement of nor discrimination against any product by ACIAR. ACIAR MONOGRAPH SERIES This series contains the results of original research supported by ACIAR, or material deemed relevant to ACIAR’s research and development objectives. The series is distributed internationally, with an emphasis on developing countries. © Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) 2013 This work is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without prior written permission from ACIAR, GPO Box 1571, Canberra ACT 2601, Australia, [email protected] Brophy J.J., Craven L.A. and Doran J.C. 2013. Melaleucas: their botany, essential oils and uses. ACIAR Monograph No. 156. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. -

Histological Comparisons of Fergusobia/Fergusonina-Induced Galls on Different Myrtaceous Hosts1 R
Journal of Nematology 36(3):249–262. 2004. © The Society of Nematologists 2004. Histological Comparisons of Fergusobia/Fergusonina-Induced Galls on Different Myrtaceous Hosts1 R. M. Giblin-Davis,2 B. J. Center,2 K. A. Davies,3 M. F. Purcell,4 S. J. Scheffer,5 G. S. Taylor,3 J. Goolsby,4 and T. D. Center6 Abstract: The putative mutualism between different host-specific Fergusobia nematodes and Fergusonina flies is manifested in a variety of gall types involving shoot or inflorescence buds, individual flower buds, stems, or young leaves in the plant family Myrtaceae. Different types of galls in the early-to-middle stages of development, with host-specific species of Fergusobia/Fergusonina, were collected from Australian members of the subfamily Leptospermoideae (six species of Eucalyptus, two species of Corymbia, and seven species of broad-leaved Melaleuca). Galls were sectioned and histologically examined to assess morphological changes induced by nematode/fly mutualism. The different gall forms were characterized into four broad categories: (i) individual flower bud, (ii) terminal and axial bud, (iii) ‘basal rosette’ stem, and (iv) flat leaf. Gall morphology in all four types appeared to result from species-specific selection of the oviposition site and timing and number of eggs deposited in a particular plant host. In all cases, early parasitism by Fergusobia/Fergusonina involved several layers of uninucleate, hypertrophied cells lining the lumen of each locule (gall chamber where each fly larva and accompanying nematodes develop). Hypertrophied cells in galls were larger than normal epidermal cells, and each had an enlarged nucleus, nucleolus, and granular cytoplasm that resembled shoot bud gall cells induced by nematodes in the Anguinidae. -

Plano De Manejo Do Parque Nacional Do Viruâ
PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO VIRU Boa Vista - RR Abril - 2014 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Dilma Rousseff MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Izabella Teixeira - Ministra INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio Roberto Ricardo Vizentin - Presidente DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - DIMAN Giovanna Palazzi - Diretora COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE MANEJO Alexandre Lantelme Kirovsky CHEFE DO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ Antonio Lisboa ICMBIO 2014 PARQUE NACIONAL DO VIRU PLANO DE MANEJO CRÉDITOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN Giovanna Palazzi - Diretora EQUIPE TÉCNICA DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ Coordenaço Antonio Lisboa - Chefe do PN Viruá/ ICMBio - Msc. Geógrafo Beatriz de Aquino Ribeiro Lisboa - PN Viruá/ ICMBio - Bióloga Superviso Lílian Hangae - DIREP/ ICMBio - Geógrafa Luciana Costa Mota - Bióloga E uipe de Planejamento Antonio Lisboa - PN Viruá/ ICMBio - Msc. Geógrafo Beatriz de Aquino Ribeiro Lisboa - PN Viruá/ ICMBio - Bióloga Hudson Coimbra Felix - PN Viruá/ ICMBio - Gestor ambiental Renata Bocorny de Azevedo - PN Viruá/ ICMBio - Msc. Bióloga Thiago Orsi Laranjeiras - PN Viruá/ ICMBio - Msc. Biólogo Lílian Hangae - Supervisora - COMAN/ ICMBio - Geógrafa Ernesto Viveiros de Castro - CGEUP/ ICMBio - Msc. Biólogo Carlos Ernesto G. R. Schaefer - Consultor - PhD. Eng. Agrônomo Bruno Araújo Furtado de Mendonça - Colaborador/UFV - Dsc. Eng. Florestal Consultores e Colaboradores em reas Tem'ticas Hidrologia, Clima Carlos Ernesto G. R. Schaefer - PhD. Engenheiro Agrônomo (Consultor); Bruno Araújo Furtado de Mendonça - Dsc. Eng. Florestal (Colaborador UFV). Geologia, Geomorfologia Carlos Ernesto G. R. Schaefer - PhD. Engenheiro Agrônomo (Consultor); Bruno Araújo Furtado de Mendonça - Dsc. -

Vegetation Survey of Batavia Downs, Cape York Peninsula
QR91003 Vegetation survey of Batavia Downs Cape York Peninsula V. J. Neldner, J. R. Clarkson Botany Branch Department of Primary Industries & Brisbane Queensland Government Technical Report This report is a scanned copy and some detail may be illegible or lost. Before acting on any information, readers are strongly advised to ensure that numerals, percentages and details are correct. This report is intended to provide information only on the subject under review. There are limitations inherent in land resource studies, such as accuracy in relation to map scale and assumptions regarding socio-economic factors for land evaluation. Before acting on the information conveyed in this report, readers should ensure that they have received adequate professional information and advice specific to their enquiry. While all care has been taken in the preparation of this report neither the Queensland Government nor its officers or staff accepts any responsibility for any loss or damage that may result from any inaccuracy or omission in the information contained herein. © State of Queensland 1991 For information about this report contact [email protected] Research Establishments Publication QR91003 Vegetation survey of Batavia Downs Cape York Peninsula V. J. Neldner, J. R. Clarkson Botany Branch Department of Primary Industries Brisbane ISSN 0813-4391 Agdex 301/06 This publication was prepared for officers of the Department of Primary Industries. It may be distributed to other interested individuals and organisations. © Queensland Government 1991 Department of Primary Industries, Queensland GPO Box 46 Brisbane Qld4001 Ill Contents List of figures Page iv List of tables iv List of plates iv Summary v 1. -

Biodiversity Summary: Burnett Mary, Queensland
Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

Northern Gulf, Queensland
Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

Plant Biodiversity Science, Discovery, and Conservation: Case Studies from Australasia and the Pacific
Plant Biodiversity Science, Discovery, and Conservation: Case Studies from Australasia and the Pacific Craig Costion School of Earth and Environmental Sciences Department of Ecology and Evolutionary Biology University of Adelaide Adelaide, SA 5005 Thesis by publication submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Ecology and Evolutionary Biology July 2011 ABSTRACT This thesis advances plant biodiversity knowledge in three separate bioregions, Micronesia, the Queensland Wet Tropics, and South Australia. A systematic treatment of the endemic flora of Micronesia is presented for the first time thus advancing alpha taxonomy for the Micronesia-Polynesia biodiversity hotspot region. The recognized species boundaries are used in combination with all known botanical collections as a basis for assessing the degree of threat for the endemic plants of the Palau archipelago located at the western most edge of Micronesia’s Caroline Islands. A preliminary assessment is conducted utilizing the IUCN red list Criteria followed by a new proposed alternative methodology that enables a degree of threat to be established utilizing existing data. Historical records and archaeological evidence are reviewed to establish the minimum extent of deforestation on the islands of Palau since the arrival of humans. This enabled a quantification of population declines of the majority of plants endemic to the archipelago. In the state of South Australia, the importance of establishing concepts of endemism is emphasized even further. A thorough scientific assessment is presented on the state’s proposed biological corridor reserve network. The report highlights the exclusion from the reserve system of one of the state’s most important hotspots of plant endemism that is highly threatened from habitat fragmentation and promotes the use of biodiversity indices to guide conservation priorities in setting up reserve networks. -

Border Rivers-Gwydir, New South Wales
Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

Australian Nursery Industry Myrtle Rust Management Plan 2012
Australian Nursery Industry Myrtle Rust (Uredo rangelii) Management Plan 2012 Developed for the Australian Nursery Industry Production Wholesale Retail V2 Acknowledgements This Myrtle Rust Management Plan has been developed by the Nursery & Garden Industry Queensland (John McDonald - Nursery Industry Development Manager) for the Australian Nursery Industry. Version 02 February 2012 Photographs sourced from I&I NSW, NGIQ and Queensland DEEDI. Various sources have contributed to the content of this plan including: Nursery Industry Accreditation Scheme Australia (NIASA) BioSecure HACCP Nursery Industry Guava Rust Plant Pest Contingency Plan DEEDI Queensland Myrtle Rust Fact Sheets I&I NSW Myrtle Rust Fact Sheets and Updates Biosecurity Queensland Myrtle Rust Program Preparation of this document has been financially supported by Nursery & Garden Industry Queensland, Nursery & Garden Industry Australia and Horticulture Australia Ltd. Published by Nursery & Garden Industry Australia, Sydney 2012 © Nursery & Garden Industry Queensland 2012 While every effort has been made to ensure the accuracy of contents, Nursery & Garden Industry Queensland accepts no liability for the information contained within this plan. For further information contact: John McDonald Industry Development Manager NGIQ Ph: 07 3277 7900 Email: [email protected] 2 Australian Nursery Industry Myrtle Rust Management Plan (Version 2) – 2012 Table of Contents 1. Introduction – Myrtle Rust in the Australian Nursery Industry 4 2. Myrtaceae Family – Genera 6 3. Myrtle Rust (Uredo rangelii) 7 4. Known Hosts of Myrtle Rust in Australia 9 4.1 Queensland known hosts 9 4.2 New South Wales additional hosts 12 4.3 Victorian known hosts 12 5. Fungicide Treatment 13 5.1 Fungicide Table 13 5.2 Myrtle Rust Fungicide Treatment Rotation Program 14 5.3 Fungicide Application 15 6. -
Burnett Mary, Queensland
Biodiversity Summary for NRM Regions Guide to Users Background What is the summary for and where does it come from? This summary has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. It highlights important elements of the biodiversity of the region in two ways: • Listing species which may be significant for management because they are found only in the region, mainly in the region, or they have a conservation status such as endangered or vulnerable. • Comparing the region to other parts of Australia in terms of the composition and distribution of its species, to suggest components of its biodiversity which may be nationally significant. The summary was produced using the Australian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. The list of families covered in ANHAT is shown in Appendix 1. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are are not not included included in the in the summary. • The data used for this summary come from authoritative sources, but they are not perfect. -

Puccinia Psidii in Queensland, Australia: Disease Symptoms, Distribution and Impact
Plant Pathology (2013) Doi: 10.1111/ppa.12173 Puccinia psidii in Queensland, Australia: disease symptoms, distribution and impact G. S. Peggab*, F. R. Giblinb, A. R. McTaggartc, G. P. Guymerd, H. Taylore, K. B. Irelande, R. G. Shivasf and S. Perrye aDepartment of Agriculture, Fisheries and Forestry, Horticulture and Forestry Science, Agri-Science Queensland, GPO Box 267, Brisbane, Qld 4001; bForest Industries Research Centre, University of the Sunshine Coast, Locked Bag 4, Maroochydore DC, Qld 4558; cQueensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, The University of Queensland, Ecosciences Precinct, GPO Box 267, Brisbane, Qld 4001; dDepartment of Science, Information Technology, Innovation and the Arts, Queensland Herbarium, Brisbane Botanic Gardens Mt Coot-tha, Mt Coot-tha Road, Toowong, Qld 4066; eDepartment of Agriculture, Fisheries and Forestry, Plant Biosecurity and Product Integrity, Biosecurity Queensland, GPO Box 267, Brisbane, Qld 4001; and fDepartment of Agriculture, Fisheries and Forestry, Plant Pathology Herbarium, Biosecurity Queensland, GPO Box 267, Brisbane, Qld 4001, Australia Puccinia psidii has long been considered a significant threat to Australian plant industries and ecosystems. In April 2010, P. psidii was detected for the first time in Australia on the central coast of New South Wales (NSW). The fungus spread rapidly along the east coast and in December 2010 was found in Queensland (Qld) followed by Victo- ria a year later. Puccinia psidii was initially restricted to the southeastern part of Qld but spread as far north as Mossman. In Qld, 48 species of Myrtaceae are considered highly or extremely susceptible to the disease. The impact of P. psidii on individual trees and shrubs has ranged from minor leaf spots, foliage, stem and branch dieback to reduced fecundity. -
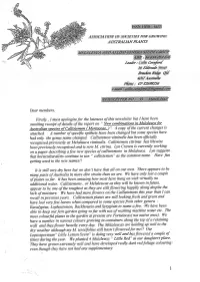
Newsletter No.33
Dear members, Firstly, I must apologise for the lateness of this newsletter but I have been awaiting receipt of details of the report on " New combinations in MelaIezrca for Australian smcies ofCalllis~ernon ( Myrtaceae. ) ". A copy of the current changes is attached. A number of specific epithets have been changed but some species have had only the genus name changed. Callistemon viminalis has been oflcially recognisedpreviously as Melaluuca viminalis. Callistemon citrinus has likewise been previously recognised and is now M. citrina. Lyn Craven is currently working on apaper describing a few new species of callistemons in Melaleuca. Lyn suggeste that horticulturalists continue to use " callistemon" as the common name. Have fun getting used to the new names!! It is still very dry here but we don't have that all on our own. There appears to be many parts of Australia in more dire straits than we are. We have only lost a couple ofplants so far. It has been amazing how most have hung on with virtually no additional water. Callistemons , or Melaleucas as they will be known in future, appear to be one of the toughest as they are stillflowering happily along despite the lack of moisture. We have had more flowers on the Callistemons this year than I can recall in previous years. Callistemonplants are still lookingfiesh and green and have lost very few leaves when compared to some species fiom other genera - Eucalyptus, Lophostemon, Backhousia and Syzygiium to name a few. We have been able to keep our fern garden going so far with use of washing machine water etc.