Master Reference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9780295744117.Pdf (3.082Mb)
Feminist Technosciences Rebecca Herzig and Banu Subramaniam, Series Editors 1r.Roy, Molecular Feminisms.indd 1 1/28/19 1:10 PM 1r.Roy, Molecular Feminisms.indd 2 1/28/19 1:10 PM Molecular Feminisms BIOLOGY, BECOMINGS, AND LIFE IN THE LAB DEBOLEENA ROY University of Washington Press Seattle 1r.Roy, Molecular Feminisms.indd 3 1/28/19 1:10 PM Publication of this open monograph was the result of Emory University’s participa- tion in TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem), a collaboration of the Association of American Universities, the Association of University Presses, and the Association of Research Libraries. TOME aims to expand the reach of long-form humanities and social science scholarship including digital scholarship. Additionally, the program looks to ensure the sustainability of university press monograph pub- lishing by supporting the highest quality scholarship and promoting a new ecology of scholarly publishing in which authors’ institutions bear the publication costs. Funding from Emory University and the Andrew W. Mellon Foundation made it possible to open this publication to the world. www.openmonographs.org Copyright © 2018 by Deboleena Roy Printed and bound in the United States of America Interior design by Thomas Eykemans Composed in Chaparral, typeface designed by Carol Twombly Cover design by Katrina Noble Cover photograph by Kheyal Roy-Meighoo and Koan Roy-Meighoo 22 21 20 19 5 4 3 2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. -

Book of Abstracts Neurogenderings III: the 1St International Dissensus Conference on Brain and Gender – Book of Abstracts
Book of Abstracts NeuroGenderings III: The 1st international Dissensus Conference on brain and gender – Book of abstracts TABLE OF CONTENTS THE GENDER THEORY OF THE VATICAN : A NEUROSCIENTIFIC CRITIQUE 3 Odile Fillod & Catherine Vidal HARDWIRED : HISTORTY OF A MISLEADING METAPHOR 4 Giordana Grossi YOUNG IN HIS/HER HEAD : A CRITICAL HISTORY OF THE ADOLESCENT BRAIN 5 Christel Gumy QUEERING GENDER USING POSITIVIST METHODS : AN EXAMPLE FROM A STUDY OF GENDER IDENTITY IN « NORMATIVE » INDIVIDUALS 6 Daphna Joel, Ricardo Tarrasch, Zohar Berman, Maya Mukamel & Effi Ziv PLASTICITY AS BOUNDARY OBJECT 7 Annelies Kleinherenbrink THE MYSTERIOUS SEX/GENDER PATTERNS OF INDIVIDUAL DISPOSITIONS AND CHOICES 8 Hanna Meissner POVERTY IN THE BRAIN ? THEORIZING NEURAL PLASTICITY 9 Victoria Pitts-Taylor QUEERING GENDER IN THE “NORMATIVE” BRAIN 10 Jared Pool & Daniel Margulies SEX/GENDER ASSESSMENT IN PSYCHOLOGY, NEUROPSYCHOLOGY AND RELATED EMPIRICAL SCIENCES 11 Diana Schellenberg PLASTIC BRAINS – FEMINIST MATERIALISM – NEOLIBERAL CONTEXTS : NOTES FOR A DISSENSUS DEBATE 12 Sigrid Schmitz TESTOSTERONE AS TROJAN HORSE : CONSTRUCTING A FEMINIST AND QUEER BIOSCIENCE WITH SOCIAL NEUROENDOCRINOLOGY 13 Sari van Anders FROM FACTS TO VALUES : IDEAS OF EQUALITY, DIFFERENCE AND FLOURISHING IN DUTCH DEBATES ON GENDER – SPECIFIC EDUCATION 14 Ties van de Werff THE DISSENSUS OF THE APPARATUS : HOW TO FRAME A META-ANALYSIS OF THE USES AND CONCLUSIONS SURROUNDING THE APPARATUS KNOWN AS LORDOSIS 15 Rachel Weitzenkorn CITED REFERENCES 16 ACADEMIC PARTNERS & SPONSORS 17 2 NeuroGenderings III: The 1st international Dissensus Conference on brain and gender – Book of abstracts THE GENDER THEORY OF THE VATICAN : A NEUROSCIENTIFIC CRITIQUE ODILE FILLOD, Author of the Blog Allodoxia (allodoxia.blog.lemonde.fr), France CATHERINE VIDAL, Pasteur Institute, Paris, CNRS, Neurobiology, France In France in 2011, the introduction of the notions of ‘sexual identity’ and ‘sexual orientation’ in high school natural science textbooks raised the anger of conservative catholic circles and of many right-wing deputies. -

Neurosexismo Una Reflexión Desde La Crítica Feminista De La Ciencia
Grado en Filosofía Curso 2020 - 2021 Facultad de Humanidades - Universidad de La Laguna TRABAJO FIN DE GRADO Neurosexismo Una reflexión desde la crítica feminista de la ciencia Alumna: Ana Pérez Almeida Tutora: María Inmaculada Perdomo Reyes 1 ÍNDICE DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3 2. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 7 2. 1 Diferencias sexuales entre mujeres y hombres ...................................................... 7 2. 2 Destino rosa y destino azul .................................................................................. 10 3. ESTADO ACTUAL ................................................................................................... 15 3. 1 Descubrimientos ignorados ................................................................................. 15 3. 2 Neurogénero ........................................................................................................ 19 4. DISCUSIÓN Y POSICIONAMIENTO ..................................................................... 22 4. 1 ¿Existen dos tipos de cerebro?............................................................................. 22 4. 2 Cerebro intersexual .............................................................................................. 25 5. CONCLUSIÓN Y VÍAS ABIERTAS ........................................................................ 29 6. BIBLIOGRAFÍA -
EL SEXO DEL CEREBRO EN DISPUTA: Críticas Al Neurosexismo Desde Una Perspectiva Neurofeminista
EL SEXO DEL CEREBRO EN DISPUTA: Críticas al neurosexismo desde una perspectiva neurofeminista Desirée Serrano Buiza Jordi Vallverdú Trabajo de Fin de Grado Grado de Filosofía Curso 2018-2019 Facultad de Filosofía y Letras UAB ÍNDICE Resumen/Abstract....................................................................................................................1 Introducción..............................................................................................................................1 Parte I: Natura vs Nurtura I.1 Darwinitis y teorías biologicistas del siglo XIX............................................................2 I.2 La genética entra en juego: el paradigma de Bateman..............................................4 I.3 El nacimiento del género...........................................................................................5 I.4 Indistinción (¿indebida?) entre Sexo-Género............................................................7 Parte II: La naturaleza del género II. 1 El mito del género....................................................................................................8 II. 2 El género en disputa................................................................................................9 Parte III: Neurosexismo VS Epistemología feminista III. 1 La cuestión actual del dimorfismo sexual del cerebro...........................................10 III. 2 El papel no imparcial de la neurociencia...............................................................11 III. 3 El neurosexismo como -

ST8: Corporalidades, Saberes E Tecnologias Seminários Temáticos
ST8: Corporalidades, Saberes e tecnologias Seminários Temáticos “Não chore, pesquise!” – Reflexões sobre sexo, gênero e ciência a partir do neurofeminismo Marina Fisher Nucci1 Resumo: A crença na existência de diferenças incomensuráveis entre homens e mulheres, assim como a suposição de que tais diferenças possuem origens biológicas, é um tema muito presente não apenas no senso comum, mas fonte de preocupação e de pesquisas de cunho científico. Levando em conta a centralidade do cérebro na atualidade, faz sentido pensar que ele seja acionado como o “local privilegiado” para explicar diferenças entre homens e mulheres. Como observa Fabíola Rohden, trata-se de uma remodelagem do dualismo de gênero e da “substancialização da diferença” – ou seja, do enraizamento do gênero em determinadas marcas corporais, através das ciências do cérebro. Assim, meu interesse nesta pesquisa é refletir sobre as relações entre sexo, gênero, ciência e feminismo, a partir da análise da produção contemporânea da neurociência a respeito das diferenças entre homens e mulheres, bem como da crítica feminista a esta produção. Interessa-me aqui as tensões entre natureza/cultura, sexo/gênero, e como elas se articulam. Deste modo, meu objeto de análise é a produção científica contemporânea de um grupo de pesquisadoras que se descrevem como “neurofeministas” e que desde 2010 organizam-se em uma rede internacional chamada NeuroGenderings, onde procuram trazer uma perspectiva feminista crítica aos estudos recentes sobre o cérebro. As neurofeministas estão engajadas em produzir uma neurociência assumidamente feminista, que se debruce sobre a materialidade dos corpos – e especialmente do cérebro –, mas que se preocupe ao mesmo tempo, politicamente, com as hierarquias de gênero. -

CONFERENCE PROGRAM Thursday 8 May 2014 | Aula – IDHEAP 14H00
CONFERENCE PROGRAM Thursday 8 May 2014 | Aula – IDHEAP 14h00-14h15 Opening Cynthia KRAUS, University of Lausanne & Anelis KAISER, University of Bern 14h15 -14h30 Welcome Franciska KRINGS, Vice-Rector, University of Lausanne 14h30-15h30 Keynote lecture Prof. Rebecca JORDAN-YOUNG, Barnard College Sex as Chimera: Tools for (Un)Thinking Difference 15h30-16h30 Keynote lecture Prof. Gillian EINSTEIN, Linköping University, Dalla Landa School of Public Health, University of Toronto When Does a Difference Make a Difference? Examples from Situated Neuroscience Chair: Anelis Kaiser 16h30-17h00 Break 17h00-18h00 Keynote lecture Prof. Georgina RIPPON, Aston University Functional Neuroimaging (FNI) and Sex/Gender Research : of Differences, Dichotomies and Entanglement 18h00-19h00 Keynote lecture Prof. Anne FAUSTO-STERLING, Brown University How Your Generic Baby Acquires Gender Chair: Cynthia Kraus Friday 9 May 2014 | Aula – IDHEAP 9h00-9h30 Presentation Isabelle DUSSAUGE, University of Uppsala & Sigrid SCHMITZ, University of Vienna Neurogenderings Network and Neurogenderings II Conference Chair: Anelis Kaiser 9h30-10h00 Introduction Cynthia KRAUS, University of Lausanne A Dissensus Conference For What? Feminism, Brain Research, and Democratic Practices Anelis KAISER, University of Bern Empirical NeuroGenderings: Outline of a Research Program 10h00-10h30 Break 10h30-12h00 Session 1 Hardwired brains? Plastic brains? Critical reflections Giordana GROSSI, State University New York at New Paltz Hardwired: History of a Misleading Metaphor Annelies KLEINHERENBRINK, -

Sex-Based Brain Differences and Emotional Harm
Duke Law Journal Online VOLUME 70 OCTOBER 2020 SEX-BASED BRAIN DIFFERENCES AND EMOTIONAL HARM BETSY J. GREY† ABSTRACT Technological advances have allowed neuroscientists to identify brain differences between women and men, which may lead to explanations for sex-biased population differences in behavior and brain-based disorders. Although the research is at its early stages, this is an appropriate time to examine some of the potential legal implications of these findings. This Article examines that question in the context of tort law, especially how scientific findings may affect the use of the reasonable person standard in emotional injury claims. Specifically, studies suggest that there may be distinct sex-based mechanisms involved in reactions to extreme stress, raising the question of whether women experience and process stress and trauma differently than men. This Article argues that these studies may eventually inform the use of the reasonableness standard for freestanding emotional harm claims. As science further develops, courts may either apply a reasonable woman standard in limited contexts or at least allow jurors to consider evidence of sex-based differences in applying a reasonable person standard. Recognizing these differences, courts have already begun to apply the reasonable woman standard to hostile workplace environment claims, and science may support broader use of that standard, especially for negligent and intentional infliction of emotional harm claims. INTRODUCTION The last decades of legal development rightfully have broken down artificial sex-based distinctions over a range of fronts—from † Jack E. Brown Chair in Law at Arizona State University’s Sandra Day O’Connor College of Law. -

Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro Centro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro Biomédico Instituto de Medicina Social Marina Fisher Nucci “Não chore, pesquise!”: Reflexões sobre sexo, gênero e ciência a partir do neurofeminismo Rio de Janeiro 2015 Marina Fisher Nucci “Não chore, pesquise!”: Reflexões sobre sexo, gênero e ciência a partir do neurofeminismo Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós- Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientadora: Prof.a Dra. Jane Araújo Russo Rio de Janeiro 2015 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/ REDE SIRIUS/ CB/C C962 Nucci, Marina Fisher “Não chore, pesquise!” : reflexões sobre sexo, gênero e ciências a partir do neurofeminismo / Marina Fisher Nucci. – 2015. 222 f. Orientadora: Jane Araújo Russo. Tese (doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social. 1. Sexo - Teses. 2. Gênero - Teses. 3. Feminismo – Teses. 4. Neurociências – Teses. I. Russo, Jane. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Medicina Social. III. Título. CDU 616.8:159.922.1 Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte. ________________________________ ______________________________ Assinatura Data Marina Fisher Nucci “Não chore, pesquise!”: Reflexões sobre sexo, gênero e ciência a partir do neurofeminismo Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós- Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aprovada em 04 de setembro de 2015. Orientadora: Profa. Dra. Jane Araújo Russo Instituto de Medicina Social - UERJ Banca Examinadora: ________________________________________________________ Prof.ª Dra. -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/201814 Please be advised that this information was generated on 2021-10-01 and may be subject to change. Feminist Interventions on the Sex/Gender Question in Neuroimaging Research by Katherine Bryant, Giordana Grossi and Anelis Kaiser The debate about sex/gender[1] in the brain continues with urgency in Western countries.[2] For one example, in 2014 the National Institute of Health (NIH) began to require that scientists examine and report differences between female and male animals in all preclinical trials (Clayton and Collins 2014). For another, in 2017 the Journal of Neuroscience Research published a nearly 800-page special issue on sex/gender influences on nervous system function with more than seventy invited contributions. Nota bene there was no open call for this issue[3] , restricting the content to articles by authors whose understanding of sex/gender is deeply rooted in the belief of the existence of fundamental differences between women’s and men’s brains (for a constructive commentary, see Rippon et al. 2017). Per the editor-in-chief of that issue, “sex matters not only at the macroscopic level, where male and female brains have been found to differ in size and connectivity, but at the microscopic level too” (Prager 2017, 11) and, echoing Cahill (2006), to ignore “sex as a biological variable” would be to leave the scientific community with “major gaps in knowledge.” Hence, the journal requires that “the inability for any reason to study sex differences where they may exist should be discussed as a study limitation” and that “manuscripts reporting exploratory analyses of potential sex differences in studies not explicitly designed to address them are encouraged” (Prager 2017, 11). -

Molecular Feminisms: Biology, Becomings, and Life in the Lab Deboleena Roy, Emory University
Molecular Feminisms: Biology, Becomings, and Life in the Lab Deboleena Roy, Emory University Publisher: University of Washington Press Publication Place: Seattle, WA 98195-9570 Publication Date: 2018-11-10 Type of Work: Book | Final Publisher PDF Publisher DOI: 10.6069/j163-3c90 Permanent URL: https://pid.emory.edu/ark:/25593/tgp38 Final published version: http://www.washington.edu/uwpress/search/books/ROYMOL.html Copyright information: © 2018 by Deboleena Roy This is an Open Access work distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Accessed September 30, 2021 9:44 PM EDT Feminist Technosciences Rebecca Herzig and Banu Subramaniam, Series Editors Molecular Feminisms BIOLOGY, BECOMINGS, AND LIFE IN THE LAB DEBOLEENA ROY University of Washington Press Seattle Publication of this open monograph was the result of Emory University’s participa- tion in TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem), a collaboration of the Association of American Universities, the Association of University Presses, and the Association of Research Libraries. TOME aims to expand the reach of long-form humanities and social science scholarship including digital scholarship. Additionally, the program looks to ensure the sustainability of university press monograph pub- lishing by supporting the highest quality scholarship and promoting a new ecology of scholarly publishing in which authors’ institutions bear the publication costs. Funding from Emory University and the Andrew W. Mellon Foundation made it possible to open this publication to the world. www.openmonographs.org Copyright © 2018 by Deboleena Roy Printed and bound in the United States of America Interior design by Thomas Eykemans Composed in Chaparral, typeface designed by Carol Twombly Cover design by Katrina Noble Cover photograph by Kheyal Roy-Meighoo and Koan Roy-Meighoo 22 21 20 19 18 5 4 3 2 1 All rights reserved. -
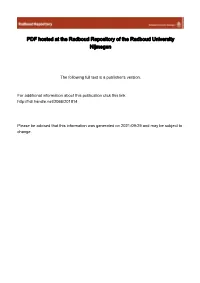
PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/201814 Please be advised that this information was generated on 2021-09-29 and may be subject to change. Feminist Interventions on the Sex/Gender Question in Neuroimaging Research by Katherine Bryant, Giordana Grossi and Anelis Kaiser The debate about sex/gender[1] in the brain continues with urgency in Western countries.[2] For one example, in 2014 the National Institute of Health (NIH) began to require that scientists examine and report differences between female and male animals in all preclinical trials (Clayton and Collins 2014). For another, in 2017 the Journal of Neuroscience Research published a nearly 800-page special issue on sex/gender influences on nervous system function with more than seventy invited contributions. Nota bene there was no open call for this issue[3] , restricting the content to articles by authors whose understanding of sex/gender is deeply rooted in the belief of the existence of fundamental differences between women’s and men’s brains (for a constructive commentary, see Rippon et al. 2017). Per the editor-in-chief of that issue, “sex matters not only at the macroscopic level, where male and female brains have been found to differ in size and connectivity, but at the microscopic level too” (Prager 2017, 11) and, echoing Cahill (2006), to ignore “sex as a biological variable” would be to leave the scientific community with “major gaps in knowledge.” Hence, the journal requires that “the inability for any reason to study sex differences where they may exist should be discussed as a study limitation” and that “manuscripts reporting exploratory analyses of potential sex differences in studies not explicitly designed to address them are encouraged” (Prager 2017, 11).