9782081255241.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German Newsreel Propaganda in France, 1940–1944
Historical Journal of Film, Radio and Television ISSN: 0143-9685 (Print) 1465-3451 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/chjf20 German newsreel propaganda in France, 1940–1944 Brett Bowles To cite this article: Brett Bowles (2004) German newsreel propaganda in France, 1940–1944, Historical Journal of Film, Radio and Television, 24:1, 45-67, DOI: 10.1080/0143968032000184498 To link to this article: https://doi.org/10.1080/0143968032000184498 Published online: 22 Jan 2007. Submit your article to this journal Article views: 475 View related articles Citing articles: 3 View citing articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=chjf20 Historical Journal of Film, Radio and Television Vol. 24, No. 1, 2004 German Newsreel Propaganda in France, 1940–1944 BBowles BRETT BOWLES, Iowa State University Excerpts from newsreels released in France during the Second World War are generally familiar to scholars thanks to their widespread use in retrospective documentaries such as Marcel Ophuls’s The Sorrow and the Pity (1969) and Claude Chabrol’s The Eye of Vichy (1993). Though historians have often used newsreels to illustrate key aspects of German policy and French collaboration, until recently these films have not received widespread attention as an object of study in their own right [1]. Following the trail blazed by Marc Ferro and Jean-Pierre Bertin-Maghit [2], a new generation of scholars is now rediscovering newsreels and documentaries as long-standing archival restrictions are lifted and fragile nitrate films are catalogued and preserved [3]. Wartime newsreels are complex cultural products encompassing political, social, and economic dimensions. -

Hollywood and France, 1914-1945 Louise G
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2011 Vive la Différence: Hollywood and France, 1914-1945 Louise G. Hilton Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Hilton, Louise G., "Vive la Différence: Hollywood and France, 1914-1945" (2011). LSU Master's Theses. 1206. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/1206 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. VIVE LA DIFFÉRENCE: HOLLYWOOD AND FRANCE, 1914-1945 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Arts in The Interdepartmental Program in Liberal Arts by Louise G. Hilton B. A., Louisiana State University, 2004 May 2011 ACKNOWLEDGEMENTS I wish, first of all, to thank my thesis advisor, Dr. Charles Shindo, for his counsel and infinite patience during the time I spent working on this project. Dr. Karl Roider also deserves heartfelt thanks for his unflagging support throughout my studies at LSU and for his agreeing to be a member of my thesis committee. I extend my appreciation to Dr. William Clark for giving of his valuable time to be a part of my committee. -

Filmmakers in the Digital Era by Dana Duma Reviewed by Titus Vîjeu 79
www.unatc.ro Academic Journal of National University of Theatre and Film “I. L. Caragiale” – Vol. 4, No. 2, 2020 UNATC PRESS UNATC The academic journal of the National University of Theatre and Film “I.L. Caragiale” publishes original papers aimed to analysing in-depth different aspects of cinema, film, television and new media, written in English. You can find information about the way to submit papers on the third cover and at the Internet address: www.unatc.ro Editors: Dana Duma Anca Ioniţă [email protected] [email protected] Co-editor: Andrei Gorzo Copy Editors: Anca Ioniță, Marian Sorin Rădulescu [email protected] Editorial Board: Laurenţiu Damian, Dana Duma, Andrei Gorzo, Lucian Georgescu, Doru Niţescu, Alex Sterian, Marius Nedelcu Advisory Board: Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles) György Baron (National University of Theatre and Film, Budapest) Tereza Barta (York University, Toronto, Canada) Wang Yao (Beijing Film Academy) UNATC PRESS ISSN: 2286 – 4466 ISSN-L: 2286 – 4466 Art Director: Alexandru Oriean Photo cover: Still from Infinite Football by Corneliu Porumboiu Printing House: Net Print This issue is published with the support of The Romanian Filmmakers’ Union (UCIN) National University of Theatre and Film “I.L. Caragiale” Close Up: Film and Media Studies Vol. 4, No. 2, 2020 UNATC PRESS BUCUREȘTI CONTENTS Close Up: Film and Media Studies • Vol. 4, No. 2, 2020 Lucian Țion Sports, Politics, and the Treatment of the Past in Porumboiu’s Documentaries The Second Game and Infinite Football 7 Dana Duma The Animated Documentary as Narrative on Traumas 21 Călin Boto On people and waters and canons 29 Mihaela Grancea, Mihai Fulger Four Romanian Nonfiction Contributions to the Filmography of the Holocaust 33 Marian Ţuţui Romanian Jews and their International Recognition in the Cinema World 43 Andrei-Iulian Iancu How long does a film “live”? 57 BOOK REVIEWS The Mass Ornament: Weimar Essays by Siegfried Kracauer; Translated, Edited, and with an Introduction by Thomas Y. -
Journal of Film Preservationfilm of Journal
Journal of Film Preservation Contributors to this issue... Ont collaboré à ce numéro... Journal Han participado en este número... 69 05/ 2005 of Film MAGDALENA ACOSTA CHRISTINE HAKIM Director General of the Cineteca nacional (México) Indonesian Film Producer, Director and Actress (Jakarta) ANTTI ALANEN Preservation Head of Programming at the Finnish Film Archive NATACHA LAURENT (Helsinki) Déléguée Générale de la Cinémathèque de Toulouse (Toulouse) BRIGITTE BERG Président of Les Documents cinématographiques ERIC LE ROY (Paris) Chef du Service accès, valorisation et enrichissement des collections, Centre national de H. MISBACH YUSA BIRAN la cinématographie (Bois d’Arcy) Director of the Sinematek Indonesia (Jakarta) VITTORIO MARTINELLI CATHERINE BLOCH Historien et chercheur de cinéma (Rieti, Italia) Deputy Director of Research of the Cineteca de Revista la Internacional Federación de Fílmicos Archivos nacional (México) DONALD MCWILLIAMS Writer, filmmaker (The Fifth Province, 2002) and THOMAS C. CHRISTENSEN teacher (Montréal) Curator at the Cinematheque of the Danish Film Institute (København) MARIO MUSUMECI Preservation Officer at the Cineteca Nazionale – ROBERT DAUDELIN Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Membre honoraire de la FIAF (Montréal) (Roma) Published by the International Federation of Film Archives MARCO DE BLOIS VLADO SKAFAR Conservateur du cinéma d’animation, Film director and critic (Ljubljana) Cinémathèque québécoise (Montréal) IVÁN TRUJILLO ALFONSO DEL AMO Director general de Actividades cinematográficas Jefe de la Comisión técnica de la FIAF,Titular de de la Filmoteca de la UNAM (México) restauraciones y servicios técnicos de la Filmoteca de Revue la Fédération Internationale des du Archives Film Española (Madrid) FUMIKO TSUNEISHI Assistant Curator at the National Film Center, The DOMINIQUE DUGAS National Museum of Modern Art (Tokyo) 69 • FIAF 05/2005 Conservateur de la télévision, Cinémathèque québécoise (Montréal) May / mai mayo 2005 69 Open Forum 2 Brief History of the Indonesian Film H. -

The Theater of Jean-Paul Sartre and Jean Giraudoux by Mary
Guilt and the War Within: The Theater of Jean-Paul Sartre and Jean Giraudoux by Mary Ann LaMarca Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Professor Alice Y. Kaplan, Supervisor ___________________________ Professor Mary Ann Frese Witt ___________________________ Professor Paol Keineg ___________________________ Professor David F. Bell Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2008 ABSTRACT Guilt and the War Within: The Theater of Jean-Paul Sartre and Jean Giraudoux by Mary Ann LaMarca Department of Romance Studies Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Professor Alice Y. Kaplan, Supervisor ___________________________ Professor Mary Ann Frese Witt ___________________________ Professor Paol Keineg ___________________________ Professor David F. Bell An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French Literature in the Department of Romance Languages in the Graduate School of Duke University 2008 Copyright by Mary Ann LaMarca 2008 Abstract The moral and ethical choices made during the Nazi Occupation of France would echo for generations: they served as a source of pain and pride when the French sought to rebuild their national identity after the ignominy of the defeat, and acted as the foundation for the intellectual legacy on which post-war life stands. In my dissertation I examine the diverse trajectory of two writers, Jean- Paul Sartre and Jean Giraudoux, during the Occupation by focusing on their dramatic works. During this period, no writer could legally exercise his vocation and receive compensation without submitting to certain legalities designed to monitor the content of artistic output. -

The Future of Memory Project
STUDIA UBB DRAMATICA, LXII, 2, 2017, p. 249 - 269 (Recommended Citation) The Future of Memory Project OLGA STEFAN1 Abstract: Due to the specific theme of this issue of Studia Dramatica dedicated to new perspectives in the critical and historical approaches in theatre and film, we invited Olga gtefan, the curator of one of the most interesting and complex projects of performing archives ever built in Eastern Europe, The Future of Memory (coordinated by Quantic Association), to write for our Journal a detailed descriptive presentation. The project had an impressive number of local partners in Romania and the Republic of Moldavia and was awarded a grant by the National Administration of Cultural Fund of Romania (AFCN). We thank Olga Stefan for her consistent contribution. Keywords: performative archives, holocaust, memory, biography “The traces were still there. But time would slowly blur them and nothing would be left.” Edgar Hilsenrath, Night, 1966– Olga Stefan is a freelance curator, writer, and lecturer originally from Chicago. Since 2009, she is living in Zurich, Switzerland. Before this, from 2005-2008, she was the executive director of the Chicago Artists’ Coalition, and the executive director of Around the Coyote Arts Festival from 1998-2003. She also served as juror for several festivals, shows, and granting agencies and she contributes regularly to ArtReview, Frieze Magazine, Art in America, Flash Art, Sculpture Magazine, Artslant, Artmargins, and TurnOnArt. 1. Freelance curator. [email protected]. OLGA STEFAN Edgar Hilsenrath was born in Halle, Germany, then migrated to Siret, Bukowina with his family in 1941 in order to escape Nazi persecution, only to be deported in 1942 by order of Marshall Ion Antonescu and interned in the ghetto of Mogilyov-Podolski until March 1944, when the Russian troops took over. -

NCJF JF2014.Pdf
17th Annual Film Festival May 1-11 BEFORE THE REVOLUTION FRIENDS FROM FRANCE / Les Interdits KIDON QUALITY BALLS: THE DAVID STEINBERG STORY NEW ENGLAND PREMIERE - Opening Night Film NEW ENGLAND PREMIERE MASSACHUSETTS PREMIERE MASSACHUSETTS PREMIERE Thursday, May 1, 5:30 pm @ Museum of Fine Arts (Remis) Saturday, May 3, 2:30 pm @ Museum of Fine Arts (Remis) Saturday, May 10, 3:00 pm @ Museum of Fine Arts (Remis) Friday, May 2, 6:00 pm @ Museum of Fine Arts (Remis) Opening Night Welcome: Consulate General of Israel to New England Sunday, May 11, 7:30 pm @ West Newton Cinema Sunday, May 11, 5:15 pm @ West Newton Cinema Sunday, May 4, 5:30 pm @ West Newton Cinema Dir: Dan Shadur | Israel | 2013 | 60m | Hebrew & Arabic w/ English subtitles Dir: Anne Weil & Philippe Kotlarski | France/Germany/Canada/Russia | 2013 | 100m | Dir: Emmanuel Naccache | France/Israel | 2014 | 89m | Hebrew & French w/ Eng. sub. Dir: Barry Avrich | Canada | 2013 | 75m | English For thousands of Israelis in the 1960s French, Russian & Hebrew w/ English subtitles A popcorn movie fantasy inspired Jerry Seinfeld, Larry David, and 1970s, Tehran, Iran, was a utopia. In this unique political thriller set in by the 2010 assassination of Hamas Dave Foley, and Martin Short Enjoying close relations with the 1979 inside the deep freeze behind leader Mahmoud al-Mabhouh in contribute to this hilarious Shah’s regime, their paradise was built the Iron Curtain, a young couple, a Dubai hotel room, this comedy must-see documentary. David on construction contracts, weapons Carole (singer/actress Soko) and spy thriller’s Ocean’s Eleven-style Steinberg—aptly described as sales, and oil. -

Le Juif: a Study of the Effectiveness Visual Anti-Semitic Propaganda In
Et derrière: Le Juif : A Study of the Effectiveness Visual Anti-Semitic Propaganda in France, 1940-1944 Kristell Le Goff Professor Beers Honors in History Spring 2010 2 Table of Contents Introduction………………………………………………………………………………………..5 Historiography…………………………………………………………………………………….8 A Brief Look at French Anti-Semitism……………………………………………………….…10 On the Walls of France: The Poster War………………………………………………………...13 The Cinematic Experience: Propaganda on the Big Screen…..………………………………....18 “Le Juif et la France” Exhibit……………………………………………………………………28 Measuring General Effectiveness of Visual Anti-Semitic Propaganda………………………….33 Conclusion……………………………………………………………………………………….41 Bibliography……………………………………………………………………………………..44 3 4 Introduction In Mein Kampf , Adolf Hitler wrote, “Propaganda is a truly terrible weapon in the hands of an expert.” 1 World War II saw the use of propaganda by the most experienced pundits who learned from previous authorities what worked. Joseph Goebbels, the Minister of Propaganda and Public Enlightenment for Hitler’s Nazi government, was inarguably a propaganda expert. Aristotle A. Kallis defines propaganda as “a systematic process of information management geared to promoting a particular goal and to guaranteeing a popular response as desired by the propagandist.” 2 The Nazis proved themselves to be masters of manipulation. Not only did they convince the German people that they would save them from their suffering resulting from World War I, but they also brainwashed them into perpetrating one of the worst crimes against humanity and, what is more, believing they were in the right to do so. The Jewish people have long been oppressed by those in power. They were enslaved by the Egyptians, their temple in Jerusalem was destroyed, their religion was outlawed, and they were expelled out of countries and forced into ghettos. -

The Ipad Is the New Cinema “It Allows Us to Extend the Classroom Beyond
1 Introduction: the iPad is the New Cinema “It allows us to extend the classroom beyond these four walls,” said an English teacher in Roslyn Heights, N.Y. about the Apple iPad2 tablet. 1 Less than a year after Apple unveiled the first iPad to great fanfare in April 2010, the New York Times reported that many American school districts were purchasing them en masse for their classes. Already by January 2011, the New York Public School system had ordered over 2,000 of the devices while the Chicago schools had already financed $450,000 in grants for their acquisition. Teachers and school administrators exuded a palpable enthusiasm for the new device that they claimed was “not just a cool new toy but rather a powerful and versatile tool with a multitude of applications, including thousands of educational uses.”2 During the 2011-12 academic year, a series of online articles claimed that the iPad boosted test scores in math and literacy while Apple’s website boasted that the device was “changing the classroom” through inspiring students’ creativity and promoting hand’s-on learning.3 Such enthusiasm for the iPad may appear almost natural given the historically long connection that Americans have made between their civilization and their sense of 1 Winnie Hu. “Math That Moves: Schools Embrace The iPad.” New York Times, January 4, 2011. http://www.nytimes.com/2011/01/05/education/05tablets.html?pagewanted=all 2 Hu, “Math that Moves.” 3 Courtney Subramanian. “New Study Finds iPads in the Classroom Boost Test Scores.” Time Techland (22 February 2012). -

Jewish Cultural and Intellectual Professionals Murdered in the Holocaust
Jewish Cultural and Intellectual Professionals Murdered in the Holocaust Born in 1892 or 1893 in Vienna, Ernst Bachrich was an Austrian composer, conductor and pianist. Bachrich first studied law at the University of Vienna and then studied music with Carl Prohaska and Carl Lafite. He studied privately with Arnold Schoenberg from June 1916 eventually taking part in Schoenberg's composition seminar. He conducted the Vienna Volksoper from 1920 to 1925 while he also conducted the Jewish sports club orchestra “Hakoah.” In 1928, he became Kapellmeister at the Düsseldorf Theatre and in 1931, he took up the same post in Duisburg. In 1936, he collaborated with Marcel Rubin and Friedrich Wildgans to organize a series of concerts in Vienna, entitled "Music of the Present". Ernst Bachrich Composer, conductor On 15 May 1942, the Nazis deported him to Izbica. He was killed on 10 or and pianist 11 July 1942 in the Majdanek/Lublin concentration camp. 1892-1942 Walter Bendix Schönflies Benjamin (15 July 1892 – 26 September 1940) was a German literary critic, philosopher, social critic, translator, radio broadcaster and essayist. Combining elements of German idealism or Romanticism, historical materialism and Jewish mysticism, Benjamin made enduring and influential contributions to aesthetic theory and Western Marxism, and is associated with the Frankfurt School. Among his major works as a literary critic are essays on Goethe's novel Elective Affinities; the work of Franz Kafka and Walter Benjamin Karl Kraus; translation theory; the stories of Nikolai Leskov; the work of 1892–1940 Marcel Proust and perhaps most significantly, the poetry of Charles Literary Baudelaire. -

THE FILM SOCIETY of LINCOLN CENTER and the JEWISH MUSEUM PRESENT the 24TH ANNUAL NEW YORK JEWISH FILM FESTIVAL January 14-29, 2015
THE FILM SOCIETY OF LINCOLN CENTER AND THE JEWISH MUSEUM PRESENT THE 24TH ANNUAL NEW YORK JEWISH FILM FESTIVAL January 14-29, 2015 Opening Night launches with the U.S. Premiere of Asaf Galay and Shaul Betser’s The Muses of Isaac Bashevis Singer and the Closing Night selection is the New York Premiere of Maxime Giroux’s Felix and Meira Highlights include an Artist Focus on Keren Cytter; the 25th anniversary celebration of Paris Is Burning; films selected by Jennie Livingston; exhibitions of film noir trailers and antiwar film posters; a midnight showing of Breakin’; a screening of The Birdcage in memory of Mike Nichols; and more NEW YORK, NY (December 4, 2014) –The Jewish Museum and the Film Society of Lincoln Center will present the 24th annual New York Jewish Film Festival at the Film Society’s Walter Reade Theater and Elinor Bunin Munroe Film Center, January 14-29, 2015. The festival’s 47 features and shorts from 11 countries—21 screening in their world, U.S., or New York premieres—provide a diverse global perspective on the Jewish experience. The festival includes a number of “beyond the screen” programs, including a presentation of the work of artist Keren Cytter followed by a discussion with Jens Hoffmann, Deputy Director, Exhibitions and Public Programs, the Jewish Museum; continuous screenings of trailers from films noirs; an exhibition of posters for antiwar movies; a midnight showing of the 1980s break-dancing hit, Breakin’; Talking Movies, panel discussions about Zionism and antiwar films; a master class on filmmaking with Susan Korda; and a special screening of the late Mike Nichols’s 1996 comedy, The Birdcage. -
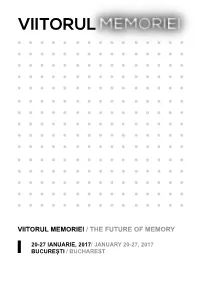
Viitorul Memoriei / the Future of Memory
VIITORUL MEMORIEI / THE FUTURE OF MEMORY 20-27 IANUARIE, 2017/ JANUARY 20-27, 2017 BUCUREȘTI / BUCHAREST „Urmele erau încă acolo. Dar timpul “The traces were still there. But time 20 IANUARIE, VERNISAJ JANUARY 20, EXHIBITION le va şterge încet şi nu va mai rămâne would slowly blur them and nothing EXPOZIȚIE ORA 19.00, CASA VERNISSAGE, 7PM, CASA nimic” – Edgar Hilsenrath would be left.” – Edgar Hilsenrath FILIPESCU-CESIANU, CALEA FILIPESCU-CESIANU, CALEA Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, An avalanche of right-wing extremism, xenophobia, VICTORIEI 151, LA MANSARDĂ VICTORIEI 151, ATTIC LEVEL rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam nationalism, racism and antisemitism is once again că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne sweeping over what we once perceived as open and Atenție! nu există lift. Accesul la mansardă se face pe trepte. Not wheelchair accessible! pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu democratic societies, closing in on us all, imbuing Ore de deschidere: 20-27 ianuarie, 12:00-18:00 Continues from January 20-27, open daily from 12-6pm frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea social relations with ever-increasing fear and hatred of imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice “the other”, an invisible and mostly imagined enemy dominante. De generaţii întregi, metodele utilizate pentru that changes with dominant political interests. For Expoziţia include imagini ale unor lucrări a elimina „istorii incomode” din versiunea oficială a generations, the instruments utilised to eliminate istoriei au inclus marginalizarea şi ştergerea totală a inconvenient narratives from official histories have făcute de artişti de renume internaţional urmelor lăsate de populaţii care perturbă mitologia included marginalisation and complete erasure of all care au trăit sau au fost martori ai dominantă a constructelor identitare naţionale.