Haiti Ou La Democratie Impossible?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Influence of Corporate Interests on USAID's Development Agenda
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 4-2-2012 The nflueI nce of Corporate Interests on USAID's Development Agenda: The aC se of Haiti Guy Metayer Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FI12050218 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Recommended Citation Metayer, Guy, "The nflueI nce of Corporate Interests on USAID's Development Agenda: The asC e of Haiti" (2012). FIU Electronic Theses and Dissertations. 609. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/609 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida THE INFLUENCE OF CORPORATE INTERESTS ON USAID'S DEVELOPMENT AGENDA: THE CASE OF HAITI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in POLITICAL SCIENCE by Guy Metayer 2012 To: Dean Kenneth G. Furton choose the name of dean of your college/school College of Arts and Sciences choose the name of your college/school This dissertation, written by Guy Metayer, and entitled The Influence of Corporate Interests on USAID's Development Agenda: The Case of Haiti, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. _______________________________________ Richard S. Olson _______________________________________ John F. -

Poto Mitan Haitian Women Pillars of the Global Economy
Discussion Guide POTO MITAN HAITIAN WOMEN PILLARS OF THE GLOBAL ECONOMY ³$PRYLQJDQGVWLUULQJILOP VKRZLQJZRPHQVSHDNLQJ IRUWKHPVHOYHV$PXVWVHH´ - Edwidge Danticat Award-winning author of Brother, I’m Dying 7KURXJK¿YH+DLWLDQZRPHQ¶VFRPSHOOLQJOLYHVPoto MitanJLYHVDQLQVLGHU SHUVSHFWLYHRQJOREDOL]DWLRQ+DLWL¶VFRQWHPSRUDU\SROLWLFDOHFRQRPLFFULVLV DQGWKHUHVLOLHQWZRPHQFKDOOHQJLQJWKLVV\VWHP ³(YHU\RQHHOVHKDVVSRNHQIRU+DLWLDQZRPHQ\HWZHKDYHDKLVWRU\RIVSHDNLQJIRURXUVHOYHV,VXSSRUWPoto Mitan EHFDXVHLWRIIHUVXVDUDUHJOLPSVHLQWRKRZ+DLWLDQZRPHQLQWKHVWUXJJOHXQGHUVWDQGWKHLUFRPSOH[FRQGLWLRQVDQG ZKDWWKH\DUHGRLQJIRUWKHPVHOYHV´- Gina Ulysse, Haitian American scholar/activist/performer Table of contents Purpose of the Guide 2 Poto Mitan Program Description 3 Filmmaker Statements 4 Background: Haiti 6 Background: Globalization 7 Planning a Screening 8 Facilitator Guidelines 9 Fundraising Tips 9 Before Viewing the Film 10 A!er Viewing the Film 10 Concepts from the Film to Explore 11 Classroom or Community Activities 12 National Partners and Resources 14 Evaluation 16 Acknowledgments and Credits 17 PURPOSE OF THE GUIDE This guide is designed to facilitate discussions about Poto Mitan: Haitian Women, Pil- lars of the Global Economy in both educational and community settings. It is a tool for community organizers, teachers, labor unions, women’s groups, and solidarity activists to dig deeper into Poto Mitan’s themes of globalization, gender, and labor organizing. Use it to build bridges between these groups and to understand how neoliberal global- ization impacts your own community. -

Haiti's Troubles: Perspectives from the Theology of Work and from Liberation Theology
Loyola University Chicago Loyola eCommons Dissertations (2 year embargo) 5-25-2011 Haiti's Troubles: Perspectives From the Theology of Work and From Liberation Theology Lys Stéphane Florival Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss_2yr Part of the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Florival, Lys Stéphane, "Haiti's Troubles: Perspectives From the Theology of Work and From Liberation Theology" (2011). Dissertations (2 year embargo). 5. https://ecommons.luc.edu/luc_diss_2yr/5 This Dissertation is brought to you for free and open access by Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Dissertations (2 year embargo) by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 2011 Lys Stéphane Florival LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO HAITI‘S TROUBLES: PERSPECTIVES FROM THE THEOLOGY OF WORK AND FROM LIBERATION THEOLOGY A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THEOLOGY BY LYS S. FLORIVAL CHICAGO, ILLINOIS MAY 2011 Copyright by Lys S. Florival, 2011 All rights reserved. ACKNOWLEDGEMENTS This opus has taken form and finally achieved completion through the contributions of so many people that mentioning all would require several pages. Most of them would nevertheless feel happy to be thanked in person. To all of those persons the author wishes to express his sincere gratitude. There are a few people, however, whose invaluable service ought to be acknowledged. -
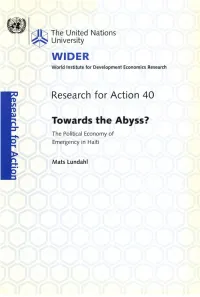
WIDER RESEARCH for ACTION Towards the Abyss?
UNU World Institute for Development Economics Research (UNUAVIDER) Research for Action 40 Towards the Abyss? The Political Economy of Emergency in Haiti Mats Lundahl This study has been prepared within the UNUAVIDER project on the Wave of Emergencies of the Last Decade: Causes, Extent, Predictability and Response, which is co-directed by Professor E. Wayne Nafziger, Senior Research Fellow, and Professor Raimo Vayrynen, University of Notre Dame, Indiana, USA. UNUAVIDER gratefully acknowledges the financial contribution to the project by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the Government of Sweden (Swedish International Development Cooperation Agency - Sida). UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER) A research and training centre of the United Nations University The Board of UNU/WIDER Harris Mutio Mule Sylvia Ostry Jukka Pekkarinen Maria de Lourdes Pintasilgo, Chairperson George Vassiliou, Vice Chairperson Ruben Yevstigneyev Masaru Yoshitomi Ex Officio Heitor Gurgulino de Souza, Rector of UNU Giovanni Andrea Cornia, Director of UNU/WIDER UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER) was established by the United Nations University as its first research and training centre and started work in Helsinki, Finland in 1985. The purpose of the Institute is to undertake applied research and policy analysis on structural changes affecting the developing and transitional economies, to provide a forum for the advocacy of policies leading to robust, equitable and environmentally sustainable growth, and to promote capacity strengthening and training in the field of economic and social policy making. Its work is carried out by staff researchers and visiting scholars in Helsinki and through networks of collaborating scholars and institutions around the world. -

A Comparative Analysis of the Neoliberal Turn in Three Former French Colonies
Power, policy and discourse: a comparative analysis of the neoliberal turn in three former French colonies Harriet Thiery A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Languages and Cultures University of Sheffield January 2020 Abstract This thesis examines the role of the Bretton Woods Institutions (BWIs) in the development of three former French colonies. Comparing the experiences of Chad, Côte d’Ivoire and Haiti, it explores the ways in which the development trajectory of postcolonial countries has been shaped by international institutions and neoliberal ideology. It does this by examining two key periods of development lending: structural adjustment and poverty reduction strategies. Adopting a neo- Gramscian theoretical approach, this study understands neoliberalism as an ideological hegemonic project as well as a development paradigm. It examines both the practical content of the programmes, and the discourse, borrowing methodological insight from Critical Discourse Analysis. The findings reveal important trends across the case studies and over time and are therefore both spatially and temporally significant. Over the thirty-year period, the World Bank and the IMF imposed a common neoliberal policy matrix, which centred on austerity, export markets, deregulation and privatisation. The SAPs undermined the sovereignty of the state, deepened dependency and impeded economic and social development. The poverty reduction strategies, in spite of claims of country-ownership and participation, continued to adhere to the neoliberal formula. Only the discourse evolved, co-opting counter-hegemonic ideals in order to legitimise the further embedding of the neoliberal agenda and the entrenchment of poverty. The approach sheds light upon the interactive relationship between policy, power and discourse, demonstrating how the dynamics of power in these three countries are both coercive and consensual. -

Assessment Mission to Haiti, January 1995
Assessment Mission to Haiti The Carter Center January 1995 Table of Contents 1. Executive Summary 1. Background, Terms of Reference, Schedule 2. The Security Environment 3. The Political climate Setting Elections Truth Commission 4. The Economic Future of the Country 5. Future Problems and a Role for the Council Elections/Democracy Development APPENDICES 1. The Port-au-Prince Agreement, September 18, 1994 2. Letter from Jimmy Carter to President Jean-Bertrand Aristide, October 12, 1994; Letter from President Aristide to Carter, November 10, 1994. 3. The Mission's Schedule of Meetings, December 11-14, 1994 4. "Consensus on Elections by Haitian Political Parties," December 13, 1994 5. Background on the Council of Freely-Elected Heads of Government Executive Summary A mission of the Council of Freely-Elected Heads of Government, an informal group of 25 leaders of the Americas, based at the Carter Center of Emory University, visited Haiti from December 11-14, 1994 at the invitation of President Jean-Bertrand Aristide. The mission was led by Council member and former Jamaican Prime Minister Michael Manley and Dr. Robert Pastor, Executive Secretary of the Council and Director of the Carter Center's Latin American and Caribbean Program. The purpose of the mission was to assess the country's political and economic climate and explore whether the Council could assist in democratic consolidation and economic development. The mission met with the President and Prime Minister, leaders from Parliament, political parties, business, the military, and the international community. The mission concluded that despite severe social, economic, and security problems, Haiti has now the best opportunity in its 200 year history to forge a democracy and construct a free-market economy that will benefit all the nation's people. -

De Dessalines À Duvalier
De Dessalines à Duvalier Race, Couleur et Nation en Haïti David Nicholls Traduit de l’anglais par Max Dorsinville, PhD I Des cendres et de la poussière, Jean-Jacques s’éleva, aigle de bronze, unifiant les damnés du nouveau monde, pour brûler, piller et tailler des traces fraîches dans la jungle noire de la domination blanche. Le fer noir frappe et le sang bleu se répand alors que les armées fuient la colère de l’Africain doré opprimé, qui serait libre…ou mort. W.P. À la mémoire de Mam qui aimait les gens et les livres et m’enseigna de même II Table des Matières Épigraphes Préface de la 3ème édition Préface de la 1ère édition Note sur la terminologie Carte 1 Introduction 2 Les Pères de l’indépendance nationale (1804-1825) 3 Orgueil et préjugés (1820-1867) 4 Libéraux et nationaux (1867-1910) 5 Haïti occupée (1915-1934) 6 Littérature et dogme (1930-1945) 7 Les Authentiques et leurs adversaires (1946-1957) 8 Culture et tyrannie (1957-1971) 9 Conclusion Bibliographie Index III Préface de la 3ème édition Mille neuf cent quatre-vingt-six vit la fin de presque trente ans de la dictature des Duvalier en Haïti lorsque, le 7 février, Jean-Claude (« Baby Doc ») Duvalier prit le chemin présidentiel familier de l’exil. Sa chute résulta dans une large mesure d’une incapacité de composer avec le mouvement grandissant de protestation à travers le pays pendant les trois mois précédents. Le Conseil National de Gouvernement (CNG) qui prit le pouvoir fut apparemment choisi par Duvalier en consultation avec l’ambassade des États-Unis afin de garantir une paisible transition. -

Haiti 2010: Exploiting Disaster1
Haiti 2010: Exploiting Disaster1 By Peter Hallward The following essay is adapted from the Afterword of the 2010 printing of Hallward's 2008 book, ‘Damming the Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment’. (Verso). Just before 5pm on Tuesday 12 January 2010, Haiti's capital city and the surrounding area were devastated by the most catastrophic earthquake in the history of the hemisphere. The scale of the destruction was overwhelming. According to the most widely cited estimates, around 220,000 people perished and more than 300,000 suffered horrific injuries, leading to many thousands of amputations.2 Stories told by the bereaved defy summary. Perhaps as many as 200,000 buildings were destroyed, including 70% of the city's schools. Today, more than half a year after the disaster in which they lost their homes and virtually all their belongings, around 1.5 million people continue to live in makeshift camps with few or no essential services, with few or no jobs, and with few or no prospects of any significant improvement in the near future. Although the earthquake has no precedent in Haitian history, the factors that magnified its impact, and the responses it has solicited, are all too familiar. They are part and parcel of the fundamental conflict that has structured the last thirty years of Haitian history: the conflict between pèp la (the people, the poor) and members of the privileged elite, along with the armed forces and international collaborators who defend them. If the 1980s were marked by the rising flood that became Lavalas, by an unprecedented popular mobilisation that overcame dictatorship and raised the prospect of modest yet revolutionary social change, then the period that began with the military coup of September 1991 is best described as one of the most prolonged and intense periods of counter-revolution anywhere in the world. -
One Year After Duvalier Government of Haiti's
Report to Congress ONE YEAR AFTER DUVALIER GOVERNMENT OF HAITI'S NONCOMPLIANCE WITH THE CONDITIONS FOR FOREIGN ASSISTANCE Volume 3 March 1987 Washington Office on Haiti TABLE OF CONTENTS Page I. Introduction 1 II. Conditions on Economic Support and Development Assistance 4 Special Foreign Assistance Act of 1986 4 Evaluation of the Government of Haiti's Compliance with the 5 Special Foreign Assistance Act of 1986 (1) improving the human rights situation 5 (2) implementing its timetable for completion of a new con- 14 constitution guaranteeing democratic principles (3) establishing a framework for free and open elections 16 including free political parties and association, labor unions, and press (4) cooperating in implementing U.S. economic assistance 21 programs (5) maintaining a system of fiscal accountability 25 (6) investigating alleged human rights abuses and corruption 27 and prosecuting those responsible (7) maintaining a free and independent judiciary system 31 (8) cooperating with the U.S. in halting illegal emigration 33 III. Conditions on Military Assistance 35 Special Foreign Assistance Act of 1986 35 A Problem of Institutional Oppression 36 Evaluation of the Government of Haiti's Compliance with the 39 Special Foreign Assistance Act of 1986 (1) submission of a formal request to the U.S. specifying a 39 plan for the reform and reorganization of the mission, com mand, and control structure of the armed forces (2) (A) preventing che involvement of the armed forces in 41 human rights abuses and corruption by removing from the force and prosecuting those responsible (B) ensuring freedom of speech and assembly 43 (C) conducting investigations into the killings in Gonaives, 49 Martissant, and Ft. -

Jean-Bertrand Aristide and the Lavalas Movement in Haiti Dimmy Herard Florida International University, [email protected]
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 11-9-2016 The olitP ics of Democratization: Jean-Bertrand Aristide and the Lavalas Movement in Haiti Dimmy Herard Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FIDC001196 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the Comparative Politics Commons Recommended Citation Herard, Dimmy, "The oP litics of Democratization: Jean-Bertrand Aristide and the Lavalas Movement in Haiti" (2016). FIU Electronic Theses and Dissertations. 3037. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/3037 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida THE POLITICS OF DEMOCRATIZATION: JEAN-BERTRAND ARISTIDE AND THE LAVALAS MOVEMENT IN HAITI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in POLITICAL SCIENCE by Dimmy Herard 2016 To: Dean John F. Stack, Jr. Steven J. Green School of International and Public Affairs This dissertation, written by Dimmy Herard, and entitled The Politics of Democratization: Jean-Bertrand Aristide and the Lavalas Movement in Haiti, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this thesis and recommend that it be approved. _______________________________________ John F. Stack, Jr. _______________________________________ Chantalle F. Verna _______________________________________ Clement Fatovic _______________________________________ Ronald W. Cox, Major Professor Date of Defense: November 9, 2016 The dissertation of Dimmy Herard is approved. -

Haiti Update
HAITI UPDATE Donald E. Schulz January 29, 1997 ******* Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA 17013-5050. Comments may also be conveyed directly to the author by calling commercial (717) 245-4123 or DSN 242-4123. Copies of this report may be obtained from the Publications and Production Office by calling commercial (717) 245-4133, DSN 242-4133, FAX (717) 245-3820, or via the Internet at [email protected]. ******* All Strategic Studies Institute (SSI) monographs are loaded on the Strategic Studies Institute Homepage for electronic dissemination. SSI's Homepage address is: http://carlisle- www.army.mil/usassi/ ******* The author wishes to thank Ambassador William Swing, Major Joseph Bernadel and Mr. Eric Falt for the assistance they gave during his recent trip to Haiti. During that visit, he spoke with many people, including U.S., Haitian and other nationals. In addition, Ms. Rachel Neild provided much useful information. Finally, Ms. Neild, Dr. Gabriel Marcella, Dr. Steven Metz and Colonel Richard Witherspoon all provided substantive criticism of the manuscript. Needless to say, the views expressed in this report are entirely the author's and do not necessarily reflect the position of the U.S. Government, the American Embassy, the Department of Defense or the U.S. Army War College. Any errors of omission or commission are entirely the author's responsibility. ii FOREWORD Recent developments in Haiti including political assassinations attributed to both former Haitian military personnel and members of President Preval's presidential security unit have once again thrust that troubled country into the international spotlight. -

The International Monetary Fund and the Neoliberal Revolution in the Developing World
CREATING CREDIBILITY: THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE NEOLIBERAL REVOLUTION IN THE DEVELOPING WORLD A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Stephen Craig Nelson August 2009 © 2009 Stephen Craig Nelson CREATING CREDIBILITY: THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE NEOLIBERAL REVOLUTION IN THE DEVELOPING WORLD Stephen Craig Nelson, Ph.D. Cornell University 2009 The International Monetary Fund (IMF) has been deeply involved in economic governance in developing countries through its conditional lending since the late 1970s. Despite the importance of the IMF in the economic and political life of its borrowers, we have, at best, an incomplete understanding of the roots of the institution’s behavior. This dissertation attempts to answer some important questions about the IMF’s lending activities, namely: why is there so much variation in the IMF’s treatment of its borrowers? I argue that the IMF is best viewed as a purposive actor driven by a set of economic ideas. These ideas shape the way the institution’s staff and management make decisions about the use of its resource in complex and unsettled political and economic circumstances. The IMF has political preference for policy teams composed of likeminded officials. I use new data to test the argument on three aspects of IMF treatment; the cross-national evidence shows that governments with a higher proportion of neoliberal policymakers receive larger loans with fewer binding conditions and are more likely to receive waivers for missed policy targets. Further, I show that the ability of top neoliberal economic officials to deliver better treatment from the IMF enables them to extend their time in office.