L'oeuvre Educative De Jeanne De Lestqnnac
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
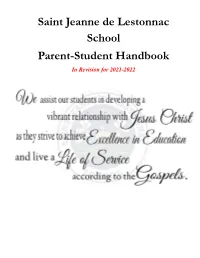
Mark up of Parent-Student Handbook
Saint Jeanne de Lestonnac School Parent-Student Handbook In Revision for 2021-2022 Table of Contents Table of Contents SAINT JEANNE DE LESTONNAC FOUNDRESS SISTERS OF THE COMPANY OF MARY OUR LADY SAINT JEANNE DE LESTONNAC SCHOOL HISTORY PHILOSOPHY AND MISSION STATEMENTS Philosophy Statement Mission Statement SCHOOLWIDE LEARNING EXPECTATIONS ADMISSIONS Non-Discrimination Statement Financial Commitment Conditions for Enrollment 2021-2022 STUDENT TUITION AND FEES Registration Fees 2021-2022 Explanation of Fees Tuition & Fees for the 2021-2022 School Year Full Time Preschool, Prekindergarten & Kindergarten Grades 1 -8 Technology Fee Annual Development/Building Fee per Family per Year Home and School Support Pledge Eighth-Grade Student Graduation Fee Method of payment for all fees: Tuition Assistance California State Licensing Requirements CURRICULUM AND ACADEMIC POLICIES Sacramental Preparation General Curriculum: Assessments and Reporting Growth Standards Based Grading Proficiency Scale Non-Academic Factors (Behavior and Responsibility) Regarding Extra Credit, Answer Guides, Study Guides, etc. 2 Back to Table of Contents Physical Education Policy ACADEMIC SUPPORT SERVICES Responsible Teachers Intervening Initiative Learners with Special Needs Student Support Services Tutoring Challenging the Academically Gifted Learner Benchmark Assessments MONITORING ACADEMIC PROGRESS Learning Management System (LMS) Christian Citizenship Award (Grades K-8) Official End-of-Year Report Cards EDUCATIONAL STUDY TRIPS HOME AND SCHOOL ASSOCIATION HEALTH Covid-19 -
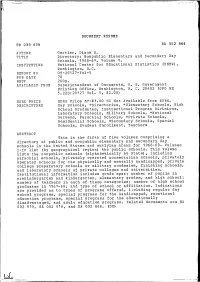
Directory: Nonpublic Elementary and Secondary Day Schools, 1968-69
DOCUMENT RESUME ED 039 634 EA 002 864 AUTHOR Gertler, Diane B. TITLE Directory: Nonpublic Elementary and Secondary Day Schools, 1968-69. Volume V. INSTITUTION National Center for Educational Statistics (DHEW) , Washington, D.C. REPORT NO 0E-20127-Vol-5 PUB DATE 70 NOTE 260p. AVAILABLE FROM Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402 (GPO HE 5.220:20127 Vol. V, $2.00) EDRS PRICE EDRS Price MF-$1.00 HC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Day Schools, *Directories, *ElementarySchools, High School Graduates, Instructional Program Divisions, Laboratory Schools, Military Schools, *National Surveys, Parochial Schools, *Private Schools, Residential Schools, *Secondary Schools, Special Schools, Student Enrollment, Teachers ABSTRACT This is the fifth of five volumes comprising a directory of public and nonpublic elementary andsecondary day schools in the United States and outlying areas for1968-69. Volumes I-IV list(by geographical region) the public schools. Thisvolume lists the nonpublic schools (alphabetically by State),including parochial schools, privately operated nonsectarianschools, privately operated schools for the physically and mentallyhandicapped, private college preparatory schools or military academies,finishing schools, and laboratory schools of private colleges anduniversities. Institutional information includes grade span; numberof pupils in prekindergarten and kindergarten, elementary grades, andhigh school; number of teachers in each of these categories;number of high school graduates in 1967-68; and type of school or affiliation.Indications are provided as to types of programsoffered, Licluding regular day school programs, special programs for thehandicapped, vocational education programs, special programs for theeducationally disadvantaged, and adult education programs. Relateddocuments are EA 002 919, EA 002 918, and EA 002 866. -
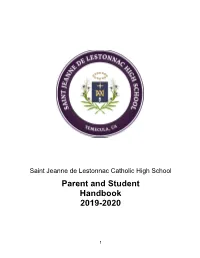
Parent and Student Handbook 2019-2020
Saint Jeanne de Lestonnac Catholic High School Parent and Student Handbook 2019-2020 1 Table of Contents Introduction 6 Mission Vision Integral Student Outcomes Curriculum Overview Education Beyond Borders History Contact 10 Office Hours Phone Numbers School Address Web Address College Board Identification Number E-Mail School Personnel 11 Leadership Team Student Services Directors School Personnel Faculty Section I: Admission and Enrollment 12 Non-discrimination Policy Admission International Student Admission Special Needs Student Admission Enrollment Re-enrollment Right to Withdraw International Student Guardian and/or Host Family Freshmen Admission Transfer Student Admission Section II: Tuition and Financial Policies 15 Tuition & Fees Student Expenses Financial Policies Withdrawal and Refund Policy Financial Assistance Scholarship Resources Section III: School Culture 19 Saint Jeanne de Lestonnac Catholic High School Student Standards Building a Culture of Responsibility Human Sexuality in the Catholic Context Student Use of Facilities 2 Section IV: Curriculum and Instruction 22 College Preparatory Curriculum Summer Session Assessment Learning Modalities Monitoring Student Progress Academic Formation Policy Academic Eligibility Academic Integrity Academic Probation No "F" Policy Students with Disabilities Final Examinations Honor Roll Outside Courses Community Service Graduation Requirements Section V: Student Programs and Services 33 Campus Ministry – Ministry of Magis Confirmation Lunch Program House/Mentor Program Associated Student -

Catholic Archives 1992
Catholic Archives 1992 Number 12 THE JOURNAL OF The Catholic Archives Society CATHOLIC ARCHIVES No. 12 1992 CONTENTS Editorial Notes 2 Sorting Religious Archives P. HUGHES 3 The Archives of the English Province of the Servite Fathers S. FOSTER, OSM 17 The Church Missionary Society Archives: or Thirty Years Work in the Basement R. KEEN 21 Association of Church Archivists of Spain 31 My Browne Heaven: The Father Browne Collection E. E. O'DONNELL, SJ 32 The Records of the Converts’ Aid Society R. RENDEL 39 Catholic Archives in the Netherlands: The Legacy of 'Glorious Roman Life' J.VANVUGT 42 The Archives of the Company of Mary Our Lady (O.D.N.) M. SMITH, ODN 49 Course for Monastic Archivists, 1991 E. R. OBBARD, OCD 52 Some Nineteenth Century Papers in the Sydney Archdiocesan Archives F. CARLETON 56 The Religious Archives Group Conference, 1991 L. E. BOSWORTH 58 The Catholic Archives Society Conference, 1991 59 Address by the Pope to the Sixth International Church Archives Day in Rome, 1991 60 Association of Church Archivists of Ireland LEO LAYDEN, CSSp 61 Book Reviews: 62 Historical Archives of the Company of Mary Our Lady 1607-1921, Pilar Foz y Foz, ODN T. G. HOLT, SJ Irish Church History Today, R. O Muiri J. A. WATT Illustrations: The Feast of Corpus Christi, Warley Barracks, 1919 34 Children at Dorling Downs, New South Wales, 1925 36 Course for Monastic Archivists 1991: cartoon sketches 53, 54. EDITORIAL NOTES The Society can perhaps reasonably claim, even after only thirteen years’ work, to be the principal body representing the interests of Roman Catholic Church archi vists in the United Kingdom, To a large extent it has succeeded by adhering to its main objectives, namely the care, preservation and use of the Church's religious, diocesan and other archives, and by responding to the expressed needs of its members. -

May 10, 2020 Fifth Sunday of Easter
May 10, 2020 Fifth Sunday of Easter Served by CLARETIAN MISSIONARIES MISIONEROS CLARETIANOS Sons of the Immaculate Heart of Mary Fr. Irudayaraj John Britto, Ǔǝǖ Pastor Fr. Ralph Berg, Ǔǝǖ Associate Fr. Vicente Montiel Romero, Ǔǝǖ Associate Fr. Gerald Caffrey, Ǔǝǖ in Residence DEACONS/DIACONO Deacon Pete Balland Deacon Joe Bueti Deacon Ernie Gonzales Deacon Tom Gregory (Retired) Deacon Tony Humphrey (Retired) Deacon Tom Kayser (Retired) PARISH OFFICE HOURS Weekdays: 8:00am to 5:00pm HORAS DE OFICINA Dias de la Semana: 8:00am to 5:00pm Jesus said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” —John 14:6 “Being the living example of God’s love to others” 150 Fleury Street † Prescott, AZ 86301 † Phone: (928) 445-3141 † Fax: (928) 717-1074 Website: www.sacredheartprescott.com † Email: [email protected] This Week Page 2 SACRED HEART CATHOLIC SCHOOL - PRESCHOOL TO 8th GRADE Principal: Shelly Cooper Preschool Director: Parish Manager: 131 N. Summit Ave. (928) 445-2621 Janice Richards Jim Wren E-mail: [email protected] (928) 445-3141 Ext. 318 (928) 445-3141 Ext. 302 www.sacredhearteducation.com E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Nǟ ǕǦǕǞǤǣ ǣǓǘǕǔǥǜǕǔ ǑǤ ǤǘǙǣ ǤǙǝǕ MǑǣǣ ǧǙǜǜ ǒǕ ǔǑǙǜǩ LǙǦǕ SǤǢǕǑǝǙǞǗ ǑǤ 9:00Ǒǝ ǟǞ FǑǓǕǒǟǟǛ. Aǜǜ ǣǓǘǕǔǥǜǕǔ MǑǣǣ IǞǤǕǞǤǙǟǞǣ ǑǢǕ ǣǤǙǜǜ ǒǕǙǞǗ ǠǢǑǩǕǔ ǖǟǢ ǑǤ ǤǘǕ ǜǙǦǕ ǣǤǢǕǑǝǙǞǗ MǑǣǣ. MǑǣǣ IǞǤǕǞǤǙǟǞǣ RǕǑǔǙǞǗǣ ǖǟǢ ǤǘǕ WǕǕǛ ǟǖ IǞǤǕǞǓǙǟǞǕǣ ǔǕ LǑ MǙǣǑ May 10, 2020 May 11 to May 17, 2020 Acts 6:1-7/Ps 33:1-2, 4-5, 18-19 [22]/1 Pt 2:4-9/ Mon. -

La Purísima Catholic School Home and School Parent Handbook
La Purísima Catholic School Home and School Parent Handbook Parent Handbook August 2018 - 2019 Table of Contents Page Life of Saint Jeanne De Lestonnac 1 School Mission Philosophy 3 Schoolwide Learning Expectations 3 Education Partnership 4-5 ● Maintaining Proper Lines of Communication ● Parents as Partners ● Parent Communication General Policies 5-7 ● Safe Environment ● Child Abuse Reporting Obligations ● Confidentiality ● Code of Christian Conduct Covering Students and Parents/Guardians ● Recommended Transfer Resulting from Parental Attitude ● Respect of Teachers and School Staff Admission Procedure 7-8 ● Academic Requirements ● Priority Listing for Acceptance ● Requirements Student Records 8 ● Record Inspection ● Record Transfer School Hours 8-9 ● Early Dismissal Minimum Days 9 Tuition Program 9-10 ● Annual Registration ● Tuition Payments ● Tuition Assistance Program ● 10 Hours of Required Parent Participation ● Scrip ● Educational Study Trip Fees ● Payments and Returned Checks ● Nonpayment of Tuition Appointments 10 ● Teachers, Staff, or Principal After School Extended Care 11-12 Food Services 12 ● Lunch Program Procedures 12-13 ● Lockers ● Lost and Found ● Electronics and Equipment from Home ● Parent Directory ● Birthday Celebrations LPCS HANDBOOK 8/27/18 Page Curriculum and Academic Policies 13-20 ● Curriculum ● Academic Policies ● Progress Reports ● Parent-Teacher Conferences ● Principal’s Honor Roll and Honor Roll ● Homework ● Retention ● Promotion and Graduation Requirements ● Testing ● Physical Education Policies ● Learning -

St. Jeanne De Lestonnac
St. Jeanne de Lestonnac Daily Saints / Saints Fuente: Catholicsaints.info Foundress of the Congregation of the Sisters of the Company of Mary. Roman Martyrology: In Bordeaux, France, St. Jeanne de Lestonnac, who, as a child, refused the invitation and efforts of her mother to draw her away from the Catholic Church and, being widowed and after educating her five children, founded the Society of the Sisters of the Company of Mary, in imitation of the Society of Jesus, Christian education for girls (1640 ) . Canonization date: May 15, 1949 by Pope Pius XII SHORT BIOGRAPHY Born December 27, 1556 at Bourdeaux, France. She married Gaston de Montferrant, Baron of Landiras, in 1572 at age 16. Mother of seven, five of whom lived to adulthood; two of the five entered religious life. Widowed at age 41, she ran the affairs of her estate and castle by herself. Believing that her obligations to the world were finished, she entered a Cistercian house at Toulouse, France at age 46. She was not up to the rigors of the order’s discipline, became seriously ill, and wanted to die at the monastery; her superiors refused to allow it. On her last night at the monastery, she had a vision of Mary who presented an image of Jeanne helping lost children. Returning to her estate, she slowly started this work with local women and priests which led to the foundation of the Sisters of the Company of Mary, devoted to the education of girls and slowing Calvinism. It was approved by Pope Paul V on 7 April 1607; Joan was elected superior in 1610. -

February 4, 2018 Fifth Sunday in Ordinary Time
Sunday, February 4, 2018 Fifth Sunday in Ordinary Time Spotlight on our parish churches: St. Joseph p. 5 New Adult Faith Formation Programs ~ Register Now! p. 6 St. Monica Prayer Group meets this Wednesday at St. Matthew's p. 7 Parish information Our Priests and Deacons Pastor: Rev. Frank J. Murray Parochial Vicar: Rev. Anthony Cipolle Rev. Apolinary Kavishe, AJ; Rev. Robert Tumwekwase, A.J. (hospital chaplains) Deacons: Rev. Mr. Timothy Dougherty and Rev. Mr. Michael Whalen Retired, living in the parish: Rev. Rudolph Leveille; Rev. Roland Nadeau Saint Paul the Apostle Parish Office [hours: M-F 8am-5pm] 217 York Street, Bangor ME 04401 Telephone: 207-217-6740 Fax: 207-217-6730 Our Parish Churches WEBSITE: https://stpaulbangor.me Email: [email protected] St. Gabriel’s Church Bulletin Email: [email protected] 435 South Main Road Winterport, ME 04496 Weekly Mass and Confession Schedule St. John’s Church Weekend Masses Weekday Masses Confessions 207 York Street Saturday Monday through Friday Friday Bangor, ME 04401-5442 4:00 p.m. St. John 8:30 a.m. St. Mary 4:45 p.m. St. Matthew 4:00 p.m. St. Joseph 5:30 p.m. St. Matthew Saturday St. Joseph’s Church Sunday Wednesday 2:30 p.m. St. John 531 North Main Street 7:00 a.m. St. Mary 9:30 a.m. St. John Brewer, ME 04412-1219 3:00 p.m. St. Joseph 8:30 a.m. St. Gabriel (when All Saints 8:30 a.m. St. Mary Catholic School is in Sunday St. Mary’s Church 10:30 a.m. -

St. Jeanne De Lestonnac Catholic.Net
St. Jeanne de Lestonnac Catholic.net Foundress of the Congregation of the Sisters of the Company of Mary. Roman Martyrology: In Bordeaux, France, St. Jeanne de Lestonnac, who, as a child, refused the invitation and efforts of her mother to draw her away from the Catholic Church and, being widowed and after educating her five children, founded the Society of the Sisters of the Company of Mary, in imitation of the Society of Jesus, Christian education for girls (1640 ) . Canonization date: May 15, 1949 by Pope Pius XII SHORT BIOGRAPHY Born December 27, 1556 at Bourdeaux, France. She married Gaston de Montferrant, Baron of Landiras, in 1572 at age 16. Mother of seven, five of whom lived to adulthood; two of the five entered religious life. Widowed at age 41, she ran the affairs of her estate and castle by herself. Believing that her obligations to the world were finished, she entered a Cistercian house at Toulouse, France at age 46. She was not up to the rigors of the order’s discipline, became seriously ill, and wanted to die at the monastery; her superiors refused to allow it. On her last night at the monastery, she had a vision of Mary who presented an image of Jeanne helping lost children. Returning to her estate, she slowly started this work with local women and priests which led to the foundation of the Sisters of the Company of Mary, devoted to the education of girls and slowing Calvinism. It was approved by Pope Paul V on 7 April 1607; Joan was elected superior in 1610. -

Chemin D'éducation : Sur Les Traces De Jeanne De Lestonnac
CHEMIN D'ÉDUCATION sur les traces de Jeanne de Lestonnac 1556-1640 C.L.D 42, av. des Platanes 37170 CHAMBRAY IMPRIMI POTEST Rome, le 21 novembre 1984 Maria Dolores Lasheras o.d.n. Françoise/SOURY-LAVERGNE CHEMIN D'ÉDUCATION sur les traces de Jeanne de Lestonnac 1556-1640 C.L.D ABREVIATIONS A.D.G. Archives Départementales de la Gironde A.N. Archives Nationales A.O.D.N. Archives de l'Ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame D.S. Dictionnaire de Spiritualité H.O. Histoire de l'Ordre des Religieuses Filles de Notre-Dame (Bouzonnie) O.D.N. Ordinis Dominae Nostrae (Sigle de l'Ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame) PRÉFACE Jeanne de Lestonnac (1556-1640), fille de Richard de Lestonnac, conseiller au Parlement de Bordeaux, et de Jeanne Eyquem de Montaigne, sœur de Michel, l'auteur des Essais, occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Eglise et dans l'histoire universelle. Elle appartenait à ce milieu humaniste qui a donné à une société en recherche de son identité et de sa vocation, les bases intellectuelles et spirituelles sur lesquelles nous avons vécu jusqu'à nos jours, et qui sur bien des points subsisteront à travers les crises de notre temps. Educatrice, elle a ouvert de nouvelles voies à la formation des intelligences et des cœurs. Elle a contribué puissamment à découvrir les moyens de tirer l'éducation des femmes d'une confusion mentale trop longtemps prolongée. A cette fin, elle a recueilli les expériences tâtonnantes faites jusque là. -

Les Châteaux De Landiras Et De Montferrand and Their Seigneurial Families —Part One: Setting, Medieval History, and Genealogy
Advances in Historical Studies 2013. Vol.2, No.2, 81-93 Published Online June 2013 in SciRes (http://www.scirp.org/journal/ahs) http://dx.doi.org/10.4236/ahs.2013.22012 Les Châteaux de Landiras et de Montferrand and Their Seigneurial Families —Part One: Setting, Medieval History, and Genealogy Donald A. Bailey Department of History, University of Winnipeg Winnipeg, Manitoba Canada Email: [email protected] Received March 25th, 2013; revised April 27th, 2013; accepted May 5th, 2013 Copyright © 2013 Donald A. Bailey. This is an open access article distributed under the Creative Commons At- tribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Apart from Arnaud Communay’s “Genealogical Essay”, as he himself noted (1889: v), the Montferrands of the Bordeaux region have been neglected.1 The present approach to their history initiated in research on the Château de Landiras, whose baronial family tended to heiresses until one of them married a Montfer- rand. So began a four-century association of the “first and second baronies of Guyenne”! This first part will describe the socio-geographical settings of the two branches, some of their medieval experiences, and then proceed to presenting the combined genealogies—a task not previously attempted. The second part will narrate their respective and blended subsequent histories. Keywords: Montferrand de Guyenne; Landiras; Saint Jeanne de Lestonnac; Bordeaux; Hundred Years’ War; French Revolution; Bertrand III; Pierre II; Lesparre; de Goth; de la Roque-Budos; Communay; Graves Wine Geographical Setting remain (Jouannet, 1837: I, 275; cited in Communay: lxxiv, n. -
Catholic Stewardship
International Catholic Stewardship Council CATHOLIC STEWARDSHIP May 2020 • e-Bulletin The Holy Spirit Gives Us Strength This year, the Church celebrates the great feast of Pentecost on May 31. A STEWARDSHIP PRAYER for May As recounted in the second chapter of the Acts of the Apostles, Pentecost occurred when the followers of Jesus Gracious and Loving God, were, filled with fear, clustered together in a room and were suddenly surprised by the dynamic presence of the When your Spirit descended Holy Spirit in their midst. Strong wind and flame seemed upon the apostles at Pentecost, to sweep the room, and the Apostles were so filled with the they spoke the languages of those gifts of the Spirit that they emerged with new confidence, who came to hear their testimony. energy and a newly discovered strength. They experienced They proclaimed a new covenant a new life in the Holy Spirit. in Christ Jesus, sanctified by his blood, bound by the Holy Spirit, and sealed in the waters of baptism. We give you thanks and praise for releasing your Spirit upon us; and in these uncertain times pray that it will break through the many barriers that divide people. Let your Spirit open our eyes as a communion of faith to your ongoing presence among us, so we can recognize you when we serve one another. In our secular culture, Pentecost goes largely unobserved. “Pentecost” cards don’t pop up on store Let your Spirit open our minds shelves weeks in advance, and there’s no merchandising so that we may gain the wisdom that remotely compares to Easter and Christmas.