09-Mercader 491.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

And Interspecific Variation in the Intestinal Microbiomes Of
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/864439; this version posted December 5, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Metagenomic shotgun analyses reveal complex patterns of 2 intra- and interspecific variation in the intestinal 3 microbiomes of codfishes 4 5 6 Even Sannes Riiser1*, Thomas H.A. Haverkamp1,2, Srinidhi Varadharajan1, 7 Ørnulf Borgan3, Kjetill S. Jakobsen1, Sissel Jentoft1 and Bastiaan Star1* 8 9 1Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences, 10 University of Oslo, PO Box 1066, Blindern, N-0316 Oslo, Norway. 11 12 2Present Address: Department of Epidemiology, Norwegian Veterinary Institute, 13 Oslo, Norway 14 15 3Department of Mathematics, University of Oslo, PO Box 1053, Blindern, N- 16 0316 Oslo, Norway. 17 18 19 * Correspondence 20 Even Sannes Riiser*: [email protected] 21 Bastiaan Star*: [email protected] 22 23 24 Abstract 25 The relative importance of host-specific selection or environmental factors in 26 determining the composition of the intestinal microbiome in wild vertebrates 27 remains poorly understood. Here, we use metagenomic shotgun sequencing of 28 individual specimens to compare the intra- and interspecific variation of 29 intestinal microbiome communities in two ecotypes (NEAC and NCC) of 30 Atlantic cod (Gadus morhua) –that have distinct behavior and habitats– and 31 three Gadidae species that occupy a range of ecological niches. Interestingly, we 32 find significantly diverged microbiomes amongst the two Atlantic cod ecotypes. -

399 4. Bibliography
click for previous page 399 4. BIBLIOGRAPHY Alcock, A., 1889. Natural history notes from H.M. Indian Marine Survey Steamer “Investigator”, Commander Alfred Carpenter, R.N., D.S.O., commanding No. 13. On the bathybial fishes of the Bay of Bengal and neighboring waters, obtained during the seasons 1885-1889. Ann.Mag.Nat.Hist., ser. 6,6(23):376-399 .................., 1891. On the deep-sea fishes collected by the “Investigator” in 1890-1891. Ann.Mag.Nat.Hist., ser. 6,8:16-34; 119-138, pls vii-viii .................., 1899. A descriptive catalogue of the Indian deep-sea fishes in the Indian Museum. Being a revised account of the deep-sea fishes collected by the Royal Indian Marine Survey ship Investigator. Calcutta, Indian Museum, 211 pp. Allen, M.J. & G.8. Smith, 1988. Atlas and zoogeography of common fishes in the Bering Sea and Northeastern Pacific. NOAA Tech.Rep. NMFS, 66: 151 pp. Altukhov, K.A., 1979. O razmnozheznii i razvitii saiki Boreogadus saida (Lepechin) v Belom More. (The reproduction and development of the Arctic cod, Boreogadus saida, in the White Sea.) Vopr.lkhtiol.. 19(5):874-82 (J.Ichthyol., 19(5):93-101) Amaoka, K. et al. (eds), 1983. Fishes from the north-eastern Sea of Japan and the Okhotsk Sea off Hokkaido. Japan Fisheries Resource Conservation Association. Tokyo. 371 pp. Andriashev, A.P., 1954. Fishes of the northern seas of the USSR. Keys to the fauna of the USSR. Zool.lnst.USSR Acad.Sci., 53. Moscow-Leningrad, 617 p. (Transl. for Smithsonian Inst. and Nat.Sci.Found., by Israel Program for Sci.Transl., 1964) ...................., 1965. -
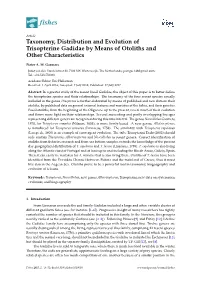
Taxonomy, Distribution and Evolution of Trisopterine Gadidae by Means of Otoliths and Other Characteristics
fishes Article Taxonomy, Distribution and Evolution of Trisopterine Gadidae by Means of Otoliths and Other Characteristics Pieter A. M. Gaemers Joost van den Vondelstraat 30, 7103 XW Winterswijk, The Netherlands; [email protected]; Tel.: +31-543-750383 Academic Editor: Eric Hallerman Received: 1 April 2016; Accepted: 7 July 2016; Published: 17 July 2017 Abstract: In a greater study of the recent fossil Gadidae, the object of this paper is to better define the trisopterine species and their relationships. The taxonomy of the four recent species usually included in the genus Trisopterus is further elaborated by means of published and new data on their otoliths, by published data on general external features and meristics of the fishes, and their genetics. Fossil otoliths, from the beginning of the Oligocene up to the present, reveal much of their evolution and throw more light on their relationships. Several succeeding and partly overlapping lineages representing different genera are recognized during this time interval. The genus Neocolliolus Gaemers, 1976, for Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855), is more firmly based. A new genus, Allotrisopterus, is introduced for Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758). The similarity with Trisopterus capelanus (Lacepède, 1800) is an example of convergent evolution. The tribe Trisopterini Endo (2002) should only contain Trisopterus, Allotrisopterus and Neocolliolus as recent genera. Correct identification of otoliths from fisheries research and from sea bottom samples extends the knowledge of the present day geographical distribution of T. capelanus and T. luscus (Linnaeus, 1758). T. capelanus is also living along the Atlantic coast of Portugal and at least up to and including the Ría de Arosa, Galicia, Spain. -

Otolith Stratigraphy of Late Weichselian and Holocene Sediments of Malangsdjupet, Off Northem Norway
Otolith stratigraphy of Late Weichselian and Holocene sediments of Malangsdjupet, off northem Norway PIETER A. M. GAEMERS & TORE O. VORREN Gaemers, P. A. M. & Vorren, T. 0.: Otolith stratigraphy of Late Weichselian and Holocene sediments of Malangsdjupet, off northern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 65, pp 187-199. Oslo 1985. ISSN 0029-196X. Otoliths of eleven fish species have been identified in cores recovered from the trough Malangsdjupet (dose to 70°N) on the Norwegian continental shelf. The codfish family (Gadidae) dominates with eight species. Three acmc-zones bclonging to the Mer/angius merlangus Lineage-Zone are establishcd: the Boreogadus sp. Acme-Zone (about 15,000 or 14,000 to 10,000 years B. P.), the Neocolliolus esmarki Acme-Zone (10,000 to 7,800 years B. P.) and the Micromesistius poutassou Acme-Zone (7,800B. P. to present). The Boreogadus sp. Acme-Zone reflects an arctic environment while the two others reflect boreal conditions. The M. poutassou Acme-Zone represents a more oceanic environment than the carly Holocene N. esmarki Acme-Zone. P. A. M. Gaemers, Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden, the Netherlands. T. O. Vorren, Institute of Biology and Geology, University of Tromsø, P. O. Box 3085 Guleng, N-9001 Tromsø, Norway. Studies of otoliths from the present sea floor and Material and methods the youngest Quaternary sediments are few in number. Jensen (1905) described otoliths from Twenty-seven gravity cores (diameter 100 mm) an area between Jan Mayen, Iceland and the from ten stations (Fig. lB) were investigated for Faroes, and many years later Wigley & Stinton otoliths. -
Svenska Strålfeniga Fiskar Actinopterygii. De Svenska Namnen Fastställda Av Kommittén För Svenska Djurnamn 100319 (Korr
Svenska strålfeniga fiskar Actinopterygii. De svenska namnen fastställda av Kommittén för svenska djurnamn 100319 (korr. 101108 + 101112 + 101117+ 101125) Ordning Familj Art Svenskt namn Kommentarer Acipenseriformes störartade fiskar 101108: störartade fiskar överflyttade från broskfiskslistan Acipenseridae störar Acipenser baeri sibirisk stör Acipenser gueldenstaedtii rysk stör 101117: Artepitet ändrat från gueldenstaedti Acipenser oxyrinchus atlantisk stör Ändrad från tidigare förslag, atlantstör, analogt med sibirisk stör och rysk stör Acipenser sturio europeisk stör Ändrad från tidigare förslag, europastör, analogt med sibirisk stör och rysk stör Anguilliformes ålartade fiskar Anguillidae egentliga ålar Anguilla anguilla ål Nemichthyidae skärfläcksålar Nemichthys scolopaceus trådål Congridae havsålar Conger conger havsål Clupeiformes sillartade fiskar Clupeidae sillfiskar Alosa alosa majfisk Alosa fallax staksill Clupea harengus sill Sardina pilchardus sardin Sprattus sprattus skarpsill Engraulididae ansjovisfiskar Engraulis encrasicolus ansjovis Cypriniformes karpartade fiskar Cyprinidae karpfiskar Abramis ballerus faren Abramis bjoerkna björkna Abramis brama braxen Abramis vimba vimma Alburnus alburnus löja Kallas även benlöja. Aspius aspius asp Carassius carassius ruda Ctenopharyngodon idellus gräskarp Cyprinus carpio karp Gobio gobio sandkrypare Hypophthalmichthys nobilis marmorkarp Leucaspius delineatus groplöja Leuciscus idus id Leuciscus leuciscus stäm Pelecus cultratus skärkniv Phoxinus phoxinus elritsa Rutilus rutilus mört -

And Interspecific Variation in the Intestinal Microbiomes Of
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/864439; this version posted December 5, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Metagenomic shotgun analyses reveal complex patterns of 2 intra- and interspecific variation in the intestinal 3 microbiomes of codfishes 4 5 6 Even Sannes Riiser1*, Thomas H.A. Haverkamp1,2, Srinidhi Varadharajan1, 7 Ørnulf Borgan3, Kjetill S. Jakobsen1, Sissel Jentoft1 and Bastiaan Star1* 8 9 1Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences, 10 University of Oslo, PO Box 1066, Blindern, N-0316 Oslo, Norway. 11 12 2Present Address: Department of Epidemiology, Norwegian Veterinary Institute, 13 Oslo, Norway 14 15 3Department of Mathematics, University of Oslo, PO Box 1053, Blindern, N- 16 0316 Oslo, Norway. 17 18 19 * Correspondence 20 Even Sannes Riiser*: [email protected] 21 Bastiaan Star*: [email protected] 22 23 24 Abstract 25 The relative importance of host-specific selection or environmental factors in 26 determining the composition of the intestinal microbiome in wild vertebrates 27 remains poorly understood. Here, we use metagenomic shotgun sequencing of 28 individual specimens to compare the intra- and interspecific variation of 29 intestinal microbiome communities in two ecotypes (NEAC and NCC) of 30 Atlantic cod (Gadus morhua) –that have distinct behavior and habitats– and 31 three Gadidae species that occupy a range of ecological niches. Interestingly, we 32 find significantly diverged microbiomes amongst the two Atlantic cod ecotypes. -

Recognition and Distribution of Two North Atlantic Gadiculus Species, G
Article Recognition and Distribution of Two North Atlantic Gadiculus Species, G. argenteus and G. thori (Gadidae), Based on Otolith Morphology, Larval Pigmentation, Molecular Evidence, Morphometrics and Meristics Pieter A. M. Gaemers 1,* and Jan Y. Poulsen 2 1 Department, University, Joost van den Vondelstraat 30, Winterswijk 7103 XW, The Netherlands 2 Department of Fish and Shellfish, Pinngortitaleriffik (Greenland Institute of Natural Resources), Kivioq 2, Post box 570, Nuuk 3900, Greenland; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +31-543-750-383 Academic Editor: Maria Angeles Esteban Received: 28 July 2017; Accepted: 3 August 2017; Published: 29 August 2017 Abstract: The silvery pout genus Gadiculus consists of small aberrant codfishes with several extinct and currently only one recognized extant species. The oldest representatives of a Gadiculus lineage known from otoliths are Early Miocene in age. Fossil evidence has showed Gadiculus to originate from older genera diverging early from other true cods of the family Gadidae. As adult specimens of different species have been found to be highly similar and difficult to distinguish based on meristic and morphometric data, the number of species in this gadid genus has been controversial since different larval morphotypes were first discovered some 100 years ago. For almost 70 years, Gadiculus thori and Gadiculus argenteus have been considered subspecies only, with a distribution in the Northeast Atlantic Ocean including the Mediterranean. In this study, we resolve the long- standing issue of extant Gadiculus not being monotypic. New results in the form of distinct adult otoliths and molecular data unambiguously show two species of Gadiculus present—in agreement with larval morphotypes. -

An Analysis of the Relationships Between Skin and Eye Colouration, Reproductive Strategy and Habitat for Swedish Marine and Brackish Teleosts
An analysis of the relationships between skin and eye colouration, reproductive strategy and habitat for Swedish marine and brackish teleosts Tom Audhav Ämneslärarprogrammet Examensarbete: 15 hp Kurs: LGBI1G Självständigt arbete (examensarbete) 1 för gymnasielärare i biologi Institution: Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Nivå: Grundnivå Termin/år: HT/2014 Handledare: Docent Helen Nilsson Sköld Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Examinator: Susanne Pihl Baden Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Kod: HT14-3130-001-LGBI1G Nyckelord: Coloration, Reproductive strategy, Teleost, mate choice, Sexual selection Abstract We live in a time of rapid and easy sharing of data. Online databases allow scientist from all over the world to instantly share their results with the whole scientific community. One such database is fishBase (Froese & Pauly, Editors 2014), where people from all over the world collect pictures and basic data on all the world's fish species. The amount of readily available data allows for exploratory and comparative studies to be conducted without individual data collection but by putting the pre-existing data under the filter of new questions. This study uses fishBase and the Swedish Nationalnyckeln, (Kullander, Nyman, Jilg & Delling, 2012) to explore the relationship of conspicuous and cryptic colouration of skin and eyes to reproduction strategy, structural and colour complexity of the habitat and depth preference in Swedish marine and brackish teleosts. There have been many studies in the past exploring the function of contrasting skin colouration, and have found it to, be a faithful conveyor of fitness. This is however, to our knowledge, the first exploratory study on a species level, and also the first to consider eye colouration as a possible important variable. -

Pigghuder, Fisk, Amfibier Og Krypdyr
Deuterostome dyr Deuterostomia 8Halvor Aarnes 2003 S.E. & O. Revidert 02-02-2005 Deuterostome bilaterale dyr omfatter pigghuder (Echinodermata), hemichordatene (Hemichordata) og ryggstrengdyrene (Chordata). Ryggstrengdyrene omfatter kappedyr (tunikater/Urochordata), lansettfisk (Cephalochordata), slimål og niøyer (rundmunner/Cyclostomata), samt virveldyrene (vertebratene), fisk, amfibier, krepsdyr, fugl og pattedyr Alle har ikkedeterminert radialkløyving, blastoporen blir til anus og munnen dannes fra en sekundær åpning i framenden av embryo i motsatt ende av blastoporen. Kroppshulen (coelom) utvikles fra arkenteron. Innholdsfortegnelse Rekke Pigghuder (Echinodermata) ........................................... 2 Klasse Sjøliljer (Crinoidea) ............................................ 4 Klasse Sjøstjerner (Asteroidea) ........................................ 5 Klasse Slangestjerner (Ophiuroidae) ................................... 7 Klasse Sjøpinnsvin (Echinoidea) ....................................... 8 Klasse Sjøpølser (Holothurioidea) ...................................... 9 Klasse Sjøtusenfryd (Concentricycloidea) .............................. 10 Rekke Pilormer (Chaetognatha) ............................................ 10 Rekke Hemichordata ...................................................... 10 Klasse Enteropneuster (Enteropneusta) ............................... 11 Klasse Pterobranchier (Pterobranchia)................................. 11 Klassen Graptolitae ................................................. 11 Rekke Ryggstrengdyr/chordadyr -

The Role of Tow Duration
1 Ices Journal Of Marine Science Archimer September 2018, Volume 75 Issue 5 Pages 1672-1681 https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy050 https://archimer.ifremer.fr https://archimer.ifremer.fr/doc/00439/55028/ Resolution of biodiversity and assemblage structure in demersal fisheries surveys: the role of tow duration Moriarty M. 1, 2, *, Sell A. F. 3, Trenkel Verena 4, Lynam C. P. 5, Burns F. 1, Clarke E. D. 1, Greenstreet S. P. R. 1, McGonigle C. 2 1 Marine Scotland Sci, 375 Victoria Rd, Aberdeen AB11 9DB, Scotland. 2 Ulster Univ, Environm Sci Res Inst, Cromore Rd, Coleraine BT52 1SA, Londonderry, North Ireland. 3 Thunen Inst Sea Fisheries, Palmaille 9, D-22767 Hamburg, Germany. 4 IFREMER, Rue Ile dYeu,BP 21105, F-44311 Nantes 03, France. 5 CEFAS, Pakefield Rd, Lowestoft NR33 0HT, Suffolk, England. * Corresponding author : M. Moriarty, email address : [email protected] Abstract : An experiment during a fisheries independent survey in the North Sea was conducted to test whether sampling effort could be reduced without a significant loss in data precision. To examine potential effects of reducing tow duration from the standard 30 min to a proposed 15 min estimates of species encounter rates, species richness, and estimates of abundance, biomass, and body size were analysed. Results show species richness estimates are lower in the short tow category. While biomass and abundance at length and body size are significantly affected by the change in tow duration, estimates of Large Fish Indicator, the Typical length and Mean-max length are not significantly affected by the regime change. -

Attempts to Predate on Gadid Fish Otoliths Demonstrated by Naticid Gastropod Drill Holes from the Neogene of Mill-Langenboom, the Netherlands
Attempts to predate on gadid fish otoliths demonstrated by naticid gastropod drill holes from the Neogene of Mill-Langenboom, The Netherlands Pieter A. M. Gaemers & Bram W. Langeveld Gaemers, P.A.M. & Langeveld, B.W. Attempts to predate on gadid fish otoliths demonstrated by nati- cid gastropod drill holes from the Neogene of Mill-Langenboom, The Netherlands. Scripta Geologica, 149: 159-183, 3 tables, 5 figs., 2 pls. Leiden, August 2015. P.A.M. Gaemers, Joost van den Vondelstraat 30, 7103 XW Winterswijk, The Netherlands (pieterenleny- [email protected]); B.W. Langeveld, Distelweg 13, 2215 DS Voorhout, The Netherlands (bramlange veld @hetnet.nl). Key words – Miocene, Pliocene, Noord-Brabant, palaeoecology, biostratigraphy, chronostratigraphy, North Sea Basin. Incomplete drill holes produced by naticid snails are occasionally found in late Cenozoic gadid oto- liths from the North Sea Basin. Among the Neogene otoliths found at Mill-Langenboom naticid drill holes are relatively common. Their occurrence is linked to strata that formed under reduced rates of sedimentation and/or that reflect non-sedimentation and erosion. The Upper Miocene–Upper Pliocene deposits at Mill-Langenboom (province of Noord-Brabant, the Netherlands) constitute a condensed sequence comprising most North Sea Basin stages of this interval from the Gramian to the end of the Pliocene, as demonstrated by index taxa amongst gadid otoliths, with a considerable hiatus between Miocene and Pliocene strata. The lag deposit at the base of the Pliocene yields otoliths that were re- worked from eroded Upper Miocene, and Lower and Middle Pliocene sedimentary rocks. Smaller hiatuses exist within the Pliocene. Under such conditions, isolated otoliths can occur in sufficient numbers on the sea floor or just below it, where naticids live and search for prey. -

(Nordlig Sølvtorsk), Gadiculus Thori
Atlas over danske saltvandsfisk Nordlig sølvtorsk Gadiculus thori Schmidt, 1913 Af Henrik Carl Sølvtorsk på 12,0 cm fra den norske del af Nordsøen, maj 2018. © Henrik Carl. Projektet er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond Alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt at gengive korte stykker af teksten med tydelig kilde- henvisning. Teksten bedes citeret således: Carl, H. 2018. Nordlig sølvtorsk. I: Carl, H. & Møller, P.R. (red.). Atlas over danske saltvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum. Online-udgivelse, december 2019. Systematik og navngivning Sølvtorsken blev oprindelig beskrevet under navnet Gadiculus argenteus Guichenot, 1850. En af de karakterer, som Guichenot (1850) baserede dannelsen af en ny slægt på, var mangel på tænder på plovskærbenet. Siden har det imidlertid vist sig, at nogle eksemplarer har tænder på plovskærbenet, mens andre mangler dem, og nogle forfattere har derfor ment, at slægten var et overflødigt synonym af Gadus (Collett 1901). Man har dog valgt at beholde slægtsnavnet Gadiculus. Det har længe været omdiskuteret, hvorvidt slægten består af én eller to arter. Den danske forsker Johannes Schmidt opsplittede i begyndelsen af 1900-tallet efter undersøgelser i både Atlanterhavet og Middelhavet arten i en sydlig art (Gadiculus argenteus) og en nordlig art (Gadiculus thori) (Schmidt 1913). Opsplitningen blev hovedsagelig begrundet med forskelle i pigmenteringen hos den spæde yngel (G. argentatus er mere pigmenteret end G. thori) samt et lidt højere antal af ryghvirvler hos G. argentatus end hos G. thori (normalt 40 vs. 42). Grænsen mellem de to arters udbredelse fandt Schmidt omkring Biscayen, og det er således G. thori, der træffes i vore farvande. En lang række senere forfattere (fx Svetovidov 1986; Cohen et al.