1 Django Reinardt De Paul Paviot
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Journal of the Duke Ellington Society Uk Volume 23 Number 3 Autumn 2016
THE JOURNAL OF THE DUKE ELLINGTON SOCIETY UK VOLUME 23 NUMBER 3 AUTUMN 2016 nil significat nisi pulsatur DUKE ELLINGTON SOCIETY UK http://dukeellington.org.uk DESUK COMMITTEE HONORARY MEMBERS OF DESUK Art Baron CHAIRMAN: Geoff Smith John Lamb Vincent Prudente VICE CHAIRMAN: Mike Coates Monsignor John Sanders SECRETARY: Quentin Bryar Tel: 0208 998 2761 Email: [email protected] HONORARY MEMBERS SADLY NO LONGER WITH US TREASURER: Grant Elliot Tel: 01284 753825 Bill Berry (13 October 2002) Email: [email protected] Harold Ashby (13 June 2003) Jimmy Woode (23 April 2005) MEMBERSHIP SECRETARY: Mike Coates Tel: 0114 234 8927 Humphrey Lyttelton (25 April 2008) Email: [email protected] Louie Bellson (14 February 2009) Joya Sherrill (28 June 2010) PUBLICITY: Chris Addison Tel:01642-274740 Alice Babs (11 February, 2014) Email: [email protected] Herb Jeffries (25 May 2014) MEETINGS: Antony Pepper Tel: 01342-314053 Derek Else (16 July 2014) Email: [email protected] Clark Terry (21 February 2015) Joe Temperley (11 May, 2016) COMMITTEE MEMBERS: Roger Boyes, Ian Buster Cooper (13 May 2016) Bradley, George Duncan, Frank Griffith, Frank Harvey Membership of Duke Ellington Society UK costs £25 SOCIETY NOTICES per year. Members receive quarterly a copy of the Society’s journal Blue Light. DESUK London Social Meetings: Civil Service Club, 13-15 Great Scotland Yard, London nd Payment may be made by: SW1A 2HJ; off Whitehall, Trafalgar Square end. 2 Saturday of the month, 2pm. Cheque, payable to DESUK drawn on a Sterling bank Antony Pepper, contact details as above. account and sent to The Treasurer, 55 Home Farm Lane, Bury St. -

Disco Gu”Rin Internet
ISCOGRAPHIE de ROGER GUÉRIN D Par Michel Laplace et Guy Reynard ● 45 tours ● 78 tours ● LP ❚■● CD ■●● Cassette AP Autre prise Janvier 1949, Paris 3. Flèche d’Or ● ou 78 Voix de son Maitre 5 février 1954, Paris Claude Bolling (p), Rex Stewart (tp), 4. Troublant Boléro FFLP1031 Jacques Diéval et son orchestre et sex- 5. Nuits de St-Germain-des-Prés ● ou 78 Voix de son Maitre Gérard Bayol (tp), Roger Guérin (cnt), ● tette : Roger Guérin (tp), Christian Benny Vasseur (tb), Roland Evans (cl, Score/Musidisc SCO 9017 FFLP10222-3 Bellest (tp), Fred Gérard (tp), Fernard as), George Kennedy (as), Armand MU/209 ● ou 78 Voix de son Maitre Verstraete (tp), Christian Kellens (tb), FFLP10154 Conrad (ts, bs), Robert Escuras (g), Début 1953, Paris, Alhambra « Jazz André Paquinet (tb), Benny Vasseur Guy de Fatto (b), Robert Péguet (dm) Parade » (tb), Charles Verstraete (tb), Maurice 8 mai 1953, Paris 1. Without a Song Sidney Bechet avec Tony Proteau et son Meunier (cl, ts), Jean-Claude Fats Sadi’s Combo : Fats Sadi (vib), 2. Morning Glory Orchestre : Roger Guérin (tp1), Forhenbach (ts), André Ross (ts), Geo ● Roger Guérin (tp), Nat Peck (tb), Jean Pacific (F) 2285 Bernard Hulin (tp), Jean Liesse (tp), Daly (vib), Emmanuel Soudieux (b), Aldegon (bcl), Bobby Jaspar (ts), Fernand Verstraete (tp), Nat Peck (tb), Pierre Lemarchand (dm), Jean Paris, 1949 Maurice Vander (p), Jean-Marie Guy Paquinet (tb), André Paquinet Bouchéty (arr) Claude Bolling (p), Gérard Bayol (tp), (tb), Sidney Bechet (ss) Jacques Ary Ingrand (b), Jean-Louis Viale (dm), 1. April in Paris Roger Guérin (cnt), Benny Vasseur (as), Robert Guinet (as), Daniel Francy Boland (arr) 2. -

100 Titres Sur Le JAZZ — JUILLET 2007 SOMMAIRE
100 TITRES SUR LE JAZZ À plusieurs époques la France, par sa curiosité et son ouverture à l’Autre, en l’occurrence les hommes et les musiques de l’Afro-Amérique, a pu être considérée, hors des États-Unis, comme une « fille aînée » du juillet 2007 / jazz. Après une phase de sensibilisation à des « musiques nègres » °10 constituant une préhistoire du jazz (minstrels, Cake-walk pour Debussy, débarquement d’orchestres militaires américains en 1918, puis tour- Hors série n nées et bientôt immigration de musiciens afro-américains…), de jeunes pionniers, suivis et encouragés par une certaine avant-garde intellectuelle et artistique (Jean Cocteau, Jean Wiener…), entrepren- / Vient de paraître / nent, dans les années 1920, avec plus de passion que d’originalité, d’imiter et adapter le « message » d’outre-Atlantique. Si les traces phonographiques de leur enthousiasme, parfois talentueux, sont qua- CULTURESFRANCE siment inexistantes, on ne saurait oublier les désormais légendaires Léon Vauchant, tromboniste et arrangeur, dont les promesses musica- les allaient finalement se diluer dans les studios américains, et les chefs d’orchestre Ray Ventura, (qui, dès 1924, réunissait une formation de « Collégiens ») et Gregor (Krikor Kelekian), à qui l’on doit d’avoir Philippe Carles Journaliste professionnel depuis 1965, rédacteur en chef de Jazz Magazine (puis directeur de la rédaction à partir de 2006) et producteur radio (pour France Musique) depuis 1971, Philippe Carles, né le 2 mars 1941 à Alger (où il a commencé en 1958 des études de médecine, interrompues à Paris en 1964), est co-auteur avec Jean-Louis Comolli de Free Jazz/Black Power (Champ Libre, 1971, rééd. -

If I Say If: the Poems and Short Stories of Boris Vian
Welcome to the electronic edition of If I Say If: The Poems and Short Stories of Boris Vian. The book opens with the bookmark panel and you will see the contents page. Click on this anytime to return to the contents. You can also add your own bookmarks. Each chapter heading in the contents table is clickable and will take you direct to the chapter. Return using the contents link in the bookmarks. The whole document is fully searchable. Enjoy. If I Say If The high-quality paperback edition is available for purchase online: https://shop.adelaide.edu.au/ CONTENTS Foreword ix Marc Lapprand Boris Vian: A Life in Paradox 1 Alistair Rolls, John West-Sooby and Jean Fornasiero Note on the Texts 13 Part I: The Poetry of Boris Vian 15 Translated by Maria Freij I wouldn’t wanna die 17 Why do I live 20 Life is like a tooth 21 There was a brass lamp 22 When the wind’s blowing through my skull 23 I’m no longer at ease 24 If I were a poet-o 25 I bought some bread, stale and all 26 There is sunshine in the street 27 A stark naked man was walking 28 My rapier hurts 29 They are breaking the world 30 Yet another 32 I should like 34 If I say if 35 If I Say If A poet 36 If poets weren’t such fools 37 It would be there, so heavy 39 There are those who have dear little trumpets 41 I want a life shaped like a fishbone 42 One day 43 Everything has been said a hundred times 44 I shall die of a cancer of the spine 45 Rereading Vian: A Poetics of Partial Disclosure 47 Alistair Rolls Part II: The Short Stories of Boris Vian 63 Translated by Peter Hodges Martin called… -

Johnny Hodges – the Composer -.:: GEOCITIES.Ws
Johnny Hodges – The Composer Compilation by Sven Eriksson Last updated 8May08 Introduction This catalogue was created to bring to light the creative powers of Johnny Hodges as a composer. In a condensed form you will find the melodies credited solely to him and tunes where he is credited as co-composer. The titles are as registered by ASCAP, the US Copyright Office, or the Smithsonian Institute, or as shown on record labels. They are in alphabetical order, with alternative title or spelling, if any. This is not a discography, so only a few examples of recordings are presented. The catalogue numbers used by The New Desor leads you to details for those recordings where Duke Ellington is present in the session. To find out when a tune was created, it is better to look for first recording date instead of registration date – several years may have passed before registration is made. Abbreviations are used in order to save space, in the hope that the short forms are understood. Months are typed in lower-case for visual clarity. For some tunes, no commercial recording has been found. Any comments or help from readers would be appreciated – please e-mail Sven Eriksson at [email protected]. 25 July 1907 – 11 May 1970 Title Composer Records: / Alternative title JH = The New Desor first entry (DExxxx) (spelling variations occur) Johnny Hodges Examples of other recordings: Issue, session date, DE = location. Personnel. Duke Ellington Abbreviations used for sets a. = listed (RCA24CD) = The Duke Ellington Centennial Edition. ASCAP The complete RCA Victor recordings 0926-63386-2. -
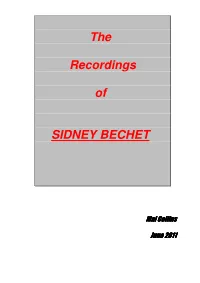
The Recordings of Sidney Bechet; in Fact It Does Not Include Much Release Information at All
The Recordings of SIDNEY BECHET Mal Collins June 2011 Introduction This is not a discography in the most accepted sense of that word: it does not itemise every commercial release of the recordings of Sidney Bechet; in fact it does not include much release information at all. The Recordings here are – at the time of writing, June 2011 - almost all free of recording copyright in many territories: 50 years from the first publication date, recordings may be freely - and legally - used, without paying royalties to the artist (not the case in the USA, and the situation is changing in Europe). This means that it is difficult - not to say impossible - to keep track of the many uses of his work: not only of his classic performances which have been free of this copyright for some time, but also now of his many French recordings, which count for more than 50% of his output. So to detail the original release information is of less and less interest (and this has already been done. None of the original shellac or vinyl releases is available, except as a collector’s item; many CD releases are also no longer available; we are into an era driven by the most popular end of the music market: the digital/download age.So to itemise ALL commercial releases is a thankless task which serves less & less benefit with every year that passes. What this document does do is: to collect together all the known recordings of Sidney Bechet; to clear up a number of anomalies and uncertainties (others will always remain); to identify all the occasions on which he plays soprano sax and/or clarinet; and to fully index all sessions by title and performer. -
Guide to the Collection of Duke Ellington Ephemera and Related Audiovisual Materials
Guide to the Collection of Duke Ellington Ephemera and Related Audiovisual Materials NMAH.AC.0386 Ellen Swartzmeyer, Scott Schwartz 1996 Archives Center, National Museum of American History P.O. Box 37012 Suite 1100, MRC 601 Washington, D.C. 20013-7012 [email protected] http://americanhistory.si.edu/archives Table of Contents Collection Overview ........................................................................................................ 1 Administrative Information .............................................................................................. 1 Arrangement..................................................................................................................... 2 Scope and Contents note................................................................................................ 2 Biographical/Historical note.............................................................................................. 2 Names and Subjects ...................................................................................................... 2 Container Listing ............................................................................................................. 4 Series 1: Oral History Project, 1925-1989............................................................... 4 Series 2: Newsletters, 1961-1962 and 1979-1989................................................... 8 Series 3: Programs, 1930-1990............................................................................. 11 Series : Publications, 1933-1988........................................................................... -

Bulletin De La Sabix, 32 | 2002 Les X Et Le Jazz - Rencontre Avec Claude Abadie X 38 2
Bulletin de la Sabix Société des amis de la Bibliothèque et de l'Histoire de l'École polytechnique 32 | 2002 Les polytechniciens et la musique Les X et le Jazz - Rencontre avec Claude Abadie X 38 Simon Hadrot Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/sabix/390 DOI : 10.4000/sabix.390 ISSN : 2114-2130 Éditeur Société des amis de la bibliothèque et de l’histoire de l’École polytechnique (SABIX) Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2002 Pagination : 23 - 34 ISBN : ISSN N° 2114-2130 ISSN : 0989-30-59 Référence électronique Simon Hadrot, « Les X et le Jazz - Rencontre avec Claude Abadie X 38 », Bulletin de la Sabix [En ligne], 32 | 2002, mis en ligne le 06 janvier 2013, consulté le 19 septembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/sabix/390 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sabix.390 Ce document a été généré automatiquement le 19 septembre 2020. © SABIX Les X et le Jazz - Rencontre avec Claude Abadie X 38 1 Les X et le Jazz - Rencontre avec Claude Abadie X 38 Simon Hadrot 1 Parmi les anciens élèves de l'X qui se sont illustrés musicalement, c'est une personnalité incontournable. Clarinettiste depuis 1937, Claude Abadie a occupé le devant de la scène jazzistique française de l'après-guerre. Son orchestre - duquel faisait partie le jeune Boris Vian à la trompette - tourna en France et à l'étranger et remporta à l'époque les prix les plus prestigieux de plusieurs concours d'orchestres amateurs. Bien qu'il soit toujours resté amateur, ses talents de musicien n'ont en rien diminué au fil des années : son tentette actuel est en activité permanente depuis près de trente-cinq ans. -

GERARD BADINI Que Je Lui Ai Demandé D’Évoquer Dans Ce Premier Entretien Qui Fut Enregistré Le 1 Juin 2002 À Deauville
Les plus jeunes d’entre nous ne l’ont peut-être découvert qu’avec la récente réédition d’un album Black & Blue (*) d’Helen Humes. Ils ont alors certainement partagé l’enthousiasme de Dominique Périchon qui, chroniquant ce disque dans notre dernier numéro, écrivait : «Il y a (...) une deuxième voix dans cet enregistrement, qui seconde et souligne celle de Helen Humes : le saxophone ténor de Gérard Badini. Un pont par-ci, un contre-chant par-là, un chorus ailleurs, le timbre du ténor (peut-être sans équivalent en France) rivalise de chaleur et de feeling avec Helen, sans tomber dans les petites phrases clichés que le blues peut susciter en particulier. Tribute To Jimmy Rushing le prouve sans conteste, grognement de plaisir aris d’un des musiciens à l’appui en fin de chorus.» Selmer P Cela se passait en 1974, au moment où Gérard Badini s’affirmait comme leader, partageant de plus en plus l’affiche avec les maîtres noirs américains. En 1974, photo Jean-Claude Meignan / pour l’amateur de jazz classique, et malgré son statut de “sideman“, Gérard Badini était déjà une figure majeure. RENCONTRES AVEC C’est sa rencontre avec le jazz et la première partie de sa carrière (la période 1952-1973) GERARD BADINI que je lui ai demandé d’évoquer dans ce premier entretien qui fut enregistré le 1 juin 2002 à Deauville. part one Guy Chauvier (*) D’autres publications récentes permettent d’écouter Gérard Badini. Sur le catalogue Black & Blue : “Mule“, de Major Holley (BB 862.32). Il est aussi question de rééditer les formidables sessions du Popcorn de 1975. -

Registrant Over Jazz Fotos I Syddansk Universitetsbiblioteks Jazzsamlinger
REGISTRANT OVER JAZZ FOTOS I SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEKS JAZZSAMLINGER FOTOS I TIMME ROSENKRANTZ-SAMLINGEN Navn på Konvolutten Navne på andre musikere på fotos under dette navn Bernard Addison Fats Adkins Freddy Albeck Timme Rosenkrantz, Art Ford Alberto & Sandra Fred Allen Henry ”Red” Allen Bobby Hackett, Buster Bailey, Timme Rosenkrantz, Fletcher Henderson Bert Ambrose Gene Ammons Cat Anderson Ivie Anderson “Tricky” Sam Nanton, Jerome O’Rhea Folke Andersson Nisse “Bagern” Lind, Akke Sundin, Gösta ”Smyget” Redlig, Anders Soldén, Olle Henricson, Sune Lundwall Andrews Sisters Patty Andrews, Maxene Andrews, La Verne Andrews Lil Hardin Armstrong Louis Armstrong Luis Russell, Timme Rosenkrantz, Cozy Cole, Jack Teagarden, Barney Bigard, Velma Middleton, Arvell Shaw, Bing Crosby, Lester Boone, Al Washington, George James, Charlie Alexander, Mike McKendrick, Tubby Hall, Zilner Randolph, Preston Jackson, Johnny Lindsay, Lawrence Lucie, Sidney Catlett, Maxine Sullivan, Marty Napoleon, Russ Philips, Dale Jones, Dizzy Gillespie, Bingie Madison, Pete Clark, Charlie Holmes, Albert Nicholas, Earl Hines, Billy Kyle, Eddie Shu, Tyree Glenn, Buddy Catlett Sidney Arodin 1 Svend Asmussen Kjeld Bonfils, Erik Frederiksen, Svend Hauberg, Christian Jensen, Ulrik Neuman, Leif Sjøberg, Max Leth, Jørgen Ingmann, Børge Ring, Georgie Auld Uffe Baadh Timme Rosenkrantz, Joe Thomas, Harry Lim Alice Babs Timme Rosenkrantz, Inez Cavanaugh, Sjöblom Buster Bailey Henry “Red” Allen, J.C. Higginbotham Mildred Bailey Jimmie Dorsey, Fud Livingston, Red McKenzie, Red Norvo -

Claude Abadie (38) Le Jazz, La Passion D’Une Vie (1920-2020)
ARTS, LETTRES ET SCIENCES ARTS, LETTRES ET SCIENCES CLAUDE ABADIE (38) LE JAZZ, LA PASSION D’UNE VIE (1920-2020) _ PAR ALBERT GLOWINSKI (58) ET JEAN SALMONA (56) 78 LA JAUNE ET LA ROUGE ARTS, LETTRES ET SCIENCES Décédé en mars dernier, Claude Abadie était un personnage aux multiples facettes. Il a consacré une grande partie de sa vie au jazz. Il donnait en janvier 2020, à cent ans passés, son dernier concert à la tête de son tentette. « Claude Abadie venait d’un autre temps dont il était le dernier témoin direct (…). Un temps où Et se fit à la porte d’entrée le Grand Remue-Ménage de l’orchestre Abadie Paris était encore une fête (…). Claude Abadie (…). L’orchestre au complet fit son entrée, applaudi par la foule immense de ses admirateurs. appartenait à cet autre temps, autour de la – On ne peut pas jouer dans le salon avec le piano dans la bibliothèque, Seconde Guerre, où se croisèrent Django remarqua astucieusement Abadie qui, décidément, n’avait pas perdu son Reinhardt, Duke Ellington (…), Charles Delaunay, temps à Polytechnique. Allez, les gars, transportez le piano, commanda-t-il Boris Vian entre beaucoup d’autres. Il s’en amusait à quatre zazous désœuvrés qui bayaient aux cornemuses dans un coin (…). avec une distance teintée d’humour (…) et avec Il parvenait à destination lorsque Abadie s’en approcha de nouveau. une précision implacable (l’esprit mathématique – Après tout, dit-il, je crois qu’on serait mieux pour jouer dans la biblio- thèque. L’acoustique, comme nous disons à Carva, est plus adéquate. -

Clark Terry Discography
Clark Terry Name Discography Compiled by Tom Lord This Clark Terry name discography is an extract from The Jazz Discography by Tom Lord. The Jazz Discography is the only general jazz discography compiled in a database. It includes almost 39,000 leaders, over 196,000 recording sessions, over 1.1 million musician entries and over 1.2 million tune entries. Details can be seen at www.lordisco.com . This detailed name discography of Clark Terry has been prepared as a companion piece to Clark Terrys autobiography. A summarized version of this name discography is included in the book. The discography includes 902 recording sessions from February 1947 to July 2008. It includes 788 sessions with Clark Terry as a sideman and 114 sessions with him as a leader. Included are 2584 unique musicians (total 12,604 entries) and 3403 unique tunes (total 7735 entries). The discography is organized chronologically by recording session. The leader of the session is listed at the top of each session in large bold print. Each session is organized with a session number (for easy reference) along with the group name, musicians including instruments, the recording location and the recording date. Tunes are listed with matrix numbers in a column to the left and releases to the right. Album titles are shown in underlined bold print after the session number or in the footnote to the session. The following five pages list abbreviations used throughout the discography. Then the 172 pages of the discography are listed. November 5, 2010 Tom Lord [email protected] Instrument