DOCUMENT RESUME ED 111 213 FL 007 080 Pohl, Jacques Trente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Histoires Croisées Folklore Et Philologie De 1870 À 1920
Histoires croisées Folklore et philologie de 1870 à 1920 Claudine Gauthier 1 Les Carnets de Bérose Copyright 2013 Lahic / Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, département pilotage de la recherche et de la politique scientifique. ISSN 2266-1964 Illustration de couverture : Mélusine. Page de titre de Histoire de Mélusine, par Jean d’Arras, Imprimé à Lyon par Gaspar Ortuin et Pierre Schenck, 1485-1486. Histoires croisées Philologie et folklore de 1870 à 1920 Claudine Gauthier Les Carnets de Bérose Lahic / DPRPS-Direction des patrimoines – 2013 Lahic / DPRPS-Direction 1 À Claude Gaignebet L’amico mio, e non de la ventura (Dante, Inf., II, 61) SOMMAIRE INTRODUCTION 8 PRÉMICES 14 Philologie et folklore 14 Il était une fois… les frères Grimm 18 LES FONDATIONS 32 Philologies : entre France et Allemagne 32 La Société de linguistique de Paris et l’étude du folklore (1865 - …) 40 LES FONDATEURS 52 Henri Gaidoz (1842-1932) 53 Gaston Paris (1839-1903) 60 OBJETS ET MÉTHODES 74 La théorie orientaliste 74 L’ « hérésie » müllerienne 77 Les folkloristes français et l’étude de la littérature orale 81 La philologie populaire 91 LES REVUES 98 La Revue celtique 99 Le folklore dans la Revue celtique 104 Romania 109 Le folklore dans Romania 112 L’obscénité dans Romania 121 Kryptadia. Recueils de documents pour servir à l’étude des traditions populaires 125 UNE SOCIABILITÉ. Les Dîners celtiques (8 juin 1879 - 24 mai 1902) 132 ÉPILOGUE 142 BIBLIOGRAPHIE 148 REMERCIEMENTS Je voudrais remercier ici Daniel Fabre et Claudie Voisenat qui ont eu l’idée de ce volume réunissant, sous une forme largement remaniée et réactualisée, l’ensemble des travaux d’historiographie que j’ai accomplis dans le cadre de mon post-doctorat du CNRS au Lahic. -
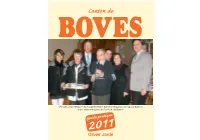
Boves 2011 Pdf:Mep
Canton de «Patoum, ancien musicien de Joséphine Baker, bénéficie du portage de repas à domicile et des aides ménagères du S.I.Vo.M. de Boves» Guide pratique 2011 Olivier Jardé Sommaire Mémento Le mot de votre Conseiller ...............................................3 Nom : ........................................................................................................................................ L’aide à domicile .............................................................4 Prénom : ................................................................................................................................... Le Conseil général de la Somme ......................................5 Domicile : ................................................................................................................................. L’Hôtel des Feuillants ......................................................6 .................................................................................................................................................. Plan du canton ................................................................7 Les 23 communes de notre canton ............................8 - 57 Ville :......................................................................................................................................... Permanences Sécurité Sociale.........................................58 Téléphone Domicile :.............................................................................................................. -
Notextes La Littérature Orale Recueillie Par Les Souvent Connus
LA LITTÉRATURE TRADITIONNELLE force en sont l'anti-germanisme et l'esprit démocratique. L'esprit civique s'est surtout développé au cours des deux derniers siècles, La mode convient d'appeler aujourd'hui eth avec des chansons locales d'auteurs le plus notextes la littérature orale recueillie par les souvent connus. Seules, quelques vieilles cités, folkloristes, et quelque chose de plus, à savoir comme Mons, Liège, Ciney ont une chanson les textes oraux d'information recueillis no qui doit quelque chose à l'Ancien Régime. tamment au magnétophone, et la littérature Par contre, la ballade narrative est moins bien des almanachs. On se limitera ici aux chan représentée qu'en maintes provinces françaises ; sons, formulettes, devinettes, proverbes, mais la plus be1Ie version de Jean Reynaud contes, légendes, théâtre et almanachs popu retour de la guerre, une ba11ade grandiose laires (c'est-à-dire traditionnels au sein du et poignante, est de Seraing. peuple). La chanson de Wallonie, en gros, n'est pas La chanson. La Wallonie, en chacun de ces autochtone: tous les 123 types de Terry-Chau domaines, occupe une place très honorable. mont, par exemple, qui sont en langue fran La collecte des chants fut commencée dès 1871 çaise (contre 35 folkloriques en dialecte) ont par la Société liégeoise de Littérature wallonne, leur pendant en France, souvent aussi au à l'exemple de l'enquête française ordonnée en Canada ou ailleurs dans la Francophonie. Les 1852 par Napoléon III ; elle fut continuée par 10 % de chansons dialectales traditionnelles la Société de Folklore wallon en 1888, par du trésor sont plus authentiquement autoch l'équipe de Wallonia en 1893, par la Commis tones, mais la moitié d'entre elles au moins sion nationale de la Vieille Chanson populaire sont des adaptations de textes ou de thèmes en 1936 et prolongée par RoGER PINON et largement attestés en France. -
Bibliothèque Achille Millien
Bibliographie thématique le 31 août 2011 Barillot, Alain J.B Millien, Achille (1838-1927) : Devoirs de l'homme.- Paris : L. Lacroix, libraire : Broquet, libraire, 1830.- III-223 p. ; In-12°. (1766-1844) Bibliothèque personnelle 3 N 11223 Support : Livre Section : Patrimoine Localisation : Nièvre Codes Stat. : Dulard, Paul-Alexandre Millien, Achille (1838-1927) : [La ]Grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature, poème.- Paris : Desaint et Saillant, 1758.- Bibliothèque personnelle XXXIV-360 p. ; In-16°. 3 N 11236 Support : Livre Section : Patrimoine Localisation : Nièvre Codes Stat. : 800 Millien, Achille (1838-1927) : [Les ]mille et une nuits : , contes arabes, traduits en français par M. Galland,...Nouvelle édition,...- Bibliothèque personnelle Paris : Billois, 1811.- 7 vol. ; in-16. 3 N 11237 Support : Livre Section : Patrimoine Localisation : Nièvre Codes Stat. : Marmontel, Millien, Achille (1838-1927) : Eléments de littérature, par Marmontel [précédés de l'Essai sur le goût].- Paris : Firmin-Didot Bibliothèque personnelle Jean-François Littérature : Etude et frères, 1846.- 3 vol. ; In-12°. enseignement Littérature française 3 N 11238 Support : Livre Section : Patrimoine Localisation : Nièvre Codes Stat. : 800 marques de marques de Barrême, François Millien, Achille (1838-1927) : [Le ]livre des comptes-faits ou Tarif Général dédié à Monseigneur Desmaretz, Ministre d'Etat & Bibliothèque personnelle (1638-1703?) Monnaie : France : 18e siècle Controlleur général des Finances : Avec lequel on peut faire toute sorte de Comptes des Monnoyes tant anciennes que nouvelles, & autres Comptes, & de Multiplications par entier & par fraction, 3 N 11239 Support : Livre Section : Patrimoine Localisation : Nièvre Codes Stat. : Musée Frédéric Blandin Millien, Achille (1838-1927) : Histoire maritime de France... : Par Léon Guérin,...- Paris : Andrieux, 1844.- 2 vol. -

French Studies | Subject Catalog (PDF)
French & Francophone Studies Catalog of Microform (Research Collections, Serials, Books on Demand and Dissertations) http://www.proquest.com/en-US/catalogs/collections/rc-search.shtml [email protected] 800.521.0600 ext. 2793 or 734.761.4700 ext. 2793 USC014-01 Revised May 2010 Table of Contents About This Catalog ............................................................................................... 3 The Advantages of Microform ........................................................................... 4 Research Collections............................................................................................. 5 The Arts ..............................................................................................................................................................6 Language & Literature .................................................................................................................................... 11 Women‘s Studies ............................................................................................................................................. 13 Religion ............................................................................................................................................................. 14 Library Catalogs & Reference ........................................................................................................................ 17 Historical Collections ..................................................................................................................................... -

Luxemburgensia
Katalog Catalogue Luxemburgensia Edition : mai 2011 Bibliothèque publique régionale Luxemburgensia INDEX / INHALTSVERZEICHNIS Fiction / Romane ............................................................................ 4 Littérature pour jeunes / Jugendliteratur ..................................... 14 Littérature classique / Klassische Literatur ................................... 29 Poésie / Gedichte ......................................................................... 32 Théâtre / Theater ......................................................................... 36 Essais, discours, satire, humour / Essais, Ansprachen, Satire, Humor ................................................ 37 Écrits divers / Verschiedene Schriften ........................................... 39 Généralités / Allgemeines ............................................................. 42 Philologie, psychologie, philosophie / Sprachwissenschaft, Psychologie, Philosophie .............................. 43 Religion / Religion ........................................................................ 43 Sciences sociales, anthropologie, statistiques/ Sozialwissenschaften, Anthropologie, Statistiken ......................... 44 Sciences politiques / Politische Wissenschaften ........................... 47 Économie, droit / Wirtschaft, Recht ............................................. 48 Administration publique / Öffentliche Verwaltung ....................... 51 Problèmes et services sociaux / Sozialwesen ................................ 52 Associations / Vereinigungen, -

Languages: from “Francoprovençal Patois” to “Arpitan” and “Arpitania”
Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages : From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania” Natalia Bichurina To cite this version: Natalia Bichurina. Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages : From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania”. Linguistics. Université de Perpignan; Università degli studi (Bergame, Italie), 2016. English. NNT : 2016PERP0016. tel-01368201 HAL Id: tel-01368201 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01368201 Submitted on 26 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natalia Bichurina Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages: From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania” Doctoral degree dissertation Supervisors: Prof. Christian LAGARDE Université de Perpignan Via Domitia (France) Dr. Caroline LIPOVSKY University of Sydney (Australia) Prof. Federica VENIER Università degli studi di Bergamo (Italy) Thesis presented for public defence at the Institut Franco-Català Transfronterer, Casa dels Països Catalans, University of Perpignan via Domitia 2016 1 Declaration of good academic conduct I Natalia Bichurina, hereby certify that this dissertation, which is 148 512 words in length, has been written by me, that it is a record of work carried out by me, and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. -

Auction House KANERZ ART PUBLIC SALE LUXEMBURGENSIA
Auction House KANERZ ART PUBLIC SALE LUXEMBURGENSIA On the occasion of this sale, objects, books, photographs, medals, paintings ... related to the Grand Duchy of Luxembourg will be scattered. Thus, historical documents and archives, objects from the Second World War (medals and pins, books), oddity items (beer, instrument, boxes, etc.), Large collection of BOCH Luxembourg and Villeroy & Boch earthenware, postcards, literature, photographs and Graphic art (Klopp, Brandy, Oppenheim, Blanc, Wildanger, Mousset, Trémont, Seimetz, Gerson, Kerg…) are available. Sunday, September 20th, 2020 At 1.30 PM Exhibition and sale in the room will take place under sanitary conditions in accordance with government recommendations (barrier gestures & limitation of the number of people in the room at the same time). In order to respect the distances on the day of the sale, only 20 people will be admitted upon registration. The sale is broadcast live with possibility of online auction on Exhibition of the lots: Thusday, 17th & Friday, September 18th from 10 AM to 6 PM, without interruption. Saturday, September 19th from 10 AM to 2 PM and the morning of the sale, from 10:00 to 12:00. All the lots are in photo on the site of the House of sale: www.encheres-luxembourg.lu Contact : [email protected] GSM : (+352) 661.909.193 Place of the sale: 35 Rue Kennedy/50 Rue des Près (Rond-point de la zone Industrielle), Steinsel, L-7333 Free Parking Photos, pre-orders and general conditions of sale can be found on the website of the auction house KANERZ ART at www.encheres-luxembourg.lu. -

Literature of Folklore, a Guide to Series 1 Proquest
University of New Mexico UNM Digital Repository Finding Aids University Libraries 2008 Literature of Folklore, A Guide to Series 1 ProQuest Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/ulls_guides Recommended Citation ProQuest. "Literature of Folklore, A Guide to Series 1." (2008). https://digitalrepository.unm.edu/ulls_guides/4 This Finding Aid is brought to you for free and open access by the University Libraries at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Finding Aids by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. LITERATURE OF FOLKLORE A Guide to Series I Units 1 - 45 Originally filmed and documented by OmniSys Corporation (formerly General Microfilm Company) Collection Guide produced by ProQuest LLC as part of Literature of Folklore Collection. Reproduced with permission. Inquiries may be made to: ProQuest LLC, P.O. Box 1346, Ann Arbor, MI 48106-1346 USA. Telephone (734) 761-7400; E-mail: info@proquest; Web-page: www.proquest.com. Literature of Folklore Series I Units 1 – 45 **There are 18 reels unavailable in this OmniSys collection. Replacement film is being located for reels 1-10, 438-439, 555, 643, 665, 745-746, 832. Unit 1 11:1 Nettesheim, Agrippa von. Magische Werke. Vol. 1-2, 4-5. Berlin: Barsdorf Verlag, 1916. 12:1 Stadler, Hermann. Albertus Magnus de animalbus libri XXVI. Vol. 15-16. Munster i.w., 1916-21. 13:1 Bischoff, Erich. Die mystik und Magie der zahlen. Berlin: Verlag Hermann Barsdorf, 1920. 13:2 Bischoff, Erich. Das jenseits der seele. Berlin: Verlag Hermann Barsdorf, 1920. -

Bibliographie Des Parlers De Franche-Comté Et Du Jura Suisse
Bibliographie des parlers de Franche-Comté et du Jura Suisse Djàn-Baityi tchi Boétchi Le Franc-Comtois Études globale sur la langue Auteur: Charles Beauquier Titre: Faune et flore populaire de Franche-Comté vol 1 Publication: Paris 1910 Auteur: Charles Beauquier Titre: Faune et flore populaire de Franche-Comté vol 2 Publication: Paris 1910 Auteur: Robert Bichet Titre: Proverbes et dictons de Franche-Comté Publication: Ed Cêtre et Librairie Franc-comtoise ● Auteur : Noëlle Bourgeois Titre : Essai de grammaire franc-comtoise Publication : Besançon, 1999 ● Auteur : Les Comtophiles, JP Colin Titre : Trésors des parlers comtois / les Comtophiles ; sous la dir. de Jean-Paul Colin ; précédé d'une lettre de Bernard Clavel Édition : 3e éd. rev. et augm. Publication : Besançon : Cêtre, 2003 ● Auteur : Georges Curasson Titre : Avant la mort de notre patois Publication : Poligny, 1955 Auteur : Dartois (vicaire-général de Besançon) Titre : Importance de l'étude des patois en général, coup-d'oeil spécial sur ceux de la Franche-Comté, par M. Dartois,... Publication : Besançon, 1850. Auteur: C. Debusne Titre: Costume de Franche-Comté, Fêtes et traditions suivi d'un lexique Publication : Édition Cabédita, Yens, 2001 Auteur: Jean-Christophe Demard et Claude Royer Titre: La Tradition franc-comtoise Vol 4: Costume/patois Publication: Wettolsheim Mars et Mercure 1980 ● Auteur: Jean-Christophe Demard et Claude Royer Titre: La Tradition franc-comtoise Vol 5: Dictons Publication: Wettolsheim Mars et Mercure 1980 Auteur : Colette Dondaine Titre : Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-Comté. Vol 1 Publication : Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1972 69-Lyon : Impr. C.B.C. Auteur : Colette Dondaine Titre : Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-Comté. -

Guide Des Gentilés
Éd. resp. : J.P. Hubin, 44 Bd Léopold II - 1080 Bruxelles | Graphisme : Françoise Hekkers - Secrétariat général DCP&P Bruxelles | Graphisme : Françoise Hubin, 44 Bd Léopold II - 1080 Éd. resp. : J.P. LES NOMS DES HABITANTS EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE GUIDE DES GENTILÉS Ministère de la Communauté française LES NOMS DES HABITANTS Service de la langue française EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE 44 Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles www.cfwb.be Pour nous aider à compléter et à mettre à jour ce répertoire de gentilés, nous vous invitons à nous communiquer vos remarques et observations à l’adresse électronique : [email protected] Les mises à jour seront disponibles sur le site du Service de la langue française : www.languefrancaise.be www.languefrancaise.be Guide des gentilés Les noms des habitants en Communauté française de Belgique Établi par Jean GERMAIN avec la collaboration de Françoise ECHER 2e tirage corrigé Dépôt légal : D/2008/9108/1 Prix de la publication : 3 euros À la mémoire d’Albert Doppagne qui a réhabilité les termes gentilé et blason populaire et en a défini le périmètre des usages et pratiques. SOMMAIRE Préface de Jean-Marie Klinkenberg, 3 Introduction, 5 Mode d’emploi, 17 Guide • Généralités : ethonymes, 19 • Région de Bruxelles-capitale, 20 • Province de Brabant wallon, 21 • Province de Hainaut, 27 • Province de Liège, 45 • Province de Luxembourg, 60 • Province de Namur, 77 • Communauté germanophone (région de langue allemande), 94 • Communes à facilités en Région flamande, 95 • Index des gentilés complexes et savants, 97 Bibliographie sélective, 108 Ce qu’il faut savoir, 109 Déjà parus dans la même collection, 110 PRÉFACE l’habitant de Bruxelles s’appelle un Bruxellois et celui de Liège un Liégeois, voilà QUE qui n’étonnera personne.