Dossier Pédagogique Lucrèce Borgia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Story of the Borgias (1913)
The Story of The Borgias John Fyvie L1BRARV OF UN ,VERSITV CALIFORNIA AN DIEGO THE STORY OF THE BORGIAS <Jt^- i//sn6Ut*4Ccn4<s flom fte&co-^-u, THE STORY OF THE BOEGIAS AUTHOR OF "TRAGEDY QUEENS OF THE GEORGIAN ERA" ETC NEW YORK G. P. PUTNAM'S SONS 1913 PRINTED AT THE BALLANTYNE PRESS TAVI STOCK STREET CoVENT GARDEN LONDON THE story of the Borgia family has always been of interest one strangely fascinating ; but a lurid legend grew up about their lives, which culminated in the creation of the fantastic monstrosities of Victor Hugo's play and Donizetti's opera. For three centuries their name was a byword for the vilest but in our there has been infamy ; own day an extraordinary swing of the pendulum, which is hard to account for. Quite a number of para- doxical writers have proclaimed to an astonished and mystified world that Pope Alexander VI was both a wise prince and a gentle priest whose motives and actions have been maliciously mis- noble- represented ; that Cesare Borgia was a minded and enlightened statesman, who, three centuries in advance of his time, endeavoured to form a united Italy by the only means then in Lucrezia anybody's power ; and that Borgia was a paragon of all the virtues. " " It seems to have been impossible to whitewash the Borgia without a good deal of juggling with the evidence, as well as a determined attack on the veracity and trustworthiness of the contemporary b v PREFACE historians and chroniclers to whom we are indebted for our knowledge of the time. -

Et Le Monstre Fera Pleurer. » Victor Hugo, Préface À Lucrèce Borgia
DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE DE DENIS PODALYDÈS « Dans votre monstre, mettez une mère [...] et le monstre fera pleurer. » Victor Hugo, Préface à Lucrèce Borgia Éric Ruf et Elsa Lepoivre © Photo Christophe Raynaud de Lage © Photo Christophe Raynaud Éric Ruf et Elsa Lepoivre 1 OMMAIRE ÉNÉRIQUE I Présentation du spectacle p.3 LUCRÈCE BORGIA II « Je n’ose ôter mon masque, il faut pourtant que p.4 Scénographie Éric Ruf j’essuie mes larmes. » : le drame de la révélation. Costumes Christian Lacroix - Lecture : Acte I, première partie, scène 4 : « ayez pitié des Lumières Stéphanie Daniel méchants ! vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. » Son Bernard Valléry - Prolongement : Entretien avec Louis Arene, créateur des Travail chorégraphique Kaori Ito masques de Lucrèce Borgia Maquillages et effets spéciauxDominique Colladant Masques Louis Arene III Un mélodrame en forme d’opéra macabre. p.11 Assistanat à la mise en scène Alison Hornus - Lecture : « Vous m’avez donné un bal à Venise, je vous rends un souper à Ferrare. » Assistanat à la scénographie Dominique Schmitt Assistanat aux maquillages Laurence Aué et Muriel Baurens - Prolongement : Florence Naugrette, « Silence, parole et musique » Avec p.16 ANNEXES Le regard du masque : Otomar Krejča Éric Ruf Don Alphonse d’Este Le mythe de Lucrèce : Prosper Mérimée, Il viccolo di Thierry Hancisse* Gubetta Madama Lucrezia Alain Lenglet* Astolfo et Montefeltro Alexandre Pavloff* Jeppo Liveretto Elsa Lepoivre Lucrèce Borgia Serge Bagdassarian* Rustighello Pierre Louis-Calixte* -

The “Voix D'or”
in Silent Cinema New Findings and Perspectives edited by Monica Dall’Asta, Victoria Duckett, lucia Tralli RESEARCHING WOMEN IN SILENT CINEMA NEW FINDINGS AND PERSPECTIVES Edited by: Monica Dall’Asta Victoria Duckett Lucia Tralli Women and Screen Cultures Series editors: Monica Dall’Asta, Victoria Duckett ISSN 2283-6462 Women and Screen Cultures is a series of experimental digital books aimed to promote research and knowledge on the contribution of women to the cultural history of screen media. Published by the Department of the Arts at the University of Bologna, it is issued under the conditions of both open publishing and blind peer review. It will host collections, monographs, translations of open source archive materials, illustrated volumes, transcripts of conferences, and more. Proposals are welcomed for both disciplinary and multi-disciplinary contributions in the fields of film history and theory, television and media studies, visual studies, photography and new media. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ # 1 Researching Women in Silent Cinema: New Findings and Perspectives Edited by: Monica Dall’Asta, Victoria Duckett, Lucia Tralli ISBN 9788898010103 2013. Published by the Department of Arts, University of Bologna in association with the Victorian College of the Arts, University of Melbourne and Women and Film History International Graphic design: Lucia Tralli 3 Researching Women in Silent Cinema: New Findings and Perspectives Peer Review Statement This publication has been edited through a blind peer review process. Papers from the Sixth Women and the Silent Screen Conference (University of Bologna, 2010), a biennial event sponsored by Women and Film History International, were read by the editors and then submitted to at least one anonymous reviewer. -
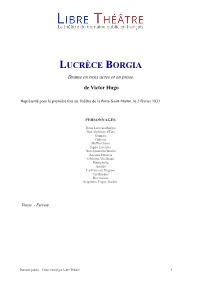
Lucèce Borgia
LUCRÈCE BORGIA Drame en trois actes et en prose de Victor Hugo Représenté pour la première fois au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 2 février 1833 PERSONNAGES Dona Lucrezia Borgia Don Alphonse d'Este Gennaro Gubetta Maffio Orsini Jeppo Liveretto Don Apostolo Gazella Ascanio Petrucci Oloferno Vitellozzo Rustighello Astolfo La Princesse Negroni Un Huissier Des moines Seigneurs, Pages, Gardes. Venise. - Ferrare. Domaine public – Texte retraité par Libre Théâtre 1 Avertissement Ainsi qu’il s’y était engagé dans la préface de son dernier drame, l’auteur est revenu à l’occupation de toute sa vie, à l’art. Il a repris ses travaux de prédilection, avant même d’en avoir tout-à-fait fini avec les petits adversaires politiques qui sont venus le distraire il y a deux mois. Et puis, mettre au jour un nouveau drame six semaines après le drame proscrit, c’était encore une manière de dire son fait au présent gouvernement. C’était lui montrer qu’il perdait sa peine. C’était lui prouver que l’art et la liberté peuvent repousser en une nuit sous le pied maladroit qui les écrase. Aussi compte- t-il bien mener de front désormais la lutte politique, tant que besoin sera, et l’œuvre littéraire. On peut faire en même temps son devoir et sa tâche. L’un ne nuit pas à l’autre. L’homme a deux mains. Le roi s’amuse et Lucrèce Borgia ne se ressemblent ni par le fond, ni par la forme, et ces deux ouvrages ont eu chacun de leur côté une destinée si diverse que l’un sera peut-être un jour la principale date politique et l’autre la principale date littéraire de la vie de l’auteur. -
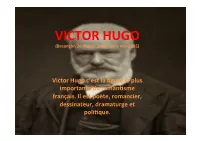
Victor Hugo 10.Pptx
VICTOR HUGO (Besançon 26 février 1802- Paris mai 1885) Victor Hugo c’est la figure la plus importante du romansme français. Il est poète, romancier, dessinateur, dramaturge et polique. VIE Il est né le 26 février 1802 à Besançon. En 1808 il vient vivre chez le père en Italie, à Avellino, où il reste sept mois. En 1913 sa mère va vivre à Paris, où HuGo commence à étudier dans une école d’ingénierie comme désirait son père, mais en 1818 il laisse ceJe école pour étudier la liJérature. Le 12 octobre 1822 il se marie avec Adèle Foucher et ils ont cinq enfants : Léopold qui est décédé au bout de trois mois, Léopoldine, Charles, François-Victor, Adèle. Trois enfants meurent jeunes, sa fille Adèle développe une maladie mentale. Quand Napoléon III devient empereur, HuGo se bat pour la liberté et il est été exilé sur l’île Guernesey. Le 5 septembre 1870 Napoléon III est chassé et, avec la III République, Victor HuGo peut retourner à Paris; en 1876 il est sénateur. Il est mort le 22 mai 1885 et sa bière est restée sous l’Arc de Triomphe pour une nuit; aujourd’hui sa tombe se trouve au Panthéon, à Paris. Pe`t Victor HuGo Victor HuGo à l’île Guernesey VICTOR HUGO: FAMILLE Adèle Foucher Léopoldine HuGo Charles HuGo François- Victor HuGo Adèle HuGo VICTOR HUGO: ÉCRIVAIN Il a été l’ écriven du roman`que français le plus important, mais il est resté loin de la mélanconie des roman`que. Victor HuGo a écrit neuf romans avec tous les generes liJéraires. -
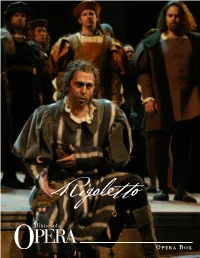
Rigoletto Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards
Opera Box Table of Contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .33 Flow Charts . .39 Giuseppe Verdi – a biography ...............................50 Catalogue of Verdi’s Operas . .52 Background Notes . .54 Victor Hugo, Francis I and Triboulet . .59 World Events in 1851 ....................................65 History of Opera ........................................66 2003 – 2004 SEASON History of Minnesota Opera, Repertoire . .77 The Standard Repertory ...................................81 Elements of Opera .......................................82 GIUSEPPE VERDI Glossary of Opera Terms ..................................86 NOVEMBER 15 – 23, 2003 Glossary of Musical Terms .................................92 Bibliography, Discography, Videography . .95 GAETANO DONIZETTI Word Search, Crossword Puzzle . .98 JANUARY 24 – FEBRUARY 1, 2004 Evaluation . .101 Acknowledgements . .102 STEPHEN SONDHEIM FEBRUARY 28 – MARCH 6, 2004 mnopera.org WOLFGANG AMADEUS MOZART MAY 15 – 23, 2004 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. See the Unit Overview for a detailed explanation. Before returning the box, please fill out the Evaluation Form at the end of the Teacher’s Guide. -

Dramatic Experience Drama and Theatre in Early Modern Europe
Dramatic Experience Drama and Theatre in Early Modern Europe Editor-in-Chief Jan Bloemendal (Huygens Institute for the History of the Netherlands) Editorial Board Cora Dietl (Justus-Liebig-Universität Gieβen ) Peter G.F. Eversmann (University of Amsterdam) Jelle Koopmans (University of Amsterdam) Russell J. Leo (Princeton University) Volume 6 The titles published in this series are listed at brill.com/dtem Dramatic Experience The Poetics of Drama and the Early Modern Public Sphere(s) Edited by Katja Gvozdeva, Tatiana Korneeva, and Kirill Ospovat LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Cover illustration: Bauerntheater (Peasants’ Theatre), by Jakob Placidus Altmutter, c. 1805. Pen-and-wash drawing, 179 × 254 mm. Courtesy of Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Grafische Sammlungen, TBar/1149. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/ Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 2211-341X isbn 978-90-04-32975-1 (hardback) isbn 978-90-04-32976-8 (e-book) Copyright 2017 by the Editors and the Authors. This work is published by Koninklijke Brill NV. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. Koninklijke Brill NV reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases. -
Life of Victor Hugo
H1--I71 I L LIN I S UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2010. COPYRIGHT NOTIFICATION In Public Domain. Published prior to 1923. This digital copy was made from the printed version held by the University of Illinois at Urbana-Champaign. It was made in compliance with copyright law. Prepared for the Brittle Books Project, Main Library, University of Illinois at Urbana-Champaign by Northern Micrographics Brookhaven Bindery La Crosse, Wisconsin 2010 BRAIZY---- OF THE UNIVERSITY Of ILLINOIS f 3 ro "Great Writers." EDITED BY PROFESSOR ERIC S. ROBERTSON, M.A. LIfE OF VICTOR H UGO. LIFE OF VICTOR HUGO FRANK T. ARZIALS LONDON WALTER SCOTT 24 WARWICK LANE, PATERNOSTER ROW 1888 (All rights reserved.) CONTENTS. CHAPTER I. PAGE Battle-field of Victor Hugo's life and work; his birth at Besangon, February 26, 1802; his parents; ancestral pretensions; his delicacy in infancy; nursed in the lap of war; at Paris in 1805 ; Colonel Hugo appointed Governor of Avellino ; his wife and children journey thither, October, I807; brigands hung along the road ; life at Avellino; Colonel Hugo follows King Joseph to Spain, June, 1808; the family return to Paris; happy days; the family join General Hugo in Spain, I8II ; adventuresby the way ; schooldays at Madrid; the family again returns to Paris, 1812; Victor's education, political and religious; M. Larivibre; General and Madame Hugo separate; Victor sent to the Pension Cordier et Decotte; he leaves school, August, 1818 . .. ...... II CHAPTER II. First exhibitions of genius; schoolboy versification; competes for the Academy prize for French poetry; honourably mentioned, 1817; resolves to devote himself to literature; General Hugo cuts off supplies; Victor resides with his mother; awarded medals for two odes at the "Floral Games " of Toulouse, 1819; writes for Conservateur Litteraire, December, 1819, to March, 1821; early allegiance to the classic school of poetry; "Odes et Podsies Diverses" published June, 1822 . -

Lucrécia Borgia: Um Drama No Oceano De Victor Hugo
1 LUCRÉCIA BORGIA : UM DRAMA NO OCEANO DE VITOR HUGO v.1 GISELLE MOLON CECCHINI Porto Alegre agosto 2009 2 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS LUCRÉCIA BORGIA: UM DRAMA NO OCEANO DE VICTOR HUGO Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Letras, área de concentração Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. GISELLE MOLON CECCHINI Prof. Dra. Ana Maria Lisboa de Mello Orientadora Data de defesa: 31/08/2009 Instituição depositária: Biblioteca Central Irmão José Otão Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre 2009 3 Dedico esta dissertação a Prof. Dra. Regina Zilberman Dedico esta dissertação a Deus, a José, Gabriel e Miguel. 4 AGRADECIMENTOS Ao CNPq; Ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica; À Prof. Dra. Ana Maria Lisboa de Mello, pelo seu generoso acolhimento e orientação; Aos Professores do Mestrado em Letras da PUC-RS; Aos Professores do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente os mestres: Carmem Lenora Martins, Ivo Bender, Maria da Graça Barcellos Ferreira, Sandra Dani; À Prof. Dra. Maria Thais Lima Santos, por tudo; À Prof. Dra. Patrícia C. Ramos Reuillard; Ao Germano Weirich; À Adriana Bayer; À Isabel e Mara; Aos atores que suaram e viajaram comigo; Ao meu pai e minha mãe, Luiz e Dilva. 5 RESUMO Esta dissertação apresenta um estudo descritivo e crítico do drama histórico Lucrécia Borgia, de Victor Hugo, à luz de teorias desenvolvidas por Anne Ubersfeld, Patrice Pavis, Constantin Stanislavski, Grotowski, Pierre Albouy, Jurij Alschitz. -

Victor Hugo Dans Le Monde
VICTOR HUGO DANS LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD Gérard Pouchain, vice-président de notre association, a fait, en mars et avril 2005, une grande tournée en Amérique du Nord pour présenter son exposition Hugo par les caricaturistes du XIXe siècle ( voir le compte rendu du catalogue établi à l’occasion de cette exposition à la Maison de Balzac à Paris dans L’Echo Hugo n°2, 2002, p. 50-51) et donner de nombreuses conférences sur Victor Hugo. Voici les programmes des manifestations organisées à l’occasion de sa présence au Canada et aux Etats- Unis. CANADA - 10 mars-14 avril : exposition Hugo par les caricaturistes du XIXe siècle . Maison de la Culture Ahuntsic-Cartiervilie (10300, rue Lajeunesse, Montréal [Québec] ). - 15 mars : récital de chansons sur des textes de Hugo par Alain Lecompte (voir notre entretien avec le chanteur dans L’Echo Hugo n° 4, 2004, p. 77-84). - 18 mars : conférence sur les caricatures de VH (avec projection sur grand écran de 130 caricatures). Maison de la Culture Ahuntsic. - 22-23 mars : Conférences sur Juliette Drouet à l’Université de Montréal (Campus Laval, puis Campus Longueuil), suivies d’une projection d’une cinquantaine de portraits de Victor Hugo et Juliette Drouet puis d’une lecture de leurs lettres par deux comédiens. - 1er avril. Visites guidées de l’exposition Hugo par les caricaturistes du XIXe siècle. Maison de la Culture Ahuntsic. A partir de 9 h deux chaînes de télévision – RDI et ARTV – proposaient des caricatures de Victor Hugo sous formes de « capsules culturelles ». Le métro de Montréal proposait le même jour, sur écrans géants, ces mêmes images. -

GIPE-002999-Contents.Pdf (488.2Kb)
• VICTOR HUGO B $Jtetcb "f bie 1tfe anb 'WlorIt OhananjayllJ'lll) Gadgil Libllll'} I 111m 111111111111111111111111111111111 GIPE-PUNE-002999 BY J. PRINGLE NICHOL JDllbDlt AN SONNENSCHEIN & CO. NEW Yon: MACMILLAN & CO. 1898 , 'ttbe ]Dilettante :JLibrar)]. 1. DANTE AND HIS IDEAL. By HBBBERT B ..Y1IB., M.R.A..S. With a Portrait. 2. BROWNING'S MESSAGE TO HIS TIMES. By Dr. EDWABD BJUtDOB. With &. Portrait and Facsimile Letters. 3, '" THE DOCTOR, AND OTHER POEMS. By T. E. BBOW1IR, M A., of Clifton College, Author of II Fote'a'le Yarns." 2 vols. G. GOETHE. By OSCAB BROWlfl"' .. , M.A.., Tutor of King'. College, Cambridge. With a Portrait. 6. DANTE. By OSC .. B BBow1I11I .., M.A. With a Frontispiece. Nos. 6 atld 6 are ...la1"gedfrom the ArIi<:leB in the "lmcycIoJ)(!'dia Brit,.ml1ica." J 7. BROWNING'S CRITICISM OF LIFE. B,v W. F. REVBLL. Member of the Loll don Browning Society. With a Poru'ait. 8. HENRIK IBSEN. By the Rev. PHILIP H. ,WICISTllED, M.A. With a Portrait. 9. THE ART OF ACTING. By PEECY FITz GEBUD. With a Portrait. 10. WALT WHITMAN. ByWILLIAH CLUBB,M.A., . Cambridge. With a Portrzit. n. VICTOR HUGO. By J.PSllfGLB N,CHOL. With a Portrzit. INTRODUCTORY. "I HAVE seen Heidelberg. I seemed to see the works of Victor Hugo, when posterity bas passed over them, when the words have grown rusty, when the superb frontage of the literary temple has clad itself with the solemnity of old ruins, when ti,me, like hoary ivy, has spread itself over the beauty of the verse. -
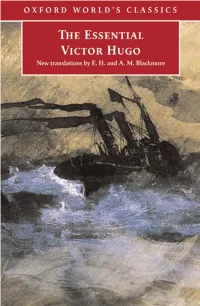
The Essential Victor Hugo
’ THE ESSENTIAL VICTOR HUGO V H was born in Besançon in , the youngest of three sons of an officer (eventually a general), who took his family with him from posting to posting, as far as Italy and Spain. Victor’s prolific literary career began with publication of poems (), a novel (), and a drama, Cromwell (), the preface of which remains a major manifesto of French Romanticism. The riot occasioned at the first performance of his drama Hernani () established him as a leading figure among the Romantics, and Notre- Dame () added to his prestige at home and abroad. Favoured by Louis-Philippe (–), he chose exile rather than live under Napoleon III. In exile in Brussels (), Jersey (), and Guernsey () he published some of his finest works, notably the satirical poems Les Châtiments (), the lyrical poems Les Contemplations (), the first series of epic poems La Légende des siècles (), and the lengthy novel Les Misérables (). Only with Napoleon III’s defeat and replacement by the Third Republic did Hugo return, to be elected deputy, and later senator. His opposition to tyranny and continuing immense literary output established him as a national hero. When he died in he was honoured by interment in the Panthéon. E. H. B and A. M. B are freelance writers and translators. Their previous Hugo translations have appeared in Six French Poets of the Nineteenth Century (Oxford World’s Classics), Selected Poems of Victor Hugo (winner of the American Literary Translators’ Association Prize and the Modern Language Association Scaglione Prize for Literary Translation), The Major Epics of Victor Hugo, and Contemplations, Lyrics, and Dramatic Monologues by Victor Hugo.