Annex 5: Evaluation Report Standard Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Famine Early Warning Systems Network Mauritania
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK MAURITANIA A USAID project managed by Chemonics International Inc. TEL: (222) 25 39 18 FAX: (222) 25 39 18 E-mail: [email protected] MONTHLY REPORT FOR APRIL 2002 RAPPORT MENSUEL DU MOIS D’AVRIL 2002 This report covers the period from March 28 to April 25, 2002 Summary FEWS NET/Mauritania conducted a fact-finding mission April 8-22 to gather information on food security conditions in crop and livestock-farming areas of the country. Available data on this year's grain harvests and on trends in conditions in livestock-raising areas point to a country- wide deterioration in food security. The local population and agricultural agencies in the regions visited by the mission agree that, on the whole, this year's grain harvests are down from last year, despite higher yields from certain types of crops and farming systems in specific grain-producing areas. Distribution of food aid is inadequate and, in general, the local population is finding it increasingly difficult to manage its food security with this year's lean period (soudure) beginning two months earlier than usual. There is a visible deterioration in the condition of natural vegetation and in grazing conditions around the country due to natural and man-made factors, depriving people of the basis of their strategy for coping with yearly grain deficits. Mass migration has intensified, particularly from Aftout and the southern portions of Hodh El Chargui and Hodh El Gharbi. The early migration of animal herds to Guidimakha and into Mali first noticed in March intensified during April, while vast tracts of grazing lands in Trarza and Brakna are unusually empty for this time of year. -

RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T3 &T4 2019
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice MINISTERE DE LA SANTE UNITE NATIONALE DU FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T3 &t4 2019 Avril 2020 Table des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................. 3 I. But, cadre, acteurs impliqués dans la vérification communautaire ............................................. 4 1.1 But de la vérification communautaire ..................................................................................... 4 1.2 Cadre de la vérification communautaire .................................................................................. 4 1.3 Les acteurs impliqués .............................................................................................................. 4 II. Phase préparatoire de la vérification communautaire .................................................................. 5 2.1 Elaboration du budget de la Vérification communautaire ................................................... 5 2.2 Amélioration du questionnaire de la vérification communautaire ...................................... 5 2.3 Amélioration du masque de saisie des données issues de l’enquête communautaire .......... 5 2.4 Mise à Jour des guides d’instructions ................................................................................ -

World Bank Document
Public Disclosure Authorized Rapport initial du projet Public Disclosure Authorized Amélioration de la Résilience des Communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique en Mauritanie Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ID Projet 200609 Date de démarrage 15/08/2014 Public Disclosure Authorized Date de fin 14/08/2018 Budget total 7 803 605 USD (Fonds pour l’Adaptation) Modalité de mise en œuvre Entité Multilatérale (PAM) Public Disclosure Authorized Septembre 2014 Rapport initial du projet Table des matières Liste des figures ........................................................................................................................................... 2 Liste des tableaux ........................................................................................................................................ 2 Liste des acronymes ................................................................................................................................... 3 Résumé exécutif ........................................................................................................................................... 4 1. Introduction .......................................................................................................................................... 5 1.1. Historique du projet ......................................................................................................................... 6 1.2. Concept du montage du projet .................................................................................................. -

Congressional Budget Justification 2015
U.S. AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION Pathways to Prosperity “Making Africa’s Growth Story Real in Grassroots Communities” CONGRESSIONAL BUDGET JUSTIFICATION Fiscal Year 2015 March 31, 2014 Washington, D.C. United States African Development Foundation (This page was intentionally left blank) 2 USADF 2015 CONGRESSIONAL BUDGET JUSTIFICATION United States African Development Foundation THE BOARD OF DIRECTORS AND THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION WASHINGTON, DC We are pleased to present to the Congress the Administration’s FY 2015 budget justification for the United States African Development Foundation (USADF). The FY 2015 request of $24 million will provide resources to establish new grants in 15 African countries and to support an active portfolio of 350 grants to producer groups engaged in community-based enterprises. USADF is a Federally-funded, public corporation promoting economic development among marginalized populations in Sub-Saharan Africa. USADF impacts 1,500,000 people each year in underserved communities across Africa. Its innovative direct grants program (less than $250,000 per grant) supports sustainable African-originated business solutions that improve food security, generate jobs, and increase family incomes. In addition to making an economic impact in rural populations, USADF’s programs are at the forefront of creating a network of in-country technical service providers with local expertise critical to advancing Africa’s long-term development needs. USADF furthers U.S. priorities by directing small amounts of development resources to disenfranchised groups in hard to reach, sensitive regions across Africa. USADF ensures that critical U.S. development initiatives such as Ending Extreme Poverty, Feed the Future, Power Africa, and the Young African Leaders Initiative reach out to those communities often left out of Africa’s growth story. -

147AV4-1.Pdf
بسم هللا إلرمحن إلرحمي إمجلهورية إ لسﻻمية إملوريتانية رشف إخاء عدل إلوزإرة إ ألوىل إلس نة إجلامعية 2019-2018 إللجنة إلوطنية للمسابقات جلنة حتكمي إملسابقة إخلارجية لكتتاب 240 وحدة دلخول إملدرسة إلعليا للتعلمي حمرض مدإولت إلتأأمت جلنة حتكمي إملسابقة إخلارجية لكتتاب 240وحدة دلخول إملدرسة إلعليا للتعلمي، يــــوم إلسبت إملوإفق 08 دمجرب 2018 عند إلساعة إلثانية عرشةزوالا يف قاعة الاجامتعات ابملدرسة إلعليا للتعلمي؛ حتت رئاســـة إلسيـــد/ أبوه ودل محمدن ودل بلبﻻ ،ه انئب رئيس إللجنة - وحبضــور أإلعضاء إملعنيني، وبعد تقدمي إلسكراتراي لنتاجئ إملسابقة أابلرقـــــام إلومهية مرتبة ترتيبا إس تحقاقيا، ذكرت إلسكراتراي جلنة إلتحكمي بعــدد إملقاعد إملطلوبة من لك شعبة، وبعد نقاش مس تفيض لنتاجئ لك بةشع عىل حدة مت إعﻻن إلناحجني حسب إلرتتيب الاس تحقايق يف لك شعبة، فاكنت إلنتاجئ عىل إلنحو إلتايل : أول : أساتذة إ لعدإدية : I- Professeurs de Collège - شعبة : إلعربية وإلرتبية إ لسﻻمية - (Ar+IR) - إلناجحون حسب إلرتتيب إ لس تحقايق Liste des admis par ordre de mérite - إلرتتيب رمق إلندإء إ لمس إلاكمل اترخي وحمل إمليﻻد إملﻻحظات إ لس تحقايق 1 0141 يحظيه النعمة اباه 1993/12/31 تنحماد 2 0001 عبد الرحمن محمدن موسى سعدنا 1991/12/31 تكند 3 0722 امنه محمد عالي ببات 1987/08/10 السبخة 4 0499 عبد الرحمن محمد امبارك القاضين 1993/01/01 السبخه 5 0004 الغالي المنتقى حرمه 1992/12/31 اوليكات 6 0145 محمد سالم محمدو بده 1984/12/04 الميسر 7 1007 محمد عالي محمد مولود الكتاب 1996/09/03 العريه 8 0536 ابد محمد سالم محمد امبارك 1992/12/31 بتلميت 9 0175 محمد محمود ابراهيم الشيخ النعمه 1982/10/29 اﻻك 10 0971 الطالب أحمد جدو سيد إبراهيم حمادي 1995/12/16 اغورط 11 0177 محمد اﻻمين احمد شين 1982/12/31 -
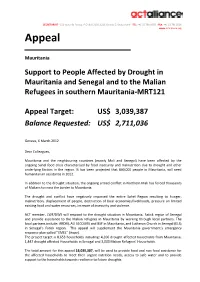
Text Begins Here
SECRETARIAT - 150 route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland - TEL: +41 22 791 6033 - FAX: +41 22 791 6506 www.actalliance.org Appeal Mauritania Support to People Affected by Drought in Mauritania and Senegal and to the Malian Refugees in southern Mauritania-MRT121 Appeal Target: US$ 3,039,387 Balance Requested: US$ 2,711,036 Geneva, 6 March 2012 Dear Colleagues, Mauritania and the neighbouring countries (mainly Mali and Senegal) have been affected by the ongoing Sahel food crisis characterised by food insecurity and malnutrition due to drought and other underlying factors in the region. It has been projected that 800,000 people in Mauritania, will need humanitarian assistance in 2012. In addition to the drought situation, the ongoing armed conflict in Northern Mali has forced thousands of Malians to cross the border to Mauritania. The drought and conflict have negatively impacted the entire Sahel Region resulting to hunger, malnutrition, displacement of people, destruction of local economies/livelihoods, pressure on limited existing food and water resources, increase of insecurity and violence. ACT member, LWF/DWS will respond to the drought situation in Mauritania, Fatick region of Senegal and provide assistance to the Malian refugees in Mauritania by working through local partners. The local partners include: ARDM, AU SECOURS and BSF in Mauritania, and Lutheran Church in Senegal (ELS) in Senegal’s Fatick region. This appeal will supplement the Mauritania government’s emergency response plan called ‘’EMEL’’ (hope). The project target is 8,653 households including: 4,206 drought affected households from Mauritania, 1,447 drought affected Households in Senegal and 3,000 Malian Refugees’ Households. -

Rapport D'evaluation
RAPPORT D’EVALUATION Projet « Assurer l’accès aux services adéquats en eau potable, hygiène et assainissement dans la Moughataa de Koubenni, Hodh el Gharbi » (2014-2018) Rapport Final OCTOBRE 2018 Marie Claire Durand – Consultante Indépendante En collaboration avec L’équipe du Bureau d’études SISTA Evaluation du projet WASH à Koubenni TABLE DES MATIERES 1 Résumé Exécutif ........................................................................................................................................... 9 2 Introduction ................................................................................................................................................ 16 2.1 Contexte ............................................................................................................................................. 16 2.2 Justification de l’action ..................................................................................................................... 18 3 Description du projet – Objet de l’évaluation ....................................................................................... 19 3.1 Objectifs du projet ............................................................................................................................. 19 3.2 Logique d’intervention du projet ................................................................................................... 21 3.2.1 Lien avec le cadre conceptuel des causes de la malnutrition ........................................... 21 3.2.2 Lien avec le cadre d’amélioration -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

The World Bank
- I Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized ReportNo. 9787-MAU STAFF APPRAISAL REPORT ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA Public Disclosure Authorized HEALTHAND POPULATIONPROJECT OCTOBER 28, 1991 Public Disclosure Authorized Populationand Human Resources Operations Division Sahelian Department Africa Region Public Disclosure Authorized This documenthas a restricteddistribution and may be used by recipientsonly in the performanceof their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without WorId Bank authorization. CURRENCY EOUIVALENTS Currency Unit = ouguiya (UM) / US$1.0 = 84 UM (August 1991) MEASURES metric system ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AfDB African Development Bank BHU Village Basic Health Unit BMZ German Ministry for Economic Cooperation CEDS Centre d'Etudes Démographiques et Sociales (Center for Demographic and Social Studies) CHN Centre Hospital,er National (National Hospital Center) CPF Centre de Promotion Féminine (Center for the Promotion of Women) DAFA Directorate of Administrative and Financial Affairs DHE Directorate of Health Education DHR Directorate of Human Resources DHHP Directorate of Hygiene and Health Protection DPM Direction de la Pharmacie et de Médicaments (Directorate of Pharmacy and Drugs) DPC Directorate of Planning and Coordination DRASS Direction Régionale de l'Action Socio-Sanitaire (Regional Health Directorate) EC European Community ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique (National School of Public Health) FPU Family Planning Unit HC Departmental Health -

Concours D'entrée Aux Enis 2019 Commission Nationale Des Concours Eni D' Aioun Instituteurs Français Emploi Liste Des Admis P
Commission Nationale des Concours Concours d'Entrée aux Enis 2019 Eni d' Aioun Emploi Instituteurs Français Liste des Admis par ordre de mérite N° Ins Nom Complet Lieu Naiss NNI Noano Centre d'origine 0045 El Wen Saguine Mohamed Touil 2643163574 97196 Eni d' Aioun 0025 Aminetou Jacques DEMAILLE Aioun 8278902568 97171 Eni d' Aioun 0074 Toutou Mahfoudh El Hadj Aioun 4618107242 97252 Eni d' Aioun 0035 Demba Oumar Diallo Kiffa 5700884195 97186 Eni d' Aioun 0023 Zeidane Isselmou Mahmoud Egjert 9915931313 97268 Eni d' Aioun 0100 Mamadou Aly N'diaye Barkeiwel 0206752300 97214 Eni d' Aioun 0073 Mana Inejih Sidatt Aioun 5576954764 97215 Eni d' Aioun 0118 Saadna Dellahi Baba Soudoud 1524422707 97238 Eni d' Aioun 0094 Cheikh Ahmed Sidi Mahmouyay Aoueinatt Tall 8281785020 97180 Eni d' Aioun 0072 Abou Hamady Ba Bababé 5602577314 94053 Eni de Nouakchott 0288 Mariem Hamidou Aw Tevragh Zeina 1479120021 91054 Eni de Nouakchott 0008 Mohamed Maoulod Mohamed Maloum Tevragh Zeina 4431537248 93174 Eni de Nouakchott 0036 miltou alassane dia boghe 7652709376 95507 Eni de Kaédi 0071 fatimata aliou ba sebkha 8286244692 95977 Eni de Kaédi 0409 Habsatou Mamadou Tall Tevragh Zeina 4685098158 93362 Eni de Nouakchott 0046 Abdel Mehdi Brahim Ba Ksar 0612134700 90424 Eni de Nouakchott 0097 Meimouna Samba Sow Kahel 3500486434 92522 Eni de Nouakchott 0127 Fatimata Mamadou Lemine Ba Elmina 1176678192 90836 Eni de Nouakchott 0186 Brahim Moussa Ba Kankoussa 3715156067 92660 Eni de Nouakchott 0267 Mohamedou Abdellahi Bedou R'Kiz 8254008294 95953 Eni de Nouakchott 0391 Mohamedou -

Child Poverty and Social Protection in Central and Western Africa CROP International Poverty Studies
CROP International Poverty Studies, vol. 5 CROP This timely book deals jointly with multi-dimensional child poverty and so- cial protection in Western and Central Africa in the context of the Sustain- able Development Goals, the Livingstone declaration, and the UN Social Protection Floor. It argues that an improved social protection coverage is needed to prevent and address the consequences of child poverty, be- cause in spite of a decline of child poverty since the start of the millenni- um, concomitant problems such as the increasing number of child brides, Nébié unregulated migration, and child traffi cking remain intractable. Child poverty is different from adult poverty, requiring its own, independent Africa and Western in Central ection Pr and Social et al. (eds.) Child Poverty measurement. This book posits that child poverty should be measured based on constitutive rights of poverty, using a multi-dimensional ap- proach. The case is also made that the underlying drivers of child poverty are inequity and inequality, lack of access to basic social services, and the presence of families without any type of social protection. Mapping current interventions, practices, and contributions of social protection in dealing with child poverty whilst recognizing its limitations, no practical policy recommendations for Western and Central Africa can be devised without acknowledging the results contained in this volume. “Comparative case studies and empirical evidence, along with important theoretical insights on childhood deprivation, are at the core of this out- standing book which should be mandatory reading for policymakers as well as academic researchers and graduate students who are working in Child Poverty and this fi eld.” Jamee K. -

N° N° Bac Nom Fr Date Naiss Lieu De Naiss A. Bac M. Bac M
N° N°BAC NOMFR DATENAISS LIEUDENAISS A.BAC M.BAC M.Class. Série Filière Sess Sexe 1 11047 MohamedVadelSidiThvagha 31/12/1994 Tintane 14 10.91 13.761429 D MEDECINE 1 G 2 11636 MalhaIbrahimaNiang 25/03/1995 Ksar 14 12.37 13.841429 D MEDECINE 1 F 3 11719 MeimineMohamedSalemBedde 26/06/1996 Teyaret 14 10.88 14.472857 D MEDECINE 1 F 4 11790 MohamedBoudineAhmedouYacine 31/12/1995 Arafat 14 12.14 13.77 C MEDECINE 1 G 5 12585 HasnyGahZeiny 02/08/1995 Bangou 14 12.13 14.324286 C MEDECINE 1 G 6 12686 YahyaAbatnaLimam 04/11/1995 TimbeSNra 14 11.9 13.415714 C MEDECINE 1 G 7 12707 MohamedYahefdhouCheikhnaAhmedBoubaca21/12/1995 Néma 14 12.03 13.932857 C MEDECINE 1 G 8 12710 MariemIsselmouTedih 31/10/1995 Toujounine 14 11.91 14.398571 C MEDECINE 1 F 9 12758 MohamedLemineDatyElMoustapha 31/05/1996 Sebkha 14 11.82 14.974286 D MEDECINE 1 G 10 13451 NessibeMoustaphaLekleib 02/12/1995 Boghé 14 10.86 14.515714 D MEDECINE 1 F 11 13567 ElDehDidiBaba 28/12/1995 N'Beike 14 12.88 14.725714 D MEDECINE 1 G 12 14275 BambiMohamedCamara 14/04/1993 SNafort 14 11.06 13.562857 D MEDECINE 1 F 13 15008 AichetouMokhtarHamed 10/12/1993 SNarNaim 14 10.8 13.564286 D MEDECINE 0 F 14 15016 MohamedElMoustaphaNagiAhmedMahmoud10/03/1995 Toujounine 14 10.78 13.861429 D MEDECINE 1 G 15 15408 AichetouMohamedElMoustaphaJedou 12/06/1993 Bareine 14 10.92 13.491429 D MEDECINE 1 F 16 15585 MohamedSalemMohamedMahmoudSidiLehss30/12/1994 TevraghZein 14 12.28 13.575714 D MEDECINE 1 G 17 15602 SidiMohamedAhmedMohamedSaid 31/07/1994 Ksar 14 11.48 14.247143 D MEDECINE 1 G 18 16354 ElHacenMohamedElHadramy