Et La Guerre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Military Aircraft Crash Sites in South-West Wales
MILITARY AIRCRAFT CRASH SITES IN SOUTH-WEST WALES Aircraft crashed on Borth beach, shown on RAF aerial photograph 1940 Prepared by Dyfed Archaeological Trust For Cadw DYFED ARCHAEOLOGICAL TRUST RHIF YR ADRODDIAD / REPORT NO. 2012/5 RHIF Y PROSIECT / PROJECT RECORD NO. 105344 DAT 115C Mawrth 2013 March 2013 MILITARY AIRCRAFT CRASH SITES IN SOUTH- WEST WALES Gan / By Felicity Sage, Marion Page & Alice Pyper Paratowyd yr adroddiad yma at ddefnydd y cwsmer yn unig. Ni dderbynnir cyfrifoldeb gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Cyf am ei ddefnyddio gan unrhyw berson na phersonau eraill a fydd yn ei ddarllen neu ddibynnu ar y gwybodaeth y mae’n ei gynnwys The report has been prepared for the specific use of the client. Dyfed Archaeological Trust Limited can accept no responsibility for its use by any other person or persons who may read it or rely on the information it contains. Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Cyf Dyfed Archaeological Trust Limited Neuadd y Sir, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, Sir The Shire Hall, Carmarthen Street, Llandeilo, Gaerfyrddin SA19 6AF Carmarthenshire SA19 6AF Ffon: Ymholiadau Cyffredinol 01558 823121 Tel: General Enquiries 01558 823121 Adran Rheoli Treftadaeth 01558 823131 Heritage Management Section 01558 823131 Ffacs: 01558 823133 Fax: 01558 823133 Ebost: [email protected] Email: [email protected] Gwefan: www.archaeolegdyfed.org.uk Website: www.dyfedarchaeology.org.uk Cwmni cyfyngedig (1198990) ynghyd ag elusen gofrestredig (504616) yw’r Ymddiriedolaeth. The Trust is both a Limited Company (No. 1198990) and a Registered Charity (No. 504616) CADEIRYDD CHAIRMAN: Prof. B C Burnham. CYFARWYDDWR DIRECTOR: K MURPHY BA MIFA SUMMARY Discussions amongst the 20th century military structures working group identified a lack of information on military aircraft crash sites in Wales, and various threats had been identified to what is a vulnerable and significant body of evidence which affect all parts of Wales. -

Australians at War Film Archive Noel Sanders
Australians at War Film Archive Noel Sanders (Sandy, Skipper) - Transcript of interview Date of interview: 16th June 2003 http://australiansatwarfilmarchive.unsw.edu.au/archive/526 Tape 1 00:42 Noel. We’ve got the tape running. We’re ready to start. Could you begin by telling me a bit about where you were born and brought up? I was brought up on the Macleay River, up on the North Coast on New South Wales. I was born at Kempsey, in the town there, 01:00 in Hollywood Private Hospital, the 4th of December, 1923. And my parents were farmers. I spent most of my early childhood in the lower Macleay, on the farm down there, and I attended primary school down there. And that was the extent of my formal education, primary school, I never did manage to get to high school. 01:30 But in later years that was, of course, detrimental to me joining the air force, so I had to work pretty hard to get on with that. How’s that? That’s good. Why didn’t you go to high school? Because in those days, farming, as it always has been, was a hard life and Dad couldn’t afford to have labour so I was the born labour. Being the eldest son. I was to 02:00 come in, and….I was quite happy to, at the age of fourteen, to join him on the farm and learn about the farm. What sort of work were you doing on the farm? The bulk of it was milking cows. -

Depiction of Airfields on Landranger 128, 1974-2018 Lez Watson
Draft 1.1 Depiction of airfields on Landranger 128, 1974-2018 Lez Watson Airfields, both military and civil, are a feature of many one-inch and 1:50 000 maps of Britain. They have been depicted in varying degrees of detail. Two seminal articles on this were published in 2014 by Ronald Blake1 2. They provided a fascinating introduction to key aspects of ‘charting the aeronautical landscape’. Blake published a paper forty years ago on disused airfields as a planning resource3. He discussed East Midlands including four in Derbyshire on the 1:50 000 sheet 128. His study identified three types of potential – locational, structural and development. He deemed Darley Moor as having little potential, but proposed Ashbourne, Burnaston and Church Broughton as ‘requiring special planning attention’. Indeed, these are the Derbyshire sites that have fulfilled this potential to some degree. Fradley in Staffordshire can be added to this category. Twenty years ago, John Nicolls wrote an introduction to airfields on Ordnance Survey 4 post-war one-inch mapping for Sheetlines . This Figure 1 provided an insight to the variation in aerodrome mapping detail. Around that time, I began to compile a publication history of my local Landranger map, including information about the airfields depicted. Later this listing evolved into a website page5. This study covers thirteen airfields: one pre-war, seven RAF Second World War plus two associated landing grounds6, one army base, and four more airfields established in recent years (fig. 1). It considers whether openings, closures, changes and subsequent 1 Ronald Blake, 2014a. ‘Charting the aeronautical landscape – Part 1: depiction of airfields on Ordnance Survey one-inch maps from the birth of practical aviation to the aftermath of World War 2’, Sheetlines 99, 19. -
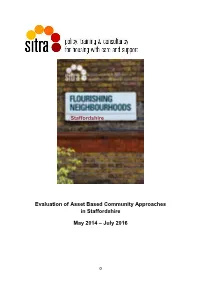
Report on Asset Based Community Approaches
Staffordshire Evaluation of Asset Based Community Approaches in Staffordshire May 2014 – July 2016 0 Acknowledgements Sitra would like to thank Asset Based Consulting, C2 and Nurture Development for sharing their learning and including us in much communication and many meetings, providing updates and honest opinion on progress. This has been a useful complement to our own research, signposting us to where to look and who to ask, and positively supporting Staffordshire County Council’s commitment to gather learning from these pilot sites to further the evolution of ABCD in the UK. We would also like to thank the people of Cannock, Fradley, Lichfield and Tamworth. Whilst not all residents may have been aware that something interesting was happening in their neighbourhoods, those that did engage were helpful, constructive and supportive. And we had the privilege to meet a number of committed people determined to help people around them and make their neighbourhoods more fulfilling places to live. Lastly, Staffordshire has diverse voluntary agencies and statutory bodies working together to improve communities. Without exception, all were welcoming and co-operative, providing views on what is happening now and what should happen in the future to help their work. Eddy McDowall, Pam Dixon and Burcu Borysik, August 2016 1 Contents Section Page 1. Introduction 4 2. Executive Summary 6 3. Evaluation Methods 9 3.1 Methodology Framework 9 3.2 Attendance at meetings 9 3.3 Interviews – first round 9 3.4 Interviews with agencies 10 3.5 Interviews – second round 10 3.6 Observation 10 3.7 Sitra Survey 10 4. -

Lichfield District Local Plan Strategy 2008-2029
Lichfield District Local Plan Strategy 2008 - 2029 Adopted 17 February 2015 Lichfield District Local Plan Strategy 2015 1 Introduction 5 Spatial Portrait & Vision 2 Spatial Portrait of the District 10 3 Vision & Strategic Priorities 18 Spatial Strategy Contents 4 The Spatial Strategy for Lichfield District 23 General Policies 5 Sustainable Communities 32 6 Infrastructure 41 7 Sustainable Transport 45 8 Homes for the Future 50 9 Economic Development & Enterprise 59 10 Healthy & Safe Communities 67 11 Natural Resources 78 12 Built & Historic Environment 89 Our Settlements 13 Lichfield City (incl. Streethay) 97 14 Burntwood 107 15 North of Tamworth 115 16 East of Rugeley 118 17 Rural 121 Appendices A Implementation & Monitoring 147 B Housing Trajectory 154 C South of Lichfield SDA Concept Statement 155 D East of Lichfield (Streethay) SDA Concept Statement 161 E Fradley SDA Concept Statement 167 F East of Burntwood Bypass SDA Concept Statement 173 G East of Rugeley SDA Concept Statement 178 H Deans Slade South of Lichfield SDA Concept Statement 183 I Cricket Lane South of Lichfield SDA Concept Statement 189 J Superseded Local Plan Policies 194 Glossary Glossary 198 Lichfield District Local Plan Strategy 2015 Contents Core Policies Core Policy 1: The Spatial Strategy 24 Core Policy 2: Presumption in Favour of Sustainable Development 33 Core Policy 3: Delivering Sustainable Development 33 Core Policy 4: Delivering our Infrastructure 42 Core Policy 5: Sustainable Transport 45 Core Policy 6: Housing Delivery 50 Core Policy 7: Employment & Economic -

Whittington to Handsacre | CFA22 | Whittington to Handsacre
LONDON-WEST MIDLANDS ENVIRONMENTAL STATEMENT ENVIRONMENTAL MIDLANDS LONDON-WEST | Vol 2 Vol LONDON- | Community Forum Area report Area Forum Community WEST MIDLANDS ENVIRONMENTAL STATEMENT Volume 2 | Community Forum Area report CFA22 | Whittington to Handsacre | CFA22 | Whittington to Handsacre Whittington to Handsacre November 2013 VOL VOL VOL ES 3.2.1.22 2 2 2 London- WEST MIDLANDS ENVIRONMENTAL STATEMENT Volume 2 | Community Forum Area report CFA22 | Whittington to Handsacre November 2013 ES 3.2.1.22 High Speed Two (HS2) Limited has been tasked by the Department for Transport (DfT) with managing the delivery of a new national high speed rail network. It is a non-departmental public body wholly owned by the DfT. A report prepared for High Speed Two (HS2) Limited: High Speed Two (HS2) Limited, Eland House, Bressenden Place, London SW1E 5DU Details of how to obtain further copies are available from HS2 Ltd. Telephone: 020 7944 4908 General email enquiries: [email protected] Website: www.hs2.org.uk High Speed Two (HS2) Limited has actively considered the needs of blind and partially sighted people in accessing this document. The text will be made available in full on the HS2 website. The text may be freely downloaded and translated by individuals or organisations for conversion into other accessible formats. If you have other needs in this regard please contact High Speed Two (HS2) Limited. Printed in Great Britain on paper containing at least 75% recycled fibre. CFA Report – Whittington to Handsacre/No 22 | Contents Contents 1 Introduction -
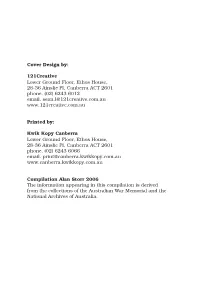
Raaf Personnel Serving on Attachment in Royal Air Force Squadrons and Support Units
Cover Design by: 121Creative Lower Ground Floor, Ethos House, 28-36 Ainslie Pl, Canberra ACT 2601 phone. (02) 6243 6012 email. [email protected] www.121creative.com.au Printed by: Kwik Kopy Canberra Lower Ground Floor, Ethos House, 28-36 Ainslie Pl, Canberra ACT 2601 phone. (02) 6243 6066 email. [email protected] www.canberra.kwikkopy.com.au Compilation Alan Storr 2006 The information appearing in this compilation is derived from the collections of the Australian War Memorial and the National Archives of Australia. Author : Alan Storr Alan was born in Melbourne Australia in 1921. He joined the RAAF in October 1941 and served in the Pacific theatre of war. He was an Observer and did a tour of operations with No 7 Squadron RAAF (Beauforts), and later was Flight Navigation Officer of No 201 Flight RAAF (Liberators). He was discharged Flight Lieutenant in February 1946. He has spent most of his Public Service working life in Canberra – first arriving in the National Capital in 1938. He held senior positions in the Department of Air (First Assistant Secretary) and the Department of Defence (Senior Assistant Secretary), and retired from the public service in 1975. He holds a Bachelor of Commerce degree (Melbourne University) and was a graduate of the Australian Staff College, ‘Manyung’, Mt Eliza, Victoria. He has been a volunteer at the Australian War Memorial for 21 years doing research into aircraft relics held at the AWM, and more recently research work into RAAF World War 2 fatalities. He has written and published eight books on RAAF fatalities in the eight RAAF Squadrons serving in RAF Bomber Command in WW2. -
Hay End Lane Report
Land at Hay End Lane Fradley Staffordshire Heritage Desk-Based Assessment for Pegasus Group CA Project: 3729 CA Report: 12059 May 2013 Land at Hay End Lane Fradley Staffordshire Heritage Desk-Based Assessment CA Project: 3729 CA Report: 12059 prepared by Nathan Blick, Research Officer date 20 April 2012 checked by Gail Stoten, Principal Consultancy Manager date March 2013 approved by Gail Stoten, Principal Consultancy Manager signed date May 2013 issue 01 This report is confidential to the client. Cotswold Archaeology accepts no responsibility or liability to any third party to whom this report, or any part of it, is made known. Any such party relies upon this report entirely at their own risk. No part of this report may be reproduced by any means without permission. © Cotswold Archaeology Building 11, Kemble Enterprise Park, Kemble, Cirencester, Gloucestershire, GL7 6BQ t. 01285 771022 f. 01285 771033 e. [email protected] CONTENTS 1. INTRODUCTION ................................................................................................ 6 Outline ................................................................................................................ 6 Location and landscape context ......................................................................... 6 Scope ................................................................................................................. 6 2. METHODOLOGY ............................................................................................... 8 Desk-based assessment -
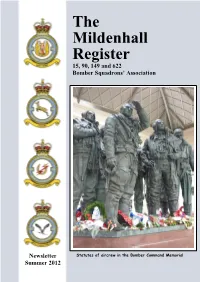
2012 Newsletter
The Mildenhall Register 15, 90, 149 and 622 Bomber Squadrons’ Association Newsletter Statutes of aircrew in the Bomber Command Memorial Summer 2012 Words from the Chairman Welcome to this special edition of the Mildenhall Register Newsletter which has been produced to cover the events of June 28, 2012 – the Dedication and Unveiling of the Bomber Command Memorial. We have also taken the opportunity to print many of the stories and news which we have received from Register members over the past year. Please do not feel left out if your story is missing for we will eventually catch up with the backlog however, we still want to hear your stories and news so don‘t stop sending them in! This year‘s reunion was again very successful in all aspects and a report is included with the newsletter. Many appreciated the dedicated service held in the Base Chapel which followed more conventional lines; indeed there is a strong feeling that we should hold the service at St John‘s Beck Row where our memorial plaque is located. However, others wish to maintain the link with the Americans and enjoy the contemporary service in the Base Chapel. I would appreciate your views which will help in planning next year‘s reunion. I hope you find this newsletter interesting and trust you will enjoy what remains of the summer! John Gentleman The Secretary’s Report I‘ll try and keep my report concise so that we can get to the main point of this 2012 special summer edition, the Bomber Command memorial. -

The Evolution of British Airborne Warfare: a Technological Perspective
The Evolution of British Airborne Warfare: A Technological Perspective By Timothy Neil Jenkins A thesis submitted to the University of Birmingham for the Degree of Doctor of Philosophy School of History and Cultures University of Birmingham July 2013 i University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The evolution of British airborne warfare cannot be fully appreciated without reference to the technological development required to convert the detail contained in the doctrine and concept into operational reality. My original contribution to knowledge is the detailed investigation of the British technological investment in an airborne capability in order to determine whether the development of new technology was justifiable, or indeed, entirely achievable. The thesis combines the detail contained in the original policy for airborne warfare and the subsequent technological investigations to determine whether sufficient strategic requirement had been demonstrated and how policy impacted upon the research programme. Without clear research parameters technological investment could not achieve maximum efficiency and consequent military effectiveness. The allocation of resources was a crucial factor in the technological development and the fact that aircraft suitability and availability remained unresolved throughout the duration of the war would suggest that the development of airborne forces was much less of a strategic priority for the British than has previously been suggested. -

A Teenager Growing up in England During WWII, the Blitz and Other Childhood Memories by Colin Green
A Teenager Growing Up in England during WWII, The Blitz and Other Childhood Memories By Colin Green suppose the background of what follows is a deep regret that not something you got hospitals involved in. I was baptized in I did not ask my parents more about their lives while they St. Michaels Church, as John Colin Green. I have no idea why I were still around. I would love have to had my Mother’s I was always called Colin – perhaps to distinguish me from recollections of living as a young child with her mother in a the son of my parents’ closest friends – the Waldeck’s – David workhouse in Oxford; I should hasten to add that her mother and Nancy - whose son and only child was called Henry John was matron there. Obviously, living through the Blitz in Smith Waldeck. At that time Henry was an unpopular name Birmingham was an interesting part of my early teens, so I for a child – God only knows why – so he was always called have penned my recollections John, which I suppose left me below. I’ve added some other with Colin. wartime stuff while I was My first schooling was at about it. Miss Webb’s Kindergarten on Perhaps I need to say a bit the Chester Road, next door to about the City of Birmingham. Chester Road Station. I believe Obviously the largest city in I was still there when we moved the U.K. is London, about eight from 34 Sycamore Road to 34 million folks, interestingly Beacon Road, Sutton Coldfield. -

Site SHA3 Fradley Heritage Impact Assessment
Site SHA3 Fradley Heritage Impact Assessment Client: Date: Lichfield District Council December 2020 Site SHA3 Fradley Heritage Impact Assessment Project Details Client: Lichfield District Council Project Number: F1618 Address: Lichfield District Council 20 Frog Lane Lichfield WS13 6HS Quality Assurance – Approval Status Issue: 1.2 Date: 02/12/20 Prepared By: Megan Lloyd-Regan and Richard Havis Checked By: Tim Murphy Approved By: Tim Murphy Prepared by: Place Services Essex County Council County Hall, Chelmsford, Essex CM1 1QH T: +44 (0)333 013 6840 E: [email protected] www.placeservices.co.uk @PlaceServices Page 3 Disclaimer This report has been prepared by Place Services with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the Contract with the client, incorporation of our General Terms and Condition of Business and taking account of the resources devoted to us by agreement with the client. We disclaim any responsibility to the client and others in respect of any matters outside the scope of the above. This report is confidential to the client and we accept no responsibility of whatsoever nature to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies on the report at its own risk. Copyright This report may contain material that is non-Place Services copyright (e.g. Ordnance Survey, British Geological Survey, Historic England), or the intellectual property of third parties, which Place Services is able to provide for limited reproduction under the terms of our own copyright licences or permissions, but for which copyright itself is not transferable by Place Services.