Jules Massenet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Visual Aspects of Le Mage
The visual aspects of Le Mage Michela Niccolai The first part of Massenet’s career was marked by the composition of several grand operas: Le Roi de Lahore (1877), Hérodiade (1881), Le Cid (1885) and Le Mage (1891). The latter , produced at the Paris Opéra, directed at that time by Ritt and Gailhard, was lavishly staged and the number of costumes was extraordinary. Even so, it remained on the bill, between spring and autumn 1891, for just thirty-one performances, from the première on 16 March. The new work was not received with great enthusiasm in the press. Henry Moreno (pen name of the publisher Henri Heugel) reported in the columns of Le Ménestre l: Pointless cliché: that is what characterises Le Mage . [...] Monsieur Massenet is obviously in a difficult period, in which he is no longer able to see clear - ly the path he had been following so successfully since the beginning. Like his hero Zarastra, he is badly in need of a spell of contemplation. He would do well to withdraw to the holy mountain to consider the dangers of over- hasty production, and then return to us stronger, fortified, ready to take on new challenges. (Henri Moreno, ‘Semaine Théâtrale, Le Mage ’, Le Ménestrel , 22 March 1891, no 12, p. 92.) Even among those close to Massenet, some appear to have been disap - pointed in their expectations of Le Mage . His friend and pupil Gustave Charpentier wrote to his father from Paris on 18 March 1891: 69 jules massenet: le mage The day before yesterday I attended the première of Le Mage (by Massenet). -

LA REVUE HEBDOMADAIRE, 11 Février 1893, Pp. 296-309. on Sait L
LA REVUE HEBDOMADAIRE , 11 février 1893, pp. 296-309. On sait l’activité surprenante de M. Massenet et son ardeur au travail. Représente-t-on une œuvre nouvelle signée de son nom, on est sûr d’apprendre en même temps qu’il est en train d’en achever une autre. A peine l’Opéra-Comique vient-il de nous donner Werther que déjà nous savons que Thaïs est terminée. Aussi la liste des opéras de M. Massenet est-elle déjà longue, et il est certain que le compositeur à qui nous devons le Roi de Lahore, Hérodiade, le Cid, Esclarmonde, Manon, le Mage et Werther, ne saurait en aucun cas être accusé de perdre son temps. Cette inépuisable fécondité entraîne avec elle ses avantages et ses inconvénients. Mais nous croyons qu’en ce qui concerne M. Massenet, elle a moins d’inconvénients que d’avantages. Tandis que certains tempéraments d’artistes ont besoin, en effet, d’une longue gestation préalable, pour exprimer leurs idées et leur donner une forme, il est de ces natures spécialement douées qui abordent tous les sujets comme en se jouant et savent en vertu de leur admirable souplesse se les approprier en les accommodant à leurs facultés. Est-il besoin de dire que M. Massenet a été doté par une bonne fée d’une de ces natures toutes d’impulsion, et qu’il n’est pas de ceux qui mûrissent laborieusement leurs œuvres? Mais // 297 // sa personnalité s’accommode à merveille de cette production infatigable, et cette fécondité même n’en est pas un des côtés les moins caractéristiques. -

4 Mars La Messe Pour Deux Chœurs Et Deux Orgues De Louis Vierne, Avec Le Chœur Massenet, Dir. Lucie Roy Et Jonathan Oldengarm Et Vincent Boucher, Orgue
4 mars La Messe pour deux chœurs et deux orgues de Louis Vierne, avec le chœur Massenet, dir. Lucie Roy et Jonathan Oldengarm et Vincent Boucher, orgue 11 mars La Messe brève et œuvres pour orgue de Fernand de La Tombelle, avec le chœur Modulation, dir. Lucie Roy et Jonathan Oldengarm et Raphaël Ashby, orgue 18 mars Autour du choral luthérien avec Réjean Poirier, orgue 25 mars Les Leçons de Ténèbre de François Couperin avec Geoffroy Salvas, baryton et Christophe Gauthier, orgue 1 avril Bach et la Résurrection avec Réal Gauthier, orgue 8 avril Œuvres sacrées pour chœur avec le Chœur du Plateau dir. Roseline Blain et Vincent Boucher, orgue 15 avril Daniel Roth, organiste de l’église Saint-Sulpice à Paris 22 avril Œuvres sacrées pour chœur et orgue avec le Chœur Classique de Montréal, dir. Louis Lavigueur et Mireille Lagacé, orgue 29 avril Éclats de mémoire, événement littéraire et musical avec Jean Marchand, narration et Hampus Lindwall (Suède) orgue Les dimanches à 15:30 dans la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran SÉRIE DES CONCERTS DU DIMANCHE 2018 50 concerts gratuits mettant en vedette 42 organistes provenant de 8 pays et accompagnés de plus de 800 choristes et instrumentistes. La Folia 6 mai au 1 juillet Les concerts d’été 15 juillet au 23 septembre Festival d’orgue de Montréal 30 septembre au 28 octobre Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire concertsdudimanche.org Eugénie Préfontaine détient un baccalauréat en chant classique et baroque à l’Université de Montréal. Au cours des dernières années, elle a tenu plusieurs rôles « TABLEAUX BIBLIQUES » dans différentes productions au sein de la compagnie Belle Lurette à Laval, dont Wanda dans l’opérette La Grande-Duchesse de Gérolstein de J.Offenbach en 2016. -
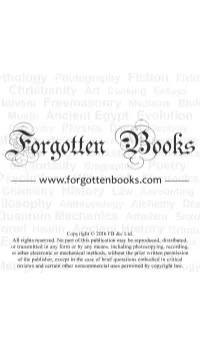
MASSENET and HIS OPERAS Producing at the Average Rate of One Every Two Years
M A S S E N E T AN D HIS O PE RAS l /O BY HENRY FIN T. CK AU THO R O F ” ” Gr ie and His Al y sia W a ner and H W g , g is or ks , ” S uccess in Music and it W How is on , E ta , E tc. NEW YO RK : JO HN LANE CO MPANY MCMX LO NDO N : O HN L NE THE BO DLEY HE D J A , A K N .Y . O MP NY N E W Y O R , , P U B L I S HE R S P R I NTI N G C A , AR LEE IB R H O LD 8 . L RA Y BRIGHAM YO UNG UNlVERS lTW AH PRO VO . UT TO MY W I FE CO NTENTS I MASSENET IN AMER . ICA. H . B O GRAP KET H II I IC S C . P arents and Chi dhoo . At the Conservatoire l d . Ha D a n R m M rri ppy ys 1 o e . a age and Return to r H P a is . C oncert a Successes . In ar Time ll W . A n D - Se sational Sacred rama. M ore Semi religious m W or s . P ro e or and Me r of n i u k f ss be I st t te . P E R NAL R D III SO T AITS AN O P INIO NS . A P en P ic ure er en ne t by Servi es . S sitive ss to Griti m h cis . -

Music Criticism and the Exposition Internationale Universelle De 1900 *
Music Criticism and the Exposition Internationale Universelle de 1900 * Lesley Wright What people ... do in such a fair is to stroll, to be a flâneur, and what they stroll between are signs of different cultures. Therefore, whether they are locals or visitors from outside the city hosting the fair, they are acting as tourists, gazing upon the signs of different cultures. People can do in an afternoon what otherwise takes a lifetime: gaze upon and collect signs of dozens of different cultures—the built environment, cultural artefacts, meals and live, ethnic entertainment.1 From 14 April to 12 November 1900 Paris hosted the largest international exposition ever seen up to that time. Just under fifty-one million visitors came to ‘tour the world’ via the exhibits of more than forty nations. The French government wanted the visitors to take home an appreciation of the host nation—respect for her culture (the âme française) and for her political might (manifested in the colonial empire)—as well as an understanding of artistic and technological progress of the previous century. Tourists, both French and foreign, would have the opportunity to compare the exhibits of participating nations and in this way establish relative rankings.2 And so a splendid retrospective art exhibit and an extensive series of concerts surveyed the French tradition in the arts while the impressive pavilions of the French colonies in Southeast Asia, Africa and North Africa attested to the nation’s wealth and power as well as her genius for administration and education.3 In the theatres attached to these pavilions indigenous peoples provided live ethnic entertainment for the flâneurs.4 The Exposition was also a grand amusement park with shopping, restaurants and popular diversions. -

Paul Vidal (1863-1931)
1/22 Data Paul Vidal (1863-1931) Pays : France Sexe : Masculin Naissance : Toulouse, 16-06-1863 Mort : Paris, 09-04-1931 Note : Chef d'orchestre, professeur et compositeur. - Prénoms complets : Paul, Antonin ISNI : ISNI 0000 0000 8133 3229 (Informations sur l'ISNI) A dirigé : De 1914 à 1919 : Théâtre national de l'Opéra-comique. Orchestre. Paris Paul Vidal (1863-1931) : œuvres (498 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres musicales (334) Salut aux Vosges Hymne à la beauté (1904) (1904) Ballet des nations Cantique (1903) (1900) Printemps nouveau Orchestrations. Le chant du départ. Méhul, Étienne- (1900) Nicolas (1900) Berceuses. Choeur à 3 voix La burgonde (1900) (1898) Retour d'Islande Solos de concert. Trombone, piano. No 2 (1897) (1897) Le chant des glaives Orchestrations. La marseillaise. Rouget de Lisle, Claude (1897) Joseph (1897) Les contrebandiers du Mont-Noir Guernica (1896) (1895) data.bnf.fr 2/22 Data Les Pyrénées Glory be to the Father (1895) (1894) Lou mètjoun La maladetta (1894) (1893) "Trois sonneries de la Rose+Croix. Piano" Chant de Noël (1892) (1892) de Erik Satie avec Paul Vidal (1863-1931) comme Destinataire de l'envoi Les feux follets Chanson de fées (1892) (1887) "Le carnaval des animaux. R 125" "Manon" (1886) (1884) de Camille Saint-Saëns de Jules Massenet avec Paul Vidal (1863-1931) comme Orchestrateur avec Paul Vidal (1863-1931) comme Auteur de la réduction musicale Invocation "Euryanthe. J 291" (1883) (1822) de Carl Maria von Weber avec Paul Vidal (1863-1931) comme Auteur de la réduction musicale "Euryanthe. J 291" "Ch'io mi scordi di te. KV 505" (1822) (1786) de Carl Maria von Weber de Wolfgang Amadeus Mozart avec Paul Vidal (1863-1931) comme Éditeur scientifique avec Paul Vidal (1863-1931) comme Auteur de la réduction musicale "Le nozze di Figaro. -

Massenet and Opera: Richness and Diversity
jules massenet : thérèse Massenet and opera: richness and diversity Jean-Christophe Branger Massenet (184 2- 1912) is known above all for two works, Manon and Werther , and to these have been added another four: Hérodiade , Thaïs , Don Quichotte and Cendrillon , which are now enjoying renewed popularity. However, his output was much larger than that: twenty-five complete operatic works have come down to us (not counting Marie-Magdeleine , an oratorio written in 1873 and staged in 1903). But his output has been large - ly neglected because of its singularity: few people realise that Massenet experimented with opera far more than most other composers, thus cre - ating a multi-faceted world all of his own. It was in Massenet’s temperament, no doubt, to feel a constant need for change and renewal, diversity and challenge, and he was generally encouraged in that direction by his publishers and librettists and those close to him. In 1896 he told the periodical Le Temp s: You will notice [...] that my works are taken from very diverse sources. I try to vary their subjects. Manon came after Hérodiade , Esclarmonde fol - lowed Le Cid . I tear myself away from one world to immerse myself imme - diately in another one that is very different, in order to change the course of my ideas. That is the best way to avoid monotony. Massenet thus approached every genre and every register. While Le Roi de Lahore (1877), Hérodiade (1881), Le Cid (1885) and Le Mage (1891) are 40 unquestionably grand operas à la Meyerbeer (including the inevitable bal - let), Ariane (1906), Bacchus (1909), Roma (1912) and Cléopâtre (posthu - mous, 1914) belong rather to an important neo-Gluckist movement, showing a keen interest in Greek and Roman antiquity. -

Memorial Library of Music Collection
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt6r29p0pm No online items Partial Guide to the Memorial Library of Music Collection Special Collections staff Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc/ © 2006 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Partial Guide to the Memorial MLM 1 Library of Music Collection Partial Guide to the Memorial Library of Music Collection Collection number: MLM Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Processed by: Special Collections staff Date Completed: 2003 Encoded by: Bill O'Hanlon © 2006 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Memorial Library of Music collection Collection number: MLM Collector: Keating, George T. Collection Size: ca. 27 linear ft. Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Abstract: This library is a collection of musical manuscripts and of printed and engraved scores inscribed by great composers, and constitutes a unique addition to Stanford's educational and cultural resources. Languages: Languages represented in the collection: English Access Collection is open for research; materials must be requested at least 24 hours in advance of intended use. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Preferred Citation Memorial Library of Music Collection, MLM. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. -

Massenet's Cendrillon
Massenet’s Cendrillon: Exploring the interactions of the orchestra and vocal line as found in the role of Cendrillon, and a dramatically rich role for the lyric mezzo soprano By Kristee Haney Submitted to the graduate degree program in the School of Music and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts. ________________________ Chairperson Dr. Roberta Schwartz ________________________ Joyce Castle _______________________ Mark Ferrell ________________________ Dr. John Stephens ________________________ Dr. Michelle Heffner - Hayes Date Defended: April 18th, 2014 ii The Dissertation Committee for Kristee Haney certifies that this is the approved version of the following dissertation: Massenet’s Cendrillon: Exploring the interactions of the orchestra and vocal line as found in the role of Cendrillon, and a dramatically rich role for the lyric mezzo soprano ________________________________ Chairperson Dr. Roberta Schwartz Date approved: April 18th, 2014 iii Abstract Composer Jules-Émile- Frédéric Massenet wrote a variety of roles for mezzo sopranos, and his soaring vocal lines are coupled with sensitive communication of the text. In Cendrillon, Massenet writes leading roles for three mezzo soprano voices: Le Prince Charmant, Madame de la Haltière, Cendrillon (and one featured supporting role, the step- sister Dorothée). The three leading roles involve different vocal and dramatic demands, while still allowing the unique colors of the mezzo soprano voice to shine. I will explore Massenet’s writing for the mezzo soprano and the interaction of the vocal line with the orchestra, in his “fairy tale” opera, Cendrillon. I will analyze scenes that deal with the role of title character Cendrillon and the specific vocal qualities that Massenet highlights in each: Cendrillon’s arias in Act I and Act III; the scene with La Feé in Act I; the duet with the Prince Charmant in Act II; and the duet / trio with Prince Charmant and La Feé that ends Act III. -

JULES MASSENET – His Life and Works by Nick Fuller I
JULES MASSENET – His Life and Works By Nick Fuller I. Introduction Jules Massenet’s operas made him one of the most popular composers of the late nineteenth century, his works performed throughout Europe, the Americas and North Africa. After World War I, he was seen as old- fashioned, and nearly all of his operas, apart from Werther and Manon , vanished from the mainstream repertoire. The opera-going public still know Massenet best for Manon , Werther , and the Méditation from Thaïs , but to believe, as The Grove Dictionary of Opera wrote in 1954, that ‘to have heard Manon is to have heard all of him’ is to do the composer a gross disservice. Massenet wrote twenty-seven operas, many of which are at least as good as Manon and Werther . Nearly all are theatrically effective, boast beautiful music and display insightful characterisation and an instinct for dramatic and psychological truth. In recent decades, Massenet’s work has regained popularity. Although he Figure 1 Jules Massenet, drawing by Ernesto Fontana (Source: is not the household name he once http://artlyriquefr.fr/personnages/Massenet%20Jules.html) was, and many of his operas remain little known, he has been winning new audiences. Conductors like Richard Bonynge, Julius Rudel and Patrick Fournillier have championed Massenet, while since 1990 a biennial Massenet festival has been held in his birthplace, Saint-Étienne, in the Auvergne-Rhône-Alpes, its mission to rediscover Massenet’s operas. His work has been performed in the world’s major opera houses under the baton of conductors Thomas Beecham, Colin Davis, Charles Mackerras, Michel Plasson, Riccardo Chailly and Antonio Pappano, and sung by Joan Sutherland, José van Dam, Frederica von Stade, Nicolai Gedda, Roberto Alagna, Renée Fleming, Thomas Hampson and Plácido Domingo. -

Hérodiade Jules Massenet (1842-1912)
1/20 Data Hérodiade Jules Massenet (1842-1912) Langue : Français Genre ou forme de l’œuvre : Œuvres musicales Date 1895 Fin de création : Note : Opéra en 4 actes. - Livret d'Henri Grémont (pseud. de Georges Hartmann) et Paul Milliet, avec la collaboration d'Angelo Zanardini, d'après "Hérodias" de Gustave Flaubert ("Trois contes", 1877). - Date de la version définitive : 1895. - 1re représentation (version en 3 actes, en italien) : Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie, 19 décembre 1881. - 1re représentation (en français) : Nantes, 29 mars 1883. - 1re représentation (version en 4 actes, en italien) : Paris, Théâtre-Italien, 1er février 1884. - 1re représentation (version définitive en 4 actes, en français) : Paris, Théâtre de la Gaîté-Lyrique, 2 octobre 1903 Domaines : Musique Détails du contenu (3 ressources dans data.bnf.fr) Contient (2) Hérodiade. Acte 1. Il est , Jules Massenet Hérodiade. Acte 1. Ne me , Jules Massenet doux, il est bon (1842-1912) refuse pas ! (1842-1912) Voir aussi (1) Hérodiade , Georges Hartmann (1881) (1843-1900), Paul Milliet (1848-1924) data.bnf.fr 2/20 Data Éditions de Hérodiade (233 ressources dans data.bnf.fr) Enregistrements (134) extrait : Herodiade , Jules Massenet Hérodiade. - Vision fugitive. - Massenet, comp.. - [2] (1842-1912), S.l. : [Pathé frères] , [1905] Hérodiade. - [1] Hérodiade. - Massenet, comp.. - [8] choix : The Great Mary , Gustave Charpentier extrait : Faust , Jules Massenet Garden (1860-1956), Jules (1842-1912), Charles Massenet (1842-1912), Gounod (1818-1893), S.l. : Giuseppe Verdi s.n. , [190.?] (1813-1901), New York : CBS , [ca 1967] extrait : Herodiade , Jules Massenet Hérodiade Acte III. - Ne pouvant réprimer les élans de la (1842-1912), [Grande- foi. -

Programmheft Manon Web.Indd
Man Jules Massenet on Jules Massenet Manon Oper in fünf Akten (1884) Text von Henri Meilhac und Philippe Gille 4 5 verlässt auch Des Grieux die Wohnung, um den Brief aufzugeben. Allein zurückbleibend, Handlung erinnert sich Manon an die schönen Stunden mit Des Grieux, die sie hier erlebt hat. Des Grieux findet seine Geliebte mit schweren Gedanken beladen. Er malt ihr eine para- 1. Akt diesische Traumwelt aus, in der sie zusammen vollkommenes Glück finden. Neuerlich Ein Gasthaus in der Provinz. Es gibt weder zu essen noch zu trinken. Guillot, de Brétigny kündigt sich ein Gast an. Des Grieux will nach ihm schauen, wird aber von Manon abge- und die drei jungen Damen Poussette, Javotte und Rosette rufen den Wirt – erst nach halten. Als er dennoch vor die Tür geht, wird er fortgerissen. Manon beklagt ihre Trennung mehrfacher Aufforderung tischt er etwas auf. Alles wartet gespannt auf die Ankunft von von Des Grieux. Reisenden. Auch Lescaut ist hierhergekommen, um seine ihm bislang noch unbekannte Cousine Manon abzuholen und ins Kloster zu geleiten. Als diese erscheint, ein Mädchen von fünfzehn Jahren, ist er geblendet von deren Schönheit und Charme. Manon erzählt aufge- 3. Akt, 1. Bild regt von ihrer Reise, der ersten, die sie unternommen hat. Lescaut geht mit zwei Kameraden In einem glanzvollen, von strahlenden Lichtern erhellten Saal. Verkäuferinnen und Ver- zum Kartenspiel. Während Manon allein ist, nähert sich ihr der reiche Guillot mit einem ein- käufer preisen ihre Waren an, Lescaut und die drei Damen Poussette, Javotte und Rosette deutigen Angebot: Er bietet ihr seinen Wagen an, um zusammen fortzufahren.