Cnrsaix Marseille Université
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapitre Quatre La Spécificité D'hôtes Des Virophages Sputnik
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE THESE DE DOCTORAT Présentée par Morgan GAÏA Né le 24 Octobre 1987 à Aubagne, France Pour obtenir le grade de DOCTEUR de l’UNIVERSITE AIX -MARSEILLE SPECIALITE : Pathologie Humaine, Maladies Infectieuses Les virophages de Mimiviridae The Mimiviridae virophages Présentée et publiquement soutenue devant la FACULTE DE MEDECINE de MARSEILLE le 10 décembre 2013 Membres du jury de la thèse : Pr. Bernard La Scola Directeur de thèse Pr. Jean -Marc Rolain Président du jury Pr. Bruno Pozzetto Rapporteur Dr. Hervé Lecoq Rapporteur Faculté de Médecine, 13385 Marseille Cedex 05, France URMITE, UM63, CNRS 7278, IRD 198, Inserm 1095 Directeur : Pr. Didier RAOULT Avant-propos Le format de présentation de cette thèse correspond à une recommandation de la spécialité Maladies Infectieuses et Microbiologie, à l’intérieur du Master des Sciences de la Vie et de la Santé qui dépend de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Vie de Marseille. Le candidat est amené à respecter des règles qui lui sont imposées et qui comportent un format de thèse utilisé dans le Nord de l’Europe permettant un meilleur rangement que les thèses traditionnelles. Par ailleurs, la partie introduction et bibliographie est remplacée par une revue envoyée dans un journal afin de permettre une évaluation extérieure de la qualité de la revue et de permettre à l’étudiant de commencer le plus tôt possible une bibliographie exhaustive sur le domaine de cette thèse. Par ailleurs, la thèse est présentée sur article publié, accepté ou soumis associé d’un bref commentaire donnant le sens général du travail. -

Genome of Phaeocystis Globosa Virus Pgv-16T Highlights the Common Ancestry of the Largest Known DNA Viruses Infecting Eukaryotes
Genome of Phaeocystis globosa virus PgV-16T highlights the common ancestry of the largest known DNA viruses infecting eukaryotes Sebastien Santinia, Sandra Jeudya, Julia Bartolia, Olivier Poirota, Magali Lescota, Chantal Abergela, Valérie Barbeb, K. Eric Wommackc, Anna A. M. Noordeloosd, Corina P. D. Brussaardd,e,1, and Jean-Michel Claveriea,f,1 aStructural and Genomic Information Laboratory, Unité Mixte de Recherche 7256, Centre National de la Recherche Scientifique, Aix-Marseille Université, 13288 Marseille Cedex 9, France; bCommissariat à l’Energie Atomique–Institut de Génomique, 91057 Evry Cedex, France; cDepartment of Plant and Soil Sciences, University of Delaware, Newark, DE 19711; dDepartment of Biological Oceanography, Royal Netherlands Institute for Sea Research, NL-1790 AB Den Burg (Texel), The Netherlands; eAquatic Microbiology, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; and fService de Santé Publique et d’Information Médicale, Hôpital de la Timone, Assistance Publique–Hôpitaux de Marseille, FR-13385 Marseille, France Edited by James L. Van Etten, University of Nebraska, Lincoln, NE, and approved May 1, 2013 (received for review February 22, 2013) Large dsDNA viruses are involved in the population control of many viruses: 730 kb and 1.28 Mb for CroV and Megavirus chilensis, globally distributed species of eukaryotic phytoplankton and have respectively. Other studies, targeting virus-specific genes [e.g., a prominent role in bloom termination. The genus Phaeocystis (Hap- DNA polymerase B (8) or capsid proteins (9)] have suggested tophyta, Prymnesiophyceae) includes several high-biomass-forming a close phylogenetic relationship between Mimivirus and several phytoplankton species, such as Phaeocystis globosa, the blooms of giant dsDNA viruses infecting various unicellular algae such as which occur mostly in the coastal zone of the North Atlantic and the Pyramimonas orientalis (Chlorophyta, Prasinophyceae), Phaeocys- North Sea. -

Bacterial Species Library with Validly Published Names (Green Curve); and Sequenced Viral Genomes (Blue)
17 March 2014 ESCMID-ESCAR PGEC MARSEILLE «Ignorance and blindness for a post-modern microbiology ! » © by author ESCMID Online Lecture Library Didier Raoult Marseille - France [email protected] www.mediterranee-infection.com © by author « ESCMIDPostmodern scienceOnline makes Lecture the theory Library of its own evolution as discontinuous, catastrophic, nonrectifiable, paradoxical.» P.97 2 INFECTIONS IN THE XXIST CENTURY Infections in the world : 17 million deaths - 30% - The big 3s : HIV - TB – malaria : no vaccine - Respiratory infections : Etiology? - Digestive infections : Etiology? - Vaccine-prevented infections© by : authorAdhesion - Nosocomial infections : Circuits? - EmergingESCMID infections Online : LectureSource Library - Cancer : Communicable 3 IGNORANCE that decreases but reveals ou ARROGANCE BLINDNES that persists and leads to FALSE DEDUCTIONS © by author and UNVERIFIED PREDICTIONSESCMID Online Lecture Library 4 EMERGING DISEASES IGNORANCE: Major and unique acceleration of knowledge in history Blindness False deductions© by author ESCMID Unverified Online predictions Lecture Library So what ? 5 Viruses: Essential Agents of Life by Günther Witzany © by author ESCMID Online Lecture Library p.64 By F.Rohwer 6 Viruses: Essential Agents of Life by Günther Witzany © by author ESCMID Online Lecture Library p.64 By F.Rohwer 7 PROGRESSES MADE IN MICROBIOLOGY FROM 1979 TO 2012 THANKS TO THE DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES Cultured Sequenced © by author a) the ESCMIDleft ordinate axis refers toOnline the cumulative numbers -

Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere
viruses Review Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere Clara Rolland 1, Julien Andreani 1, Amina Cherif Louazani 1, Sarah Aherfi 1,3, Rania Francis 1 , 1,2 1, 1 1 Rodrigo Rodrigues , Ludmila Santos Silva y, Dehia Sahmi , Said Mougari , 1 1, 1,2 1,§ 1, Nisrine Chelkha , Meriem Bekliz z, Lorena Silva , Felipe Assis ,Fábio Dornas k, Jacques Yaacoub Bou Khalil 3, Isabelle Pagnier 1,3, Christelle Desnues 1,¶, Anthony Levasseur 1,3, Philippe Colson 1,3,Jônatas Abrahão 1,2 and Bernard La Scola 1,3,* 1 MEPHI, APHM, IRD 198, Aix Marseille Univ, Department of Medicine, IHU-Méditerranée Infection, 13005 Marseille, France; [email protected] (C.R.); [email protected] (J.A.); cherifl[email protected] (A.C.L.); aherfi[email protected] (S.A.); [email protected] (R.F.); [email protected] (R.R.); [email protected] (L.S.S.); [email protected] (D.S.); [email protected] (S.M.); [email protected] (N.C.); [email protected] (M.B.); [email protected] (L.S.); [email protected] (F.A.); [email protected] (F.D.); [email protected] (I.P.); [email protected] (C.D.); [email protected] (A.L.); [email protected] (P.C.); [email protected] (J.A.) 2 Laboratório de Vírus, Instituto de Ciêncas Biológicas, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 31270-901 Belo Horizonte, Brazil 3 IHU IHU-Méditerranée Infection, 13005 Marseille, France; [email protected] * Correspondence: [email protected] Present address: Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, CNRS UPR9022, Université de Strasbourg, y 67000 Strasbourg, France. -

Virus World As an Evolutionary Network of Viruses and Capsidless Selfish Elements
Virus World as an Evolutionary Network of Viruses and Capsidless Selfish Elements Koonin, E. V., & Dolja, V. V. (2014). Virus World as an Evolutionary Network of Viruses and Capsidless Selfish Elements. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 78(2), 278-303. doi:10.1128/MMBR.00049-13 10.1128/MMBR.00049-13 American Society for Microbiology Version of Record http://cdss.library.oregonstate.edu/sa-termsofuse Virus World as an Evolutionary Network of Viruses and Capsidless Selfish Elements Eugene V. Koonin,a Valerian V. Doljab National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, USAa; Department of Botany and Plant Pathology and Center for Genome Research and Biocomputing, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USAb Downloaded from SUMMARY ..................................................................................................................................................278 INTRODUCTION ............................................................................................................................................278 PREVALENCE OF REPLICATION SYSTEM COMPONENTS COMPARED TO CAPSID PROTEINS AMONG VIRUS HALLMARK GENES.......................279 CLASSIFICATION OF VIRUSES BY REPLICATION-EXPRESSION STRATEGY: TYPICAL VIRUSES AND CAPSIDLESS FORMS ................................279 EVOLUTIONARY RELATIONSHIPS BETWEEN VIRUSES AND CAPSIDLESS VIRUS-LIKE GENETIC ELEMENTS ..............................................280 Capsidless Derivatives of Positive-Strand RNA Viruses....................................................................................................280 -

Exploration of the Propagation of Transpovirons Within Mimiviridae Reveals a Unique Example of Commensalism in the Viral World
The ISME Journal (2020) 14:727–739 https://doi.org/10.1038/s41396-019-0565-y ARTICLE Exploration of the propagation of transpovirons within Mimiviridae reveals a unique example of commensalism in the viral world 1 1 1 1 1 Sandra Jeudy ● Lionel Bertaux ● Jean-Marie Alempic ● Audrey Lartigue ● Matthieu Legendre ● 2 1 1 2 3 4 Lucid Belmudes ● Sébastien Santini ● Nadège Philippe ● Laure Beucher ● Emanuele G. Biondi ● Sissel Juul ● 4 2 1 1 Daniel J. Turner ● Yohann Couté ● Jean-Michel Claverie ● Chantal Abergel Received: 9 September 2019 / Revised: 27 November 2019 / Accepted: 28 November 2019 / Published online: 10 December 2019 © The Author(s) 2019. This article is published with open access Abstract Acanthamoeba-infecting Mimiviridae are giant viruses with dsDNA genome up to 1.5 Mb. They build viral factories in the host cytoplasm in which the nuclear-like virus-encoded functions take place. They are themselves the target of infections by 20-kb-dsDNA virophages, replicating in the giant virus factories and can also be found associated with 7-kb-DNA episomes, dubbed transpovirons. Here we isolated a virophage (Zamilon vitis) and two transpovirons respectively associated to B- and C-clade mimiviruses. We found that the virophage could transfer each transpoviron provided the host viruses were devoid of 1234567890();,: 1234567890();,: a resident transpoviron (permissive effect). If not, only the resident transpoviron originally isolated from the corresponding virus was replicated and propagated within the virophage progeny (dominance effect). Although B- and C-clade viruses devoid of transpoviron could replicate each transpoviron, they did it with a lower efficiency across clades, suggesting an ongoing process of adaptive co-evolution. -
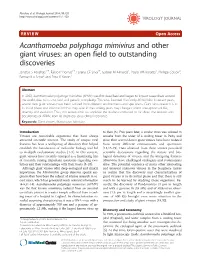
Acanthamoeba Polyphaga Mimivirus and Other Giant Viruses
Abrahão et al. Virology Journal 2014, 11:120 http://www.virologyj.com/content/11/1/120 REVIEW Open Access Acanthamoeba polyphaga mimivirus and other giant viruses: an open field to outstanding discoveries Jônatas S Abrahão1*†, Fábio P Dornas1†, Lorena CF Silva1†, Gabriel M Almeida1, Paulo VM Boratto1, Phillipe Colson2, Bernard La Scola2 and Erna G Kroon1 Abstract In 2003, Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV) was first described and began to impact researchers around the world, due to its structural and genetic complexity. This virus founded the family Mimiviridae. In recent years, several new giant viruses have been isolated from different environments and specimens. Giant virus research is in its initial phase and information that may arise in the coming years may change current conceptions of life, diversity and evolution. Thus, this review aims to condense the studies conducted so far about the features and peculiarities of APMV, from its discovery to its clinical relevance. Keywords: Giant viruses, Mimiviridae, Mimivirus Introduction to then [5]. Five years later, a similar virus was isolated in Viruses are remarkable organisms that have always amoeba from the water of a cooling tower in Paris, and attracted scientific interest. The study of unique viral since then several dozen giant viruses have been isolated features has been a wellspring of discovery that helped from many different environments and specimens establish the foundations of molecular biology and led [11,15-19]. Data obtained from these viruses provoked to in-depth evolutionary studies [1-3]. In this context, scientific discussions regarding the nature and bio- giant viruses have recently emerged as a fascinating line logical dynamics of viruses, and the intriguing features of research, raising important questions regarding evo- Mimivirus have challenged virologists and evolutionists lution and their relationships with their hosts [4-10]. -

Discovery and Further Studies on Giant Viruses
Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere Clara Rolland, Julien Andreani, Amina Louazani, Sarah Aherfi, Rania Francis, Rodrigo Rodrigues, Ludmila Silva, Dehia Sahmi, Said Mougari, Nisrine Chelkha, et al. To cite this version: Clara Rolland, Julien Andreani, Amina Louazani, Sarah Aherfi, Rania Francis, et al.. Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere. Viruses, MDPI, 2019, 11 (4), pp.312. 10.3390/v11040312. hal-02094406 HAL Id: hal-02094406 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02094406 Submitted on 19 Dec 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NoDerivatives| 4.0 International License viruses Review Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere Clara Rolland 1, Julien Andreani 1, Amina Cherif Louazani 1, Sarah Aherfi 1,3, Rania Francis 1 -

Twiv 206 Transcript
This Week in Virology with Vincent Racaniello, Ph.D. Episode #206: Viral turducken Aired 11 November 2012 Hosts: Vincent Racaniello, Alan Dove, Dickson Despommier, and Kathy Spindler http://www.twiv.tv/2012/11/11/twiv-206-viral-turducken/ [0:9:36] Discussion of Paper about Dedifferentiating Cells to Become Stem Cells Vincent: We have two cool papers today. The first one is actually very topical because it has to do with a discovery for which the Nobel Prize this year in physiology or medicine was awarded. We did not mention because this was for de-differentiating cells to become stem cells. Are you aware of this Dickson? Dickson: Vaguely. Vincent: So Shinya Yamanaka was one of two people to get the Nobel Prize this year and that is what this paper is founded on. He found that you could put four transcription proteins—people call them factors, but they are proteins—into cells and they de-differentiate and become stem cell like. Dickson: Just inject them into the cell? Vincent: No, he used a retroviral vector to deliver them. Alan: This is critical to understanding this next paper. Vincent: So this is a paper that deals with this. He got the Nobel Prize for this appropriately because this is amazing that you can make stem cells and you do not have to get them from embryos. You must have followed this Alan. Alan: Oh intensively. This comes up now all the time these induced pluripotent stem cells. We have mentioned it in passing a couple of time on TWiV I think because they are such an amazing technology. -

Génomique Des Virus Géants, Des Virophages, Et Échanges Génétiques Avec Leurs Hôtes Eucaryotes Lucie Gallot-Lavallée
Génomique des virus géants, des virophages, et échanges génétiques avec leurs hôtes eucaryotes Lucie Gallot-Lavallée To cite this version: Lucie Gallot-Lavallée. Génomique des virus géants, des virophages, et échanges génétiques avec leurs hôtes eucaryotes. Sciences du Vivant [q-bio]. Aix-Marseille Université (AMU), 2017. Français. NNT : 2017AIXM0458. tel-01668916 HAL Id: tel-01668916 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01668916 Submitted on 20 Dec 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (ED 62) LABORATOIRE INFORMATION GÉNOMIQUE ET STRUCTURALE Génomique des virus géants, des virophages, et échanges génétiques avec leurs hôtes eucaryotes Lucie Gallot-Lavallée Thèse présentée pour obtenir le grade universitaire de docteur en science de la vie et de la santé Discipline : Biologie Spécialité : Génomique et Bioinformatique Soutenue le 7 novembre 2017 devant le jury : Elisabeth Herniou Rapportrice Marie-Agnès Petit Rapportrice Gwenaël Piganeau Examinatrice Christophe Robaglia Examinateur Guillaume Blanc Co-directeur de thèse Jean-Michel Claverie Co-directeur de thèse 2 Remerciements Merci tout d’abord à mes deux directeurs de thèse Guillaume Blanc et Jean-Michel Claverie, sans qui cette thèse n’aurait pas pu exister. -

Giant Viruses and Their Mobile Genetic Elements: the Molecular Symbiotic Hypothesis
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/299784; this version posted April 11, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. Giant Viruses and their mobile genetic elements: the molecular symbiotic hypothesis. Jonathan Filée Evolution, Génomes, Comportement & Ecologie, CNRS, IRD, Univ.Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91198 Gif-sur-Yvette Avenue de la Terrasse, 91190 Gif sur Yvette, France. [email protected] Highlight - Giant Virus (GV) genomes are loaded with diverse classes of mobile genetic elements (MGEs) - MGEs cooperate with GV genes in order to fulfill viral functions. - Site-specific endonucleases encoded by MGEs are used as anti-host or anti-competing viral compounds - Integrase/transposase genes derived from MGEs have been recruited to generate integrative proviral forms. - MGEs and GVs may thus compose a mutualistic symbiosis Summary Among the virus world, Giant viruses (GVs) compose one of the most successful eukaryovirus families. In contrast with other eukaryoviruses, GV genomes encode a wide array of mobile genetic elements (MGEs) that encompass diverse, mostly prokaryotic-like, transposable element families, introns, inteins, restriction-modification systems and enigmatic classes of mobile elements having little similarities with known families. Interestingly, several of these MGEs may be beneficial to the GVs, fulfilling two kinds of functions: 1) degrading host or competing virus/ virophages DNA and 2) promoting viral genome integration, dissemination and excision into the host genomes. By providing fitness advantages to the virus in which they reside, these MGES compose a kind of molecular symbiotic association in which both partners should be regarded as grantees. -
Mimiviridae: an Expanding Family of Highly Diverse Large Dsdna Viruses Infecting a Wide Phylogenetic Range of Aquatic Eukaryotes Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel
Mimiviridae: An Expanding Family of Highly Diverse Large dsDNA Viruses Infecting a Wide Phylogenetic Range of Aquatic Eukaryotes Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel To cite this version: Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel. Mimiviridae: An Expanding Family of Highly Diverse Large dsDNA Viruses Infecting a Wide Phylogenetic Range of Aquatic Eukaryotes. Viruses, MDPI, 2018, 10 (9), pp.506. 10.3390/v10090506. hal-01887346 HAL Id: hal-01887346 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01887346 Submitted on 5 Nov 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License viruses Review Mimiviridae: An Expanding Family of Highly Diverse Large dsDNA Viruses Infecting a Wide Phylogenetic Range of Aquatic Eukaryotes Jean-Michel Claverie * and Chantal Abergel Aix Marseille Univ, CNRS, IGS, Structural and Genomic Information Laboratory (UMR7256), Mediterranean Institute of Microbiology (FR3479), 163 Avenue de Luminy, F-13288 Marseille, France; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +33-49-182-5420 Received: 14 August 2018; Accepted: 15 September 2018; Published: 18 September 2018 Abstract: Since 1998, when Jim van Etten’s team initiated its characterization, Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) had been the largest known DNA virus, both in terms of particle size and genome complexity.