RATOAVIMBAHOAKA Lazaina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MAHAJANGA BV Reçus: 246 Sur 246
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 4 MAHAJANGA BV reçus: 246 sur 246 INDEPE TIM MANAR AREMA MAPAR HVM NDANT ANARA : FANILO N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E ASSOCI REGION 41 BETSIBOKA BV reçus 39 sur 39 DISTRICT: 4101 KANDREHO BV reçus7 sur 7 01 AMBALIHA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 1 0 5 02 ANDASIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 03 ANTANIMBARIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 04 BEHAZOMATY 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 05 BETAIMBOAY 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 06 KANDREHO 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 07 MAHATSINJO SUD 0 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 5 TOTAL DISTRICT 0 0 42 40 0 40 0 11 0 1 1 27 DISTRICT: 4102 MAEVATANANA BV reçus19 sur 19 01 AMBALAJIA 0 0 6 5 0 5 0 2 0 0 2 1 02 AMBALANJANAKOMBY 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 03 ANDRIBA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 04 ANTANIMBARY 0 0 8 8 0 8 0 1 0 0 0 7 05 ANTSIAFABOSITRA 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 0 5 06 BEANANA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 07 BEMOKOTRA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 1 2 08 BERATSIMANINA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 6 09 BERIVOTRA 5/5 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 10 MADIROMIRAFY 0 0 6 6 0 6 0 1 0 0 1 4 11 MAEVATANANA I 0 0 10 9 0 9 0 3 0 0 2 4 12 MAEVATANANA II 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 0 6 13 MAHATSINJO 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 8 14 MAHAZOMA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 15 MANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 0 0 1 5 16 MARIA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 1 3 17 MAROKORO 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 18 MORAFENO 0 0 6 3 0 3 0 3 0 0 0 0 19 TSARARANO 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 2 3 TOTAL DISTRICT 0 0 134 125 0 125 0 33 0 0 15 77 DISTRICT: 4103 TSARATANANA BV reçus13 sur 13 01 AMBAKIRENY 0 0 8 8 0 8 0 4 0 0 0 4 02 AMPANDRANA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 03 ANDRIAMENA 0 0 8 7 0 7 0 4 0 0 0 3 04 -

Determination Des Impacts 6
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana Public Disclosure Authorized MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ----------- Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance Partagée dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWIOFish2) ----------- Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Présentée par : Public Disclosure Authorized Stat : n° 70202- 23- 2004-0-00009 – NIF : 4000418823 Siège : Centre Commercial (Ex-service Plus) Tanambao – MANAKARA Succursale : Lot 179 B bis Antanandrano – Ankadikely Ilafy Antananarivo Tél : 034 02 628 27 –034 20 477 17 E-mail: [email protected]; [email protected] 1 SOMMAIRE TABLE DES ILLUSTRATIONS SIGLES ET ACRONYMES 1 Introduction................................................................................................................................. 1 1.1 Mise en contexte .......................................................................................................... 1 1.2 Justification et objet de l’EIES ..................................................................................... 2 1.3 Plan du présent EIES .................................................................................................... 2 2 Description du sous-projet ......................................................................................................... 4 2.1 Objectifs du sous-projet ............................................................................................... 4 2.2 Délimitation géographique du site d’intervention -

GL Madagascar Strategy 2016 – 2020
GL Madagascar Strategy 2016 – 2020 Figure 1: 08 March celebration, Tuléar, Madagascar http://gemcommunity.genderlinks.org.za/gallery/main.php?g2_itemId=50400 1 TABLE OF CONTENTS Executive Summary Table of key indicators Summary Strategic positioning Regional context Political context Key gender issues GL‟s Theory of Change GL’s Programme of Action Alliance Media Governance and economic justice Partnerships Results for Change Lessons learned Strategic thrust 2016-2020 Institutional effectiveness Risk analysis Internal and external Sustainability Programme Funding Diversification Annexes A. Local government beneficiary analysis B. SWOT C. Intervention logic Accompanying documents Budget 2016 - 2020 2 3 EXECUTIVE SUMMARY Table of key indicators KEY INDICATORS FOR MONITORING GL MADAGASCAR WORK 2015 Target - 2020 Impact level indicators SADC Gender and Development Index Score 60% 72% Citizen Score Card 69% 83% Life time experience of GBV – 2012 Gender Progress Score - 2015 64% 77% % women in parliament - 2014 21% 42% % women in local government - 2014 6% 20% % women sources in the media - 2010 31% 50% Outcome level indicators Average Gender and Local Government Score (GLGS) – 2014 68% 82% Highest GLGS – 2015 91% 98% Lowest GLGS- 2015 47% 56% Contribution by councils to COE work in 2015 40 000 ZAR 120 000 ZAR Overall COE budget in 2015 2 928 350 ZAR 8 785 000 ZAR % contribution by COE‟s 1.4% 1.4 % Average Gender and Media Score (GMS) – 2015 77% 92% Highest GMS – 2015 94% 98% Lowest GMS -2015 59% 71% Outreach indicators -

Liste Candidatures Conseillers Melaky
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS INDEPENDANT RANDRIANIAINA AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 NOMENJANAHARY (Randrianiaina RANDRIANIAINA Nomenjanahary Nomenjanahary) RAZAFIARIVELO HONORINE (Independant AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 RAZAFIARIVELO Honorine Razafiarivelo Honorine) GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 JEANNOT Miaraka@andry Rajoelina) IANAO TOKIKO, IZAHO TOKINAO (Independant AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 RATSIMIDOSY Andriamahefa Simon Ratsimidosy Andriamahefa Simon) AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 MANASOA (Fikambanana No Vaha Olana) MANASOA RANDRIANTENDRINJANAHARY FRANCOIS AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 D'ASSISE (Independant RANDRIANTENDRINJANAHARY Francois D'assise Randriantendrinjanahary Francois D'assise) JEAN MIRADJI BEN YOUSSOUF (Independant AMBATOMAINTY AMBATOMAINTY 1 JEAN MIRADJI Ben Youssouf Papan'assanaty) AMBATOMAINTY BEMARIVO 1 TSIVERILAZA (Independant Tsiverilaza) TSIVERILAZA LEMANENO BENOIT (Independant Lemaneno AMBATOMAINTY BEMARIVO 1 LEMANENO Benoit Benoit) AMBATOMAINTY BEMARIVO 1 LUCIEN ALIBAY (Independant Lucien Alibay) LUCIEN Alibay GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOMAINTY BEMARIVO 1 RAMANANTENA Ferry Tomson Miaraka @ Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOMAINTY MAROTSIALEHA 1 RAZAFINDRAKOTO Emmanuel Jean Claude Miaraka @ Andry Rajoelina ) GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOMAINTY SARODRANO 1 RANDRIAMIHAJA Vincent Arnel Miaraka@andry Rajoelina) RAKOTONDRAZAKA FELIX (Independant AMBATOMAINTY SARODRANO 1 RAKOTONDRAZAKA Felix -
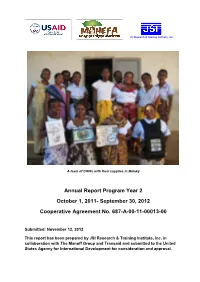
Annual Report Program Year 2 October 1, 2011
JSI Research & Training Institute, Inc. A team of CHWs with their supplies in Melaky Annual Report Program Year 2 October 1, 2011- September 30, 2012 Cooperative Agreement No. 687-A-00-11-00013-00 Submitted: November 12, 2012 This report has been prepared by JSI Research & Training Institute, Inc. in collaboration with The Manoff Group and Transaid and submitted to the United States Agency for International Development for consideration and approval. JSI Research & Training Institute, Inc. Madagascar Community-Based Integrated Health Program: “MAHEFA” Program Year 2: October 1, 2011- September 30, 2012 Cooperative Agreement No. 687-A-00-11-00013-00 Submitted to: USAID/Madagascar in Antananarivo, Madagascar. Prepared for: Dr. Jocelyne ANDRIAMIADANA, AOR Mr. Robert Kolesar, Alternate AOR USAID/Madagascar Prepared by: JSI Research & Training Institute, Inc. Community-Based Integrated Health Program: ―MAHEFA‖ JSI Research & Training Institute, Inc. Lot II K 63 Ter Ivandry-« Villa Sylvie » Antananarivo (101) Tel. (261) 034 79 261 17 This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of JSI Research and Training Institute, Inc. and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government. 2 Table of Contents List of Tables.............................................................................................................................................. 5 Acronyms and Abbreviations.................................................................................................................. -

21454 Stage 7-8.Pdf
TATITRA DINGANA VII - VIII KAOMININA AMBANIVOHITRA MAFAIJIJO 20 – 21 – 22 JOLAY 2015 Sarin’ny Mpizaika 1 Teny fampidirana: Ny 20 – 21 – 22 Jolay 2015 dia natao teto amin’ny kaomina ambonivohitr’i Maintirano, tao amin’ny efitranon’ny Kivohin’ny Ampela ny atrik’asa mikasika ny miralenta, izay nanofanana ireo vehivavy nilatsaka ho Ben’ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Tonga nanatrika ny fanokafana ny Ben’ny tanànan’ny Maintirano. Miisa 40 ireo mpiofana, izay kandidà nilatsaka ho Ben’ny tanàna na ho mpanolo-tsaina amin’ny fifidianana manaraka izao. Ny tanjon’ny atrik’asa dia ny fampahafatarana ny miralenta amin’ireo mpilatsaka ho fidiana. Lohahevitra maro no nentina nodinihina nandritra ny atrikasa, isan’izany: Ny hevitra fototra iompanan’ny miralenta (GENRE ET SEXE), izay mampisongadina ny mahalahy sy ny mahavavy ara-voajanahary, eo ihany koa ireo toetra mampiavaka napetraky ny fiaraha-monina. Ny toetra ara-boajanahary izay tsy azo ovana, fa ny toetra napetrakin’ny fiaraha-monina kosa, dia miova araky ny toerana sy ny fotoana. Ny miralenta sy ny fitondrana fanjakana, tafiditra ao anatin’izany ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin’ny seha-pitantanana, inona no sakana eo amin’ny fidirana, rehefa tafiditra ary inona no vahaolana. Mifampitohy amin’izany ny fitarihana mitondra fanaovana: fanovana entin’ny vehivavy rehefa tonga eo amin’ny seha-pitantanana izy. Fanadihadiana ny zava-misy eo an-toerana: hahitana ireo olana na filàna fototra andavanandro mety ahitana vaha-olana eo no eo, sy ny filàna maharitra mila paik’ady, tsy maintsy hitadiavana vaha-olana maharitra hitsinjovana ny ho avy sy ho an’ny taranaka faramandimby. -
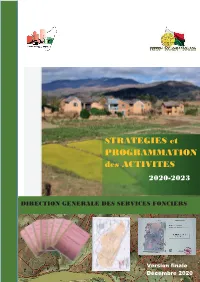
STRATEGIES Et PROGRAMMATION Des ACTIVITES 2020-2023
STRATEGIES et PROGRAMMATION des ACTIVITES 2020-2023 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS Version finale Décembre 2020 Sommaire 1. Etat des lieux 5 1.1. Réalisations 5 1.1.1. Répartition des Services Fonciers sur le territoire national : 5 1.1.2. Evolution de la sécurisation foncière à madagascar 6 1.1.3. Situation de la dématérialisation des documents fonciers 6 1.1.4. Situation des plans locaux d’occupation foncière (PLOFS) 7 1.1.5. Situation de couverture en image satellitaire 7 1.2. Limites 7 1.2.1. Situation des archives 7 1.2.2. Situation des ressources 7 1.2.3. Les projets financés par les partenaires techniques et financiers (PTF) 8 1.2.4. Situation du budget alloué par l’etat à l’administration foncière-ressources propres internes (RPI) 9 2. Stratégies de développement du secteur foncier 11 2.1. Les documents de référence 11 2.2. Vision et objectifs 12 2.3. Présentation des axes stratégiques 12 3. Programmation des activités et budgétisation 13 3.1. Indicateurs de résultats (2021-2023) 13 3.2. Projection d’indicateurs en 2030 13 3.2.1. Axe 1 : sécurisation foncière massive 14 3.2.1.1. Budget et indicateurs des activités de l’axe 1 : sécurisation foncière massive (2020 à 2030) 16 3.2.2. Axe 2 : modernisation des services fonciers 19 3.2.2.1. Budget et indicateur des activités de l’axe 2 : modernisations des services fonciers (2020 à 2030) 22 3.2.3. Axe 3 : la bonne gouvernance de l’administration foncière 28 3.2.3.1. -

Rapport De Réconciliation 2018 – EITI-Madagascar
Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Rapport de réconciliation 2018 EITI-Madagascar Décembre 2019 EY Rapport final | 1 Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Sommaire INTRODUCTION ........................................................................................................... 15 Contexte de la mission ............................................................................................. 15 Objectifs de la mission ............................................................................................. 16 Normes de travail .................................................................................................... 17 Notre approche ....................................................................................................... 17 Limitations de nos travaux ....................................................................................... 19 EXIGENCES #3.1, #3.2 ET #3.3 : VUE D’ENSEMBLE SUR LA PROSPECTION, LA PRODUCTION ET LES EXPORTATIONS ......................................................................................................... 20 Vue d’ensemble du secteur minier ............................................................................. 20 Vue d’ensemble du secteur des hydrocarbures amont ................................................. 39 EXIGENCE #6.3 : CONTRIBUTION DU SECTEUR EXTRACTIF A L’ECONOMIE ...................... 43 Contribution dans le PIB ........................................................................................... 43 Contribution -

4304 Maintirano
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAINTIRANO Commune: ANDABOTOKA Code Bureau: 430401010101 ANTSAKOALAMOTY, SOATANA, MALAI EPP ANTSAKOALAMOTY SALLE 01 INSCRITS: 80 VOTANTS: 36 BLANCS ET NULS: 1 SUFFRAGE EXPRIMES: 35 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT SOAMANIRY GILBERT 0 0,00% 2 INDEPENDANT RANDRIANAMBININA EPHRAIM STEPHAN 30 85,71% 3 INDEPENDANT LOUKMAN KALAVAH 0 0,00% 4 INDEPENDANT PIKULAS CONSTANTIN 0 0,00% 5 IRD 5 14,29% Total des voix 35 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAINTIRANO Commune: ANDABOTOKA Code Bureau: 430401030101 AMBALAMANGA, TSIMIFOSA, ANKILA EPP AMBALAMANGA SALLE 01 INSCRITS: 290 VOTANTS: 115 BLANCS ET NULS: 5 SUFFRAGE EXPRIMES: 110 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT SOAMANIRY GILBERT 2 1,82% 2 INDEPENDANT RANDRIANAMBININA EPHRAIM STEPHAN 45 40,91% 3 INDEPENDANT LOUKMAN KALAVAH 2 1,82% 4 INDEPENDANT PIKULAS CONSTANTIN 6 5,45% 5 IRD 55 50,00% Total des voix 110 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAINTIRANO Commune: ANDABOTOKA Code Bureau: 430401040101 KIMAZIMAZY, MANOMBO, MANDROSOA BUREAU FKT KIMAZIMAZY SALLE 0 INSCRITS: 110 VOTANTS: 65 BLANCS ET NULS: 0 SUFFRAGE EXPRIMES: 65 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT SOAMANIRY GILBERT 0 0,00% 2 INDEPENDANT RANDRIANAMBININA EPHRAIM STEPHAN 5 7,69% 3 INDEPENDANT LOUKMAN KALAVAH 2 3,08% 4 INDEPENDANT PIKULAS CONSTANTIN 3 4,62% 5 IRD 55 84,62% Total des voix 65 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAINTIRANO Commune: ANDABOTOKA Code Bureau: 430401050101 BELINTA, ANDRAFIABE, ANTANIMBA EPP BELINTA SALLE 01 INSCRITS: 182 VOTANTS: -

Des Fraudes Et Des Anomalies
Des fraudes et des anomalies Extrait du Madagascar-Tribune.com http://www.madagascar-tribune.com/Des-fraudes-et-des-anomalies,3619.html Elections communales Des fraudes et des anomalies - Politique - Date de mise en ligne : mardi 18 décembre 2007 Madagascar-Tribune.com Copyright © Madagascar-Tribune.com Page 1/3 Des fraudes et des anomalies Contrairement aux déclarations des hauts responsables, les dernières élections communales ont été entächées de fraudes et des anomalies flagrantes. A preuve, des requêtes pullulent dans les tribunaux administratifs. L'ordre du président de publier, dès demain les résultats pourraient envenimer la situation. Des voix s'élèvent dans la commune de Tranomaro, district d'Amboasary-Sud pour dénoncer les fraudes électorales et les irrégularités. Selon des témoins occulaires, les électeurs de cette localité ont voté, le 12 décembre dernier, sans carte d'identité nationale, bien que la loi exige le port de cette carte au moment du scrutin. Pire encore, des mineurs sont inscrits sur la liste électorale et ont pu voter normalement. Malgré l'opposition de certains candidats, le chef fokontany et le représentant local de l'administration n'en n'ont pas tenu compte. Depuis hier, la situation à Tranomaro s'est aggravée. Les électeurs réclament l'ouverture d'une enquête plus approfondie afin d'éclaircir cette affaire. Parallèlement, des requêtes ont été déposées auprès du tribunal administratif pour annulation du scrutin du 12 décembre. Comme à l'accoutumée, ces requêtes risquent d'être rejetées par les juges électoraux. Par ailleurs, dans la commune rurale d'Amboditavolo, dans le district de Vatomandry, les électeurs ont observé un sit-in devant la commune après avoir constaté des fraudes massives lors des communales. -

MONOGRAPHIE REGION MELAKY.Pdf
CENTRE DE RECHERCHES, D’ETUDES ET D’APPUI A L’ANALYSE ECONOMIQUE À MADAGASCAR MONOGRAPHIE RÉGION MELAKY CREAM, février 2013 Monographie de la région d’Analamanga <Contributeurs / crédit photo / cartes> Monographie téléchargeable depuis<adresse internet> Cream, février 2013 Sommaire INTRODUCTION 9 Chapitre I Cadre physique et administratif 11 I.1. Localisation géographique et cadre physique 13 I.1.1. Localisation géographique 13 I.1.2. Relief 14 I.1.3. Hydrologie 14 I.1.4. Géologie 17 I.1.5. Climatologie 20 I.1.6. Sauvegarde de l`environnement 21 I.2. Cadre Administratif 26 I.2.1. Généralités sur les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et les services techniques déconcentrés (STD) 26 I.2.2. Découpage Administratif de la Région Analamanga 27 I.2.3. Les services territoriaux déconcentrés 28 Chapitre II Population 35 II.1. Etat de la population 36 II.1.1. Population totale 36 II.1.2. Composition et caractéristiques démographiques de la population 37 II.1.3. Caractéristiques de la population 40 II.1.4. Statut de la femme 43 II.2. Mouvements de la population 44 II.2.1. Migration interne 45 II.2.2. Immigration 46 II.2.3. Emigration 46 II.3. Habitat 47 II.3.1. Type d’habitation 47 II.3.2. Caractéristiques des habitats 47 II.4. Niveau de vie et pauvreté 49 II.4.1. Possession de bien durable 49 II.4.2. Ratio et intensité de la pauvreté de pauvreté 50 Chapitre III Organisation sociale et économique 53 III.1. Organisation de la société civile 55 III.1.1. -

Feasibility Study on the Protection and Management of the Barren Isles Ecosystem, Madagascar
Garth Cripps Feasibility study on the protection and management of the Barren Isles ecosystem, Madagascar 309A/B Aberdeen Studios, 22-24 Highbury Grove, London N5 2EA, UK. [email protected] Tel: +44 (0)20 7359 1287 Fax: +44 (0)800 066 4032 © WWF 2011 . Copyright in this publication and in all text, data and images contained herein, except as otherwise indicated, rests with WWF. Keywords: Barren Isles, coral reefs, feasibility study, Madagascar, marine protected area. Acknowledgements: Financial support for this study was provided by WWF and the Natural Museum of Geneva through the: "Réseau interdisciplinaire pour une gestion durable de la biodiversité marine: diagnostic environnemental et social autour des tortues marines dans le sud-ouest de l’Océan Indien." Recommended citation: Cripps, G. 2010. Feasibility study on the protection and management of the Barren Isles ecosystem, Madagascar. Blue Ventures Conservation Report (2009), for WWF and the "Réseau interdisciplinaire pour une gestion durable de la biodiversité marine: diagnostic environnemental et social autour des tortues marines dans le sud-ouest de l’Océan Indien ". 272 pp Table of Contents List of figures ............................................................................................................................................................7 List of tables .............................................................................................................................................................9 Abbreviations and Acronyms .................................................................................................................................12