Alpes Bei\N01ses
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
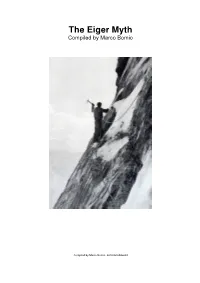
The Eiger Myth Compiled by Marco Bomio
The Eiger Myth Compiled by Marco Bomio Compiled by Marco Bomio, 3818 Grindelwald 1 The Myth «If the wall can be done, then we will do it – or stay there!” This assertion by Edi Rainer and Willy Angerer proved tragically true for them both – they stayed there. The first attempt on the Eiger North Face in 1936 went down in history as the most infamous drama surrounding the North Face and those who tried to conquer it. Together with their German companions Andreas Hinterstoisser and Toni Kurz, the two Austrians perished in this wall notorious for its rockfalls and suddenly deteriorating weather. The gruesome image of Toni Kurz dangling in the rope went around the world. Two years later, Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer and Fritz Kasparek managed the first ascent of the 1800-metre-high face. 70 years later, local professional mountaineer Ueli Steck set a new record by climbing it in 2 hours and 47 minutes. 1.1 How the Eiger Myth was made In the public perception, its exposed north wall made the Eiger the embodiment of a perilous, difficult and unpredictable mountain. The persistence with which this image has been burnt into the collective memory is surprising yet explainable. The myth surrounding the Eiger North Face has its initial roots in the 1930s, a decade in which nine alpinists were killed in various attempts leading up to the successful first ascent in July 1938. From 1935 onwards, the climbing elite regarded the North Face as “the last problem in the Western Alps”. This fact alone drew the best climbers – mainly Germans, Austrians and Italians at the time – like a magnet to the Eiger. -

University of Zurich Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
Haeberli, W (2008). Changing views of changing glaciers. In: Orlove, B [et al.]. Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society. Berkeley, US, 23-32. Postprint available at: http://www.zora.uzh.ch University of Zurich Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich. Zurich Open Repository and Archive http://www.zora.uzh.ch Originally published at: Orlove, B [et al.] 2008. Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society. Berkeley, US, 23-32. Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Changing views of changing glaciers Haeberli, W Haeberli, W (2008). Changing views of changing glaciers. In: Orlove, B [et al.]. Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society. Berkeley, US, 23-32. Postprint available at: http://www.zora.uzh.ch Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich. http://www.zora.uzh.ch Originally published at: Orlove, B [et al.] 2008. Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society. Berkeley, US, 23-32. 2 Changing Views of Changing Glaciers Wilfried Haeberli Glacier changes have been observed for cen- together with instrumentally measured sea- turies. Throughout historical times, the per- surface and land air temperatures, as the ception of these often striking changes in highest-confi dence temperature indicators in high-mountain environments has shifted the climate system (Figure 2.39a in Houghton from legends about holy peaks and fear of et al. 2001). punishment for worldly misbehavior via natural This chapter concentrates on the increas- catastrophes to curiosity about movements ing interest in the glacier during roughly the from the “icy sea” of mountains and roman- past three to four centuries in the European tic enthusiasm for and realistic documenta- Alps, where rich material exists, where sys- tion of local phenomena to the discovery of tematic monitoring programs were fi rst initi- past Ice Ages and the corresponding ideologi- ated, and where discussions have sometimes cal disputes about the origin and evolution of been intense. -

311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20
FAHRPLANJAHR 2021 311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20. Mai 2021 vom 13.12.–21.5. R R R R R R R 135 137 139 141 143 145 147 BOB BOB BOB BOB BOB BOB BOB Interlaken Ost 06 05 06 35 07 05 07 35 08 05 08 35 09 05 Wilderswil 06 10 06 40 07 10 07 40 08 10 08 40 09 10 Zweilütschinen 06 16 06 46 07 16 07 46 08 16 08 46 09 16 Lauterbrunnen 06 25 06 55 07 25 07 55 08 25 08 55 09 25 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB Lauterbrunnen 04 48 05 24 06 07 06 37 07 07 07 37 08 07 08 37 09 07 09 37 Wengwald 04 56 05 32 06 15 06 45 07 15 07 45 08 15 08 45 09 15 09 45 Wengen 04 59 05 35 06 19 06 49 07 19 07 49 08 19 08 49 09 19 09 49 Wengen 08 24 08 54 09 24 09 54 Allmend 08 29 08 59 09 29 09 59 Wengernalp 08 40 09 10 09 40 10 10 Kleine Scheidegg 08 49 09 19 09 49 10 19 543 547 JB JB Kleine Scheidegg 09 27 10 27 Eigergletscher 09 32 10 32 1543 JB Eigergletscher 09 45 Jungfraujoch 10 11 R R R R R R R 149 151 153 155 157 159 161 BOB BOB BOB BOB BOB BOB BOB Interlaken Ost 09 35 10 05 10 35 11 05 11 35 12 05 12 35 Wilderswil 09 40 10 10 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 Zweilütschinen 09 46 10 16 10 46 11 16 11 46 12 16 12 46 Lauterbrunnen 09 55 10 25 10 55 11 25 11 55 12 25 12 55 349 351 353 355 357 359 361 WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB Lauterbrunnen 10 07 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 12 59 Wengwald 10 15 10 45 11 15 11 45 12 15 12 45 13 07 Wengen 10 19 10 49 11 19 11 49 12 19 12 49 13 10 Wengen 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 Allmend 10 29 10 59 11 29 11 59 12 29 12 59 Wengernalp 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 13 10 Kleine Scheidegg 10 49 11 19 11 49 12 19 12 49 13 19 551 555 559 JB JB JB Kleine Scheidegg 11 27 12 27 13 27 Eigergletscher 11 32 12 32 13 32 1547 1551 1555 1559 JB JB JB JB Eigergletscher 10 45 11 45 12 45 13 45 Jungfraujoch 11 11 12 11 13 11 14 11 1 / 17 FAHRPLANJAHR 2021 311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20. -

Jungfraujochtop of Europe
Jungfraujoch Top of Europe Sales Manual 2016 jungfrau.ch en So_Pano_JB_A3_So-Pano_JB_A3 26.05.15 09:26 Seite 1 Jungfrau Mönch 4158 m 13642 ft Eiger 4107 m 13475 ft 3970 m 13026 ft Jungfraujoch Top of Europe Schreckhorn 3454 m 11333 ft 4078 m 13380 ft Wetterhorn Breithorn Eismeer Gspaltenhorn 3692 m 12113 ft 3782 m 12409 ft 3160 m 10368 ft Tschingelhorn 3437 m 11277 ft 3557 m 11736 ft Jungfrau Region Eigerwand Schilthorn 2865 m 9400 ft 2971 m 9748 ft General overview and arrival Schwarzhorn 2928 m 9607 ft Eigergletscher Birg 2320 m 7612 ft The Jungfrau Region lies in the heart of Switzerland, in the Bernese Bus parking Kleine Scheidegg Oberland at the foot of mighty Eiger, Mönch & Jungfrau. Bus companies making excursions in the Grosse Scheidegg 2061 m 6762 ft 1961 m 6434 Pfingstegg Wengernalp The region offers a fantastic and diverse array of unique and natural Jungfrau Region will find ideal bus 1391 m 4564 ft Alpiglen Lauberhorn 1873 m 6145 ft attractions within a compact area. These include Lakes Thun and Brienz, parking facilities at Interlaken Ost, First Gletscherschlucht Tschuggen 2472 m 8111 ft 2168 m 7113 ft a high-Alpine glacier and mountain world, quietly flowing rivers, Wilderswil, Grindelwald Grund and Oberer Marmorbruch Männlichen Gimmelwald Brandegg 1400 m 4593 ft thundering waterfalls and exceptional flora and fauna. Lauterbrunnen railway stations. Schreckfeld Gletscher 2230 m 7317 ft Grindelwald Stechelberg Allmendhubel Jungfrau Railways travel to the unique natural wonders in the UNESCO 1034 m 3393 ft Allmend Grindelwald Grund Bort 922 m 3025 ft 1912 m 6273 ft World Heritage of the Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. -

Butterflies of the Swiss Alps
Butterflies of the Swiss Alps Naturetrek Tour itinerary Outline itinerary Day 1 Fly Zürich and transfer by train to Wengen. Day 2/7 Butterfly & wildlife excursions from Wengen. Day 8 Transfer by train to Zürich and fly London. Departs June. Focus Butterflies, birds and other wildlife. Grading Day walks only. Grade B. Between 915 and 2,280 metres (though mostly by cable-car!). Dates and Prices Visit www.naturetrek.co.uk (tour code CHE03) or see the current Naturetrek brochure. Highlights: A general wildlife holiday focusing on butterflies Spectacular mountain scenery of the Bernese Oberland No road travel, all journeys by train & cable car Small family run hotel with unobstructed views of the Jungfrau Look for butterflies amongst the meadows & moraines at the foot of the Jungfrau False Heath, Cynthia’s, Titania’s & Mountain Fritillaries all possible Alpine Marmot & Ibex, plus White-winged Snow Finch & Ring Ouzel among other wildlife 10% of the holiday cost donated to Butterfly Conservation Led by expert naturalist guide Top:, Lauterbrunnen Valley, Titania's Fritillary & North Face of the Eiger. Images by David Tattersfield Naturetrek Mingledown Barn Wolf’s Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Butterflies of the Swiss Alps Tour itinerary Introduction In the heart of the spectacular Bernese Oberland, set high on a sheltered alp above the precipitous cliffs of the Launterbrunnen Valley, lies the idyllic Swiss village of Wengen. Backed by three of Europe’s highest snowy peaks – the Eiger, Mönch and Jungfrau – Wengen sits at 1,163 metres and offers easy access to the enveloping panorama of jagged mountains and the flower-rich meadows, pastures and spruce forests at their feet. -

Exclusive Brand Presence in the Jungfrau Region – Top of Europe
Rail advertising in the Jungfrau Region 2018 Exclusive brand presence in the Jungfrau Region – Top of Europe www.apgsga.ch Advertising in the Jungfrau Region | 2 Attractive destination in the Jungfrau tourist region in the Bernese Oberland As one of the leading tourism companies, the Jungfrau Railway Group is proba- bly the most important mountain railway company in Switzerland. Every year, hundreds of thousands of guests from Switzerland and around the world visit the beautiful and internationally renowned Jungfrau Region and its most famous highlight for its visitors: the Jungfraujoch. The Jungfrau Railway (JB), the Wengernalp Railway (WAB), the Berner Oberland Railway (BOB) and the Lauterbrunnen – Mürren Railway (BLM) make up the railway network in the Jungfrau Region. Jungfrau Railway (JB) The rack railway takes Berner Oberland Railway (BOB) The Berner guests from Kleine Scheidegg to Jungfraujoch Oberland-Bahn runs along the Lütschinen- Top of Europe. The journey leads them to the valleys from Interlaken East to Grindelwald and highest train station in Europe and ascends Lauterbrunnen. Jungfrau Railway 1,400 metres. Lauterbrunnen – Mürren Railway Wengernalp Railway (WAB) The Wenger- (BLM) Starting at the mountain station nalp Railway (WAB) connects the villages Grütschalp, the narrow-gauge railway BLM Lauterbrunnen and Grindelwald with Kleine connects Grütschalp with the holiday town Scheideggg, 2,061 metres above sea level. of Mürren. Basic information BOB WAB JB BLM Length of network in km 23.7 19.1 9.3 4.7 Number of stops 8 10 5 -

Wanderkarte Der Jungfrau Region
Wanderkarten: © Schweizer Wanderwege Schweizer © Wanderkarten: G UN IT E L M U 1.00 H 1.40 H 2.50 H 6.10 H 2.30 H 37 Jungfrau Eiger Walk 1 First – Bachalpsee – First 36 Eiger Trail 62 Schynige Platte – Faulhorn – First 61 Panoramaweg Schynige Platte Neu · New · Nouveau 3S-Bahn Eiger Express DE Ein gut ausgebauter Erlebnisbergweg mit verschiedenen DE Von der First führt der Weg leicht auf und ab zum Bachalpsee. DE Ein abenteuerlicher Bergweg am Fuss der imposanten Eiger- DE Von der Schynige Platte führt die klassische Höhenwanderung DE Attraktive Wanderroute zwischen Brienzersee und Grindel- DE Die neue 3S-Bahn Eiger Express bringt Sie in 15 Minuten vom inszenierten Stationen. Thema ist die Eigernordwand, welche seit Im Hintergrund erheben sich die mit ewigem Eis bedeckten, nordwand. Ein Erlebnis für geübte Wanderer mit guter Ausrüstung. leicht aufwärts zum Faulhorn. Hier steht das älteste Berghotel waldtal. Vorbei an Murmeltierkolonien und wunderschönen Grindelwald Terminal zur Station Eigergletscher. Mit direkter Um- Jahrzehnten unvergessliche Geschichten bietet. majestätischen Berner Alpen. Europas. Nach kurzem Abstieg erreichen wir den Bachalpsee und Alpenblumen. steigemöglichkeit sind Sie 47 Minuten schneller auf dem Jungfrau- EN A spectacular but safe mountain trail at the foot of the imposing die First. joch – Top of Europe. EN A well laid adventure trail with various points offering interes- EN A gently undulating path leads from First to Lake Bachalpsee. Eiger North Wall. For well-equipped and experienced hikers only. EN Attractive route between Lake Brienz and the Grindelwald tingly staged presentations. The theme is the Eiger North Wall, In the background soar the spectacular, eternally snow-covered EN From Schynige Platte, the classic high-Alpine hike climbs gently Valley. -

Alpine Flowers of the Swiss Alps
Wengen - Alpine Flowers of the Swiss Alps Naturetrek Tour Report 17 - 24 June 2018 Antennaria dioica Crocus vernus Lauterbrunnen valley Pulsatilla vernalis Report and images by David Tattersfield Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Wengen - Alpine Flowers of the Swiss Alps Tour participants: David Tattersfield (tour leader) with 16 Naturetrek clients. Day 1 Sunday 17th June We arrived in Zurich in the early afternoon and took the comfortable inter-city trains to Interlaken. Here we joined the regional train and followed the milky waters of the Lutschine River to Lauterbrunnen. The last leg of the journey was on the cogwheel railway to Wengen, where it was just a short walk to our hotel. We arrived around 5.30pm, with time to settle in before dinner. Day 2 Monday 18th June We enjoyed a sunny day with cloud drifting over the mountain tops and only thickening during the late afternoon. We took the Mannlichen cable-car, high above the village and spent the morning exploring a wide range of habitats, as we made our way towards the summit, at 2343 metres. Inevitably, we made slow progress, with new discoveries every few paces. The mountain pasture was speckled with the white flowers of Kupfer’s Buttercup Ranunculus kuepferi and drifts of Globeflower Trollius europaeus made rich-yellow patches on the cliff- tops. Here and there were colourful patches of Spring Gentian Gentiana verna, Bird’s-eye Primrose Primula farinosa and Whorled Lousewort Pedicularis verticillata and near the edges of melting snowdrifts, we found Oxlip Primula elatior, the delightful frilled flowers of Alpine Snowbell Soldanella alpina and patches of Spring Crocus Crocus vernus. -

Regional-Pass Bernese Oberland Map 2021
La Neuveville Luzern Wolhusen Burgdorf Rigi Regional-Pass Berner Oberland Jegenstorf Kleine Emme Littau Arth-Goldau Area of validity 2021 Sumiswald- h Malters Weggis Stand/Version/Etat: 12.2020 Grünen Emme Vierwald- Horw Aare Ins c Kehrsiten- Hasle- Vitznau Verkehrsmittel Rüegsau Bürgenstock Brunnen Napf Entlebuch Mode of transport Ramsei u Bürgenstock E Hergiswil m Pilatus stättersee Bahnen Busse Seilbahnen Schiffe Stansstad m b RailwaysNeuchâtel Buses Cableways Boats Kerzers Aare Kleine Emme C e Alpnacher- Stans Ostermundigen e Alpnachstad see Bern n 1 B Urner- l Schüpfheim Alpnach Dorf Lac t Langnau i.E. Bern Gümligen Dallenwil see Europaplatz a t Geltungsbereich Murten de Morat Rosshäusern Bern Worb Signau l Trubschachen n Lac Flughafen Area of validity 26 E Escholzmatt de Neuchâtel Laupen Wolfenschiessen Portalban La Broye Kehrsatz Rubigen Freie Fahrt Langis Sarnen Kerns Free travel Zäziwil Avenches Belp Flühli LU Libre circulation La Sarine Flamatt Konolfingen Sachseln Münsingen Sarner - Grafenort 38 Halber Preis vom Normaltarif Toffen see Flüeli- Schmitten Ranft ½ fare Jassbach Engelbergtunnel Aare Wichtrach Röthenbach i.E. Reuss Oberdiessbach Ristis Kaufdorf Heimenschwand Emme Giswil Glaubenbielen Sonderpreis Schwarzenburg Kiesen Süderen Sörenberg Engelberg Special price Thurnen Kemmeri- Payerne Oberlangenegg boden Lungerer- Riggisberg Unterlangenegg Rossweid Rothornbahn Stöckalp Fribourg Uttigen see Trübsee Seftigen Heimberg Schwarzenegg Turren Jochpass Rosé Lungern Regional-Pass nicht gültig Steffisburg Innereriz Hohgant Brienzer -

Die Kleine Scheidegg
DIE KLEINE SCHEIDEGG ERNST WINKLER «Von Lauterbrunnen nach Grindelwald giebt es zwey sehr unterschiedene Wege. Niederwärts das Thal hinaus nach Zweylütschinen und von da durchs Lütschenthal geht fahrbar der eine; aufwärts über die Scheideck der Wengen oder Wengernalp geht der andere, doch nur Pferden und Fußgängern gebahnte. Zum erstenmal ward dieser im Jahr 1771 von Herrn Pfarrer Wyttenbach, in Begleit des berühmten Freundes von Johannes Müller, des Herrn von Bonstetten, zu Gunsten der Reisenden unserer Zeit erprobt, und dann auf das nachdrücklichste empfohlen. Kein Reisender sollte unter¬ lassen ihn zu versuchen. Er ist gefahrlos. Er ist nicht über 8 Stunden weit. Er ist der höchste von unseren oberländischen Bergpässen. Er gewährt, wie kein anderer, einen er¬ habenen Anblick des herrlichsten Schneegebirges. Man schreitet eine Stunde lang steil empor bis zu dem zerstreuten Berghüttendorf Wengen. Alsdann führt müheloser der Pfad eine geraume Zeit längs einer breiten Abflachung des Berghangs über dem Lauter- brunnenthale hin nach dem Trümletenthal, welches fast rechtwinklicht von der Jung¬ frau nach jenem zur Tiefe dringt. Plötzlich aber wendet sich der Weg und zieht eine Stunde lang, mitten durch eine gastfreundliche Sennerey von zahlreichen Hütten, im steten Anschauen der Jungfrau und beyder Eiger, östlich auf den obersten Grat der Scheideck, und von hier windet er sich in den Boden des Grindelwaldthaies, das unaus¬ gesetzt vor dem spähenden Blicke liegt, und jenseits die große Haslischeideck zur Gränze hat.» Mit diesen Worten leitete der Professor für Philosophie an der Universität Bern, Dichter und Geograph Johannes Rudolf Wyß «der Jüngere» (1781-1830), nicht nur die wohl erste eingehendere und eindrückliche Schilderung eines der bekanntesten und am meisten begangenen schweizerischen Paßübergänge ein. -

Annual Report
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG ANNUAL REPORT 2016Part 1: Management Report Official Version JUNGFRAUBAHN HOLDING AG ANNUAL REPORT 2016 Table of contents TABLE OF CONTENTS 1 MANAGEMENT REPORT 1.1 WELCOMING ADDRESS TO THE SHAREHOLDERS 3 1.2 JUNGFRAUBAHN HOLDING AG IN BRIEF 6 1.3 MESSAGE FROM COMPANY MANAGEMENT 16 1.4 SPECIAL 23 2 SEGMENTS 2.1 JUNGFRAUJOCH 31 2.2 WINTER SPORTS 34 2.3 ADVENTURE MOUNTAINS 37 2.4 OTHER COMPANIES 40 JUNGFRAUBAHN HOLDING AG ANNUAL REPORT 2016 MANAGEMENT REPORT JUNGFRAUBAHN HOLDING AG 3 ANNUAL REPORT 2016 Management report WELCOMING ADDRESS TO THE SHAREHOLDERS Dear Shareholders, Global tourism has seen solid growth rates for years. This has also opened up a steadily rising market potential for Jungfraujoch – Top of Europe. We can take advantage of this: at the end of 2015, we achieved one million visitors for the first time. The majority of them came from Asia. As with the financial crisis in 2008, the past year has shown that obstacles can arise time and again in global tourism sales. Terrorist attacks in Europe influenced the behaviour of international customers. Despite this, the Jungfraubahn Group achieved its second best result in a challenging environment. We are convinced that the Jungfrau Railways Group is well prepared for the challenging times ahead, thanks to its anchoring in the region and the international character of its brand as well as its integrated range of services. We can support this with a solid group profit of CHF 30.9 million. Our value creation should also add value accordingly to all «Stakeholders» and you as shareholders. -

Wyssen Reference Projects Eiger North Face - How to Do Avalanche Control in Severe Terrain
Wyssen Reference Projects Eiger North Face - How to do avalanche control in severe terrain Safety through innovation Avalanche Protection from Eiger North Face Project: Avalanche Protection from Eiger North Face Place: Jungfrau Region Country: Switzerland Year: Installation 2003 Customer: Wengernalpbahn AG Protected Object: Railway between Grindelwald and Kleine Scheidegg, Ski slopes, Ski resort Installed Systems: Wyssen Avalanche Tower 12 shots How this came about... In 2003, an Avalanche Tower was installed in the lowest part of the Eiger North Face to protect the Wengernalp railway on its way up to the Jungfraujoch. The aim of this measure was to protect a section between Grindelwald and Kleine Scheidegg that had not been protected by snow sheds. Most endangered parts are protected with snowsheds. The reason that the whole line is not protected by snow sheds is that the tourists can enjoy the impressive panorama of the Eiger North Face along the route. The person then in charge of safety Ueli Frutiger, decided to look for a solution that did not obscure the view all along the line. Therefore it had to be a temporary measure, indicating that a remote avalanche control system RACS was needed. Safety through innovation Challenging placement and construction of the anchorage The world famous Eiger North Face is known by its climbers on one hand for its climbing difficulties and on the other hand for its objective hazards such as for example rapid weather changes, avalanches and rock falls. It was known that Wyssen Avalanche Towers withstand small to medium avalanche forces and could be proven at this location once more.