Brochure 2019-2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IPA Index 1 People - D
IPA Index 1 People - D D, [ ]: 1900.févr-mars.18 (ger), 1901.9 (ger), 1901.47 D, [ ] (Mr) SPRAGUE DE CAMP, L (1940) [Spec] American English from Northern New Jersey [Morris County; inf= --- , aged 80, of Boonton]. NWS 1940.67- 68 D, [ ] (Mrs) SPRAGUE DE CAMP, L (1943) [Spec] New York City American [infs=two young women [Miss C, --- ], b and r in New York City of business class parents who were also native speakers]. NWS. 1943.11-12 D, E BALDWIN, J R (1966) The glottal stop in Turkish [infs: --- , İzmir]. 1966.30-32 D, I BALDWIN, J R (1966) The glottal stop in Turkish [infs:--- , Istanbul]. 1966.30-32 D L, [ ]: 1913.127 (fra), 1914.Suppl.2 (fra) D’ARCANGELI, Luciana ROGERS, Derek & --- (2004) Italian. NWS [inf= female, ‘cultivated accent with no strong regional features’]. 2004.117-121 D’EUGENIO, Antonio (Dr): 1975.48 (ita), 1975.Suppl.9 (ita), 1978.Suppl.10 (ita), 1990.ii.57 (ita), 1994.48 (ita), 1998.122 (ita) CHAPALLAZ, M (1978) [Rev] --- (1978) L’Insegnamento della Pronuncia Inglese agli Italiani. Vol 1, Bologna: Pàtron Editore 1978.91-93 D’HEUREUSE: see HEUREUSE D’IMPERIO, Mariapaola: 1998.122 (usa), 2005.125 (fra) D’URSO, Sergio (Rev): 1960.38 (ita), 1961.Suppl.vii (ita), 1968.23 DA COSTA, Domingos José: 1907.33 (por) DA COSTA, Jaime: 1998.122 (por) DA COSTA ANDRADE: see ANDRADE DA CRUZ, A: 1932.48 (por), 1934.32 (por) DA CUNHA: see NEVES DA CUNHA DA MATTA MACHADO, Miriam T (Mlle): 1976.96 (fra), 1978.Suppl.5 (fra), 1981.Suppl.5 (fra), 1994.53 (brz), 1998.122 (brz), 2000.120 (brz) © M K C MacMahon 2007 IPA Index 2 People - D DA PALMA: see PALMA, A V V da DA SILVA: see also SILVA, M J da, ALVES DA SILVA, T C DA SILVA TEIXEIRA, António J (Mr): 2005.127 (por) DAAE, [ ]: IPA exam result (French). -

SHDGR 16P E.Pdf
Sous-série GR 16 P Dossiers administratifs de résistantes et résistants Lettre E Date de Département de Cote NOM, Prénoms Commune de naissance Pays de naissance FFC FFI RIF DIR FFL naissance naissance GR 16 P 207059 EABO GR 16 P 207060 EACHY, Louis Marcel Eugène 17.02.1925 Saint-Quentin Aisne FRANCE Homologué GR 16 P 207061 EADE, Louis 18.12.1911 Londres ROYAUME-UNI GR 16 P 207062 EADME GR 16 P 207064 EAGALDE GR 16 P 207065 EAGAR, Victor 10.01.1900 Belfast IRLANDE GR 16 P 207066 EALET, Félix Charles 14.11.1919 Nantes Loire-Inférieure FRANCE GR 16 P 207067 EALET, Jean François Victor 15.03.1913 Bezons Seine-et-Oise FRANCE Homologué GR 16 P 207068 EAN, Nu 00.00.1914 Pu Rach CAMBODGE Homologué GR 16 P 207069 EANNO, Jean Marie 28.07.1921 Saint-Philibert Morbihan FRANCE Homologué GR 16 P 207070 EARD, Fernand Eugène 19.08.1922 Modane Savoie FRANCE Homologué GR 16 P 207063 EASSINGER, Paul GR 16 P 207071 EASTON GR 16 P 207072 EATON ép. CANET, Evelyne 13.11.1921 Lille Nord FRANCE Homologué GR 16 P 207073 EATON EVANS ép. HAMILTON, Constance Vera 24.09.1901 Preston ROYAUME-UNI Homologué GR 16 P 207074 EAUBELLE, Henri Louis 27.11.1926 Longxuyen VIET NAM Homologué GR 16 P 207075 EAUDEVIE GR 16 P 207076 EB, Jean 13.09.1913 Saint-Sauveur Oise FRANCE Homologué GR 16 P 207077 EBA, Ebono CAMEROUN GR 16 P 207078 EBA, Marc 00.00.1922 Nkolkang CAMEROUN Homologué GR 16 P 207079 EBABA, Raymond 00.00.1921 Eyecke CAMEROUN Homologué GR 16 P 207080 EBAH, Denies GR 16 P 207081 EBALE, Endom 00.00.1914 Boroa CAMEROUN Homologué GR 16 P 207082 EBALLE, Pierre 00.00.1920 -

The Phonetician As a Valuable Publication for Institutions and Individuals Outside Our Official Membership
ISPhS International Society of Phonetic Sciences President: J.-P. Köster Secretary General: Honorary President: R. Huntley Bahr H. Hollien Executive Vice President: A. Braun Vice Presidents: Past Presidents: A. Braun H. Kelz H. Hollien R. Colton H. J. Künzel W.A. Sakow † M. Dohalská-Zichová S. Lambacher M. Kloster-Jensen D. Horga A. Laufer M. Romportl † R. Huntley Bahr B. Malmberg † E. Zwirner † D. Jones † Honorary Vice Presidents: A. Abramson P. Janota P. Ladefoged R. K. Potapova F. Weingartner S. Agrawal W. Jassem A. Marchal M. Rossi R. Weiss L. Bondarko M. Kloster-Jensen H. Morioka M. Shirt E. Emerit M. Kohno R. Nasr E. Stock G. Fant E.-M. Krech T. Nikolayeva M. Tatham Regional Secretaries: S. Agrawal India M. Bakalla Mid-East R. de Figueiredo Sout h America M. Dohalská-Zichová & T. Duběda Czech Section Auditor: J. M. H. Neppert Deutschspr. Abt. (DA) A. Braun C. Paboudjian Europe-South R. K. Potapova Russia P. French United Kingdom Treasurer: K. Slethei Nordic R. Huntley Bahr E. Meister Baltic Y. H. Wang SE Pacific H. Yamazawa Japan Associations: J. Hoit & W. S. Brown, Jr. American Association of Phonetic Sciences T. de Graaf & A. C. M. Rietveld Dutch Society of Phonetics A. Braun International Association for Forensic Phonetics H. Umeda & T. Sugawara Phonetic Society of Japan G. Demenko & M. Steffen-Batogowa Polish Phonetics Association Institutes: Kay Elemetrics, Lincoln Park, NJ, USA: J. Crump Inst. for the Advanced Study of Communication Processes, Univ. Florida, USA: H. Hollien Dept. of Phonetics, University of Trier, Germany: J.-P. Köster Dept. of Phonetics, University of Helsinki, Finland: A. -

Tone and Intonation: Introductory Notes and Practical Recommendations Alexis Michaud, Jacqueline Vaissière
Tone and intonation: introductory notes and practical recommendations Alexis Michaud, Jacqueline Vaissière To cite this version: Alexis Michaud, Jacqueline Vaissière. Tone and intonation: introductory notes and practical recom- mendations. KALIPHO - Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik, Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft (ISFAS) Abt. Allgemeine Sprachwissenschaft Christian - Albrechts - Universität zu Kiel, 2015, Special Issue: ”Theoretical and empirical foundations of ex- perimental phonetics”, 3, pp.43-80. halshs-01091477v3 HAL Id: halshs-01091477 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01091477v3 Submitted on 5 Feb 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik (KALIPHO), Inst. f. Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft (ISFAS), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2 Tone and Intonation – Introductory Notes and Practical Recommendations Alexis Michaud International Research Institute MICA Hanoi University of Science and Technology, CNRS, Grenoble INP, Vietnam Langues et Civilisations à Tradition Orale, CNRS/Sorbonne Nouvelle, France [email protected] Jacqueline Vaissière Laboratoire de Phonétique et Phonologie Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, CNRS, Paris [email protected] The present article aims to propose a simple introduction to the topics of (i) lexical tone, (ii) intonation, and (iii) tone-intonation interactions, with practical recommendations for students. -

Relazione Sulle Attività Dell'università Per Stranieri Di Siena (Anno 2017) Versione
Siena, 24 aprile 2018 RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (ANNO 2017) AI SENSI DELL’ART. 3-QUATER, LEGGE 1/2009 VERSIONE 1.0 IL RETTORE Prof. PIETRO CATALDI 1 Indice Introduzione » 3 1. Descrizione dell’Università per Stranieri di Siena » 4 1.1 L’Ateneo » 4 1.2 Le strutture dell’Ateneo istituite ai sensi del nuovo Statuto (2012) » 5 2. I risultati raggiunti nel 2017 » 8 2.1 Alcuni indicatori generali » 8 2.2 I principali risultati delle attività formative » 9 2.2.1 La qualità percepita dagli studenti » 14 2.3. I principali risultati della ricerca » 15 2.4 Le principali attività di internazionalizzazione 16 3. Le relazioni delle strutture » 26 DADR- Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca » 26 Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione » 117 Centro di Eccellenza della Ricerca » 133 Centro CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera » 139 Centro CLASS - Centro linguistico di Ateneo per le lingue straniere » 147 Centro Linguistico CLUSS » 164 Centro Ditals – Certificazione Didattica » 173 Centro FAST –Formazione e aggiornamento anche con supporto » 193 tecnologico Biblioteca » 208 Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali 211 Centro Servizi Informatici » 213 Siena Italtech – tecnologie per lo sviluppo linguistico s.r.l. » 215 2 Introduzione Secondo quanto è richiesto dalla Legge 1/2009, art 3-quater, recepita nell’art. 13, c. 8 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, “con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita relazione contenente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati”. -
IPA Index 1 People - P
IPA Index 1 People - P P, D --- (1895) [Q&A: French (Q) - subjunctive and past tense]. 1895.174 PACKET, A: 1904.153 (net), 1905.13 (net), 1906.16 (net), 1907.19 (net), 1908.19 (net), 1909.20 (net) PADBERG, F: 1900.janv.5 (fra), 1901.4 (fra), 1901.47 PADBURY, A E: 1905.86 (eng), 1906.5 (eng), 1907.5 (eng), 1908.5 (eng), 1909.5 (eng) PADERNI, Ricardo Gustavo: 1998.134 (arg), 2000.121 (arg) PADGETT, Wilfred Wood: IPA exam result. 1923.8 PADLEY, Sadie A (Miss): 1928.64 (usa), 1930.18 (usa), 1930.73 (usa), 1932.20 (usa), 1934.35 (usa), 1936.40 (usa), 1938.36 (usa) --- (1933) [Spec] American English [inf=b & ed Eastern New York.] < O’SHEA, W J (1931-1932) 35th Annual Report on Oral English and Phonetics, New York. See also JONES, D 1934.19. 1933.79 PADLINA, Laura: 1910.29 (chl) PAÉGLÉ, Edward: 1908.41 (rus), 1909.26 (rus), 1910.25 (rus), 1911.33 (rus), 1912.48 (rus), 1913.32 (rus), 1914.Suppl.22 (rus), 1914.40 (rus), 1925.Suppl.10 (lat) NOËL-ARMFIELD, G (1910) [Rev] --- (1910) Angļu Walodas mahziba eesahzejeem. English Lessons for Beginners. Rigā: Latvia Press. 1910.130-131 --- & JONES, D (1910) [Spec] Lettish. Sol. 1910.138-139 [--- post-card chart of Russian sounds.] 1911.114 PÄSCHKE, [ ]: 1904.10 (ger), 1904.60, 1905.10 (ger), 1905.27 PAGE, C H (Dr): 1895.31 (fra), 1896.17 (usa), 1896.35 PAGE, G E (Miss): 1925.Suppl.10 (usa) PAGE, J F: 1912.155 (usa), 1913.36 (usa), 1914.Suppl.26 (usa) PAGE, W Sutton ~ SUTTON PAGE, W (Rev): 1913.88 (ind), 1914.Suppl.30 (ind), 1914.40 (ind), 1914.60 (ind), 1925.Suppl.13 (eng), 1930.13 (eng), 1932.16 (eng), 1934.31 (eng), 1936.36 (eng) --- (1929) [Rev] CHATTERJI, S K (1928) A Bengali Phonetic Reader. -

Das Forschungsjahr 2007
www.gwz-berlin.de das forschungsjahr 2007 Wissenschaft braucht Freunde und Förderer Initiative Deutschland – Das Wissenschaftsjahr 2007 Land der Ideen Die Geisteswissenschaften. Werden Sie Mitglied im Kreis der Freunde und Förderer des Zentrums für Literatur- und Das Zentrum Moderner Orient und ABC der Menschheit Kulturforschung e.V. bzw. in der Gesellschaft zur Förderung des Zentrums Moderner Orient e.V. Auf Grundlage der Empfehlungen des Wissenschaftsrats vom Juni 1991 und vom das Zentrum für Literatur- und Kultur- Im Jahr 2007 standen erstmals die und unterstützen Sie so die Tätigkeit der Zentren aktiv. November 1994 initiierte der Wissenschaftssenator im Land Berlin Ende 1995 die forschung wurden 2007 im Rahmen Geisteswissenschaften im Mittelpunkt Gründung des Vereins Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V. und übertrug ihm die der Initiative „Deutschland – Land eines Wissenschaftsjahres. Nach sieben Dem Vorstand der Freunde und Förderer des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung e.V. Trägerschaft für drei Forschungszentren. Am 1. Januar 1996 begann die erste zwölfjährige e der Ideen“ als Ausgewählter Ort ausge- Jahren, die sich den Naturwissenschaf- Wa nc shin gehören an: Aris Fioretos, Schriftsteller und ehemaliger Botschaftsrat für kulturelle Förderphase der Zentren. Auf Grundlage einer Empfehlung des Wissenschaftsrats vom Yo zeichnet. ten widmeten, wurden nun die Vielfalt rove gy gt Va Zü a Fragen an der Schwedischen Botschaft in Deutschland (Vorsitzender); Wolfgang Thierse, Januar 2006, in der die Forschungsleistungen der Zentren seit 1996 als hervorragend on und Bedeutung der geisteswissenschaft- nco ka rich -en-P D. rt U uver Vizepräsident des Deutschen Bundestages (Stv. Vorsitzender); Wolfgang Kreher, bewertet und deren Weiterförderung und Weiterführung empfohlen wurde, begann am a lichen Fächer, Themen und Methoden C. -

Book of Abstracts
16th International Congress of Phonetic Sciences Book of Abstracts www.icphs2007.de Edited by Jürgen Trouvain and William J. Barry ICPhS XVI Saarbrücken, 6-10 August 2007 Previous Congresses 1st Amsterdam (1932) 2nd London (1935) 3rd Ghent (1938) 4th Helsinki (1961) 5th Münster (1964) 6th Prague (1967) 7th Montréal (1971) 8th Leeds (1975) 9th Copenhagen (1979) 10th Utrecht (1983) 11th Tallinn (1987) 12th Aix-en-Provence (1991) 13th Stockholm (1995) 14th San Francisco (1999) 15th Barcelona (2003) Proceedings: Ingmar Steiner Webdesign: Kerstin Hadelich Database: Henrik Benner, Aalborg Cover and Logo Design: Stefan Grenner, Saarbrücken Front Cover Photograph: www.designladen.com Print: Pirrot GmbH, Dudweiler ii www.icphs2007.de ICPhS XVI Saarbrücken, 6-10 August 2007 Message from the General Chair Dear Colleagues, On behalf of the Phonetic Sciences in Germany, I welcome you to Saarbrücken and the Saarland. Though Saarbrücken is the venue, it was a Consortium of Phoneticians from the whole country that was accorded the honour of hosting the XVIth ICPhS, 43 years and 11 congresses after the last meeting in Germany, in Münster, Westphalia. For us, one of the important things about such a Congress is the signal it sends to the emerging generation of speech scientists. As far as Germany is concerned, many have come here from their universities to act as student helpers in the minute-to-minute running of the Congress. Being part of the events here and experiencing the intellectual excitement of discussions and of the exchange of results and ideas will, we hope, serve to strengthen their interest and inspire their own future work in speech research. -
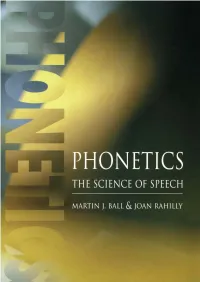
Phonetics the Science of Speech
Phonetics This page intentionally left blank Phonetics The Science of Speech Martin J. Ball School of Psychology and Communication, University of Ulster at Jordanstown and Joan Rahilly School of English, The Queen's University of Belfast First published in Great Britain in 1999 by Arnold, a member of the Hodder Headline Group, Published in 2013 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 ThirdAvenue,New YorkNY 10017 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 1999 Martin J. Ball and Joan Rahilly All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without either prior permission in writing from the publisher or a licence permitting restricted copying. In the Uni ted Kingdom such licences are issued by the Copyright Licensing Agency: 90 Tottenham Court Road, London W1P 9HE. The advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of going to press, but neither the authors nor the publisher can accept any legal reponsibility or li ability for any errors or omissions. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the Library of Congress ISBN 978-0-340-70009-9 (hbk) ISBN 978-0-340-70010-5 (pbk) Production Editor: -
Edmondson, Jerold A., John H. Esling and LAMA Ziwo (拉玛兹偓) (2016) Nuosu Yi
John H. Esling, Department of Linguistics, University of Victoria Recent Publications: Edmondson, Jerold A., John H. Esling and LAMA Ziwo (拉玛兹偓) (2016) Nuosu Yi. Journal of the International Phonetic Association, 46. http://dx.doi.org/10.1017/S0025100315000444 John H. Esling, Scott R. Moisik & Christopher Coey. (2015). ‘iPA Phonetics: Multimodal iOS application for phonetics instruction and practice’. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (paper 263). Glasgow. Scott R. Moisik, John H. Esling, Lise Crevier-Buchman, Angélique Amelot & Philippe Halimi. (2015). Multimodal imaging of glottal stop and creaky voice: Evaluating the role of epilaryngeal constriction. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (paper 247). Glasgow. Chakir Zeroual, Philip Hoole, Adamantios I. Gafos & John H. Esling. (2015). Gestural coordination differences between intervocalic simple and geminate plosives in Moroccan Arabic: An EMA investigation. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (paper 706). Glasgow. Esling, John H., Christopher Coey & Scott R. Moisik. (2014). Auditory categories and laryngoscopic/ultrasound images in the iPA Phonetics app’. Canadian Acoustics, 42(3), 98-99. Esling, John H. (2014). States of the larynx in laughter. In Jürgen Trouvain & Nick Campbell (Eds.), Phonetics of Laughing. Saarbrücken: Universaar – Saarland University Press. App on the Apple Store: Coey, Christopher, John H. Esling & Scott R. Moisik. (2014). iPA Phonetics, Version 1.0 [2014]. Department of Linguistics, University of Victoria. Moisik, Scott R., Hua Lin & John H. Esling. (2014). A study of laryngeal gestures in Mandarin citation tones using simultaneous laryngoscopy and laryngeal ultrasound (SLLUS). Journal of the International Phonetic Association, 44, 21-58. Moisik, Scott R. -

Social and Linguistic Speech Prosody Proceedings of the 7Th International Conference on Speech Prosody
Social and Linguistic Speech Prosody Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody ISSN: 2333-2042 SP-7 Conference Programme Social and Linguistic Speech Prosody 1 Frontmatter/Preface 1.1 Statistics by Country (showing number of authors) Authors from 45 countries sent in submissions to Speech Prosody 2014 5 countries didn’t make it - we hope they’ll try again for SP8! 1.2 Accepted authors by country: Algeria 1 Australia 6 Austria 1 Bangladesh 1 Belgium 6 Brazil 17 Canada 12 China 16 Costa Rica 1 Czech Republic 7 Denmark 1 Estonia 9 European Union 281 Finland 8 France 59 Germany 70 Hong Kong 6 Hungary 26 India 4 Iran 1 Ireland 12 Israel 3 Italy 15 Japan 29 Mexico 1 Netherlands 16 Norway 1 Poland 8 Portugal 6 Qatar 1 Russian Federation 2 Saudi Arabia 1 Slovakia 3 South Africa 2 Spain 18 Swaziland 1 Sweden 7 Switzerland 12 Taiwan 7 UK 25 USA 76 Campbell, Gibbon, and Hirst (eds.) Speech Prosody 7, 2014 i SP-7 Conference Programme 1.3 Acceptance rates: We have seen a 35% increase in acceptances since Speech Prosody in Nara, 10 years ago, and a 68% increase in submissions. 2004 (in Nara): 164/180; 29 oral and 135 poster 2014 (in Dublin): 222/303; 42 oral and 180 poster 2004: 91% acceptance rate 2014: 73% acceptance rate 2004: 21% oral/poster ratio 2014: 23% oral/poster ratio altogether 480 authors and 4 keynote speakers are represented at SP7 Speech Prosody - brought to you in Dublin by the Pros Bros! (photo courtesy of Jolanta Bachan, Brighton 2012) Campbell, Gibbon, and Hirst (eds.) Speech Prosody 7, 2014 ii SP-7 Conference