Les Mutins De Knysna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mou on China-Myanmar Corridor Project Inked
Established 1914 Volume XVIII, Number 28 7th Waxing of Nayon 1372 ME Wednesday, 19 May, 2010 Four political objectives Four economic objectives Four social objectives * Development of agriculture as the base and all-round development * Uplift of the morale and morality of the entire * Stability of the State, community peace and of other sectors of the economy as well nation tranquillity, prevalence of law and order * Proper evolution of the market-oriented economic system * Uplift of national prestige and integrity and * National reconsolidation * Development of the economy inviting participation in terms of preservation and safeguarding of cultural her- * Emergence of a new enduring State Constitu- technical know-how and investments from sources inside the itage and national character tion country and abroad * Uplift of dynamism of patriotic spirit * Building of a new modern developed nation in * The initiative to shape the national economy must be kept in the * Uplift of health, fitness and education stand- accord with the new State Constitution hands of the State and the national peoples ards of the entire nation Secretary-1 receives Chinese True patriotism * It is very important for everyone Transport Minister and party of the nation regardless of the place he lives to have strong Union Spirit. NAY PYI TAW, 18 May—Secretary-1 of the Mr. Li Shenglin and party at the State Peace and * Only Union Spirit is the true State Peace and Development Council General Development Council Office, here, at 2 p.m. to- Thiha Thura Tin Aung Myint Oo received Minis- day. patriotism all the nationalities will ter of Transport of the People’s Republic of China (See page 8) have to safeguard. -

Uefa Champions League 2009/10 Season Match Press Kit
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/10 SEASON MATCH PRESS KIT FC Girondins de Bordeaux (first leg: 1-3) Olympique Lyonnais Stade Chaban-Delmas, Bordeaux Wednesday 7 April 2010 - 20.45CET (20.45 local time) Matchday 10 - Quarter-finals, second leg Contents Match background.........................................................................................2 Match facts....................................................................................................4 Squad list.......................................................................................................7 Head coach....................................................................................................9 Match officials...............................................................................................10 Fixtures and results......................................................................................11 Match-by-match lineups...............................................................................15 Competition facts..........................................................................................18 Team facts....................................................................................................19 Legend.........................................................................................................22 This press kit includes information relating to this UEFA Champions League match. For more detailed factual information, and in-depth competition statistics, please refer to the matchweek press kit, which -

AS Roma - FC Girondins De Bordeaux CARTELLA STAMPA Stadio Olimpico, Roma Martedì 9 Dicembre 2008 - 20.45CET Gruppo a - Giornata 6
AS Roma - FC Girondins de Bordeaux CARTELLA STAMPA Stadio Olimpico, Roma Martedì 9 Dicembre 2008 - 20.45CET Gruppo A - Giornata 6 Contenuto 1 - Storia della partita 7 - Informazioni UEFA 2 - Dati sulla partita 8 - Formazioni partita per partita 3 - Rosa squadra 9 - Dati sulla competizione 4 - Allenatori 10 - Dati sulle squadre 5 - Direttori di gara 11 - Legenda 6 - Notizie nazionali La presente cartella stampa include informazioni su questa partita di UEFA Champions League. Per informazioni ulteriori, e statistiche approfondite sulla competizione, si consiglia di fare riferimento al press kit settimanale, che può essere scaricato qui: http://it.uefa.com/uefa/mediaservices/presskits/index.html Storia della partita Il Gruppo A è l'unico girone di cui non si conosce ancora il nome di nessuna delle due squadre ammesse alla prossima fase. Sebbene l'AS Roma guidi il girone con un punto di vantaggio, è molto probabile che dovrà almeno pareggiare in casa contro il FC Girondins de Bordeaux per accedere agli ottavi. Per i transalpini la situazione è chiara: devono vincere allo Stadio Olimpico per avanzare in UEFA Champions League, diversamente proseguiranno la stagione europea in Coppa UEFA come terzi classificati. • I giallorossi sono balzati al primo posto grazie al 3-1 in Transilvania, con cui hanno messo fine alle speranze di qualificazione del CFR 1907 Cluj. La Roma ha risolto la questione già nei primi 23 minuti. Al gol iniziale di Matteo Brighi, primo centro per il centrocampista in UEFA Champions League, seguiva la punizione trasformata da Francesco Totti. Yssouf Koné accorciava le distanze di testa per i padroni di casa, ma ancora Brighi si incaricava di ristabilire le distanze al 64'. -

2009/10 UEFA Champions League Statistics Handbook, Part 2
Debreceni VSC UEFA CHAMPIONS LEAGUE | SEASON 2009/10 | GROUP E Founded: 12.03.1902 Telephone: +36 52 535 408 Address: Oláh Gabor U 5 Telefax: +36 52 340 817 HU-4032 Debrecen E-mail: [email protected] Hungary Website: www.dvsc.hu CLUB HONOURS National Championship (4) 2005, 2006, 2007, 2009 National Cup (3) 1999, 2001, 2008 National Super Cup (4) 2005, 2006, 2007, 2009 Debreceni VSC UEFA CHAMPIONS LEAGUE | SEASON 2009/10 | GROUP E GENERAL INFORMATION Managing Director: Sándor Szilágyi Supporters: 2,700 Secretary: Judit Balla Other sports: None Press Officers: Gabór Ganczer Zoltán Csubák Captain: Zoltán Kiss PRESIDENT CLUB RECORDS Gábor Szima Most Appearances: Sándor Csaba - 399 league matches (1984-2000) Date of Birth: 02.10.1959 Most Goals: Sandór Tamás - Date of Election: 92 goals in 301 matches (1991-97 & 08.01.2002 2002-08) STADIUM – FERENC PUSKÁS (Budapest) Ground Capacity: 36,160 Floodlight: 1,400 lux Record Attendance: 104,000 (v Austria on 16.10.1955) Size of Pitch: 105m x 68m HEAD COACH – András HERCZEG Date of Birth: 11.07.1956 in Gyöngyös Nationality: Hungarian Player: DSI (1970-74) Debreceni VSC (1974-79) Honvéd Szabó Lajos SE (1979-81) Hajdúböszörmény (1981) Hajdúszoboszló (1981-84) Karcag (1984-86) Hajdúszoboszló (1986-88) Coach: DSI (1988-95) Debreceni VSC (Assistant Coach 1994-97 / Head Coach 1997-98) Hungarian Olympic Team (1998-99) Tiszaújváros (2000-01) Debreceni VSC (Assistant Coach 2004-2007 / Head Coach since January 2008) Hungarian Championship Winner 2005, 2006, 2007, 2009 Hungarian Cup Winner 2008 Hungarian Super Cup -

FC Girondins De Bordeaux Stade De Gerland, Lyon Tuesday 30 March 2010 - 20.45CET (20.45 Local Time) Matchday 9 - Quarter-Finals, First Leg
UEFA CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2009/10 MATCH PRESS KIT Olympique Lyonnais FC Girondins de Bordeaux Stade de Gerland, Lyon Tuesday 30 March 2010 - 20.45CET (20.45 local time) Matchday 9 - Quarter-finals, first leg Contents Match background.........................................................................................2 Match facts....................................................................................................3 Squad list.......................................................................................................6 Head coach....................................................................................................8 Match officials................................................................................................9 Fixtures and results......................................................................................10 Match-by-match lineups...............................................................................14 Competition facts..........................................................................................17 Team facts....................................................................................................18 Legend.........................................................................................................21 This press kit includes information relating to this UEFA Champions League match. For more detailed factual information, and in-depth competition statistics, please refer to the matchweek press kit, which can be downloaded at: http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/presskits/index.html -
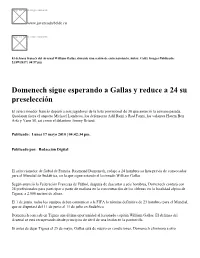
Domenech Sigue Esperando a Gallas Y Reduce a 24 Su Preselección
Image not found or type unknown www.juventudrebelde.cu Image not found or type unknown El defensa francés del Arsenal William Gallas, durante una sesión de entrenamiento.Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 04:57 pm Domenech sigue esperando a Gallas y reduce a 24 su preselección El seleccionador francés depuró a seis jugadores de la lista provisional de 30 que anunció la semana pasada. Quedaron fuera el arquero Mickael Landreau, los defensores Adil Rami y Rod Fanni, los volantes Hatem Ben Arfa y Yann M, así como el delantero Jimmy Briand Publicado: Lunes 17 mayo 2010 | 04:42:34 pm. Publicado por: Redacción Digital El seleccionador de fútbol de Francia, Raymond Domenech, redujo a 24 hombres su lista previa de convocados para el Mundial de Sudáfrica, en la que sigue estando el lesionado William Gallas. Según anunció la Federación Francesa de Fútbol, después de descartar a seis hombres, Domenech contará con 24 profesionales para participar a partir de mañana en la concentración de los «bleus» en la localidad alpina de Tignes, a 2.000 metros de altura. El 1 de junio, todos los equipos deben comunicar a la FIFA la nómina definitiva de 23 hombres para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio en Sudáfrica. Domenech concede en Tignes una última oportunidad al lesionado capitán William Gallas. El defensa del Arsenal se está recuperando desde principios de abril de una lesión en la pantorrilla. Si antes de dejar Tignes el 25 de mayo, Gallas está de nuevo en condiciones, Domenech eliminará a otro hombre. -

2009/10 UEFA Champions League Technical Report
TECHNICAL REPORT 2009/10 ENGLISH SECTION PARTIE FRANÇAISE DEUTSCHER TEIL STATISTICS THOMAS / POPPERFOTO / GETTY IMAGES TECHNICAL REPORT This report has been published as a permanent record of the 2009/10 UEFA Champions League, which was the competition’s 18th season. In addition to the factual and statistical data that make it a reference work, it contains analysis, reflections and debating points which, it is hoped, will give technicians food for thought and, by highlighting tendencies and trends at the peak of professional football, also offer coaches who are active in the development levels of the game information that may be helpful in terms of working on the qualities which will be needed by the UEFA Champions League performers of the future. A full house at the Estadio Santiago Bernabéu in Madrid watches the opening ceremony raise the curtain on the UEFA Champions League’s first-ever Saturday final. REWIND AND FAST FORWARD Rewinding images of 125 games is a valid antidote to the tendency to read the 2009/10 season as a story of Milan, Munich and Madrid. It is easy to forget that FC Internazionale Milano won once in their first five games and that FC Bayern München took four points from the opening four fixtures. Both finalists qualified in extremis from a group phase in which three former UEFA Champions League winners were eliminated. Among the eight group winners, only three were former champions of Europe. There was no shortage of cameos which underlined that, in the UEFA Champions League, lapses of concentration are usually punished. The 2006 finalists, Arsenal FC, opening their campaign against R. -

PDF Numbers and Names
CeLoMiManca Checklist Uefa Champions League 2009 - 2010 1 UEFA Champions 17 Arjen Robben 37 David Trezeguet 57 Nir Davidovitch 77 Rio Ferdinand League Logo 18 Luca Toni 38 Amauri 58 Alon Harazi 78 Nemanja Vidic 2 Poster Final Madrid 19 Ivica Olic 39 Club Emblem 59 Jorge Teixeira 79 John O'Shea 2010 20 Miroslav Klose 40 Cedric Carrasso 60 Dekel Keinan 80 Paul Scholes 3 Official Ball 21 Mario Gomez 41 Matthieu Chalme 61 Shai Maymon 81 Ryan Giggs 4 UEFA Champions 22 Club Emblem 42 Henrique 62 Eyal Meshumar 82 Ji-Sung Park League Trophy 23 Gianluigi Buffon 43 Marc Planus 63 Tsepo Masilela 83 Darren Fletcher 5 Club Emblem 24 Fabio Cannavaro 44 Benoit Tremoulinas 64 Eyal Golasa 84 Michael Carrick 6 Jörg Butt 25 Giorgio Chiellini 45 Micha 65 Baram Kayal 85 Michael Owen 7 Martin Demichelis 26 Fabio Grosso 46 Franck Jurietti 66 Lior Refaelov 86 Nani 8 Philipp Lahm 27 Nicola Legrottaglie 47 Alou Diarra 67 John Culma Jairo 87 Luis Antonio 9 Daniel Van Buyten 28 Martin Caceres 48 Yoann Gourcuff 68 Yero Bello Valencia 10 Edson Braafheid 29 Claudio Marchisio 49 Jaroslav Plasil 69 Vladimer Dvalishvili 88 Dimitar Berbatov 11 Danijel Pranjic 30 Mohamed Sissoko 50 Fernando 70 Mohammad Ghadir 89 Wayne Rooney 12 Anatoliy Menegazzo 90 Club Emblem Tymoshchuk 31 Mauro Camoranesi 71 Yaniv Katan 51 Wendel 91 Igor Akinfeev 13 Mark Van Bommel 32 Felipe Melo 72 Shlomi Arbeitman 52 Marouane Chamakh 92 Georgi Schennikov 14 Bastian 33 Diego 73 Club Emblem Schweinsteiger 34 Sebastian Giovinco 53 Fernando Cavenaghi 74 Edwin Van Der Sar 93 Vasili Berezutski 15 Franck -

Des Gains Et Des Dépenses Qui Portent À Réflexion ...!!
Des gains et des dépenses qui portent à réflexion .... !! Joueurs de l'équipe de France : 1. Thierry Henry (Barcelone/ESP) 666 000€/mois 2. Franck Ribéry (Bayern Munich/ALL) 416 000€/mois 3. Lassana Diarra (Real Madrid/ESP), 416 000€/mois 4. Nicolas Anelka (Chelsea/ANG), 400 000€/mois 5. Eric Abidal (Barcelone/ESP), 400 000€/mois 6. Patrice Evra (Manchester United/ANG), 400 000€/mois 7. Yoann Gourcuff (Bordeaux), 367 000€/mois 8. William Gallas (Arsenal/ANG), 320 000€/mois 9. Florent Malouda (Chelsea/ANG) 292 000€/mois 10. Abou Diaby (Arsenal/ANG), 292 000€/mois 11. Gaël Clichy (Arsenal/ANG), 292 000€/mois 12. Sidney Govou (Lyon), 267 000€/mois 13. Jérémy Toulalan (Lyon), 258 000€/mois 14. André-Pierre Gignac (Toulouse), 242 000€/mois 15. Alou Diarra (Bordeaux), 233 300 €/mois 16. Bacary Sagne (Arsenal/Ang), 216 700€/mois 17. Hugo Lloris (Lyon), 208 300€/mois 18. Djibril Cissé (Panathinaïkos/GRE), 208 000€/mois 19. Anthony Reveillère (Lyon) 208 000€/mois 20. Steve Mandanda (Marseille), 192 000€/mois 21. Mathieu Valbuena (Marseille), 192 000€/mois 22. Sébastien Squillaci (Séville/ESP), 180 000€/mois 23. Cédric Carrasso (Bordeaux), 166 700€/mois 24. Marc Planus (Bordeaux), 85 000€/mois Sélectionneurs : Salaire Sélectionneur Pays entraîné mensuel brut 1. Fabio Capello Angleterre 733 333 € 2. Marcelo Lippi Italie 250 000 € 3. Joachim Loew Allemagne 208 333 € 4. Berter Van Marwijk Pays-Bas 150 000 € 5. Ottmar Hitzfeld Suisse 145 833 € 6. Vicente Del Bosque Espagne 125 000 € 7. Carlos Queiroz Portugal 112 500 € 8. Pim Verbeek Australie 100 000 € 9. Carlos Parreira Afrique du Sud 100 000 € 10. -

Ligue 1 2014/2015: Your Guide to the Season Ahead
Ligue 1 2014/2015: Your Guide to the Season Ahead Get French Football News A Note from the Editor: From Copacabana beach to the Stade Auguste Delaune: Ligue 1 kicks off again on the 8th of August when Reims host back-to-back champions Paris Saint Germain in the first encounter of the new season. The summer brought with it one of the most wholesome World Cups in recent history, where Ligue 1 stars both thrived and blossomed. Whether you were marveling at David Ospina or Guillermo Ochoa between the sticks, noting the potential of Serge Aurier or appreciating the sheer brilliance of James Rodriguez, it seemed that wherever one turned; the spirit of France’s top flight was being embodied by some of its most emblematic characters. While the majority of the aforementioned stars will undoubtedly move on this summer, Ligue 1 is not standing still. Zlatan Ibrahimovic is ready to lead PSG to Champions League glory, regardless of the supposed limitations that Financial Fair Play regulations have imposed on the Ligue 1 champions. The seasonal managerial merry-go-round has gone some way to reshuffling the pack and Willy Sagnol, Marcelo Bielsa, Hubert Fournier, Claude Makélélé, Leonardo Jardim and Jean Luc Vasseur have all been handed fresh starts at various outfits. A new campaign brings with it three new sides. Ligue 1 welcomes back an eclectic bunch of former stalwarts with open arms in Metz, Caen and Lens. The latter club had the last laugh during a summer that may well be remembered for the administrative headaches that the French football watchdog the DNCG were causing, initially refusing Antoine Kombouaré’s men entry into France’s top flight. -

2011-2012 Panini Adrenalyn XL French Foot League 1
www.soccercardindex.com 2011-2012 Panini Adrenalyn XL French Foot League 1 Ajaccio 75 MBaye Niang 148 John Mensah 223 François Clerc (I) 296 Antoine Devaux 1 Guillermo Ochoa 76 Kandia Traoré 149 Anthony Réveillère 224 Anthony Mounier(I) 297 Adrien Regattin 2 Anthony Lippini 77 Alexis Thébaux (S) 150 Maxime Gonalons 298 Paulo Machado 3 Carl Medjani 78 Romain Hamouma (SS) 151 Yoann Gourcuff Paris 299 Franck Tabanou 4 Mehdi Mostefa 79 Benjamin Nivet (I) 152 Kim Källström 225 Nicolas Douchez 300 Umut Bulut 5 Yohann Poulard 80 Pierre-Alain Frau (I) 153 Michel Bastos 226 Sylvain Armand 301 François Sirieix (S) 6 Fabrice Begeorgi 154 Jérémy Pied 227 Zoumana Camara 302 Moussa Sissoko (SS) 7 Johan Cavalli Dijon 155 Ishak Belfodil 228 Marcos Ceara 303 Daniel Braaten (I) 8 Christian Kinkela 81 Jean-Daniel Padovani 156 Jimmy Briand 229 Christophe Jallet 304 Paulo Machado (I) 9 Jean-Baptiste Pierazzi 82 Abdoulaye Bamba 157 Bafétimbi Gomis (S) 230 Diego Lugano 10 Leyti NDiaye 83 Steven Paulle 158 Cristiano Marques Cris (SS) 231 Mamadou Sakho Valenciennes 11 Paul Lasne 84 Samuel Souprayen 159 Yoann Gourcuff (I) 232 Mathieu Bodmer 305 Nicolas Penneteau 12 Araujo Ilan 85 Benjamin Corgnet 160 Kim Källström (I) 233 Clément Chantôme 306 Gaëtan Bong 13 Frédéric Sammaritano (S) 86 Lesly Malouda 234 Blaise Matuidi 307 David Ducourtioux 14 Richard Socrier (SS) 87 Daisuke Matsui Marseille 235 Jérémy Menez 308 Rudy Mater 15 Guillermo Ochoa (I) 88 Eric Bauthéac 161 Steve Mandanda 236 Kevin Gameiro 309 Christopher Mfuyi 16 Araujo Ilan (I) 89 Raphaël Caceres 162 -
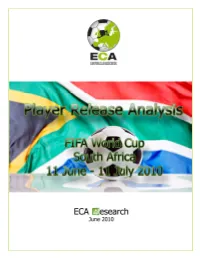
ECA Player Release Analysis 2010 World Cup.Pdf
Player release analysis FIFA World Cup 2010™ Table of Contents Foreword …………………………………………………………………………………………………… p.2 Highlights…………………………………………………………………………………………………… p.3 Introduction ……………………………………………………………………………………………… p.4 Confederation representation …………………………………….………………………… p.5 Most represented national championships ………………………………………… p.6 Club analysis……………………………………………………………………………………… p.9 European club analysis……………………………………………………………………… p.17 European club representation in all teams…………………………………………… p.19 European Club Association clubs represented……………………………………… p.21 Annexe I: Full list of National Team squads p.23 Annexe II: Provisional Players’ release table of the FIFA World Cup 2010™ p.30 Disclaimer This research is based on the FIFA Official Squad List published on the 1st of June 2010 and amended on the 11th of June. The European Club Association has endeavoured to keep the information up to date, but it makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, with respect to this information. The aim of this research is purely informative. 1 European Club Association – June 2010 Foreword The FIFA World Cup 2010™ is the most important international football competition in the world. It is organised by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and the first edition was held in 1930. The 19th edition is hosted in South Africa from the 11th of June to the 11th of July 2010. For the FIFA World Cup 2010™, all clubs have to release their players for the tournament according to the FIFA regulations: in accordance with Article 36 Paragraphs 2b) and 5c) of the Status and Transfer of Players, “if a player is called up, he must be released to play in the final competition organised by FIFA or a confederation and held in a period fixed/set in the calendar.