Toubib Or Not Toubib ?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AIBA Youth World Boxing Championships Yerevan 2012 Athletes Biographies
AIBA Youth World Boxing Championships Yerevan 2012 Athletes Biographies 49KG – HAYRIK NAZARYAN – ARMENIA (ARM) Date Of Birth : 30/08/1995 Club : Working Shift Sport Company Coach : Marat Karoyan Residence : Yerevan Number of bouts : 60 Began boxing : 2002 2012 – Klichko Brothers Youth Tournament (Berdichev, UKR) 6th place – 49KG Lost to Sultan Abduraimov (KAZ) 12:3 in the quarter-final; Won against Danilo Pleshkov (UKR) AB 2nd round in the first preliminary round 2012 – Armenian Youth National Championships 1st place – 49KG Won against Andranik Peleshyan (ARM) by points in the final; Won against Taron Petrosyan (ARM) by points in the semi-final 2012 – Pavlyukov Youth Memorial Tournament (Anapa, RUS) 7th place – 49KG Lost to Keith Flavin (IRL) 30:6 in the quarter-final 2011 – AIBA Junior World Championships (Astana, KAZ) 7th place – 46KG Lost to Georgian Tudor (ROM) 15:14 in the quarter-final; Won against Dmitriy Asanov (BLR) 22:14 in the first preliminary round 2011 – European Junior Championships (Keszthely, HUN) 5th place – 46KG Lost to Timur Pirdamov (RUS) 17:4 in the quarter-final; Won against Zsolt Csonka (HUN) RSC 2nd round in the first preliminary round 2011 – Armenian Junior National Championships 1st place – 46KG 49KG – ROBERT TRIGG – AUSTRALIA (AUS) Date Of Birth : 03/01/1994 Place Of Birth : Mount Gambier Height : 154cm Club : Mt. Gambier Boxing Club Coach : Colin Cassidy Region : South Australia Began boxing : 2010 2012 – Oceanian Youth Championships (Papeete, TAH) 1st place – 49KG Won against Martin Dexon (NRU) by points -

2015 Topps UFC Chronicles Checklist
BASE FIGHTER CARDS 1 Royce Gracie 2 Gracie vs Jimmerson 3 Dan Severn 4 Royce Gracie 5 Don Frye 6 Vitor Belfort 7 Dan Henderson 8 Matt Hughes 9 Andrei Arlovski 10 Jens Pulver 11 BJ Penn 12 Robbie Lawler 13 Rich Franklin 14 Nick Diaz 15 Georges St-Pierre 16 Patrick Côté 17 The Ultimate Fighter 1 18 Forrest Griffin 19 Forrest Griffin 20 Stephan Bonnar 21 Rich Franklin 22 Diego Sanchez 23 Hughes vs Trigg II 24 Nate Marquardt 25 Thiago Alves 26 Chael Sonnen 27 Keith Jardine 28 Rashad Evans 29 Rashad Evans 30 Joe Stevenson 31 Ludwig vs Goulet 32 Michael Bisping 33 Michael Bisping 34 Arianny Celeste 35 Anderson Silva 36 Martin Kampmann 37 Joe Lauzon 38 Clay Guida 39 Thales Leites 40 Mirko Cro Cop 41 Rampage Jackson 42 Frankie Edgar 43 Lyoto Machida 44 Roan Carneiro 45 St-Pierre vs Serra 46 Fabricio Werdum 47 Dennis Siver 48 Anthony Johnson 49 Cole Miller 50 Nate Diaz 51 Gray Maynard 52 Nate Diaz 53 Gray Maynard 54 Minotauro Nogueira 55 Rampage vs Henderson 56 Maurício Shogun Rua 57 Demian Maia 58 Bisping vs Evans 59 Ben Saunders 60 Soa Palelei 61 Tim Boetsch 62 Silva vs Henderson 63 Cain Velasquez 64 Shane Carwin 65 Matt Brown 66 CB Dollaway 67 Amir Sadollah 68 CB Dollaway 69 Dan Miller 70 Fitch vs Larson 71 Jim Miller 72 Baron vs Miller 73 Junior Dos Santos 74 Rafael dos Anjos 75 Ryan Bader 76 Tom Lawlor 77 Efrain Escudero 78 Ryan Bader 79 Mark Muñoz 80 Carlos Condit 81 Brian Stann 82 TJ Grant 83 Ross Pearson 84 Ross Pearson 85 Johny Hendricks 86 Todd Duffee 87 Jake Ellenberger 88 John Howard 89 Nik Lentz 90 Ben Rothwell 91 Alexander Gustafsson -
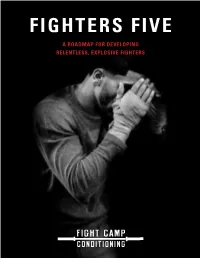
Fighters Five a Roadmap for Developing Relentless, Explosive Fighters Foundation of Developing Physical Fighters
FIGHTERS FIVE A ROADMAP FOR DEVELOPING RELENTLESS, EXPLOSIVE FIGHTERS FOUNDATION OF DEVELOPING PHYSICAL FIGHTERS POWER STRENGTH ENDURANCE HEALTH YOU’RE A COMBAT ATHLETE hether you’re a fighter or grappler, you chose to Wcompete in one of the toughest sports that exist. Champions in these sports are built over time, with consistency, hard work, planning, attention to detail, monitoring and adjusting along the way. There is no quick fix, shortcut, easy way to the top At the highest levels everybody is talented and tough. The difference between them and the thousands of others gunning for the Number One Spot? Winners take consistent, massive action towards improving themselves every week. Top athletes must organize their whole life around improving their mindset, skill, strength, conditioning, recovery, nutrition and more. And most importantly: winners have an absolute, crystal-clear vision of Who They Are and Where They Are Going. They are constantly analyzing and assessing throughout camp and then making adjustments to address their specific situation. SIMPLY GRINDING & WORKING HARD IS NOT ENOUGH TELL ME IF THIS SOUNDS LIKE YOU: • You consume so much information, you are confused about what to do. • You find yourself subscribing to old-school, outdated training methods. • Your workouts are more about building mental toughness (“building character”) than improving athleticism. • Whether you train alone or with a team of coaches, you lack a coordinated plan of action. • You try to mimic or train like your favorite athletes. • You don’t test or monitor any aspect of your training, your body, or your health. • You have bowed to the altar of high intensity training, no days off and are grinding yourself into a deep hole. -

42397 Ufc Houston
Texas Dept. of Licensing and Regulation GREG ALVAREZ, PROGRAM MANAGER Inspectors: G. ALVAREZ, J,DIX, G. CALDERON, J. ERICKSON Timekeepers: P.O BOX 12157, AUSTIN, TX 78711 V. MILLER, H, VILLAGOMEZ, H, VAN VERLAIN, A. MARTINEZ SAMMY CAROLINA (512) 475-2875 FAX (512) 463-1087 Referees: HURB DEAN 4476 3/21/16 ,JOE SOLIZ 4445 3/28/16 DUKE DUET Date: 10/03/15 Event #: 42397 KERRY HATLEY 4379 10/3/16, FRANCISCO COLLAZO 4456 3/11/16 Physician: City: HOUSTON Promoter: UFC Judges: DEREK CLEARY 4501 3/11/16 W, LEE, R. TAYLOR (W) Location: TOYOTA CENTER FOX SPORTS SAL DAMATO 4453 2/24/16, PATRICK PATLAN 4432 1-13-16 D, PARKUS, G. DIAZ 1510 POLK STREET PPV JOSH FERRARO 4461 4/28/16 CHRIS REED 4474 8/27/16 R. TEMPLE © Contestant's Name / Texas Suspension Bout # Residence (city/state) MMA ID License Weight Rou nds Results/Remarks Until ANGELA HILL APP IN NAMAJUNAS BY 1 BROOKLYN, NY 138-232 LICENSING 115 SUBMISSION 10/7/2015 ROSE ANAMJUNAS APP IN 3X5 2:47 FIRST SOLIS MAPLE GROVE, MN 131-303 LICENSING 115 10/7/2015 DERRICK LEWIS APP IN LEWIS BY TKO 1:59 THIRD 2 HOUSTON, TX 116-645 LICENSING 265 10/13/2015 VICTOR PESTA APP IN 3X5 HATLEY PRAGUE, CZ 138-837 FOLDER 237 11/3/2015 ALI BAGAUTINOV APP IN BENAVIDEZ BY DECISION 3 MOSCOW, RUSSIA 133-339 FOLDER 125 DAMATO 27-30 11/18/2015 JOE BENAVIDEZ 12/11/2015 3X5 SOLIS 27-30 SOLIS WEST SACRAMENTO, CA 103-058 36519 126 CLEARY 28-29 11/18/2015 SERGIO PETTIS 3/31/2016 PETTIS BY DECISION 4 MILWAUKEE, WI 125-684 36817 126 DAMATO 29-27 11/13/2015 CHIIS CARIASO 3/31/2016 3X5 PATLIN 29-27 SOLIS TUCSON, AZ 109-672 36821 126 CLEARY 29-28 11/18/2015 ISLAM MAKHACHOV APP IN MARTINS BY TKO 1:46 5 LAS VEGAS, NV 143-938 FOLDER 156 FIRST 11/30/2015 ADRIANO MARTINS APP IN 3X5 COLLAZO BRAZIL 131-340 LICENSING 156 10/7/2015 ALBERT TUMENOV APP IN TUMENOV BY TKO 2:55 6 FAIRFIELD, NJ 137-334 FOLDER 170 FIRST 10/13/2015 ALAN JOUBAN APP IN 3X5 COLLAZO STUDIO CITY, CA 119-891 LICENSING 170 11/3/2015 Texas Dept. -

031. Boys Pf Children
031. BOYS PF CHILDREN -25 Ring Pool DIAMOND WORLD CUP 2017, Anapa, RUS 1/1 1 BHALERAO ARNAV_ASHISH (WAKO India Kickboxing Federation,IND) 2 2 Abysov Artyom (Master / ДЮСШ №7,RUS) 7 3 Abysov Artyom (Master / ДЮСШ №7,RUS) Final 4 10 Abysov Artyom (Master / ДЮСШ №7,RUS) 5 5 6 Sofyanik Ivan (Academia Fight Style,RUS) 1 7 8 Abysov Artyom (Master / ДЮСШ №7,RUS) 9 1. Abysov Artyom (SAMARA) 10 2. Garbuzov Matvey (SAMARA) Prasol Elisey (Academia Fight Style,RUS) 3. Sofyanik Ivan (Fight Style) 1 3. Prasol Elisey (Fight Style) 11 5. BHALERAO ARNAV_ASHISH (WAKO INDIA - SANTOSH) 12 Garbuzov Matvey (Master / ДЮСШ №7,RUS) 4 13 14 Garbuzov Matvey (Master / ДЮСШ №7,RUS) 7 15 Referees: 16 (c)sportdata GmbH & Co KG 2000-2017(2017-09-24 21:02) v 9.6.1 build 1 License: SDIL Sabrina Weiss (expire 2017-12-31) 032. BOYS PF CHILDREN -28 Ring Pool DIAMOND WORLD CUP 2017, Anapa, RUS 1/1 1 2 3 Final 4 Abysov Artyom (Master / ДЮСШ №7,RUS) 6 5 6 7 8 Garbuzov Matvey (Master / ДЮСШ №7,RUS) 9 1. Garbuzov Matvey (SAMARA) 10 2. Abysov Artyom (SAMARA) 11 12 Garbuzov Matvey (Master / ДЮСШ №7,RUS) 7 13 14 15 Referees: 16 (c)sportdata GmbH & Co KG 2000-2017(2017-09-24 21:02) v 9.6.1 build 1 License: SDIL Sabrina Weiss (expire 2017-12-31) 033. BOYS PF CHILDREN -32 Ring Pool DIAMOND WORLD CUP 2017, Anapa, RUS 1/1 1 Atalyan Artem (DUSH №3,RUS) 2 0 Zalertsev Maxim (GoldenDragon,RUS) 11 3 Zalertsev Maxim (GoldenDragon,RUS) Final 4 10 Zalertsev Maxim (GoldenDragon,RUS) 10 5 Dzhandzhuliya Zurab (Boevie Perchatki,RUS) 6 -2 Sobolev Maxim (Sport Scool №2,RUS) 3 7 Sobolev Maxim (Sport Scool №2,RUS) 8 6 Zalertsev Maxim (GoldenDragon,RUS) 9 Suchkov Vladislav (Federation of kickboxing and martial-arts,RUS) 1. -

Fox Sports Highlights – 3 Things You Need to Know
FOR IMMEDIATE RELEASE Wednesday, Sept. 24, 2014 FOX SPORTS HIGHLIGHTS – 3 THINGS YOU NEED TO KNOW NFL on FOX: AMERICA’S GAME OF THE WEEK Returns with Eagles at 49ers COLLEGE FOOTBALL: Battle of Ranked Teams on FOX Sports 1 as No. 11 UCLA Takes on No. 15 Arizona State in Pac-12 South Battle UFC: THE ULTIMATE FIGHTER Features No. 4 Penne and No. 3 Ellis Vying for Quarterfinal Spot Tonight on FOX Sports 1 #ICYMI: Grand Jury Decides Three-Time NASCAR Champion Tony Stewart Will Not Face Charges in On-Track Death of Fellow Racer Kevin Ward Jr. http://foxs.pt/1uHlgrF ************************************************************************************************************* STUDIO FOX SPORTS LIVE – MLB RACES DRAW TO EXCITING FINISH, COVERAGE OF JETER’S FINAL SERES, THURSDAY NIGHT COLLEGE FOOTBALL POSTGAME, RYDER CUP UPDATES, DAILY NFL REPORTS Network/When: FOX Sports 1 & FOX Sports GO, nightly (11:00 PM ET) Talent: Jay Onrait, Dan O’Toole, Charissa Thompson, Cole Wright, Ryan Field, Jay Glazer, Gabe Kapler, Joel Klatt, Matt Leinart, Donovan McNabb, Randy Moss, Petros Papadakis, Brady Quinn, Bill Reiter, Ephraim Salaam, Peter Schrager, Clay Travis. This Week: With both the college and pro football season in full swing, FOX SPORTS LIVE has all the action covered with nightly news and analysis from a host of contributors. This week’s college football schedule is highlighted by Thursday night’s Pac-12 showdown between No. 11 UCLA and No. 15 Arizona State on FOX Sports 1, and analyst Joel Klatt, on-site to call the matchup, delivers a live post-game hit from Sun Devil Stadium. With the MLB regular season reaching its hotly contested finish, nightly highlights and analysis continue with analyst Gabe Kapler in studio breaking down all the significant action and previewing the Wild Card play-in games and potential Division Series matchups. -

Prensa AEPSAD 03 Abr 2019
Los mejores maratones del mundo ponen el foco en la lucha antidopaje. ECO DIARIO Magomedov, primer peleador de UFC vetado por la USADA. AS Abbott World Marathon Majors reveal new anti-doping initiative. RUNNERS WORLD WADA full of praise as independent expert completes work in Moscow after helping with RUSADA reinstatement process. INSIDE THE GAMES ECO DIARIO 02/04/2019 Los mejores maratones del mundo ponen el foco en la lucha antidopaje Seis de los más importantes maratones del mundo anunciaron este martes una nueva financiación del programa antidopaje, dirigido por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), órgano independiente creado en 2017 por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para investigar los casos de dopaje. Los 'Majors', asociación que agrupa a seis de los grandes maratones mundiales (Tokio, Boston, Chicago, Nueva York, Berlín y Londres), anunciaron en un comunicado la financiación de un programa antidopaje "revolucionario" por parte de la AIU, con una "política de controles basada en las investigaciones y la información". La AIU se ocupa desde 2017 de los tests e investigaciones en la lucha contra el dopaje, así como de la corrupción y el fraude en el atletismo mundial. La participación de los 'Majors', cuyo montante exacto no ha sido desvelado, permitirá la contratación de al menos una persona suplementaria y el aumento de los medios de investigación dirigidos hacia los mejores maratonianos del mundo. "La inversión permite investigar mejor a los maratonianos, con el fin de identificar los corredores en riesgo, establecer un plan de control antidopaje sobre el buen atleta en el buen momento, más que un programa de controles más general", detalló a los medios el director de la AIU Brett Clothier. -

2017: Fight Card and Results: Events 386 to 424
2017: Fight Card and Results: Events 386 to 424 Event 424 UFC 219: Cyborg vs. Holm December 30, 2017 Las Vegas, Nevada Weight Winner Loser Method Round Time Women's Featherweight Championship Women's Feather Cris Cyborg © Holly Holm Decision (unanimous) (49‐46, 48‐47, 48‐47) 5 5:00 Lightweight Khabib Nurmagomedov Edson Barboza Decision (unanimous) (30‐25, 30‐25, 30‐24) 3 5:00 Lightweight Dan Hooker Marc Diakiese Submission (guillotine choke) 3 0:42 Women's Straw Carla Esparza Cynthia Calvillo Decision (unanimous) (29‐28, 29‐28, 29‐28) 3 5:00 Welterweight Neil Magny Carlos Condit Decision (unanimous) (30‐27, 30‐27, 29‐28) 3 5:00 Light Heavyweight Michał Oleksiejczuk Khalil Rountree Jr. Decision (unanimous) (30‐27, 30‐27, 30‐27) 3 5:00 Featherweight Myles Jury Rick Glenn Decision (unanimous) (30‐27, 30‐27, 30‐27) 3 5:00 Middleweight Marvin Vettori Omari Akhmedov Draw (majority) (28‐28, 29‐28, 28‐28) 3 5:00 Flyweight Matheus Nicolau Louis Smolka Decision (unanimous) (30‐26, 30‐26, 30‐25) 3 5:00 Bantamweight Tim Elliott Mark De La Rosa Submission (anaconda choke) 2 1:41 For the UFC Women's Featherweight Championship. Event 423 UFC on Fox 26: Lawler vs. dos Anjos December 16, 2017 Winnipeg, Manitoba, Canada Weight Winner Loser Method Round Time Welterweight title eliminator Welterweight Rafael dos Anjos Robbie Lawler Decision (unanimous) (50‐45, 50‐45, 50‐45) 5 5:00 Catchweight 148.5 lb Josh Emmett Ricardo Lamas KO (punch) 1 4:33 Welterweight Santiago Ponzinibbio Mike Perry Decision (unanimous) (29‐28, 29‐28, 29‐28) 3 5:00 Light Heavyweight -

2016 Topps UFC Knockout BASE FIGHTER CARDS 1 Holly Holm 2
2016 Topps UFC Knockout BASE FIGHTER CARDS 1 Holly Holm 2 Patrick Cummins 3 Ryan Bader 4 José Aldo 5 Chris Weidman 6 Clay Guida 7 Ricardo Lamas 8 Frankie Edgar 9 Henry Cejudo 10 Derek Brunson 11 Rafael dos Anjos 12 Uriah Hall 13 Alexander Gustafsson 14 Raphael Assunção 15 Beneil Dariush 16 Stipe Miocic 17 Michael Johnson 18 Cain Velasquez 19 Joseph Benavidez 20 Eddie Alvarez 21 Edson Barboza 22 Renan Barão 23 Luke Rockhold 24 Tyron Woodley 25 Dustin Poirier 26 Travis Browne 27 Fabricio Werdum 28 Max Holloway 29 Rashad Evans 30 Donald Cerrone 31 Thomas Almeida 32 Thiago Alves 33 Anthony Pettis 34 Demian Maia 35 Benson Henderson 36 Ilir Latifi 37 Quinton Jackson 38 Al Iaquinta 39 Matt Brown 40 Carlos Condit 41 Tony Ferguson 42 Maurício Shogun Rua 43 Conor McGregor 44 Rory MacDonald 45 Nate Diaz 46 Jon Jones 47 Michael Bisping 48 TJ Dillashaw 49 Lyoto Machida 50 Mirko Cro Cop 51 Chad Mendes 52 Frank Mir 53 Demetrious Johnson 54 Jared Rosholt 55 Antonio Silva 56 Kyoji Horiguchi 57 Joanna J?drzejczyk 58 Jim Miller 59 Cláudia Gadelha 60 Junior Dos Santos 61 Carla Esparza 62 Zach Makovsky 63 Rose Namajunas 64 Stephen Thompson 65 Jessica Penne 66 Conor McGregor 67 Tecia Torres 68 Robbie Lawler 69 Paige VanZant 70 Ovince Saint Preux 71 Randa Markos 72 Olivier Aubin-Mercier 73 Joanne Calderwood 74 Ben Rothwell 75 Michelle Waterson 76 Elias Theodorou 77 Juliana Lima 78 Aljamain Sterling 79 Felice Herrig 80 Tom Lawlor 81 Miesha Tate 82 Urijah Faber 83 Cat Zingano 84 Daniel Cormier 85 Julianna Peña 86 Sage Northcutt 87 Ruslan Magomedov 88 Glover Teixeira -

The Origins of Legal Consciousness SA PERE AUD E
SAPERE AUDE The Origins of Legal Consciousness Segovia, 22–26 May, 2017 Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe venue El Rancho de la Aldegüela Torrecaballeros (Segovia) in collaboration with The Valsaín Foundation (Fundación Valsaín) with support from The Council of Europe Foreign and Commonwealth Office, UK The Mott Foundation Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) We don’t receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us. Marcel Proust 2 / 3 Monday, 22 May MORAL, LEGAL, AND POLITICAL ASPECTS OF FREEDOM 10.00–10.30 Opening ceremony: 17.30–18.00 Plenary: Lena Nemirovskaya Anastasia Gontareva FOUNDER, MOSCOW SCHOOL OF CIVIC EDUCATION Alexander Shmelev Alvaro Gil-Robles Stepan Skorikov COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE (1999–2006), PRESIDENT, THE VALSAÍN FOUNDATION 18.00–20.00 Round table: Civilisation and Culture Javier Lopez Escobar REGIONAL DELEGATE, REGIONAL COMMUNITY OF CASTILLA Y LEÓN Alexander Shmelev 10.30–12.00 Session: 20.30 Dinner Can we get democracy without values? Alvaro Gil-Robles 12.00–12.30 Coffee break 12.30–14.00 Session: Two things are important in life – purpose and meaning; however, Rights, Freedoms and Values in the Digital citizenship and public welfare simply provide the necessary conditions and Globalised World for them. If one thinks about this properly, a modern civic society isn’t Tomás de la Quadra-Salcedo the worst place we can live our lives in, as long as the will to improve our way of life has not been extinguished. -

The Ukrainian Weekly, 2021
THE UKRAINIAN WEEKLY Published by the Ukrainian National Association Inc., a fraternal non-profit association Vol. LXXXIX No. 18 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, MAY 2, 2021 $2.00 Blasts at arms depots in Bulgaria, Czech Republic Russia military threat remains as Zelenskyy part of Russian plot to thwart Ukraine says Ukraine ‘must always be ready’ Office of the President of Ukraine Armed Forces of Ukraine Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits the southern Kherson region near A U.S. military (left) and Ukrainian officer greet each other at Kyiv’s Boryspil the administrative border of occupied Crimea on April 27. Airport on April 28 upon the delivery of $7.85 billion worth of U.S. security assis- tance to Ukraine. She said the “purpose of the actions of by Mark Raczkiewycz by Mark Raczkiewycz While visiting Ukrainian military fortifi- the Russian citizens was to cut off the sup- cations near Crimea on April 27, Mr. KYIV – A secretive Russian military intel- ply of special products to Georgia and KYIV – After Russia announced that Zelenskyy said the country remains on ligence unit has been implicated in a series Ukraine.” more than 100,000 soldiers were ordered alert because Russia’s troops could return of explosions at munitions depots in Three Russian suspects who are “most back to their permanent bases on April 23 “at any moment.” Bulgaria and the Czech Republic as part of likely” agents of the Russian military intelli- following military drills near Ukraine’s “The fact the troops are withdrawing a long-term clandestine operation to crip- gence directorate (GRU) are also sought state borders and in occupied Crimea, doesn’t mean the army should not be ready ple the supply of weapons for Ukraine’s over two poisoning attempts of Bulgarian Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy for the possibility that troops could return war effort. -

Invicta Champions Division Champion Loser Event Date
Invicta Champions Division Champion Loser Event Date Featherweight 136 to 145 lbs Cristiane Justino © Def Daria Ibragimova Invicta FC 15 January 16, 2016 Featherweight 136 to 145 lbs Cristiane Justino © Def Faith Van Duin Invicta FC 13 July 9, 2015 Featherweight 136 to 145 lbs Cristiane Justino © Def Charmaine Tweet Invicta FC 11 February 27, 2015 Featherweight 136 to 145 lbs Cristiane Justino © New Marloes Coenen Invicta FC 6 July 13, 2013 Bantamweight 126 to 135 lbs Tonya Evinger © New Irene Aldana Invicta FC 13 July 9, 2015 Bantamweight 126 to 135 lbs Lauren Murphy Vacant Vacant July 3, 2014 Bantamweight 126 to 135 lbs Lauren Murphy © New Miriam Nakamoto Invicta FC 7 December 7, 2013 Flyweight 116 to 125 lbs Jennifer Maia © Interm Vanessa Porto Invicta FC 16 March 11, 2016 Flyweight 116 to 125 lbs Barb Honchak © Def Takayo Hashi Invicta FC 9 November 1, 2014 Flyweight 116 to 125 lbs Barb Honchak © Def Leslie Smith Invicta FC 7 December 7, 2013 Flyweight 116 to 125 lbs Barb Honchak © New Vanessa Porto Invicta FC 5 April 5, 2013 Strawweight 106 to 115 lbs Livia Renata Souza © Def DeAnna Bennett Invicta FC 15 January 16, 2016 Strawweight 106 to 115 lbs Livia Renata Souza © New Katja Kankaanpää © Invicta FC 12 April 24, 2015 Strawweight 106 to 115 lbs Katja Kankaanpää © New Stephanie Eggink Invicta FC 8 September 6, 2014 Strawweight 106 to 115 lbs Carla Esparza Vacant Vacant December 11, 2013 Strawweight 106 to 115 lbs Carla Esparza © New Bec Hyatt Invicta FC 4 January 5, 2013 Atomweight 96 to 105 lbs Ayaka Hamasaki © Def Amber Brown Invicta FC 16 March 11, 2016 Atomweight 96 to 105 lbs Ayaka Hamasaki © New Herica Tiburcio © Invicta FC 13 July 9, 2015 Atomweight 96 to 105 lbs Herica Tiburcio © New Michelle Waterson © Invicta FC 10 December 5, 2014 Atomweight 96 to 105 lbs Michelle Waterson © Def Yasuko Tamada Invicta FC 8 September 6, 2016 Atomweight 96 to 105 lbs Michelle Waterson © New Jessica Penne © Invicta FC 5 April 5, 2013 Atomweight 96 to 105 lbs Jessica Penne © New Naho Sugiyama Invicta FC 3 October 6, 2012 Event Title Event Date Evinger vs.