Hugo Cabret, La Tentation Du Mythe Christel Taillibert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Honors Education Through Popular Culture and Critical Pedagogy
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Honors in Practice -- Online Archive National Collegiate Honors Council 2021 “Movies, TV Shows, and Memes . Oh My!”: An Honors Education through Popular Culture and Critical Pedagogy Evan W. Faidley Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/nchchip Part of the Curriculum and Instruction Commons, Educational Administration and Supervision Commons, Gifted Education Commons, Higher Education Commons, and the Liberal Studies Commons This Article is brought to you for free and open access by the National Collegiate Honors Council at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Honors in Practice -- Online Archive by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. “Movies, TV Shows, and Memes . Oh My!”: An Honors Education through Popular Culture and Critical Pedagogy Evan W . Faidley University of Akron Abstract: Entertainment media and popular culture often overdramatize the col- lege experience . An honors colloquium engages students in scholarly research and discourse involving thematic elements of academic life in popular culture . An interdisciplinary approach to race, class, the professoriate, Greek life, and foreign experience is espoused . Through a lens of critical social theory, students deconstruct misinformed “stories most often told” to reconstruct more cogent understandings of college life and student experience . With a curriculum designed to advance social justice through equitizing education and amending cultural perceptions, this collo- quium helps develop self-motivated, self-regulated, and engaged learners . Keywords: media literacy; college life films; critical social theory (CST); interdisci- plinarity; University of Akron (OH)—Williams Honors College Citation: Honors in Practice, 2021, Vol . -
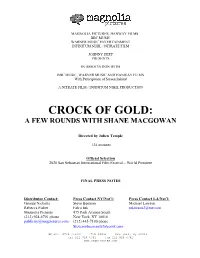
Crock of Gold: a Few Rounds with Shane Macgowan
MAGNOLIA PICTURES, HANWAY FILMS BBC MUSIC WARNER MUSIC ENTERTAINMENT INFINITUM NIHIL / NITRATE FILM JOHNNY DEPP PRESENTS IN ASSOCIATION WITH BBC MUSIC, WARNER MUSIC AND HANWAY FILMS With Participation of Screen Ireland A NITRATE FILM / INFINITUM NIHIL PRODUCTION CROCK OF GOLD: A FEW ROUNDS WITH SHANE MACGOWAN Directed by Julien Temple 124 minutes Official Selection 2020 San Sebastian International Film Festival – World Premiere FINAL PRESS NOTES Distributor Contact: Press Contact NY/Nat’l: Press Contact LA/Nat’l: George Nicholis Steve Beeman Michael Lawson Rebecca Fisher Falco Ink [email protected] Magnolia Pictures 475 Park Avenue South (212) 924-6701 phone New York, NY 10016 [email protected] (212) 445-7100 phone [email protected] 49 west 27th street 7th floor new york, ny 10001 tel 212 924 6701 fax 212 924 6742 www.magpictures.com Foreword If future generations look back at what it was truly like to be both human and alive in the late 20th century, they will be hard put to find a more powerful and enlightening testament than the songs of Shane McGowan. In a world where music has become increasingly sanitized and unable to venture beneath the surface clichés of human emotion, Shane’s songs stand out in ever greater relief. None has bared their soul like Shane McGowan. His unique ability to plumb the dark recesses of the human soul, while in the very same breath celebrating its capacity to find healing transcendence, in both love and the sublime mysteries of existence, goes a long way to making sense of who we actually are. -

HUGO CABRET Editore S.A.S
RASSEGNA STAMPA CINEMATOGRAFICA HUGO CABRET Editore S.A.S. Via Goisis, 96/b - 24124 BERGAMO HUGO Tel. 035/320.828 - Fax 035/320.843 - Email: [email protected] 1 Regia: Martin Scorsese Interpreti: Asa Butterfield (Hugo Cabret), Ben Kingsley (Papa Georges/Georges Méliès), Sacha Baron Cohen (Capostazione), Chloe Moretz (Isabelle), Ray Winstone (Zio Claude), Emily Mortimer (Lisette), Jude Law (Padre di Hugo), Johnny Depp (Sig. Rouleau), Michael Pitt (Proiezio- nista), Christopher Lee (Sig. Labisse), Michael Stuhlbarg (Rene Tabard), Helen McCrory (Mamma Jeanne) Genere: Avventura/Fantasy - Origine: Stati Uniti d'America - Anno: 2011 - Soggetto: tratto dal libro per ragazzi 'La straordinaria invenzione di Hugo Cabret' di Brian Selznick (ed. Mondadori) - Sceneggiatura: John Logan - Fotografia: Robert Richardson - Musica: Howard Shore - Mon- taggio: Thelma Schoonmaker - Durata: 125' - Produzione: Graham King, Tim Headington, Martin Scorsese, Johnny Depp per Gkfilms/Infinitum Nihil - Distribuzione: RAI Cinema/01 Distribution (2012) Dal primo lungometraggio di Scorsese è scoperta di vita e di sentimenti, di vola per grandi rimasti bambini o me- (datato 1968) ad oggi sono passati 44 gioie e di dolori, antidoto unico contro glio, per grandi che sappiano ancora anni e una serie di titoli che, a citarne l'appiattimento e l'inerzia del pensiero. stupirsi come sanno fare solo i bambini. solo alcuni, segnano momenti irrinun- Così da un lato c'è l'anziano Mèliès e E quale magia, ancora oggi, può destare ciabili di un immaginario filmico sem- dall'altro il piccolo Hugo, adolescente tanta meraviglia se non quella del ci- pre plastico, vigoroso, incisivo (da desideroso di catturare la magia del nema? Perché il film di Scorsese è an- "Taxi driver" a "Toro scatenato", da movimento, dei colori, dell'avventura che un viaggio, un viaggio nel cinema "L'età dell'innocenza" al recente "Shut- senza freni: l'esperienza degli anni con delle origini quando la settima arte era ter Island"). -

What Are These Industry Professionals Looking For?
What are these Industry Professionals Looking For? Are you asking yourself . WHO ARE THESE PEOPLE? WHAT ARE THEY LOOKING FOR? HOW CAN THEY BENEFIT ME? Of course you need to do your research on these people and the companies they work for, but here is some information to have at your fingertips. You can find out more info about these pros by utilizing Google, Deadline, IMDB, etc. Roberto Alcantara (BA ‘04), VP of Content at Project 10 Project 10 is looking for comedy TV series. Roberto can offer professional advice to those looking for a career in content development, above the line producing, aspiring writers. Search Project 10 on Deadline. Dominique Anders (BA ’03), Co-EP at Defy Media and Business Coach for Creatives Dominique can advise and help people in the genres of reality/unscripted TV, docs and branded/digital content. Her general clients are about midway through their careers. She works a lot with people who have found success and are looking to take it to the next level but creating their own projects but are a little stuck at getting there. Orion Barnes (BA ’97), Talent Agent, Rogers Orion Talent Agency Looking for actors. 2016 CAAN Connect – Industry Professionals Greg Cortez (BA ’05) Music Publicity and Marketing Executive, 42West Greg is in the Entertainment Publicity business and works primarily with A-list recording artists including Wiz Khalifa, Miguel, Adam Lambert, Alanis Morissette, Sara Bareilles and Joe Jonas to name a few. Greg is best suited to meet with those who want to pursue careers in marketing/branding. -

British Academy Children's Awards 2012 Nominations
British Academy Children's Awards 2012 Nominations ANIMATION The Amazing Adrenalini Brothers! Production Team Pesky Productions/POP The Amazing World Of Gumball Ben Bocquelet, Mic Graves, Joanna Beresford Cartoon Network Europe in association with Dandelion Studios, Boulder Media & Studio Soi/Cartoon Network UK The Gruffalo’s Child Production Team Magic Light Pictures in association with Studio Soi/BBC One The Mechanical Musical Marvel Chris Randall, Julie Boden Second Home Studios/THSH Birmingham CHANNEL OF THE YEAR CBBC CBeebies CiTV Cyw COMEDY 4 O’Clock Club Spencer Campbell, Julie Edwards, Paul Rose CBBC/CBBC Diddy Movies Steve Ryde, Julian Kemp CBBC/CBBC Horrible Histories Production Team Lion TV/Citrus Television/CBBC Sorry I’ve Got No Head Jeremy Salsby, Iain Curtis, Graham Stuart SO Television/CBBC 1 DRAMA Lost Christmas Elliot Jenkins, John Hay, David Logan Impact Film & Television/CBBC Postcode Production Team The Foundation/CBBC Roy John Rice, Alan Shannon, Mark Cumberton JAM Media/CBBC Tracy Beaker Returns Gina Cronk, Neasa Hardiman, Elly Brewer CBBC/CBBC ENTERTAINMENT The Big Performance 2 Helen Soden, Nicola Lloyd, Gareth Malone Twenty Twenty TV/CBBC Friday Download Jeremy Salsby, Melony Smith, Fiona Walmsley Saltbeef Productions/CBBC Junior Bake Off Anna Beattie, Kieran Smith, Amanda Westwood Love Production/CBBC The Slammer Steve Ryde, Jeanette Goulbourn, Samantha Lockett CBBC/CBBC FACTUAL Deadly 60 Scott Alexander, Kirstine Davidson BBC Bristol for CBBC/CBBC My Life: Me, My Dad and His Kidney Rachael Smith, Cat Lewis, -

CHRISTOPHER LEPS Kick the Can (Spec Ad) Director, Stunt Coordinator Alex Madison, Producer
FEATURE Spaceman Stunt Coordinator Stephen Nemeth, Producer Dance Camp Stunt Coordinator Jon M. Chu, Producer Book of Swords Stunt Coordinator Wayne Kennedy, Producer Torque Fight Coordinator (uncredited) Neal H. Moritz, Producer The Waiters 2nd Unit Director Kipp Tribble, Producer Clutch Stunt Coordinator Robert Stio, Producer TELEVISION Greenleaf (1 ep.) Cover Coordinator Al Dickerson, Producer RocketJump: The Show (1 ep.) Stunt Coordinator Freddie Wong, Producer Complications (2 eps.) Cover Coordinator Craig Siebels, Producer Burger King Star Wars commercial Fight Coordinator John Landis, Director Angel (1 ep.) Asst. Sword Coordinator Skip Schoolnik, Producer Worst Case Scenarios (1 ep.) Stunt Co-Coordinator Craig Piligian, Producer Mortal Kombat Conquest (14 eps.) Asst. Fight Coordinator (uncredited) Larry Kasanoff, Producer Out of the Blue Stunt Coordinator Sam Riddle, Producer Chase (spec ad) Director, Stunt Coordinator Alex Madison, Producer CHRISTOPHER LEPS Kick the Can (spec ad) Director, Stunt Coordinator Alex Madison, Producer DIRECTOR STUNT COORDINATOR SHORT FILM STUNTMAN Director, Producer, Writer, Editor Muse (2014) www.imdb.me/christopherleps Wholehearted (2012) www.christopherleps.com Century of Light (2011), [email protected] Ed & Vern’s Rock Store (2008) Cop Sign (2005) 818 . 618 . 5661 Shadow (2004), Saber Duel (2003) Director, Producer, Editor Testing (2015) Amy and Elliot (2009) SPECIAL SKILLS AND ABILITIES Directing | Editing | Pre-Viz | Martial Arts & Weapons (30 years) | Fight Choreography | Driving Sword Work | Mo-Cap | Reactions | High Falls | Mini-Tramp | Wire Work | Air Rams & Ratchets BIO Over the past 27 years, I’ve had a unique adventure in the TV and film industry. My diverse career started at the Walt Disney Company in 1989, but my zeal for cinema was sparked by the movies seen in my youth. -

DAVE WARREN Production Designer
(10/21/20) DAVE WARREN Production Designer http://davewarrendesign.com/ FILM & TELEVISION DIRECTOR COMPANIES PRODUCERS “DON’T BREATHE AGAIN” Rodo Sayagues Sony Pictures Fede Alvarez Bad Hombre Sam Raimi Rob Tapert “DOWNHILL” Nat Faxon Fox Searchlight Pictures Stephanie Azpiazu Jim Rash Likely Story Anthony Bregman “OPHELIA” Claire McCarthy Covert Media Daniel Bobker Bobker/Kruger Films Sarah Curtis Forthcoming Films Paul Hanson Ehren Kruger “EMERALD CITY” Tarsem Singh NBC Matthew Arnold (Series) David Schulner “PRIDE AND PREJUDICE Burr Steers Cross Creek Pictures Marc Butan AND ZOMBIES” Allison Shearmur Prods. Sean McKittrick Sony Pictures Releasing Brian Oliver Allison Shearmur “THE ZERO THEOREM” Terry Gilliam Voltage Pictures Nicolas Chartier Mediapro Studios Dean Zanuck “THE IMAGINARIUM OF Terry Gilliam Davis Films Terry Gilliam DOCTOR PARNASSUS” Infinity Features William Vince (Co-Designer and Art Director) Nomination: Academy Award for Best Art Direction Nomination: BAFTA Award for Best Production Design Nomination: Satellite Award for Best Production Design “THE VICE” Various Carlton Television Stephen Smallwood (Series) Rob Pursey AS ART DIRECTOR: “SNOW WHITE AND THE Rupert Sanders Universal Pictures Joe Roth HUNTSMAN” Roth Films Palak Patel (Supervising Art Director) “HUGO” Martin Scorsese Paramount Pictures Martin Scorsese (Supervising Art Director) GK Films Johnny Depp Winner: Art Directors Guild Award Infinitum Nihil Graham King “YOUR HIGHNESS” David Gordon Green Universal Pictures Scott Stuber Stuber Productions “10,000 BC” -

Daniel Auteuil
JUILLET/AOÛT 2013 www.cotecine.fr N° 62 PAR LES CRÉATEURS DE PIRATES DES CARAÏBES JERRY BRUCKHEIMER FILMS PRESENTE UN FILM DE GORE VERBINSKI DISNEY ET JERRY BRUCKHEIMER FILMS PRESENTENT JOHNNY DEPP “LONE RANGER : NAISSANCE D’UN HEROS” (THE LONE RANGER) UNE PRODUCTION BLIND WINK/INFINITUM NIHIL UN FILM DE GORE VERBINSKI ARMIE HAMMER TOM WILKINSON WILLIAM FICHTNER BARRY PEPPER JAMES BADGE DALE MUSIQUE EFFETS SPECIAUX ET COSTUMES CONSULTANT MONTAGE PRESENTEUN FILM DE DIRECTEUR DE PRODUCTEURS ET HELENA BONHAM CARTER DE HANS ZIMMER ANIMATION DE INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC DE PENNY ROSE VISUEL CRASH JERRMCCREERY BRUCKHEIMERY DE CRAIG FIL WOODMS , A.C.E. ET JAMES HA GOREYGOOD VERBINSKI, A.C.E. LA PHOTOGRAPHIE BOJAN BAZELLI, ASC EXECUTIFS MIKE STENSON CHAD OMAN TED ELLIOTT TERRY ROSSIO JOHNNY DEPP ERIC MCLEOD PRODUIT ADAPTE SCENARIO REALISE ERIC ELLENBOGEN PAR JERRY BRUCKHEIMER GORE VERBINSKI A L’ECRAN PAR TED ELLIOTT TERRY ROSSIO ET JUSTIN HAYTHE DE JUSTIN HAYTHE ET TED ELLIOTT & TERRY ROSSIO PAR GORE VERBINSKI Distribué par THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE DISNEY ET JERRY BRUCKHEIMER FILMS PRESENTENT JOHNNY DEPP “LONE RANGER : NAISSANCE D’UN HEROS” (THE LONE RANGER) UNE PRODUCTION BLIND WINK/INFINITUM NIHIL UN FILM DE GORE VERBINSKI ARMIE HAMMER TOM WILKINSON WILLIAM FICHTNER BARRY PEPPER JAMES BADGE DALE MUSIQUE EFFETS SPECIAUX ET COSTUMES CONSULTANT MONTAGE DIRECTEUR DE PRODUCTEURS ET HELENA BONHAM CARTER DE HANS ZIMMER ANIMATION DE INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC DE PENNY ROSE VISUEL CRASH MCCREERY DE CRAIG WOOD, A.C.E. ET JAMES HAYGOOD, A.C.E. LA PHOTOGRAPHIE -

Readily Admits) That Was Provoked by a Growing Interest in the Female Sex
Martin Scorsese’s Divine Comedy Also available from Bloomsbury: The Bloomsbury Companion to Religion and Film, edited by William L. Blizek Dante’s Sacred Poem, Sheila J. Nayar The Sacred and the Cinema, Sheila J. Nayar Martin Scorsese’s Divine Comedy Movies and Religion Catherine O’Brien BLOOMSBURY ACADEMIC Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square, London, WC1B 3DP, UK 1385 Broadway, New York, NY 10018, USA BLOOMSBURY and the Diana logo are trademarks of Bloomsbury Publishing Plc First published in Great Britain 2018 Copyright © Catherine O'Brien, 2018 Catherine O'Brien has asserted her right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this work. For legal purposes the Acknowledgements on p. vi constitute an extension of this copyright page. Cover design by Catherine Wood Cover image © Appian Way / Paramount / Rex Shutterstock All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers. A catalogue record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: O’Brien, Catherine, 1962- author. Title: Martin Scorsese’s divine comedy: movies and religion / Catherine O’Brien. Description: London; New York, NY : Bloomsbury Academic, 2018. | Includes bibliographical references and index. | Includes filmography. Identifiers: LCCN 2017051481| -

Sherlock Gnomes”
Production Information PARAMOUNT PICTURES and METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES present A ROCKET PICTURES Production, “SHERLOCK GNOMES”. Executive produced by Sir Elton John. Produced by Steve Hamilton Shaw, David Furnish, and Carolyn Soper. Based on characters by Rob Sprackling & John Smith, Andy Riley & Kevin Cecil, Keely Asbury, and Steve Hamilton Shaw. Story by Andy Riley & Kevin Cecil and Emily Dee Cook & Kathy Greenburg. Screenplay by Ben Zazove. Directed by John Stevenson. The beloved garden gnomes from GNOMEO AND JULIET are back for a whole new adventure in London. When Gnomeo and Juliet first arrive in the city with their friends and family, their biggest concern is getting their new garden ready for spring. However, they soon discover that someone is kidnapping garden gnomes all over London. When Gnomeo and Juliet return home to find that everyone in their garden is missing – there’s only one gnome to call… SHERLOCK GNOMES. The famous detective and sworn protector of London’s garden gnomes arrives with his sidekick Watson to investigate the case. The mystery will lead our gnomes on a rollicking adventure where they will meet all new ornaments and explore an undiscovered side of the city. This action-packed sequel features the voices of returning cast, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith, Stephen Merchant and Ozzy Osbourne, plus Johnny Depp as Sherlock Gnomes, Chiwetel Ejiofor as Watson and Mary J. Blige as Irene. GNOMES AWAY FROM HOME Someone is stealing London’s yard ornaments, and there’s only one detective small enough for a mystery this big: Sherlock Gnomes. “From the beginning, it was integral to a sequel that we embrace a different classic story and ‘gnomify’ it,” says producer STEVE HAMILTON SHAW. -

I, JOHN CHRISTOPHER DEPP II, of Infinitum Nihil, 1472 N Sweetzer Avenue, LA 90069, USA, WILL SAY As Follows
On behalf of: Claimant Witness: John Christopher Depp II No: Second Exhibit: JD2 Date: 12 December 2019 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE Claim No. HQ18M01923 QUEEN'S BENCH DIVISION MEDIA AND COMMUNICATIONS LIST BETWEEN: JOHN CHRISTOPHER DEPP II Claimant -and- (1) NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD (2) DAN WOOTTON Defendants SECOND WITNESS STATEMENT OF JOHN CHRISTOPHER DEPP II I, JOHN CHRISTOPHER DEPP II, of Infinitum Nihil, 1472 N Sweetzer Avenue, LA 90069, USA, WILL SAY as follows: I. I am the Claimant in these proceedings. 2. Unless stated otherwise, the facts and matters referred to in this witness statement are within my own knowledge and true or are true to the best of my knowledge, information and belief based on sources stated within this witness statement. D22 On behalf of: Claimant Witness: John Christopher Depp II No: Second Date: 12 December 2019 3. There is now produced to me and marked "Exhibit JD2" a paginated bundle of true copy documents referred to in this witness statement. References to page numbers are references to Exhibit JD2, unless otherwise stated. 4. I make this witness statement in support of my claim in these proceedings. A. INTRODUCTION 5. These proceedings relate to an article published by the Defendants, which appeared online on 27 April 2018 and in hard copy on 28 April 2018 (together, the "Article"). As set out in the Particulars of Claim dated 13 June 2018, at paragraph 10, the Article included words which I contend meant and were understood to mean that I was guilty, on overwhelming evidence, of serious domestic violence against my former wife, Ms Amber Heard, causing significant injury and leading to her fearing for her life. -

WARNER BROS. PICTURES Präsentiert in Zusammenarbeit Mit VILLAGE ROADSHOW PICTURES Eine INFINITUM NIHIL/GK FILMS/ZANUCK COMPANY Produktion Ein TIM BURTON Film
WARNER BROS. PICTURES präsentiert in Zusammenarbeit mit VILLAGE ROADSHOW PICTURES eine INFINITUM NIHIL/GK FILMS/ZANUCK COMPANY Produktion ein TIM BURTON Film JOHNNY DEPP MICHELLE PFEIFFER HELENA BONHAM CARTER EVA GREEN JACKIE EARLE HALEY JONNY LEE MILLER CHLO Ë GRACE MORETZ BELLA HEATHCOTE Regie TIM BURTON Produzenten RICHARD D. ZANUCK, GRAHAM KING, JOHNNY DEPP, CHRISTI DEMBROWSKI, DAVID KENNEDY Drehbuch SETH GRAHAME-SMITH Story JOHN AUGUST und SETH GRAHAME-SMITH nach der TV-Serie von DAN CURTIS Executive Producers CHRIS LEBENZON, TIM HEADINGTON und BRUCE BERMAN Kamera BRUNO DELBONNEL, A.F.C., A.S.C. Schnitt CHRIS LEBENZON, A.C.E. Kostümdesign COLLEEN ATWOOD Co-Produzentin KATTERLI FRAUENFELDER Musik DANNY ELFMAN Deutscher Filmstart: 10. Mai 2012 im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany a division of Warner Bros. Entertainment GmbH www.DarkShadows.de 2 INHALT Tim Burton inszeniert diese Gruselkomödie nach der klassischen Kultserie „Dark Shadows“ – zur hochkarätigen Besetzung zählen Johnny Depp, Michelle Pfeiffer und Helena Bonham Carter. Im Jahr 1752 stechen Joshua und Naomi Collins mit ihrem kleinen Sohn Barnabas im englischen Liverpool in See, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Doch selbst auf den Weiten des Ozeans gelingt es ihnen nicht, dem geheimnisvollen Fluch der Familie zu entkommen. Zwei Jahrzehnte später: Barnabas (Johnny Depp) erobert die Welt – oder doch zumindest das Städtchen Collinsport/Maine. Als Herr von Collinwood Manor verfügt Barnabas über Reichtum und Macht … bis der unverbesserliche Frauenheld den gravierenden Fehler begeht, Angelique Bouchards (Eva Green) Herz zu brechen. Angelique ist eine Hexe im wahrsten Sinne des Wortes und beschert ihm ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod: Sie verwandelt ihn in einen Vampir, um ihn dann lebendig zu begraben.