Disney Ou L'avenir En Couleur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

August 2021 Stock Picks
August 2021 Stock Picks TOP 25 STOCKS August-21 UPDATED RANK TICKER NAME SECTOR INDUSTRY 1 ADBE Adobe Inc 57 - Technology 57201020 - Software 2 ASML ASML Holding NV (ADR) 57 - Technology 57101020 - Semiconductor Equipment & Testing 3 MSFT Microsoft Corporation 57 - Technology 57201020 - Software 4 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 57 - Technology 57101010 - Semiconductors 5 GOOGL Alphabet Inc 57 - Technology 57201030 - Online Services 6 NVDA NVIDIA Corporation 57 - Technology 57101010 - Semiconductors 7 AAPL Apple Inc 57 - Technology 57106020 - Phones & Handheld Devices 8 AMZN Amazon.com, Inc. 53 - Consumer Cyclicals 53402010 - Retailers - Department Stores 9 ISRG Intuitive Surgical, Inc. 56 - Healthcare 56101010 - Advanced Medical Equipment & Technology 10 COST Costco Wholesale Corporation 53 - Consumer Cyclicals 53402020 - Retailers - Discount Stores 11 V Visa Inc 57 - Technology 57201030 - Online Services 12 MA Mastercard Inc 57 - Technology 57201030 - Online Services 13 SBUX Starbucks Corporation 53 - Consumer Cyclicals 53301020 - Restaurants & Bars 14 BLDR Builders FirstSource, Inc. 53 - Consumer Cyclicals 53203020 - Construction Supplies & Fixtures 15 HD Home Depot Inc 53 - Consumer Cyclicals 53403020 - Retailers - Home Improvement Products & Services 16 GS Goldman Sachs Group Inc 55 - Financials 55102010 - Investment Banking & Brokerage Services 17 GM General Motors Company 53 - Consumer Cyclicals 53101010 - Auto & Truck Manufacturers 18 DIS Walt Disney Co 53 - Consumer Cyclicals 53302020 - Broadcasting 19 BAC Bank of America Corp -

Fiscal Year 2018 Annual Financial Report
6JAN201605190975 Fiscal Year 2018 Annual Financial Report 6DEC201801030965 WorldReginfo - 48c03cba-3b63-4c12-81df-68e282fbfa8a UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended September 29, 2018 Commission File Number 1-11605 Incorporated in Delaware 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 I.R.S. Employer Identification No. (818) 560-1000 95-4545390 Securities Registered Pursuant to Section 12(b) of the Act: Name of Each Exchange Title of Each Class on Which Registered Common Stock, $.01 par value New York Stock Exchange Securities Registered Pursuant to Section 12(g) of the Act: None. Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes No Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes No Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. Yes No Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate Web site, if any, every Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files). -

The Walt Disney Company Exclusion of Shareholder Proposal by Myra K
SANFORD J. LEWIS, ATTORNEY January 6, 2021 Via electronic mail Office of Chief Counsel Division of Corporation Finance U.S. Securities and Exchange Commission 100 F Street, N.E. Washington, D.C. 20549 Re: Shareholder Proposal to Disney Inc. Regarding Advertising Policies and Social Media on Behalf of Myra Young To Whom It Concern: Myra K. Young (the “Proponent”) is beneficial owner of common stock of Disney Inc. (the “Company”) and has submitted a shareholder proposal (the “Proposal”) to the Company. I have been asked by the Proponent to respond to the letter dated October 31, 2020 ("Company Letter") sent to the Securities and Exchange Commission by Lillian Brown of Wilmer Hale. In that letter, the Company contends that the Proposal may be excluded from the Company’s 2021 proxy statement. I have reviewed the Proposal, as well as the letter sent by the Company, and based upon the foregoing, as well as the relevant rules, it is my opinion that the Proposal must be included in the Company’s 2021 proxy materials and that it is not excludable under Rule 14a-8. A copy of this letter is being emailed concurrently to Lillian Brown of Wilmer Hale. Summary The Proposal requests that the Board of Directors commission an independent third-party report assessing how and whether Disney ensures the Company’s advertising policies are not contributing to violations of civil or human rights. Among other things, such report should consider whether advertising policies contribute to the spread of hate speech, disinformation, white supremacist recruitment efforts, or voter suppression efforts, and whether the policies undermine efforts to defend civil and human rights such as through the demonetization of content that seeks to advance and promote such rights. -

1 of 9 a I R L I N E S Delta/Free Messaging Delta Airlines
AIRLINES Delta/Free Messaging Delta Airlines announced that customers on its Wi-Fi enabled plans will be able to communicate via iMessage, WhatsApp and Facebook Messenger at no charge. Note: The offer allows text messaging use only and will not support the transfer of photo or video files. AUTOMOTIVE Ford/Lyft Ride-hailing service Lyft and Ford Motors struck a partnership to develop and test autonomous vehicle designs and technology, with the aim of putting Ford’s self-driving vehicles on Lyft’s ride-hailing network in the future. BROADCAST Raycom/CNH TV station group Raycom (65 TV and 2 radio stations covering 44 markets in 20 states) and Community Newspaper Holdings (110 newspapers, websites and niche publications in 22 states) announced merger plans. DATA comScore/Activation Data-ist comScore launched a tool called Activation to help advertisers use mobile, desktop and TV consumer behavior data to activate audience segments. The product can be accessed via 15 ad tech platforms including AppNexus, Salesforce and Adobe. Nielsen/Visual IQ Nielsen acquired Visual IQ, an entity that focuses on multi-touch attribution and performance measurement using audience segments providing insights on digital conversions, in-store sales and brand awareness across multiple devices and channels. DIGITAL Twitter/280 Twitter is expanding its character usage from 140 to 280 with a test group. ELECTRONICS Marketer Share The chart below delineates U.S. electronic sales leaders, by dollar value, according to TraQline, as reported by The Wall Street Journal: Sales Leader Market Share Sales Leader Market Share Best Buy 29.3% Apple 7.6% Wal-Mart 13.9% Others 38.2% Amazon 11.2% 1 of 9 ELECTRONICS(cont’d) Marketer Share The following chart lists U.S. -

Stars in Social Media: New Light Through Old Windows?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Gaenssle, Sophia; Budzinski, Oliver Working Paper Stars in social media: New light through old windows? Ilmenau Economics Discussion Papers, No. 123 Provided in Cooperation with: Ilmenau University of Technology, Institute of Economics Suggested Citation: Gaenssle, Sophia; Budzinski, Oliver (2019) : Stars in social media: New light through old windows?, Ilmenau Economics Discussion Papers, No. 123, Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre, Ilmenau This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/195424 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die -

Big Food, Big Tech, and the Global Childhood Obesity Pandemic
Big Food, Big Tech, and the Global Childhood Obesity Pandemic AUTHORS: Jeff Chester, MSW Kathryn C. Montgomery, PhD MAY 2021 Katharina Kopp, PhD Big Food, Big Tech, and the Global Childhood Obesity Pandemic | 2 Acknowledgments This report is part of a unique partnership of four organizations—Berkeley Media Studies Group, Color of Change, UnidosUS, and Center for Digital Democracy—working together to promote policies to ensure health equity for youth, communities of color, and other at-risk populations. The partnership is funded through a generous grant from the Robert Wood Johnson Foundation, which has also supported CDD’s ongoing research to investigate how contemporary digital marketing and Big Data practices impact young people’s health. We are very grateful to the Foundation’s commitment to these efforts. We also want to thank the following individuals and organizations who helped us with the writing and publication of the report: Jamie Bussel, Lori Dorfman, Gary O. Larson, and Burness Communications. Big Food, Big Tech, and the Global Childhood Obesity Pandemic INTRODUCTION | 3 INTRODUCTION devastating. For decades, there has been a steady and disturbing rise in The coronavirus pandemic triggered a dramatic obesity among children and youth. For example, obesity rates among increase in online use. With tens of millions of families teens ages 12 to 19 have quadrupled remaining in their homes, people turned to the internet since the 1980s. According to the most recent public health data, 19.3 to order food, stay up with the fast-breaking news, percent of all youth between the ages and engage with family and friends. -

UNITED STATES SECURITIES and EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended October 3, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________. Commission File Number 001-38842 Delaware 83-0940635 State or Other Jurisdiction of I.R.S. Employer Identification Incorporation or Organization 500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521 Address of Principal Executive Offices and Zip Code (818) 560-1000 Registrant’s Telephone Number, Including Area Code Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.01 par value DIS New York Stock Exchange Securities Registered Pursuant to Section 12(g) of the Act: None. Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes x No o Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes ☐ No x Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. -

Fiscal Year 2019 Annual Financial Report 13DEC201905470521 UNITED STATES SECURITIES and EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C
6JAN201605190975 Fiscal Year 2019 Annual Financial Report 13DEC201905470521 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 28, 2019 or TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________. Commission File Number 001-38842 Delaware 83-0940635 State or Other Jurisdiction of I.R.S. Employer Identification Incorporation or Organization 500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521 Address of Principal Executive Offices and Zip Code (818) 560-1000 Registrant’s Telephone Number, Including Area Code Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.01 par value DIS New York Stock Exchange Securities Registered Pursuant to Section 12(g) of the Act: None. Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes No Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes No Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. -

Mattel Toy Fair Analyst Meeting
Toy Fair Analyst Meeting Friday, February 16th, 2018 Toy Fair Analyst Meeting Friday, February 16th, 2018 Overview Margo Georgiadis CEO, Mattel, Inc. Welcome Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We are excited to be here with you today and to share the latest developments that demonstrate the power of Mattel's brands and the value creation opportunities that lie ahead. A global industry leader in toys in 150 countries Mattel is a global industry leader in toys, anchored by one of the broadest portfolios of iconic multigenerational brand franchises in the world. Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price have remained number one globally for many years in their categories. Our brands have enormous global appeal, reaching 150 countries. This is led by accessible core play patterns that consumers have loved for generations. Every minute around the world, we sell 100 Barbie dolls, 900 Hot Wheels die-cast cars and 150 Fisher-Price items. The velocity and global appeal of these brand franchises is unprecedented and continues to grow. No company is more passionate about kids and families than Mattel. During today's program, you are going to get a really clear picture of how we are delivering on that passion for consumers worldwide and inspiring the next generation to create a brighter tomorrow. Our strategy Returning to a high-performing toy company As I shared a few weeks ago on our earnings call, job one for Mattel is returning to a high- performing toy company. We are well on our way to achieving this. In addition, we are setting the stage to unlock even more value beyond our toy industry heritage. -
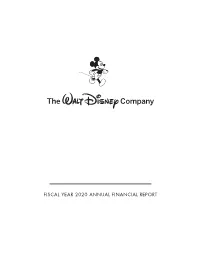
2020 Annual Report
FISCAL YEAR 2020 ANNUAL FINANCIAL REPORT UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended October 3, 2020 or TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________. Commission File Number 001-38842 Delaware 83-0940635 State or Other Jurisdiction of I.R.S. Employer Identification Incorporation or Organization 500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521 Address of Principal Executive Offices and Zip Code (818) 560-1000 Registrant’s Telephone Number, Including Area Code Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.01 par value DIS New York Stock Exchange Securities Registered Pursuant to Section 12(g) of the Act: None. Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes x No o Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes No x Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. -

Annu Al Guide 17/18
Television Asia Plus Annual Guide 2017/2018 Guide Annual Plus Asia Television ANNUAL GUIDE 17/18 MCI (P) 047/06/2017 PPS 1812/01/2013 (025534) ISSN0219-6166 MCI (P)047/06/2017PPS1812/01/2013 www.onscreenasia.com ONTENTS C TERRITORIES CHANNELS CONTENT PROVIDERS & OTT PLATFORMS Australia 2 BBC Worldwide Asia 40 China 5 CNBC Asia Pacifi c 42 AJA Video Systems 60 Hong Kong 9 The Walt Disney Company 43 Caracol Televisión 63 India & Subcontinent 10 Euronews 44 Deutsche Welle 64 Indochina & Myanmar 14 GMA Worldwide Inc. 45 Keshet International 66 Indonesia 16 NBCUniversal International Networks 46 Telemundo 67 Japan 18 PCCW Media Limited 47 Standard Listings 68 Macau 20 Scripps Networks Interactive 48 Malaysia 21 Sony Pictures Television Networks, Asia 50 SATELLITES & SERVICES New Zealand 24 Turner International Asia Pacifi c 52 ABS 87 Philippines 25 VR Educate 53 STN 88 Singapore 26 Viacom International Media Networks 54 Standard Listings 88 • MediaCorp 29 Standard Listings 56 • StarHub 29 TECHNOLOGY South Korea 30 Standard Listings 91 Taiwan 34 Thailand 37 PUBLISHER MARKETING EXECUTIVE Ficus Zheng FINANCE Annie Tan fi [email protected] | (65) 6521 9775 FINANCE MANAGER Kenny Yeoh [email protected] | (65) 6521 9781 MARKETING EXECUTIVE Kenneth Peh [email protected] | (65) 6521 9740 [email protected] | (65) 6521 9787 EDITORIAL CEO Raymond Wong AD ADMIN EXECUTIVE Koe Shan Chan EDITORIAL DIRECTOR K. Dass [email protected] | (65) 6521 9777 [email protected] | (65) 6521 9741 [email protected] -

Dipartimento Di Impresa E Management Cattedra Di Economia E Gestione Dei Media
Dipartimento di Impresa e Management Cattedra di Economia e Gestione dei media L'acquisizione di 21st Century Fox nel processo di consolidamento dell'industria audiovisiva americana Relatore Prof. Luca Balestrieri Candidato Giuseppe Bufano Matr.689421 Correlatore Prof. Gianluca Comin Anno accademico 2017/2018 INDICE Introduzione p.1 Capitolo 1: Il settore dell’audiovisivo negli Stati Uniti 1.1. Descrizione del settore p.1 1.2. Analisi SWOT del settore p.1 1.2.1. Punti di forza p.2 1.2.2. Punti di debolezza p.3 1.2.3. Opportunità p.4 1.2.4. Minacce p.5 1.3. Analisi dei competitor all’interno del settore p.6 1.3.1. Le società p.6 1.3.1.1. Viacom p.6 1.3.1.2. Sony p.7 1.3.1.3. Warner Media p.7 1.3.1.4. 21st Century Fox p.7 1.3.1.5. Comcast Corporation p.8 1.3.1.6. The Walt Disney Company p.8 1.3.2. Quote di mercato p.8 1.4. Analisi delle tendenze all’interno del settore p.13 1.4.1. Pubblicità p.13 1.4.2. Strategie societarie p.14 1.4.2.1. Warner Media p.14 1.4.2.2. Sony p.17 1.4.2.3. Viacom p.18 1.4.2.4. Comcast Corporation p.20 1.4.2.5. The Walt Disney Company p.22 1.4.2.6. 21st Century Fox p.24 1.5. Analisi delle minacce portate da business alternativi (OTT) p.25 Capitolo 2: Le società 2.1.21st Century Fox p.30 2.1.1.